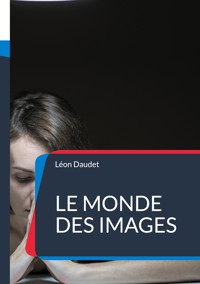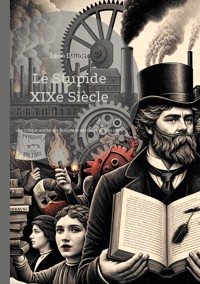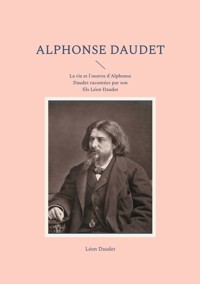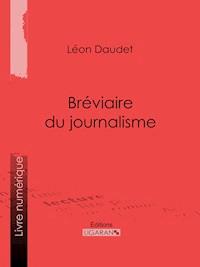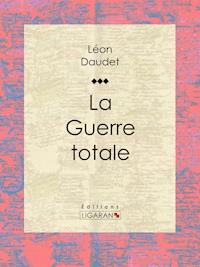
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
"La Guerre totale, écrit par Léon Daudet, est un livre captivant qui plonge le lecteur au cœur de la Première Guerre mondiale. Publié en 1915, ce récit saisissant nous transporte dans les tranchées, où l'auteur, lui-même engagé volontaire, relate avec une précision remarquable les horreurs et les souffrances vécues par les soldats.
Daudet nous offre un témoignage poignant de cette guerre dévastatrice, décrivant avec une plume incisive les combats acharnés, les bombardements incessants et les conditions de vie inhumaines des soldats. Il nous fait ressentir la peur, la douleur et l'angoisse qui étreignent ces hommes confrontés à l'absurdité de la guerre.
Mais au-delà de la violence des combats, La Guerre totale explore également les conséquences psychologiques de ce conflit sur les soldats. Léon Daudet nous livre des portraits saisissants de ces hommes brisés par la guerre, décrivant leurs traumatismes, leurs doutes et leurs espoirs perdus.
Ce livre, à la fois réaliste et poétique, est un témoignage essentiel sur l'une des périodes les plus sombres de l'histoire. Léon Daudet, par sa plume puissante et émouvante, nous offre une vision profonde et intime de la guerre, nous invitant à réfléchir sur les ravages de la violence et les sacrifices des soldats.
La Guerre totale est un ouvrage incontournable pour tous ceux qui souhaitent comprendre et ressentir l'impact dévastateur de la Première Guerre mondiale. À travers ce récit poignant, Léon Daudet nous rappelle l'importance de ne jamais oublier les horreurs de la guerre, afin de préserver la paix et l'humanité.
Extrait : ""Nous sommes dans la quatrième année de la guerre européenne et l'on peut dire que les nations de l'Entente, gardiennes de la civilisation, commencent seulement à comprendre le caractère de la lutte sans merci engagée contre elles par la barbarie allemande."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335016383
©Ligaran 2015
Nous sommes dans la quatrième année de la guerre européenne et l’on peut dire que les nations de l’Entente, gardiennes de la civilisation, commencent seulement à comprendre le caractère de la lutte sans merci engagée contre elles par la barbarie allemande. Sans doute, n’est-il jamais trop tard pour bien faire, mais je pense que nous aurions déjà, depuis plusieurs mois la victoire, si la conception de la guerre totale – telle que nous la font les Allemands, et que nous devrions la leur faire – avait été admise, puis réalisée par nos gouvernements respectifs.
Ce sera le mérite de Clemenceau d’avoir, dans son discours réquisitoire au Sénat du 22 juillet 1917, fait entrer enfin cette conception dans le domaine public. Je rappelle sans orgueil, mais aussi sans fausse modestie, que je lutte pour elle dans l’Action française, depuis le commencement des hostilités. De même que pour l’Avant-Guerre, les évènements m’ont donné raison. Je vais exposer la thèse et ses exemples, non en polémiste, mais en historien, soucieux d’une démonstration convaincante. Le journal convient à la polémique quotidienne. Au livre, la sérénité critique. D’ailleurs, au moment où j’écris, la preuve de ce que j’ai avancé et soutenu est faite presque sur tous les points.
Qu’est-ce que la guerre totale ? C’est l’extension de la lutte, dans ses phases aiguës comme dans ses phases chroniques, aux domaines politique, économique, commercial, industriel, intellectuel, juridique et financier. Ce ne sont pas seulement les armées qui se battent, ce sont aussi les traditions, les institutions, les coutumes, les codes, les esprits et surtout les banques. L’Allemagne a mobilisé dans tous ces plans, sur tous ces points. Elle s’est livrée à un débordement de propagande, toujours acharnée, parfois intelligente, parfois stupide, rarement inutile. Elle a constamment cherché, au-delà du front militaire, la désorganisation matérielle et morale du peuple qu’elle attaquait. Elle a poursuivi, pendant les hostilités, en l’intensifiant, son programme d’exploitation de l’espionnage et de la trahison, qui était celui de l’avant-guerre.
Prenons, par exemple, la Russie. Il appert aujourd’hui que le gouvernement allemand s’était ménagé des intelligences à la Cour, et dans les conseils du gouvernement – Stürmer et Protopopof – comme dans les hautes sphères militaires, comme dans les milieux révolutionnaires. La pénétration allemande antérieure à la guerre avait rendu cette tactique relativement aisée. Il y avait en Russie, dès le début, une germanisation par en haut, cherchant à compléter et à rejoindre une germanisation par en bas. Stürmer tendait les bras à Lénine. La défection russe n’a pas d’autre cause. Elle doit être, pour tous les alliés, un terrible enseignement.
La Russie n’est pas un pays d’ancienne unification comme la France. Elle n’a pas derrière elle des siècles de civilisation monarchique comme la France. Aussi l’ignorance de la nécessité de la guerre totale est-elle plus excusable et plus compréhensible de sa part que de la nôtre. Chez nous, les divers cabinets qui se sont succédé depuis le 3 août 1914, jusqu’à Clemenceau exclusivement, ont donné l’impression qu’ils considéraient la lutte actuelle comme un épisode plus ou moins rapide et tragique, après lequel les choses reprendraient leur cours normal. Un ministre âgé, académicien et qui devrait être expérimenté, a même pu exprimer à la Chambre cette idée fatale et dangereuse qu’il faudrait respecter après la guerre, « le libre développement économique de l’Allemagne ! » On sait où mène ce libre développement : à l’invasion et à l’occupation du territoire français. C’est là une erreur formidable et telle que celui qui l’énonce fait la preuve qu’il ne comprend absolument rien au conflit actuel. Je me suis frotté les yeux en lisant une telle déclaration et je me suis demandé : « Alors, à quoi auront servi tant d’héroïques sacrifices ? »… À laisser faire le barbare germain, à laisser passer ces incendiaires ! Funeste est le jargon du libéralisme, quand un grand peuple joue ses libertés et son avenir.
Quand on pense qu’à l’heure où j’écris, nos tribunaux français ne se sont pas encore mis d’accord sur la question de savoir s’il convient ou non d’accorder la capacité juridique à l’ennemi, de lui ouvrir l’accès de nos prétoires ! Il s’est trouvé des juges pour défendre cette thèse insensée qui, admise, permettrait à un officier allemand de poursuivre chez nous le recouvrement d’une créance contre la veuve d’un militaire français tué à la guerre. « La fôôôrme, messieurs, la fôôôrme », bêlait Bridoison. Tout ce que la presse française compte de journalistes patriotes et raisonnables a protesté contre cette conception trop juridique, à coup sûr inhumaine, et dont les Allemands pourraient largement profiter. De pays à pays en guerre, les avantages légaux équivalent aux avantages militaires. MM. Godefroy et Tronquoy ne s’en étaient pas rendu compte. Mais comment le Garde des Sceaux d’alors ne sut-il pas leur faire entendre que l’état de guerre est quelque chose de différent de l’état de paix ?
Sans la guerre totale, le blocus par lequel les nations alliées prétendaient à bon droit – du moins jusqu’à la défection russe – encercler et affamer l’Allemagne, n’était et ne pouvait être qu’un mot. Par les mailles relâchées de la non-surveillance administrative, policière et douanière, les objets de première et seconde nécessité parvenaient à la Germania en suffisance, sinon en abondance. Les neutres la ravitaillaient à qui mieux mieux, et elle trouvait jusque chez nous des complicités criminelles. Je ne veux alourdir cet exposé d’aucune documentation fatigante. Mais c’est par centaines que me parvenaient les lettres de dénonciation au sujet de telle ou telle personne qui faisait le commerce avec l’ennemi. Comment s’y reconnaître dans ce fatras ? Même en faisant aussi large que possible la part de la médisance et de la forgerie, il est évident que l’Allemagne a tenu à peu près pendant trois ans et demi et que, si le blocus avait été strict, elle n’eût pas dû ni pu tenir plus de deux ans.
Ne m’objectez pas que la conception de la guerre courte est responsable de cette défaillance, que nous eussions agi autrement, si nous avions prévu la guerre longue et chronique. L’Allemagne aussi croyait à la guerre courte, à la campagne « fraîche et joyeuse ». Néanmoins, dès le printemps, elle a mené la guerre comme il faut la mener, sur tous les plans ; ses mesures étaient prises de longue date pour l’offensive d’espionnage et de trahison derrière notre front. Sitôt après sa défaite de la Marne et la stabilisation de la lutte, elle s’efforça de les intensifier. Elle se dit que tout n’était pas perdu, qu’il fallait reprendre la tâche à pied d’œuvre et regagner patiemment une situation qu’avaient compromise, du 5 au 12 septembre 1914, le sort des armes et l’habileté de nos généraux.
Ici je suis forcé de supposer que vous avez lu l’Avant-Guerre ou suivi ‚ depuis le coup d’Agadir, les campagnes de l’Action Française. En deux mots, à l’ouverture des hostilités, notre situation était telle : la majorité des parlementaires de la Chambre – c’est-à-dire de la fraction la plus agissante du Parlement – ne croyait pas à l’imminence, ni même à la possibilité de la guerre. Dans cette majorité même, s’était constitué, autour de M. Joseph Caillaux, ce que j’appelais le clan des Ya : un groupement de personnalités du monde politique, industriel et surtout financier, adonnées à la besogne ingrate et périlleuse du « rapprochement franco-allemand ». C’est à cette besogne que s’applique l’axiome célèbre : Errare humanum est, perseverare diabolicum. La leçon d’Agadir, venant après tant d’autres alertes savamment échelonnées depuis quarante-quatre ans, n’avait pas ouvert les yeux de ces messieurs, ni dissous leur pernicieux entêtement. Pernicieux n’est pas un terme excessif, car l’Allemand augmente ses prétentions à mesure qu’on lui cède davantage et le meilleur et le plus sûr moyen d’exciter son insatiable convoitise est de le laisser s’installer chez soi.
C’est à vous d’en sortir, vous qui parlez en maître.
La maison est à moi, je le ferai connaître.
C’est ainsi que la concession, en pleine paix, du port et de la mine de Diélette au métallurgiste Thyssen, a été, j’en ai la conviction, pour beaucoup dans le changement d’attitude du Kaiser, noté au Livre Jaune par M. Cambon. Après la Normandie, pourquoi pas Paris ?
Là où M. Caillaux et ses amis s’imaginaient amadouer l’ogre, ils l’appâtaient. Le prétendu rapprochement franco-allemand semblait aux Allemands le rapprochement du chat et de la souris. La France étant à portée de leurs mâchoires industrielle et militaire, ils comptaient n’en faire qu’une bouchée.
Quand on tenait un pareil langage, qui est celui du bon sens le plus plat, en 1912 et 1913, on passait, aux yeux des gens rassis, pour un énergumène ou un visionnaire. M. Caillaux, dont la femme n’avait pas encore tué Calmette – tragique pendant de l’affaire Victor Noir – passait, aux yeux des mêmes gens, pour un politicien avisé et qui avait trouvé le filon. Nul ne songeait à s’étonner des étranges fréquentations auxquelles il s’adonnait dès cette époque, et qui allaient de l’Allemand naturalisé Emil Ullmann, directeur du Comptoir National d’Escompte de Paris, au journal le Gil Blas, qu’administraient les « gebrüder Merzbach », banquiers franco-berlinois, au Courrier Européen dirigé par un certain Paix-Séailles, associé de l’Allemand Emmel, avec Vigo dit « Almereyda » comme secrétaire de la rédaction.
Si je cite ici le nom de M. Caillaux, ce n’est point pour accabler un accusé, c’est parce que ce nom est devenu un symbole. Il représente l’aboutissement d’une expérience politique de quelque vingt années – résumée par Maurras dans son admirable et prophétique ouvrage Kiel et Tanger– et qui nous a plutôt coûté cher. Les faits sont là. Jamais nous n’avons eu plus de prévenances pour le commerce allemand, l’industrie allemande, la finance allemande, l’art allemand que de 1909 à 1914. On voit le résultat. Non seulement le caillautisme ne nous a pas épargné les horreurs de la guerre et de l’invasion, – ce qui eût été sa seule raison d’être, sa seule excuse – mais il les a au contraire facilitées et précipitées. C’est ainsi qu’un faux point de vue au pouvoir peut engendrer les pires catastrophes. La méfiance de Madame Edmond Adam et de Paul Déroulède vis-à-vis de l’Allemagne, méfiance maintenue par la Nouvelle Revue et la Ligue des Patriotes, était l’attitude la moins onéreuse et qui en imposait à notre ennemie héréditaire. Que n’avons-nous su la conserver !
Les gens du clan des Ya, et ceux qui faisaient avant la guerre des affaires avec l’Allemagne, ne sont point tous a priori des scélérats. Ils étaient et demeurent des imprudents. Pour quelques-uns, du fait de la guerre, l’entêtement ou la cupidité, ou les deux réunis, ont fait que l’imprudence a tourné au crime. Ajoutons que l’Allemand est aussi naturellement maître-chanteur qu’espion et qu’il ne lâche pas aisément celui qui a signé un contrat avec lui. Compromettre pour conserver, telle est sa devise. Il s’y est conformé largement.
Représentons-nous ce qui s’est passé au moment de la déclaration de la guerre. Les Allemands étaient convaincus que leurs travaux d’approche et de pénétration, joints à leur supériorité militaire, les mèneraient à Paris en un mois. La conviction de leurs créatures était la même. Les uns et les autres comptaient qu’après quelques engagements d’avant-garde, ou même une bataille générale mais courte, en mettant les choses au pire, un traité de paix serait signé qui servirait ensuite de base, sans trop de tiraillements ni de rancune, au fameux rapprochement franco-allemand. L’enthousiasme de la population française, la science de Joffre, de Castelnau et de leurs seconds, l’intervention de la Providence – aide-toi, le Ciel t’aidera – sont venus jeter par terre cette hasardeuse combinaison. Nous sommes ainsi entrés, les uns et les autres, dans la guerre chronique. Nouvelle erreur des Allemands et de leurs créatures : le peuple français, trop impatient, ne saura pas tenir. Or, au contraire, ce peuple français tant calomnié, tant méconnu par lui-même – voir Quand les Français ne s’aimaient pas de Maurras – a magnifiquement tenu. C’est alors que s’est posée pour les Allemands la grosse question d’une campagne menée chez nous, par leurs créatures d’avant-guerre, pour la corruption et la destruction de notre bon moral ; des sommes considérables, plusieurs vingtaines de millions, ont été consacrées par gros paquets à cette œuvre souterraine, qui a atteint son maximum d’intensité d’avril à juin 1917. Mais, en somme, le coup a échoué et le bonheur de cet échec n’est pas moindre que celui de la victoire de la Marne. Il a échoué d’abord, parce que la clairvoyance est épidémique et contagieuse, comme l’aveuglement, ensuite parce que l’Action Française était là. Les Allemands ont joliment raison de nous haïr spécialement et de nous insulter nommément, mes amis et moi, dans leurs feuilles. Nous avons copieusement mérité leur fureur. Nous nous efforcerons de continuer à la mériter. Ces imbéciles ne comprennent pas qu’ils accroissent ainsi notre autorité auprès de nos compatriotes.
Je m’en vais, dans les pages qui suivent, vous montrer l’Allemagne à l’œuvre, chez nous, pendant la guerre, en arrière du front et notamment à Paris. « Mélodrame, cinéma, inventions romanesques », vont crier à la fois ceux qui ont des yeux pour ne pas voir et les gens plus ou moins compromis dans cette tragique aventure. Ces sottises maintenant ne portent plus. Des scandales récents et des inculpations retentissantes ont prouvé que les manœuvres de corruption allemande ne se passaient pas seulement dans les têtes des collaborateurs de l’Action Française et de l’auteur de l’Avant-Guerre. Des évènements considérables ont prouvé jusqu’à l’évidence que ces manœuvres avaient eu leur répercussion en Russie, en Italie, en Roumanie, en Irlande, en Espagne, en Suisse, qu’il s’agissait d’un système général, appliqué méthodiquement, chez les adversaires comme chez les neutres. Ce système est aujourd’hui percé à jour, et tout porte à croire qu’il va être vigoureusement contrebattu. Tant mieux : car la persistance, sur ce point, de l’aveuglement et des errements des alliés a écarté d’eux jusqu’à présent une victoire que, par leurs sacrifices et leur vaillance, ils auront amplement méritée.
Un emboché – le nom l’indique – est celui qui, avant la guerre, subissait intellectuellement, moralement, financièrement, industriellement, commercialement, l’influence allemande, qui était lié à l’Allemagne par le sang familial, l’esprit ou l’intérêt. Il y avait, au 31 juillet 1914, des embochés dans tous les milieux et à tous les niveaux sociaux. Ils abondaient dans le monde, ainsi que dans le monde tout court. Je ne leur fais de leur attitude aucun reproche. Je constate seulement qu’ils se trompaient et qu’en les mettant en garde contre la perfidie du peuple allemand nous avions raison.
On pourrait former un recueil d’une terrible ironie, en réunissant les déclarations, tirades, développements, favorables à l’empereur et à l’emprise allemands, qui foisonnaient dans les journaux français d’avant-guerre. Pour beaucoup, la germanophilie était un snobisme. Pour d’autres, une dépendance de l’amour de la science, de l’organisation et de la méthode. Les visites et les renseignements que recevaient Guillaume II et son entourage flattaient ainsi leur vanité ethnique et leur laissaient croire que toute la France était à l’image de ces adulateurs. D’où surprise et mécontentement quand un évènement politique quelconque, pierre de touche de l’opinion vraiment nationale, venait démontrer le contraire et faire tomber ces illusions. Elles reprenaient ensuite plus vivaces.
– Vous savez que Guillaume II a réellement beaucoup d’amitié pour nous. Les Allemands le lui reprochent assez. À la dernière tournée de tel théâtre parisien à Berlin, il n’a eu d’yeux que pour la petite une telle.
– Vous savez que Guillaume II rêve d’une entente industrielle avec les Français. Il en a parlé à un tel qui allait l’entretenir d’un projet de fusion d’usines en Normandie.
– Vous savez que Guillaume II a fait les honneurs de la revue à la mission française. Au déjeuner qui a suivi, il n’y en avait que pour les Français.
Vers 1905, j’avais écrit, dans la Libre Parole, un article intitulé « Ceci tuera cela », où je souhaitais à Guillaume II une mort cancéreuse semblable à celle de son auguste père. Ce fut, chez plusieurs de mes confrères, un tolle. Ernest Judet se signala par la vigueur de sa réprobation. Toucher à Guillaume II, quelle goujaterie ! Un prince qui aimait tant Watteau et qui parlait l’argot de Paris. N’avait-il pas dit à une comtesse authentique : « Je m’en bats l’œil ! » et sans accent. Comment suspecter les sentiments d’un pareil homme ! Devant ce nouveau Frédéric II, il n’était pas un badaud à âme de chambellan qui ne se sentît un peu Voltaire. Cet engouement était d’ailleurs limité à quelques gens du monde, diplomates, journalistes et hauts financiers. La France véritable demeurait rétive et lisait les livres de Barrès consacrés aux « bastions de l’Est ». Bien que diffus dans la grande masse populaire, les souvenirs de 1870-1871 avaient encore de la force et de la persistance. On s’en rendit compte à la façon dont ils flambèrent au moment de la mobilisation. J’étais couché dans mon lit de Touraine avec une fêlure des os du crâne, conséquence d’une chute d’automobile, quand mon petit monde vint m’annoncer qu’à la gare d’Amboise les paysans et les paysannes distribuaient aux partants le vin, les fruits, le beurre, toutes les denrées à profusion. J’aurais sauté de joie. Cette prodigalité, chez une population d’une stricte économie, était le signe de l’enthousiasme et un présage de victoire. Cet emballement patriotique annonçait la Marne.
Au début, beaucoup d’embochés se frappaient carrément la poitrine en déclarant : « Je me suis trompé. Les Allemands sont des menteurs. Ils ne me prendront plus à leurs déclarations d’amitié. » Quelques-uns voulurent bien m’écrire qu’ils avaient méconnu mon travail l’Avant-Guerre, mais que le bien-fondé de mes avertissements leur apparaissait cette fois en pleine lumière. Je n’en tirai nulle vanité. D’autres refoulèrent momentanément leur erreur et leur déception, mais ils en conservèrent de la rancœur contre ceux qui avaient vu juste et ils ne devaient pas tarder à la leur montrer. C’est très humain. Celui qui s’est trompé pardonne malaisément à celui qui a eu raison.
Il eût fallu à certains embochés un véritable héroïsme pour brûler carrément ce qu’ils avaient adoré et supporter l’idée d’une guerre totale : je veux parler de ceux qui, fuyant la menace de l’impôt sur le revenu ou pour toute autre raison, avaient des capitaux et des intérêts en Allemagne, ou joints à des capitaux et à des intérêts allemands. Ces embochés n° 1, fréquents dans les milieux politico-financiers et assez fréquents dans les salons, étaient tantôt des Français authentiques, tantôt des Français plus ou moins mâtinés de turc, de suisse, d’espagnol, de russe et d’américain du Sud, tantôt des Allemands naturalisés de longue date, ou des fils d’Allemands naturalisés. J’ai expliqué ailleurs (Avant-Guerre, Hors du Joug allemand) ce qu’était cette naturalisation à la Delbrück, je n’y reviens pas. Le plus grand journal officieux de la République, le Temps, l’a découverte deux ans et demi après moi.
Ces embochés n° 1 constituaient le terrain douteux, sinon suspect, où l’Allemagne, grâce à la prolongation de la guerre, planta quelques-uns de ses jalons, et recruta ce que la Gazette de Francfort appelait euphémiquement « des personnes recommandables ». Leur rôle fut désastreux pour nous et divers.
Les uns, chez qui le sentiment patriotique ou d’hospitalité française était complètement rongé par la germanophilie, acceptèrent de servir ici de correspondants ou de garde-meubles, ou de briseurs de séquestres à leurs anciens compères allemands.
Parmi ceux-là, les pires, ou les plus fascinés par l’Allemagne, allèrent jusqu’à l’aider dans sa longue lutte contre le blocus allié, qui va de la déclaration de guerre de l’Angleterre à la déclaration de guerre de l’Amérique. Il est indéniable qu’il y ait eu en France, pendant trois ans de guerre, un vaste système de ravitaillement de l’ennemi. Un des plus importants agents de ce système, le sieur Théodore Mante, de Marseille, a été démasqué, jugé et condamné.
D’autres, n’osant mettre la main à la pâte, cherchèrent un biais pour manifester quand même leur sympathie à l’abominable envahisseur. Ce fut le clan des anti-anglais, des dénigreurs de l’Angleterre, qui répandirent, au début de la coopération, des bruits les plus abominables, les plus perfides et les plus faux. Les mêmes, plus tard, renonçant à jeter la zizanie entre l’Angleterre et la France, recommencèrent, contre la participation américaine, leur campagne de calomnie. Le type achevé de ces entreprises criminelles est la série d’articles signés « M. Badin » dans le Bonnet Rouge. Mais le thème a été repris maintes fois par d’autres feuilles défaitistes ou semi-défaitistes, sous une forme, il est vrai, plus dissimulée.
La propagande orale antinationale, ou antianglaise, a été très employée au cours de la guerre. C’est une forme d’ensemencement de l’imagination publique particulière et où les embochés sont passés maîtres. Le mot d’ordre part en général d’une maison de commerce à succursales multiples, ou d’un établissement de banque, ou d’un salon. Quelquefois il circule seul, quelquefois il est accompagné d’un petit tract, qu’on passe sous le manteau, ou d’une anecdote mensongère. Ainsi que dans le jeu du furet, la rapidité de la diffusion est extraordinaire. Rappelons-nous, en août et septembre 1914, ce qu’on appela la rumeur infâme, le bruit absurde et scélérat : « Ce sont les nobles et les curés qui voulaient la guerre et qui l’ont faite. » Un peu plus tard on raconta que les Anglais ne se battaient pas, qu’ils étaient tous employés dans des services d’intendance, qu’ils ne songeaient à rien d’autre qu’à leur thé. À un autre moment, il fut affirmé que les soldats annamites tiraient, dans les rues de Paris, sur les femmes et sur les enfants. Je ne prends ici que les racontars les plus niais et les plus notoires. Il y en eut d’autres, plus venimeux et plus habiles, réservés aux milieux plus relevés. Je suis arrivé à cette certitude qu’il n’y avait pas plus de cinq ou six officines de ces rumeurs déprimantes, officines reliées entre elles par un même intérêt, qui était et qui est l’intérêt allemand. Elles se heurtaient au solide bon sens de la race française et aussi à son horreur de l’appréhension. Le mot d’un peuple à la fois brave et impressionnable tel que le nôtre, et qui se méfie de son impressionnabilité, est en temps de crise : « Nous verrons bien. »
– Mais si les Allemands marchent de nouveau sur Paris ?
– Nous verrons bien.
– Mais il est impossible de les percer.
– Nous verrons bien.
– Mais, dans six mois, ce sera la disette.
– Nous verrons bien.
– Mais, avec la disette, ce sera l’émeute, le massacre, l’incendie, la rage, la peste et les sept fléaux.
– Nous verrons bien.
Il y eut des histoires admirables : une très bonne Française était en visite chez une dame qui a un certain rang social, qui s’occupe d’art, et qui, niaiserie ou embochage, déclarait froidement que les soldats français étaient des goujats et les soldats allemands de petits saints : « Ils n’ont pas touché à mes bibelots, ni à ma cave. » La bonne Française prend la mouche à ce récit scandaleux, se lève et déclare qu’elle va dénoncer un tel langage, si révoltant, au Préfet de police. Fureur et invectives de la dame artiste. Malheureusement le Préfet de Police était un pauvre homme, du nom de Laurent, complètement endormi dans les bras de la Sûreté générale, elle-même sous la coupe d’agents de l’ennemi. Ainsi la démarche n’eut aucun résultat. Il m’aurait assez plu de voir la défaitiste mondaine saboulée d’importance en cette occasion par un agent de l’autorité. Je crois même que, ministre, je l’eusse envoyée à la Santé, pendant quelques jours, méditer sur les propos inconsidérés du temps de guerre. Une millionnaire, qui démoralise les autres dans son salon, m’apparaît comme plus coupable qu’une pauvre institutrice grisée par les mirages humanitaires d’avant-guerre. Je ne suis, fichtre, pas démocrate, mais j’ai en moi cette fibre populaire qui est d’ailleurs celle du bon sens. Impitoyable aux grands, indulgent aux petits, telle est ma devise, et je désirerais ne pas mourir sans avoir eu l’occasion de l’appliquer une bonne fois.
Puisque nous en sommes au Préfet Laurent, il faut que je vous raconte que j’eus avec lui une entrevue, précisément au sujet des embochés et agents allemands à Paris. À ce moment, l’Action Française lançait un feuilleton de moi intitulé La Vermine du Monde, qui était une illustration romancée de l’Avant-Guerre et que m’avait demandé notre ami René Theeten, faisant fonction d’administrateur. Jeanniot, le grand artiste et l’admirable patriote que l’on sait, avait dessiné à cette occasion une belle affiche, où l’on voyait un poilu en uniforme sauter à la gorge de personnages boches, mâles et femelles, qui s’enfuyaient en hurlant. La veille du jour où l’on devait coller l’affiche, coup de téléphone : « M. le Préfet de police désire parler à M. Daudet au sujet de l’affiche, qui est inadmissible. » Un quart d’heure après, je montais le grand escalier de la Tour Pointue et j’étais aussitôt introduit dans le cabinet de M. Laurent. Je trouvai un brave bonhomme à moustaches, rouge, somnolent qui jouait avec un énorme coupe-papier d’ivoire derrière une table chargée de paperasses. À côté de lui un monsieur mince, brun et pâle de visage, se tenait comme une bonne d’enfant près de la voiture où dort son gosse. Le Préfet me présenta ce tiers, qui était son chef de cabinet : « Monsieur Maunoury ». Je savais que ce Maunoury était l’ami intime de Malvy, ministre de l’Intérieur, de Vigo, dit Almereyda, directeur du Bonnet Rouge, et qu’il avait joué un rôle plus que bizarre, en opposition avec le général Clergerie, dans l’affaire de l’espion et escroc Garfunkel dit « le docteur Georges ». Aussi j’esquissai un salut très bref et m’adressai aussitôt à Laurent, le priant de me dire ce qui l’avait si fort scandalisé dans mon affiche.
Le bonhomme fit un geste vague, en soulevant une paupière lourde et bouffie. Ce fut « Monsieur Maunoury » qui me répondit : « C’est une affiche de coup d’État. Ce n’est pas le soldat qui arrête les espions en France, c’est le gardien de la paix. » Il ajouta : « Autre inconvenance : votre Allemand est décoré de la Légion d’honneur. C’est une insulte à l’Ordre. » J’avais bonne envie de jeter à cet imprudent ce seul mot, qui l’eût fait rentrer sous terre : « Garfunkel » ; mais je me contins et fis remarquer posément à Laurent que l’Allemand Emil Ullmann, du Comptoir National d’Escompte de Paris – je l’en ai fait chasser depuis lors – était décoré de la Légion d’honneur. J’en citai dix autres à sa suite. J’ajoutai que, les gardiens de la paix étant parfois soldats, rien n’empêchait de penser que le poilu de Jeanniot avait servi antérieurement sous les ordres du Préfet de police. De quoi Laurent demeura interloqué. Quant à « Monsieur Maunoury », il était rentré dans son cabinet, contigu à celui de son vieux nourrisson, mais j’apercevais son pied verni, demeuré en travers de la porte, et le lobe irrité de son oreille droite.
Soupirant comme un qui vient d’échapper à une remontrance, M. Laurent me conta alors que les gouvernantes allemandes lui avaient donné, au commencement de la guerre, bien du tintouin : « Chaque « fraülein » était si recommandée ! Je me rappelle une nommée Frida… »
À ce mot, « Monsieur Maunoury » réapparut : « Monsieur le Préfet, c’est le moment de la signature. »
Le pauvre esclave en effet tombait mal et je devais connaître, par la suite, l’extraordinaire odyssée de Frida Lippmann, la recommandée du ministre Malvy. Je pris congé du Préfet et de son étonnant chef de cabinet, en me promettant de scruter à fond le rôle de « Monsieur Maunoury ». Je devais y faire plus d’une découverte.