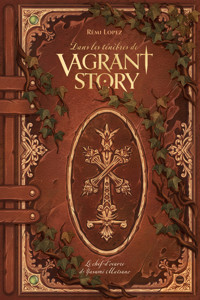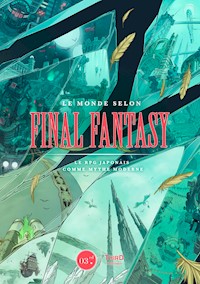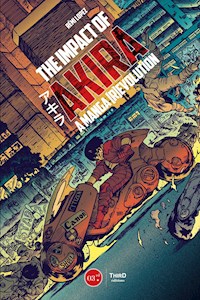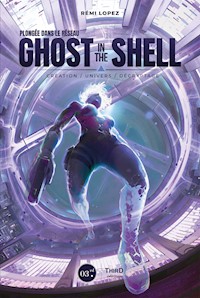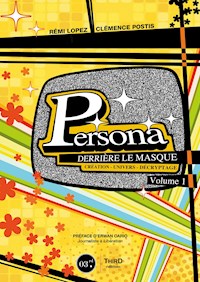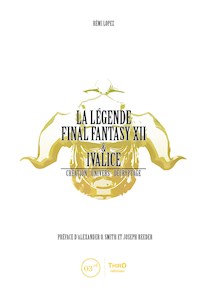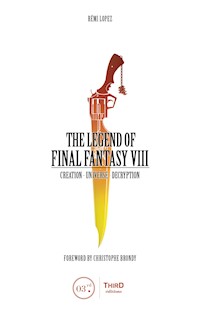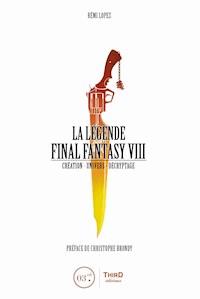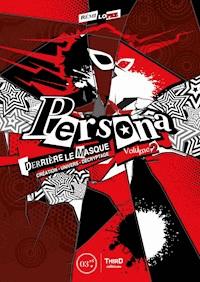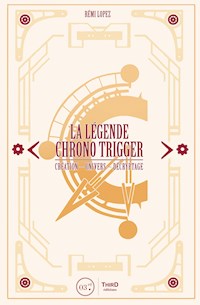
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Third Editions
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
A la découverte de l'univers de Chrono Trigger et de ses origines.
Chrono Trigger est considéré par les fanatiques de RPG comme le jeu le plus abouti de Square et l'un des jeux les plus emblématiques de la Super Nintendo. Cette saga vendue à plusieurs millions d'exemplaires est devenue un incontournable de l'histoire du RPG et même de l'histoire du jeu vidéo. Rémi Lopez revient sur la genèse et la création de ces jeux mythiques qui ont marqué des révolutions (plus ou moins grandes) dans le monde du jeu vidéo. Mais la saga Chrono possède aussi deux autres volets (Radical Dreamers et Chrono Cross) qui viennent agrandir et compléter l'univers créé dans Chrono Trigger.
Découvrez, dans cet ouvrage fourni et documenté, la genèse d'un jeu mythique et de la célèbre saga de RPG Kingdom Hearts.
EXTRAIT
Dans les années quatre-vingt-dix, annuler le développement d’un jeu ne signait pas nécessairement la mort économique d’un studio, mais ressemblait davantage au chiffonnement d’une feuille de papier qu’on jette nonchalamment à la poubelle. Les jeux mobilisaient moins de personnel et demandaient moins de temps de conception compte tenu des compétences limitées des machines, si bien qu’il n’était pas rare de voir une partie du contenu d’un projet annulé atterrir sur un autre jeu, un peu par opportunisme. Inimaginable de penser cela aujourd’hui, où les équipes de développement sont ultra-spécialisées, les coûts bien plus importants et les ajouts de dernière minute bien trop difficiles à intégrer. Ajouter une scène de dialogue à un RPG, par exemple, impliquerait en 2018 d’enregistrer de nouvelles parties vocales ou de réunir le casting pour la motion capture, alors qu’en 1995, quelques lignes de code et du texte dans une boîte en bas de l’écran faisaient l’affaire.
Chrono Trigger a largement profité de cette méthode de développement d’un autre temps, le sien, où la création d’un jeu se faisait de manière plus ou moins collégiale et où un stagiaire pouvait suggérer l’idée du siècle en apportant les cafés en salle de réunion. C’est dans ce brainstorming permanent qu’est né Chrono Trigger, classique parmi les classiques, mais dont la forme finale n’a pourtant été que le fruit d’un tâtonnement de plusieurs années. Ses créateurs, qu’il s’agisse de Yūji Horii, Hironobu Sakaguchi ou Takashi Tokita, n’avaient pas de vision précise et encore moins définitive en entamant le développement, une idée qui serait absolument suicidaire de nos jours. On ne conçoit plus de jeux en y allant sur le tas.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Titulaire d’une licence de japonais obtenue à Bordeaux‑III,
Rémi Lopez fait ses premières armes comme auteur en 2004 sur Internet, en rédigeant des chroniques de bandes originales de jeu vidéo. Deux ans plus tard, il rejoint le magazine Gameplay RPG pour y officier à la même tâche, avant de suivre Christophe Brondy, alors rédacteur en chef, et toute son équipe, sur son nouveau projet : le mensuel Role Playing Game. Rémi a depuis signé l’ouvrage La Légende Final Fantasy VIII et le livre sur la musique OST. Original Sound Track aux éditions Pix’n Love en 2013.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Légende Chrono Triggerde Rémi Lopez est édité par Third Éditions 32, rue d’Alsace-Lorraine, 31000 TOULOUSE [email protected] www.thirdeditions.com
Nous suivre : : @ThirdEditions : Facebook.com/ThirdEditions : Third Éditions
Tous droits réservés. Toute reproduction ou transmission, même partielle, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l’autorisation écrite du détenteur des droits.
Une copie ou reproduction par quelque procédé que ce soit constitue une contrefaçon passible de peines prévues par la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la protection des droits d’auteur.
Le logo Third est une marque déposée par Third Éditions, enregistré en France et dans les autres pays.
Directeurs éditoriaux : Nicolas Courcier et Mehdi El Kanafi Assistants d’édition : Damien Mecheri et Clovis Salvat Textes : Rémi Lopez Relecture : Jérémy Daguisé et Anne-Sophie Guénéguès Mise en pages : Julie Gantois Couverture de l’édition classique : Johann « Papayou » Biais Couverture de l’édition « First Print » : Maliki
Cet ouvrage à visée didactique est un hommage rendu par Third Éditions à la série de jeux Chrono.
L’auteur se propose de retracer un pan de l’histoire des jeux vidéo Chrono dans ce recueil unique, qui décrypte les inspirations, le contexte et le contenu de ce titre à travers des réflexions et des analyses originales.
Chrono Trigger, Chrono Cross et Radical Dreamers sont des marques déposées de Square Enix. Tous droits réservés. Le visuel de couverture est inspiré d’un artwork de la série Chrono Trigger.
Édition française, copyright 2018, Third Éditions. Tous droits réservés.
ISBN 978-23-77840-73-1
À Marie V.il est 16416.
AVANT-PROPOS
AU COURS de mes précédents ouvrages sur Final Fantasy, Persona, ou encore Cowboy Bebop, je me suis toujours pudiquement retenu de parler de moi, de mon expérience personnelle avec ces œuvres qui me sont pourtant chères. Les avant-propos que j’ai eu à rédiger n’étaient donc que de simples entrées en matière dignes d’une introduction de commentaire composé ; classique, sans risque, et purement pratique. Une bande-annonce avant le film que je m’efforçais simplement d’écrire correctement.
Une fois n’est pas coutume, je me permettrai ici de briser cette routine et d’utiliser, au moins pour cet avant-propos, la première personne du singulier pour évoquer mon histoire ambiguë avec la série des Chrono. Non pas pour flatter mon ego — bien qu’il paraisse que parler de soi envoie une dose de dopamine dans le sang —, mais pour mettre en valeur l’importance de l’état d’esprit avec lequel on aborde un jeu, surtout lorsqu’il s’agit de notre genre de prédilection.
J’ai toujours été un amoureux du RPG japonais. J’avais seulement neuf ans quand Final Fantasy VII m’a collé la torgnole mémorable qui allait définir mes goûts en matière de jeu vidéo pour les années à venir. Comme un musicien qui trouve très tôt « son » instrument, le J-RPG est devenu pendant mon adolescence une véritable obsession, ma ludothèque se remplissant, quelle que soit la machine, presque uniquement de jeux du genre, avant que le passage à vide de la génération PlayStation 3 et Xbox 360 ne m’oblige à élargir mes horizons vidéoludiques (une bonne chose, finalement).
N’ayant pu jouer à Chrono Trigger, dans un premier temps, que par la voie de l’émulation (pas de panique, j’ai naturellement « effacé la ROM au bout de 48 heures ») et non par celle de l’import, j’avais déjà suffisamment d’expérience derrière moi pour juger le jeu avec un certain recul ; oui, le RPG de Squaresoft était effectivement génial, mais je n’ai pas ressenti le « choc » évoqué par quantité de fans de la série qui, pour certains, avaient découvert tout un genre avec Trigger, tout comme je l’avais fait avec Final Fantasy VII. Chrono Trigger n’était pas ma première « grande aventure » et, si j’ai malgré tout beaucoup apprécié le jeu, je n’en parle pas aujourd’hui avec des étoiles dans les yeux. L’attachement affectif, celui qui ne peut apparaître dans un test ou un compte rendu purement technique, n’est toujours pas là, même après avoir bouclé cet ouvrage. Peut-être Trigger avait-il omis de me surprendre en voulant être trop accessible ? Ou était-ce là le syndrome « Citizen Kane » de l’indifférence aux classiques découverts trop tard ? Comme j’avais déjà terminé à l’époque des jeux plus obscurs comme SaGa Frontier 2, Vagrant Story ou Koudelka, Chrono Trigger m’avait-il « ramené en arrière » tandis que je cherchais déjà autre chose dans le RPG japonais ?
Il m’arrive d’envier ceux qui ont pu apprécier le jeu au moment de sa sortie, au Japon comme aux États-Unis. Mais d’un autre côté, nous avons tous eu « notre » Chrono Trigger, notre première rencontre avec cette future madeleine qui donne du goût aux souvenirs chéris, alors pourquoi vouloir croquer celle des autres ? Et puis, comme nous aurons tout le temps de le voir, Trigger reste un classique intemporel (sans jeu de mots) du RPG japonais, qu’on y soit attaché émotionnellement ou pas.
C’est toutefois mon aventure avec Chrono Cross qui m’a encouragé à relater mon expérience personnelle dans cet avant-propos. Bien qu’il s’agisse d’un grand jeu de la PlayStation, je ne l’ai découvert qu’assez tardivement (autour de 2010), et ma première impression s’est révélée très, très négative. Et je ne parle pas ici des premières minutes de jeu, mais bien de son intégralité puisque je me suis effectivement « forcé » à le terminer (mon côté maniaque m’oblige toujours à conclure ce que j’ai entamé – oui, vous avez bien lu plus haut, je suis venu à bout de SaGa Frontier 2). Avec le recul, j’ai compris que ce très mauvais moment (d’une quarantaine d’heures, tout de même) devait surtout son amertume à des attentes totalement à côté de la plaque. Non seulement j’avais abordé Chrono Cross comme une simple suite de Trigger, mais aussi et surtout comme un J-RPG linéaire « classique ». En me trompant fondamentalement sur la nature du jeu, j’ai faussé d’emblée mon expérience et suis tout simplement passé à côté de ce qui devait être un fascinant voyage. Parce que j’estimais peut-être ne plus pouvoir être surpris, voire déstabilisé par un jeu d’une époque que je connaissais par coeur ?
J’ai d’abord trouvé Chrono Cross fastidieux, pas clair, trop compliqué et frustrant. Ce n’est qu’en y rejouant quelques années plus tard que j’ai pu redécouvrir le jeu pour ce qu’il était vraiment : un chef-d’œuvre exigeant. On ne vous prend pas par la main. On ne trouve pas les solutions à votre place. Et moi qui m’attendais, comme dans Chrono Trigger, à devoir me rendre du point A au point B en suivant les indications qu’on me donnait, je m’étais rapidement perdu dans un monde qui demande à être découvert sur la durée, et pas présenté sur un plateau. En rejouant à Chrono Cross avec moins d’empressement, j’ai eu l’impression d’y jouer véritablement pour la première fois. La liberté d’action, les multiples quêtes annexes, le casting gigantesque ; foncer vers l’épilogue revient à quitter le Louvre après avoir vu La Joconde. Et après cinq parties, il m’en restait encore à découvrir. Aujourd’hui, je peux dire préférer Cross à Trigger, malgré cette désastreuse première impression.
Nous reviendrons en temps et en heure au cours de cet ouvrage sur ce qui fait le sel de ces deux aventures tellement différentes l’une de l’autre. Ce court texte d’introduction se veut surtout être un encouragement à ne pas s’arrêter à cette première impression, quel que soit le jeu (ou le film, le livre ou l’album !). Car si je n’avais pas accordé de seconde chance à Chrono Cross, vous ne tiendriez sans doute pas ce livre dans les mains.
Bonne lecture à tous.
RÉMI LOPEZ
Titulaire d’une licence en langue et civilisation japonaises, il est tombé dans la marmite du RPG étant petit. Une passion qui ne l’a jamais quitté puisque à dix-sept ans, il écrit ses premiers articles pour la presse spécialisée, de Gameplay RPG à Role Playing Game, après avoir fait ses armes sur Internet en amateur. Grand admirateur de Jung, Campbell et Eliade, il a entamé sa carrière d’auteur en écrivant à deux reprises sur Final Fantasy, d’abord sur le huitième épisode en 2013, puis sur l’univers d’Ivalice en 2015, chez Third Éditions, avant de coécrire deux autres ouvrages consacrés à la saga Persona. Enfin, toujours pour le même éditeur, Rémi Lopez a rédigé un ouvrage complet sur l’anime culte de Shin’ichirō Watanabe, Cowboy Bebop.
CRÉATION
LE SACRO-SAINT ÂGE D’OR
Parmi toutes les séries à succès de Square (qu’il s’agisse de feu Squaresoft ou de Square Enix), celle des Chrono fait office de curiosité, au moins dans sa forme : seulement deux jeux majeurs, pas de nouvel épisode depuis presque vingt ans et pourtant, sa fanbase reste active, fantasmant toujours à l’idée d’une éventuelle résurrection de la licence. Il faut croire qu’une série ne peut être complète sans un troisième épisode, les fans de Half-Life ou Shenmue (plus chanceux dans ce dernier cas) ne diront pas le contraire. Comment donc expliquer cet inépuisable amour pour une paire de RPG restés dans les années quatre-vingt-dix ?
Ces années quatre-vingt-dix, justement. Tout le monde s’accordera à dire que l’on se trouve alors en plein âge d’or du RPG japonais (que l’on pourrait étirer jusqu’au début des années deux mille). En revanche, pour ce qui est de définir clairement de quoi cet âge d’or est le nom, les volontaires ne se bousculeront pas au portillon. Peut-être parce que cela impliquerait d’expliquer clairement ce qu’un J-RPG définit et, par extension, ses différences avec le C-RPG ? Ce qui est certain, c’est que le milieu des années quatre-vingt-dix et la relative stagnation du RPG occidental ont permis à son pendant japonais de se démarquer et de dominer radicalement le marché console, ce qui a au moins eu le mérite de séparer de manière assez nette les fans de RPG selon leur support de choix (PC ou console), plus encore que par leur préférence de style.
De ce fait, si le RPG japonais, à travers le premier Dragon Quest (Enix, 1986), a posé les bases du genre en s’inspirant de Wizardry (Sir-Tech, 1981) et Ultima (Origin Systems, 1981), on peut penser que l’éloignement du C-RPG du marché console et le manque de renouvellement du genre en général dans la première moitié des années quatre-vingt-dix ont laissé aux Japonais un large carrefour créatif et commercial sur consoles. Toutefois, il convient de préciser que les Japonais font d’abord des jeux destinés à leur marché ; si c’est encore vrai aujourd’hui, imaginez donc à l’époque ! L’appellation « âge d’or du J-RPG » ressort ainsi particulièrement en Occident, puisqu’elle rime à la fois avec la découverte d’un genre qui commençait à s’exporter de manière plus systématique, mais également avec le basculement d’une partie du public habitué aux C-RPG, séduit par l’innovation des Japonais sur consoles. Bien sûr, l’époque sera aussi marquée par le nombre considérable de J-RPG qui abreuveront le marché, mais, plus qu’une débandade de sorties, c’est surtout l’originalité des titres qui fera la renommée de cette ère dorée. Car s’il y a bien quelque chose que les Japonais ont su faire pendant ces quelques années, c’est expérimenter et transformer leurs propres codes.
Chrono Trigger (1995) et Chrono Cross (1999) se situent donc en plein dans cette époque et auraient pu faire figure d’ambassadeurs si les années quatre-vingt-dix n’avaient pas connu autant de « classiques ». Chacun dans leur style – Cross n’est pas une bête continuation de son aîné –, les deux jeux ont innové dans la forme comme dans le fond, jouant avec la nitroglycérine du scénariste, le voyage dans le temps, dans une perspective à la fois narrative et ludique. Si les possibilités offertes par la torsion du temps et de l’espace avaient de quoi donner le vertige dans le cas d’un RPG, pour les studios japonais de l’époque, et peut-être Square en particulier, l’idée paraissait plus excitante que terrifiante.
L’âge d’or du RPG pourrait être analysé sous bien des angles et, à l’instar de la parabole des aveugles et de l’éléphant, le débat pourrait finir en dialogue de sourds. Arrêtons-nous donc sur ces aspects importants que sont la créativité japonaise et le patinage des productions occidentales, pour expliquer brièvement le pourquoi de cette dénomination, et partons maintenant décortiquer chacun des jeux dans leurs genèse et développement, ce qui tendra à nous fournir d’autres éléments de réponse.
CHRONO TRIGGER, L’ŒUVRE COLLÉGIALE
UN PROJET DE RÊVE
Dans les années quatre-vingt-dix, annuler le développement d’un jeu ne signait pas nécessairement la mort économique d’un studio, mais ressemblait davantage au chiffonnement d’une feuille de papier qu’on jette nonchalamment à la poubelle. Les jeux mobilisaient moins de personnel et demandaient moins de temps de conception compte tenu des compétences limitées des machines, si bien qu’il n’était pas rare de voir une partie du contenu d’un projet annulé atterrir sur un autre jeu, un peu par opportunisme. Inimaginable de penser cela aujourd’hui, où les équipes de développement sont ultra-spécialisées, les coûts bien plus importants et les ajouts de dernière minute bien trop difficiles à intégrer. Ajouter une scène de dialogue à un RPG, par exemple, impliquerait en 2018 d’enregistrer de nouvelles parties vocales ou de réunir le casting pour la motion capture, alors qu’en 1995, quelques lignes de code et du texte dans une boîte en bas de l’écran faisaient l’affaire.
Chrono Trigger a largement profité de cette méthode de développement d’un autre temps, le sien, où la création d’un jeu se faisait de manière plus ou moins collégiale et où un stagiaire pouvait suggérer l’idée du siècle en apportant les cafés en salle de réunion. C’est dans ce brainstorming permanent qu’est né Chrono Trigger, classique parmi les classiques, mais dont la forme finale n’a pourtant été que le fruit d’un tâtonnement de plusieurs années. Ses créateurs, qu’il s’agisse de Yūji Horii, Hironobu Sakaguchi ou Takashi Tokita, n’avaient pas de vision précise et encore moins définitive en entamant le développement, une idée qui serait absolument suicidaire de nos jours. On ne conçoit plus de jeux en y allant sur le tas.
Si l’on devait retracer la genèse de Chrono Trigger, il faudrait faire comme ses héros : visionner les choses sur deux lignes temporelles. La première remonte au début des années quatre-vingt-dix, aux prémices de ce qui deviendra l’un des plus grands mélodrames de l’histoire du jeu vidéo, à savoir le coup de poker de Sony et son divorce d’avec Nintendo, un épisode à mi-chemin entre le film d’espionnage et la tragédie shakespearienne. Dès la fin des années quatre-vingt, Nintendo salivait à l’idée d’incorporer à sa nouvelle machine, la Super Famicom, un support CD qui lui aurait permis un stockage de données considérable pour l’époque. Le constructeur japonais travaillait alors dans l’ombre avec Sony et le futur « père » de la PlayStation, Ken Kutaragi, pour concevoir ce qui aurait vraisemblablement démoli toute concurrence sur le marché des consoles. Bien que rien n’eût encore été formellement signé entre Sony et Nintendo, Square s’est attelé à la création d’un jeu qui aurait inauguré ce support CD, et dont le nom de code était Maru Island. Kōichi Ishii en était alors le réalisateur (après Seiken Densetsu sur Gameboy en 1991) et Hiromichi Tanaka, le producteur. Figure historique de Square, Tanaka avait été l’un des artisans derrière les premiers Final Fantasy, et ce Maru Island devait être une sorte d’excroissance du projet original de Final Fantasy IV, davantage orienté action (le game designer est d’ailleurs remercié dans les crédits du jeu). Les développeurs se sont donc lancés dans la création du jeu avec, en guest star, Akira Toriyama (Dragon Ball) au character design1. Autant dire que les ambitions de Square s’avéraient très, très importantes, mais c’était sans compter sur les caprices du destin. À la surprise générale (et celle de Sony en particulier), Nintendo annonce en 1991 un partenariat avec le constructeur Philips2, signant l’épilogue d’un jeu de suspicions entre Sony et Nintendo à propos de qui roulera l’autre dans la farine au niveau des royalties. De fait, le projet d’un lecteur CD signé Sony pour la Super Famicom est tombé aux oubliettes en l’espace d’une journée et le fameux « SNES-CD » s’est envolé comme un doux rêve. Chez Square, c’est la Bérézina3.
Ishii et Tanaka se montrent prêts à jeter leur bébé avec l’eau du bain. Fort heureusement, leur travail n’était pas totalement perdu, puisqu’il s’est avéré possible d’en « fourrer » la majeure partie dans une simple cartouche, au prix de l’abandon d’événements, de monstres, de mini-jeux et des contributions de Toriyama. Cet enfant bâtard, retravaillé dans la douleur, va finalement sortir en août 1993 sous le nom de Seiken Densetsu 2, ou Secret of Mana. Quant au contenu supprimé, on en retrouvera une partie dans... Chrono Trigger.
Revenons un peu en arrière pour jeter un œil à « l’autre ligne temporelle ». À l’aube des années quatre-vingt-dix, Hironobu Sakaguchi, Yūji Horii et Akira Toriyama, tous trois à l’origine de licences au succès sans cesse grandissant (respectivement Final Fantasy, Dragon Quest et Dragon Ball), commencent à nourrir l’idée d’un projet en commun. Le déclic viendra durant un séjour aux États-Unis, en 1992, qui avait, à la base, pour but de s’informer des avancées technologiques et graphiques autour du jeu vidéo. Une fois de retour au bercail, les choses ont pris un tournant plus « constructif » : les trois hommes ont pris le temps de se rencontrer régulièrement pour parler du projet, mais leurs velléités créatives se sont presque retournées contre eux, puisque chacune de leurs réunions résultait surtout en une somme d’idées folles qui peinaient à trouver un socle solide. De plus, le trio s’était mis en tête d’attendre la sortie, ou au moins l’annonce concrète, d’un support CD pour la Super Famicom, chose qui, et c’est le moins que l’on puisse dire, tardait à venir. Il aura fallu l’intervention de Kazuhiko Aoki, qui rêvait de produire le projet, pour que les choses prennent enfin forme. Parce qu’ils ne seraient jamais parvenus à concevoir quoi que ce soit en se voyant quelques minutes çà et là, il a été décidé de se réunir une bonne fois pour toutes et de définir de bonnes bases pour le projet. Après quatre jours de réunions intensives, l’esquisse d’un nouveau jeu commençait à se dessiner. Le « Dream Project » était en marche.
UN JEU QUI TRAVERSERA LES ÉPOQUES
Parce que le projet ne s’appellerait ni Final Fantasy ni Dragon Quest, Sakaguchi et Horii y voyaient là l’occasion de s’éloigner de leur série respective pour partir dans une direction différente. Laquelle ? Peu importe, juste « une autre direction ». Les deux hommes pouvaient qui plus est compter sur leur renommée grandissante (sans parler de celle de Toriyama) pour vendre leur futur jeu sans qu’il ait à porter le nom d’une licence célèbre. L’opportunité de créer était donc énorme. Il était d’abord question de construire un univers qui ne serait ni un faux Final Fantasy, ni un clone de Dragon Quest, et encore moins une simple copie de Dragon Ball. Sakaguchi avait pourtant essayé de s’inspirer assez largement de ce dernier pour ses premières ébauches, avant de s’en éloigner peu à peu ; le papa de Final Fantasy voulait avant tout un univers « dansant ». Un peu comme l’ambiance des réunions de travail, où jusqu’à cinquante employés de Square se serraient parfois pour manifester leurs suggestions, signe que le projet attisait la curiosité de toutes les équipes de développement, même celles qui ne travaillaient pas sur le jeu !
Comme nous le disions en introduction, les développeurs de jeux vidéo étaient, au début des années quatre-vingt-dix, des touche-à-tout dont les contours de l’activité professionnelle n’étaient pas bien définis. En substance, un producteur exécutif pouvait participer au design des monstres, un planner écrire un morceau du scénario et un réalisateur déléguer des pans entiers de son œuvre à ses collègues. Avant l’ultra-spécialisation contemporaine et les effectifs dépassant la centaine de personnes, la conception s’opérait de manière très collégiale, surtout chez Square. Et si, au départ, les rôles de Yūji Horii et Akira Toriyama étaient bien cimentés, c’était nettement moins le cas pour Sakaguchi. Concrètement, Horii se trouvait en charge de l’histoire et griffonnait des croquis des personnages avant de les faire passer à Toriy ama, qui les sublimait de son coup de crayon bien particulier4. Le dessinateur s’occupait également du monster design et des environnements, ce qui inspira énormément le reste de l’équipe dans un second temps. Quant à Sakaguchi, son travail se « résumait » à gérer l’ensemble du système de jeu et faire le relais entre Horii et l’équipe de développement, le scénario évoluant évidemment à mesure que de nouvelles idées y étaient incorporées. Le père de Final Fantasy ne s’est toutefois pas contenté du rôle de superviseur, puisqu’il lui arrivait également de plancher sur des tâches plus concrètes comme le codage de certains événements, voire le design des monstres ! L’ambiance au sein du studio poussait à la créativité et à la suggestion d’idées, donnant parfois des résultats surprenants comme l’incorporation d’un mini-jeu de course (contre Johnny, en 2300 AD), qu’un développeur avait créé dans son coin et que ses collègues ont presque eu envie de voir évoluer en un vrai jeu à part entière !
L’effervescence au sein du studio n’empêchait toutefois pas d’effectuer un travail rigoureux. Sakaguchi avouera qu’il avait même pris l’habitude de réclamer un rapport tous les matins sur l’avancée du projet, chose qu’il n’avait jamais faite auparavant.
Bien que l’on attribue la « réalisation » de Chrono Trigger à Yoshinori Kitase, Takashi Tokita et Akihiko Matsui, le jeu n’est en réalité ni l’œuvre d’un homme, ni de trois, ni même de dix. Kitase et Tokita se sont essentiellement occupés des sous-scénarios et Matsui, du design des personnages et des monstres pendant les combats, un défi technique sur lequel nous reviendrons plus loin. Cette porosité des rôles a par ailleurs donné lieu à des scènes plutôt comiques, puisque Kitase, qui avait travaillé sous la direction de Sakaguchi sur Final Fantasy V, se sentait obligé de prendre des gants, même en tant que nouveau réalisateur, pour exiger quelque chose de Sakaguchi, qui, dans l’organigramme, n’était « que » superviseur ! Ça n’a été finalement qu’au moment de coder les crédits de la séquence de fin qu’il a fallu déterminer clairement « qui avait fait quoi » et trouver un titre pour chacun5.
Chrono Trigger constituait le premier projet d’un nom qui deviendra irrémédiablement associé à la série, celui de Masato Kato. Arrivé en cours de développement, il s’agissait là de son premier emploi chez Square, en tant que planificateur de l’histoire. La tâche de Kato ne s’est toutefois pas résumée à organiser des post-it sur un tableau et à mettre en forme l’histoire générale proposée par Horii, puisqu’on lui doit aussi la création de tout l’arc scénaristique autour du royaume de Zeal, un élément fondamental de l’univers de Chrono Trigger et Cross dont Kato se montre particulièrement fier6. L’expérience sera pourtant rude : le tout jeune développeur admettra plus tard que les réunions de travail comme les séances de planning ont fait partie des plus intenses de sa carrière. Et évidemment, quand l’idée des voyages dans le temps a été proposée (par une personne qui ne faisait pas partie du projet, pour l’anecdote), le développement a pris une tout autre tournure. Comme si l’on passait de la 2D à la 3D, toute nouvelle suggestion se voyait prolongée d’un niveau de réflexion supplémentaire, ouvrant la voie à encore davantage de possibilités. Vertigineux, mais excitant. L’idée, qui avait quand même un certain poids, a fini par être acceptée malgré les réserves de Kato lui-même. Horii en particulier n’était pas mécontent, car le créateur de Dragon Quest s’avère un grand fan de la série de 1966 The Time Tunnel. Et puis, l’innovation ne se fait jamais sans prise de risque.
Il n’était pas question de réduire l’idée du voyage dans le temps à une simple mécanique scénaristique : ses implications allaient changer fondamentalement la nature de Chrono Trigger.