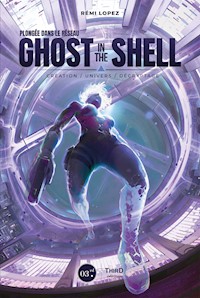
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Third Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Envie de découvrir les dessous du succès internation de Ghost in Shell ? Ouvrez alors vite ce livre !
Presque trente-cinq ans après sa création par le crayon de Masamune Shirow,
Ghost in the Shell est considéré comme l’un des plus grands représentants japonais de la science-fiction, et notamment du genre cyberpunk. De l’opacité du manga de Shirow à la conscience sociale de Stand Alone Complex, en passant par les réflexions philosophiques du diptyque culte de Mamoru Oshii, cet ouvrage explore les coulisses et analyse les thèmes de la franchise dans son ensemble. En plus de décrire les processus de création du manga, des séries et des films,
Rémi Lopez plonge corps et âme au coeur de l’oeuvre afin d’en extraire l’essence. Débats philosophiques sur la conscience à l’heure de la cybernétique et du posthumanisme, intrigues politico-industrielles inspirées de faits réels, reflets des crises sociales contemporaines du Japon : tous les aspects de
Ghost in the Shell sont ici disséqués et analysés.
Prolonger le plaisir de cette saga en vous procurant ce livre d'analyse du phénomène !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Titulaire d’une licence de japonais obtenue à Bordeaux-III,
Rémi Lopez fait ses premières armes comme auteur en 2004 sur Internet, en rédigeant des chroniques de bandes originales de jeux vidéo. Deux ans plus tard, il rejoint le magazine
Gameplay RPG pour y officier à la même tâche, avant de suivre Christophe Brandy, alors rédacteur en chef, et toute son équipe sur son nouveau projet : le mensuel
Role Playing Game. Rémi a depuis signé des ouvrage comme
La Légende Final Fantasy VIII (Third Éditions) ou encore le livre sur la musique
OST. Original Sound Track (Les éditions Pix’n Love) .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 647
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
INTRODUCTION : LE JAPON ET LA SCIENCE-FICTION
PRESQUE TRENTE-CINQ ANS après sa création par le crayon de Masamune Shirow, Ghost in the Shell est considéré comme l’une des plus grandes franchises de la science-fiction et l’un des principaux représentants du cyberpunk, un sous-genre profitant aujourd’hui d’une seconde jeunesse. Si quantité d’œuvres du même genre sont restées piégées dans les années 1980 et leur esthétique très identifiable, Ghost in the Shell a su évoluer sans se reposer paresseusement sur la récente vague de nostalgie pour cette époque (Stranger Things, Ready Player One, le mouvement synthwave…), en vue de traverser les années et les visions changeantes de l’avenir, dont les projections sont toujours dépendantes du moment présent. De l’effervescence consumériste du miracle japonais d’après-guerre à la gueule de bois de la décennie perdue, puis de l’exportation à l’étranger jusqu’à la mondialisation de la culture manga, Ghost in the Shell a toujours vécu avec son temps, comme un reflet de l’état du Japon et, d’une certaine manière, de l’imaginaire collectif.
En raison de l’épaisseur de l’œuvre et de l’inépuisable richesse des thématiques qu’elle évoque, Ghost in the Shell peut être abordée et disséquée de bien des manières. Dans les mains d’un autre auteur, vous auriez fini avec un livre certainement très différent de celui-ci. S’il nous aura fallu un certain temps pour déterminer quelle serait la ligne exacte, l’angle d’approche que nous pouvions emprunter pour discuter de ce pilier de la science-fiction moderne, nos réflexions nous ont peu à peu mené à l’homme et son environnement. Pas seulement à sa relation à la nature ou son entourage direct, mais aussi et surtout à ce qu’il tend à construire mentalement, philosophiquement – le théâtre de son existence, de son destin. Si nous devenions demain des cyborgs et que nos capacités physiques comme intellectuelles s’en trouvaient modifiées, augmentées, transcendées même, nous ne changerions pas seulement notre enveloppe physique, mais aussi notre rapport entier au monde et à nous-mêmes. À une époque où tout évolue très vite, trop vite, et où la question transhumaniste relève de moins en moins de la spéculation fantaisiste, ce mélange de crainte et d’espoir lié au progrès technologique est on ne peut plus d’actualité.
Et c’est vrai qu’en décortiquant suffi amment Ghost in the Shell, on retombe invariablement sur ces questions en apparence insolvables qui renvoient au mystère de la condition humaine. De l’obstination à chercher sa place en tant qu’individu et en tant qu’espèce à celle de faire de son existence un récit sensé, Ghost in the Shell ne fait que placer dans un contexte futuriste et clairement postmoderne les interrogations philosophiques fondamentales qui agaçaient déjà nos plus illustres ancêtres grecs, ici éclatées par les perspectives vertigineuses d’un progrès scientifique exponentiel. L’omniprésence de gadgets high-tech, les acrobaties permises par les corps cybernétiques et l’artillerie militaire dernier cri ont beau donner le ton de la franchise et en être ses aspects les plus rapidement reconnaissables, ce ne sont là que les électrons gravitant autour du noyau de l’atome ; ce noyau qui est et reste l’être humain, dans toute sa décourageante complexité.
Mais au fond, n’est-ce pas là l’essence de la science-fiction en tant que genre ? L’intérêt même des projections et des hypothèses mettant l’homme dans ces situations inédites, ces cas de figure inattendus qui lui permettent d’en apprendre davantage sur lui-même ? La science-fiction tend à redistribuer les cartes, en ce qu’elle livre un point de vue fantaisiste mais souvent pertinent sur notre condition moderne. Au moment de la publication des premiers chapitres de Ghost in the Shell en avril 1989, Katsuhiro Ôtomo était en passe de terminer son chef-d’œuvre Akira, les deux mangas se croisant brièvement dans les pages du Weekly Young Magazine. Première vraie vitrine de l’imaginaire cyberpunk à la japonaise, Akira décrivait des paysages mêlant opulence et décadence, grande fortune et misère crasse, un reflet du Japon des années 1980 où les nouveaux riches se gavaient en gonflant une dangereuse bulle économique pendant qu’une autre jeunesse, désabusée et en marge du système, cherchait d’autres moyens de s’affirmer. La catastrophe ouvrant le manga, rasant ce Tokyo imaginaire le même jour que la publication du premier chapitre, traduisait à la fois l’écho du traumatisme de 1945 et la peur d’un holocauste nucléaire que la guerre froide semblait faire pendre comme une épée de Damoclès au-dessus du monde. Le portrait des militaires était loin d’être flatteur, à quelques exceptions près, et plaçait Akira dans la longue série d’œuvres critiques des va-t-en-guerre inconscients, comparables à ceux ayant emmené le Japon dans la désastreuse guerre du Pacifique au début des années 1930. Et pourtant, au milieu de ces renvois au passé, et au-delà des craintes contemporaines transposées dans un futur dystopique, il y avait surtout l’histoire d’un jeune homme, Tetsuo, désespérément en recherche de lui-même, de liens à créer, d’une place à trouver.
Ghost in the Shell s’inscrit dans cette anticipation presque introspective. La franchise n’a jamais cherché à se montrer prophétique dans sa forme, à l’instar du major Kusanagi dans l’adaptation de Mamoru Oshii en 1995 – l’œuvre ayant véritablement catapulté Ghost in the Shell sur la scène internationale –, qui aime plonger dans les profondeurs pour y toucher quelque chose de vrai, isolée des artifices et des lumières éblouissantes d’une ville qui, elle, a noyé son humanité dans le tout-marchandise. William Gibson, l’auteur du Neuromancien, que l’on considérerait à terme comme l’œuvre fondatrice du mouvement cyberpunk, avait remarqué lui-même en arrivant à Shibuya que les visages des gens étaient « éblouis par un millier de soleils médiatiques ». Mais ces paysages éclatants, ces panoramas où la publicité et les enseignes géantes ont étouffé même le ciel, ne sont que l’illustration aveuglante d’un homme se prenant pour Icare, à la différence près que le soleil est ici sa propre création, et qu’il pense pouvoir le maîtriser. Un peu comme l’économie bouillonnante des années 1980 japonaises, avant l’éclatement de la bulle qui plongerait le pays dans la récession. L’authenticité de l’existence, le major Kusanagi semble la retrouver dans le plongeon, un terme clef de la franchise qui, sans être nommé systématiquement, revêtirait bien des significations.
Le succès de Ghost in the Shell ne s’est pas fait en un jour. D’ailleurs, si l’on se penche sur l’histoire compliquée de la science-fiction au Japon, il semblait loin d’être garanti. À l’origine, les premiers auteurs du genre s’étaient inspirés des grands classiques de Jules Verne traduits au Japon à la fin du XIXe siècle1. Mais il fallut attendre le début du XXe siècle avant de pouvoir lire de vrais récits de fiction spéculative, avec souvent la guerre comme toile de fond, à une époque où le Japon affrontait la Russie (1904-1905). Et si la critique de l’armée passait encore avant le début des années 1930, la prise progressive du pouvoir par les militaires allait compliquer la dénonciation d’un autoritarisme d’État de plus en plus liberticide. La censure était telle qu’il devint interdit, à partir de 1937 et jusqu’à la défaite de 1945, d’écrire des histoires traitant de crimes, ce qui embêta terriblement les auteurs de science-fiction, car le genre était encore très lié à celui du mystery2, auquel il tendait souvent à ajouter une touche de fantastique. Quelques auteurs trouvèrent toutefois une faille pour pouvoir critiquer le totalitarisme au pouvoir, puisqu’il était autorisé, voire même encouragé, de cracher sur les régimes ennemis, comme celui des Soviétiques, permettant ainsi à des petits malins de projeter habilement leur message sous couvert de propagande antirusse.
La chute du régime militaire à la fin de la guerre et l’occupation américaine ne libérèrent pas immédiatement la créativité des auteurs de science-fiction du carcan de la censure. Car s’ils étaient effectivement débarrassés de l’œil implacable de l’armée, il faudrait attendre encore un peu pour voir naître « l’âge d’or » de la science-fiction japonaise, que l’un de ses plus illustres auteurs, Shin’ichi Hoshi (1926-1997), situerait dans les années 1960, juste après la création des deux principales publications dédiées au genre, le fanzine Uchûjin (« Extraterrestre », publié entre 1957 et 2013) et SF Magazine (entamé en 1960 et toujours publié !), à une époque où toute une génération d’auteurs, la première d’après-guerre, était encore très influencée par la science-fiction anglosaxonne des années 1950, très portée sur les mystères de la vie spatiale. Car si jusque-là, dans le monde de la littérature, la science-fiction avait été considérée comme incompatible avec la « littérature pure » ou jun bungaku, élitiste et focalisée sur les sentiments du narrateur, le genre commençait à s’infiltrer partout, brouillant les frontières, notamment grâce à la plume d’Abe Kôbô (1924-1993), un autre immense auteur dont le Dai yon kanpyôki (Inter Ice Age 4), publié pour la première fois en 1958, est considéré comme la première véritable œuvre de hard-SF3, technique et verbeuse. L’acceptation du fantastique, du « et si » spéculatif et de l’incroyable se heurtait alors à une vieille tradition littéraire japonaise empreinte de naturalisme et d’une insistance sur le réel comme ultime frontière. Un point de vue illustré par l’un des premiers critiques littéraires japonais, Tsubôchi Shôyô (1859-1935), dans un texte semblable à une sentence de mort pour le genre bourgeonnant : « Puisqu’il est impossible d’examiner directement le futur, il est impossible d’écrire un récit s’y déroulant. Quelques personnes ont rédigé des nouvelles se passant dans le futur, non pas en se basant sur leurs observations, mais grâce au pouvoir de l’imagination. Puisque cette méthode d’analogie se base sur la logique inductive à partir du présent, il s’agit, finalement, d’une performance intellectuelle. L’art, en revanche, doit être perçu à travers le prisme des émotions. De fait, il ne peut pas y avoir d’art basé sur l’imagination4. » Autant dire qu’il fallut bien des années à la science-fiction japonaise pour s’affi mer comme genre littéraire légitime et s’affranchir des vieilles étiquettes. Il restait cependant une constante qui continuerait de s’affi mer jusqu’à nos jours : l’importance de l’humain au-delà de la technologie. Le climat autoritaire d’avant la Seconde Guerre mondiale avait fait naître des histoires voyant d’un regard critique la tyrannie du maître envers l’élève et la destruction systématique de l’expression personnelle, créative. Avec le « miracle japonais » d’après-guerre et l’apparition d’un nouveau mode de vie largement transformé par la consommation, la science-fiction réorienta ses craintes en direction d’un matérialisme grandissant, faisant peu à peu disparaître les traditions et la spiritualité.
Au cours des années 1960, les foyers japonais découvrirent en effet pour la première fois le confort apporté par les trois trésors de l’époque moderne : la télévision, le réfrigérateur et la machine à laver. Il n’était pourtant pas évident pour tous que cette américanisation rapide du mode de vie allait dans le bon sens, et s’il y eut bien un auteur qui parvint à traduire les inquiétudes liées au progrès technologique et la transformation des foyers, ce fut sans doute Shin’ichi Hoshi, véritable roi de la « micro-fiction », qui signa de son vivant plus d’un millier d’histoires courtes. Dans Senden no Jidai (« L’Ère de la propagande/publicité »), les gens ont été totalement conditionnés par la publicité et ne s’expriment plus qu’en slogans en réponse au moindre stimulus ; Mane Eiji (« L’Ère de l’argent », en anglais dans le texte) met l’accent sur l’essor d’un tout commercial, dans un avenir où absolument tout est régi par un accord financier et où les banques proposent même un « compte pour soudoiement » ; Aru Noiroze (« La Névrose ») associe l’éthique professionnelle japonaise, sa culture de la honte et l’informatisation grandissante du monde du travail dans un récit aux échos très contemporains, dans lequel un jeune travailleur voit une erreur mineure de sa part enregistrée dans l’ordinateur récemment acquis par son entreprise. Il réalise alors qu’à chaque fois que son nom sera entré dans la machine, cette erreur apparaîtra comme une tache indélébile que les hommes ont déjà oubliée ; mais pas l’ordinateur. Lui n’oubliera jamais. Dans un pays où la réputation du groupe passe avant tout et où le fautif est sacrifié sur l’autel du collectif, la froideur mécanique et implacable de l’information numérique apparaît comme une sentence encore plus cruelle, justifiant l’adage contemporain : « Internet n’oublie jamais. »
L’automatisation des tâches n’était pas que synonyme de confort, bien au contraire. Le phénomène faisait peser sur l’esprit des Japonais la peur de l’ennui, de la passivité devant une vie se faisant toute seule, à une époque où l’effort collectif pour reconstruire le Japon avait valeur de sacerdoce national. Dans Mokei no Jidai (« L’Ère des maquettes/modèles »), Sakyô Komatsu (1931-2011) présentait un avenir dépassionné où plus personne n’innove et où tout le monde se contente de reproduire ce qui existe déjà, à différentes échelles. On y parlait déjà de poupées sexuelles. Yukio Mishima lui-même, dans un registre plus réactionnaire, décriait l’érosion des traditions qui rendait les Japonais moins japonais, dans son roman L’Ange en décomposition. Il finirait son manuscrit le jour de son spectaculaire suicide.
Comme le suggérait le titre du tout premier fanzine à vraiment connaître le succès, Uchûjin, les auteurs de science-fiction des années 1960 (et au-delà) étaient fascinés par l’espace et la vie extraterrestre, cette dernière leur permettant de porter un regard différent sur l’espèce humaine. Dans Fuman (« Mécontent »), Shin’ichi Hoshi racontait l’histoire d’un homme envoyé dans l’espace contre son gré et mourant de froid, avant d’être ramené à la vie par des aliens disposant d’une technologie très avancée. Un appareil installé sur la tête de l’homme lui permet de traduire ses pensées dans le langage de ses hôtes, qui se montrent particulièrement polis et avenants, contrairement aux Terriens. Il arrive ainsi à convaincre les extraterrestres, pourtant pacifistes, de faire sauter la Terre, mais ceux-ci refusent d’appuyer eux-mêmes sur le bouton, la tâche devant revenir à un Terrien. L’homme s’exécute. L’amertume est la même dans Sedai Kakumei (« Révolution générationnelle ») de Jirô Ikushima (1933-2003), dans lequel la génération née pendant les années militaires (de 1926 à 1940) se voit aidée par des petits lutins verts pour traduire en justice la génération précédente dite « de Meiji » (ceux nés avant 1921), responsable de l’escalade guerrière ayant mené le pays à la ruine.
L’influence du mystère de l’espace se voyait également dans le marché du manga et de l’animation, en plein développement, avec de grandes séries comme Space Battleship Yamato (1974), Galaxy Express 999 (1977) ou encore Space Runaway Ideon (1980). Et si le théâtre de ces aventures s’installait généralement au-delà de l’orbite terrestre, les thématiques évoquées restaient inévitablement humaines. Space Battleship Yamato mêlait le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et les nouveaux enjeux environnementaux, en présentant une Terre devenue invivable à cause de météorites radioactives envoyées contre elle par des aliens hostiles. Le dernier espoir de l’humanité se révèle alors être le Yamato, un vaisseau japonais coulé à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ayant réellement existé (un film le concernant est sorti en 2005 : Les Hommes du Yamato), retapé et paré à explorer l’espace à la recherche d’un appareil pouvant contrer les effets de la pollution.
L’angoisse de la destruction, les Japonais la connaissent, et les catastrophes d’Hiroshima et Nagasaki n’en sont pas les uniques raisons. La fréquence des tremblements de terre rappelle régulièrement aux habitants de l’Archipel la fragilité de leur géographie, et c’est cette question des séismes qui fut au centre de l’un des plus grands succès de la science-fiction japonaise : La Submersion du Japon, un roman de Sakyô Komatsu sorti en 1973. L’auteur se révélera particulièrement prolifique dans le registre de la fiction-catastrophe mettant dans la balance l’avenir de l’espèce humaine, mais La Submersion du Japon restera son plus grand succès, que même les Américains adaptèrent au cinéma en récupérant des scènes de la version japonaise (un peu comme ils l’avaient fait avec Godzilla). Comme l’indique le titre du roman, l’histoire est celle de la submersion progressive mais inévitable du Japon dans le Pacifique, et des perspectives de certains de ses habitants et du monde entier devant l’ampleur d’une telle tragédie. Personne n’aurait pu écrire le récit de cette catastrophe comme le fit Komatsu. La Submersion du Japon résonne de l’amour si particulier que les Japonais éprouvent envers leur archipel : certains préfèrent l’accompagner dans sa submersion plutôt que de rejoindre le continent avec les dizaines de millions de réfugiés. L’énorme succès du roman engendra la création de nouveaux magazines de science-fiction mais aussi de critiques du genre, appuyant encore davantage la nécessité de l’anoblir en tant que genre littéraire légitime et respectable.
L’imaginaire des années 1980 représentera une redirection du point de vue, vers l’infini de l’espace à celui plus abstrait du cyberespace. Les mystères de la cybernétique, impliquant la relation à notre propre chair, notre cerveau et plus généralement notre intégrité physique, remplaceront ceux des galaxies lointaines. Ghost in the Shell débarqua en 1989 sur un terrain déjà préparé par les travaux de William Gibson et Bruce Sterling, mais aussi les paysages du Blade Runner de Ridley Scott et ceux du viscéral Akira de Katsuhiro Ôtomo. Fort du succès d’Appleseed, qui posait déjà les bases d’une réflexion sur les dilemmes éthiques d’une technologie devenue prométhéenne, Masamune Shirow créa à l’aube de la nouvelle décennie un manga incroyablement exigeant, saturant les pages de notes techniques et de terminologies trop opaques pour le grand public, dont nous continuons de faire la pénible exégèse aujourd’hui. L’impressionnante richesse du texte servira malgré tout de terreau fertile à une franchise qui puisera sans cesse son inspiration dans l’œuvre originelle. Ghost in the Shell ne sera pourtant jamais adapté directement à l’écran, le film de Mamoru Oshii de 1995 n’en reprenant lui-même que certaines séquences pour en laisser de côté l’essentiel. Mais le manga de Masamune Shirow disposait de suffisamment de graines de sagesse et de génie pour en voir germer des fruits plus de trente ans après. Et si, comme la plupart de ses contemporains du mouvement cyberpunk, le mangaka faisait clairement dans la pseudoscience, cela ne l’empêchait pas de pousser au maximum ses réflexions et de faire de son œuvre un hybride étrange de hard-SF et de spiritualité orientale, à l’instar de quelques-unes de ses autres œuvres, comme l’inclassable Orion, dont la publication fut entamée peu après celle de Ghost in the Shell. En d’autres termes, l’esprit de Shirow voguait dans les craquelures séparant la science dure du domaine de la foi et du mystérieux, entre les structures neuronales du cerveau et les mythes du shintoïsme.
Cette porosité du réel, ce va-et-vient opéré par Shirow entre le concret et le spirituel, ne disqualifiera pourtant ni l’un ni l’autre. Le propre de la science-fiction n’est pas tant d’anticiper l’avenir avec exactitude ou de se faire le héraut des prochaines innovations technologiques, que d’exprimer des idées, des espoirs et des craintes. C’est un vieux débat que de savoir si la science-fiction doit être plus « science » que « fiction », amenant fatalement à déterminer les frontières concrètes du genre et à devoir ou non l’associer au fantastique en général. Le Japon n’a pas échappé à ces querelles sémantiques et autres polémiques provoquées par les garde-fous du monde littéraire, des empoignades qu’Abe Kôbô considérait comme stériles dans un texte publié en 1962 : « Nous ne devons pas oublier que le concept de réalisme n’est rien de plus qu’une technique littéraire, sans relation avec les faits scientifiques, ou même de la “réalité” dans le sens conventionnel du terme. Par exemple, il y a des critiques littéraires qui encensent une œuvre en disant que les prédictions de l’auteur se sont réalisées : non seulement ça n’a rien à voir avec de la critique, mais c’est desservir la littérature. […] La science-fiction en général peut être pensée comme une littérature d’hypothèses. En d’autres termes, l’horrible monstre de Frankenstein n’est rien d’autre qu’une hypothèse visant à sonder les profondeurs de l’amour et de la solitude5. » Et il est vrai que l’œuvre de Mary Shelley n’avait au fond rien de scientifique, et la valeur de son travail ne sera pas jugée, dans sa postérité, sur des critères réalistes. C’était le romantisme qui primait, et qui fera de Frankenstein un monument de la littérature gothique. Pour le tout premier numéro de SF Magazine, Abe Kôbô écrivit : « La nouvelle de science-fiction représente une découverte à la hauteur de celle de Christophe Colomb, en ce qu’elle combine une hypothèse extrêmement rationnelle à la passion irrationnelle de l’imaginaire… La poésie produite par la collision de la tension intellectuelle avec l’appel à l’aventure n’est pas seulement contemporaine ; elle dépend de l’esprit originel de la littérature. »
En dépit des longues digressions verbeuses de Masamune Shirow dans le manga originel ou des intrigues militaro-politiques tentaculaires de ses multiples adaptations, Ghost in the Shell porte avant tout un regard original et fascinant sur l’homme et son rapport au monde en se projetant dans un futur imaginaire pour y traiter de sujets intemporels. Ses différents architectes se sont seulement permis d’y apporter leur touche personnelle, leur angle d’attaque, qu’il soit contemplatif chez Mamoru Oshii, sociopolitique chez Kenji Kamiyama (Stand Alone Complex) ou éthique chez Rupert Sanders.
La première partie de cet ouvrage, baptisée « Shell », relate la longue et tumultueuse conception de Ghost in the Shell en tant que franchise, des premières bribes d’idées de Masamune Shirow à la récente adaptation hollywoodienne. Un cours d’histoire s’étendant sur plus de trente ans et revenant exhaustivement sur chacune des itérations de la série6, ses créateurs, succès et déconvenues. Et s’il s’agit là du « corps », de ses tissus, ses liens et réseaux tangibles, la seconde partie du livre, appelée « Ghost », se concentrera sur les grands thèmes et idées de Ghost in the Shell, du fond au-delà de la forme, du fantôme dans la coquille.
Biographie de l’auteur
Rémi Lopez est titulaire d’une Licence en langue et civilisation japonaises, et est tombé dans la marmite du RPG étant petit. Une passion qui ne l’a jamais quitté puisque, à dix-sept ans, il écrit ses premiers articles pour la presse spécialisée, de Gameplay RPG à Role Playing Game, après avoir fait ses armes sur Internet en amateur. Grand admirateur de Jung, Campbell et Eliade, il a entamé sa carrière d’auteur en écrivant à deux reprises sur Final Fantasy, d’abord sur le huitième épisode en 2013, puis sur l’univers d’Ivalice en 2015, chez Third Éditions, avant de coécrire deux autres ouvrages consacrés à la saga Persona. Enfin, toujours pour le même éditeur, Rémi Lopez a rédigé trois autres ouvrages : Cowboy Bebop. Deep Space Blues, La Légende Chrono Trigger et Le choc Akira. Une [r]évolution du manga.
1. Le Tour du monde en quatre-vingts jours en 1878 et Vingt Mille Lieues sous les mers en 1884.
2. Un genre mettant en scène un crime ou un meurtre dont l’identité du coupable est à découvrir, tant par le lecteur que par l’enquêteur, ou le protagoniste de l’histoire. Le mystery comprend donc la fiction policière, l’enquête procédurale, le roman noir ou encore le true crime.
3. Un sous-genre de la science-fiction ou une « approche » faisant passer au premier plan le désir d’exactitude scientifique, parfois au détriment de la fluidité de la narration ou du développement des personnages.
4. Citation tirée de Japanese Science Fiction, A View of Changing Society, de Robert Matthew (Routledge, 1989).
5. KÔBÔ, Abe. « Two Essays on Science Fiction; The Boom in Science Fiction (1962) & Science Fiction, the Unnameable (1966) », initialement publiés dans Abe Kôbô Zenshû, traductions de Christopher Bolton et Thomas Schnellbächer, Science Fiction Studies n° 88, novembre 2002, SF-TH Inc.
6. À l’exception des adaptations en jeux vidéo ou des projets les plus anecdotiques.
PARTIE UNE : SHELL
1.1. L’AVANT-GHOST IN THE SHELL
Tout comme Rome, le développement de Ghost in the Shell en une franchise tentaculaire ne se fit pas en un jour. Loin de là. Passant de main en main au fil de ses incarnations, repensé et réinterprété par des esprits créatifs au style parfois atypique, le monde imaginé par Masamune Shirow ne peut que difficilement prétendre jouir, aujourd’hui, d’une solide cohérence de fond ou de forme ; qui se rappelle encore des planches érotiques du manga d’origine et de sa Motoko exubérante ? Est-il d’ailleurs seulement possible, ou même pertinent, de comparer les figures de style de Mamoru Oshii sur ses deux longs-métrages de 1995 et 2004 avec le format procédural de Stand Alone Complex ? Plus de trente ans après la publication de l’œuvre originale, Ghost in the Shell est devenu une gigantesque toile, dont le centre n’est aujourd’hui plus qu’un vague souvenir, un panthéon de dieux dont on a oublié l’origine.
Le démiurge de Ghost in the Shell s’appelle Masanori Ota, plus connu sous le pseudonyme de Masamune Shirow. Un nom de plume pour isoler un artiste déjà bien solitaire dans le confort d’un anonymat dont il ne sortira que très peu en dépit de son succès, ses interviews se comptant encore de nos jours sur les doigts d’une main. De fait, on ne sait pas grand-chose de la vie personnelle de Shirow, bien qu’il soit possible de reconstruire, au moins dans leurs grandes lignes, son parcours et sa maturation artistique jusqu’à la réalisation de Ghost in the Shell en 1989.
Le manga ? Pourquoi pas ?
Né le 23 novembre 1961 dans ce qui restera sa ville de cœur, Kobe1, Shirow ne suivit pas le modèle classique, presque cliché, d’un amour dévorant pour la bande dessinée, contrairement à beaucoup de ses contemporains et futurs collègues tombés dans la marmite du manga dès leur plus jeune âge. Toutefois, cette absence de passion n’empêcha pas le jeune garçon de développer une certaine fibre artistique, dès l’école élémentaire, pour un art graphique encore très différent de celui avec lequel il se distinguerait plus tard : « Je faisais de l’aquarelle sans y attacher trop d’importance, et pour mon plaisir, je sortais souvent pour peindre les montagnes locales ou le bord de mer, en emmenant avec moi des livres illustrés richement référencés dont je ne comprenais rien2. » Ce dernier détail ne devrait pas surprendre les plus fervents admirateurs de Shirow : ici se trouvaient certainement les racines d’un jusqu’au-boutisme presque obsessionnel pour la compréhension et la description mécanique des choses, qui donnerait plus tard naissance à des mangas incroyablement exigeants pour leurs lecteurs, des œuvres dont la substance se cache souvent derrière une technicité à l’opacité décourageante.
Si la génération de mangaka ayant précédé celle de Shirow s’était enivrée des aventures d’Atom (Astro, le petit robot) et d’une science-fiction relativement « cartoonesque », les années 1970 et le début des années 1980 verraient naître un nouveau genre de SF : plus sérieuse, plus violente aussi. Un virage qui signera la fin d’une première vague de super-robots anthropomorphes aux couleurs vives et aux designs simplistes à la Gô Nagai (Goldorak, Mazinger Z), alors parfaitement pensés pour le marché du jouet. En débarquant dans les petites lucarnes en 1979, la série Mobile Suit Gundam marqua l’avènement d’une nouvelle vision de l’anime dit mecha, plus complexe et mature dans ses intrigues, mais aussi dans le design de ses robots géants ; le marché suivit et les jouets devinrent des maquettes, le public cible passant des enfants aux adolescents et aux jeunes adultes. On trouvait parmi eux Masamune Shirow : « Si je devais citer des noms [qui m’ont influencé], ce seraient ceux de Katsuhiro Ôtomo, de Fujihiko Hosono et du studio Nue. Ma génération a grandi au moment où la télévision en couleur se généralisait. Quand j’étais au lycée, entre seize et dix-huit ans, j’ai dû être influencé par des dessins animés comme Gundam, et plus tard, lorsque j’étais étudiant, par Macross3. »
Malgré son admiration pour cette génération émergente de nouveaux robots et leur apparence plus brute, plus réaliste et émulant presque l’armement militaire, Shirow resta éloigné du monde du manga, s’obstinant à lui préférer l’animation et les séries venues d’outre-Atlantique. Pas question pour autant d’abandonner ses chers pinceaux puisqu’à la sortie du lycée, il fut reçu à l’université des arts d’Osaka4 pour y étudier la peinture à l’huile. C’est là qu’il fit la connaissance, au sein de son établissement, du « groupe de recherche sur le manga » Atlas (créé en 1978), après que sa sœur, qui y travaillait depuis 1980, eut fait part à ses collègues du désir naissant chez Shirow de « dessiner des mangas de science-fiction ». Atlas, qui publiait ses propres productions dans un fanzine éponyme, accueillit les premiers coups de crayon de Shirow dans son sixième numéro d’août 1980. En y prêtant attention, on reconnaissait déjà dans son style hésitant l’influence évidente de Leiji Matsumoto, surtout en ce qui concernait les traits longilignes et les yeux tristes de ses personnages féminins. Shirow se cherchait une identité et n’était pas encore bien sûr de vouloir se diriger vers le manga pour étancher sa soif de création. Mais l’occasion était trop belle, et le jeune artiste décida de tenter sa chance : « C’est comme ça que quelqu’un comme moi, qui n’avais jamais acheté de manga auparavant, finit par en dessiner. C’est peut-être à cause de cela qu’on ne distingue qu’assez peu dans mon travail le [savoir-faire] des mangas classiques. Certaines personnes ont la gentillesse d’y voir un style [unique], mais d’autres parlent d’immaturité, disent que je n’ai pas les connaissances de base essentielles qui rendraient mon travail plus commercial5. » Avec ce petit groupe d’amateurs, Shirow s’essaya donc au manga pendant deux années formatrices, avant de se lancer dans la création de sa toute première œuvre d’envergure, intitulée Black Magic. Une réponse à cette nouvelle génération de robots géants qui avait allumé chez lui une étincelle d’inspiration : « Gundam était populaire, mais comme je faisais beaucoup de sport, j’avais peu de temps pour regarder la série. Mes seuls moments libres étaient ceux que je passais confiné à la maison quand j’étais blessé. Macross avait commencé à l’époque où je dessinais Black Magic, et ça avait touché quelque chose en moi, mais maintenant, j’ai le sentiment que si la série m’avait totalement satisfait, je serais resté spectateur plutôt que de devenir mangaka moi-même6. »
Black Magic, le premier jet
Avant d’être récupéré par la Seishinsha en 1985, Black Magic fut d’abord publié comme dôjinshi7 par Atlas en février 1983. À travers cette première vraie histoire de science-fiction, le squelette des futurs travaux de Shirow commençait à se dessiner – on le comparerait ensuite à un brouillon de son légendaire Appleseed, qui ferait véritablement décoller sa carrière deux ans plus tard. Définitivement un produit de son temps, Black Magic peut être placé au carrefour de Terminator, Space Battleship Yamato et Macross : les humains ont colonisé une partie du système solaire et se sont massivement installés sur Vénus, où ils ont construit une sorte de superordinateur omniscient baptisé Némésis, devenu avec le temps un dictateur rationnel et incontestable. Pour l’aider dans sa tâche de superviser le développement humain, Némésis a pris l’initiative de créer une nouvelle race d’humanoïdes, les bioroïdes (un terme que l’on retrouvera dans Appleseed). Mais après des années de fidélité à leur créateur, les « bioroïdes » décident finalement de s’émanciper « officieusement » sous l’égide du mystérieux Zeus. Pour répondre à ce séparatisme naissant, Némésis conçoit alors une sorte de super-soldat bioroïde nommé Typhon, dans le but de veiller sur les humains et contrecarrer les plans de Zeus, qui tend à juger la race humaine comme inférieure. C’est là la version très résumée du background de Black Magic, qui s’ouvre sur une double-page faite de présentations essentiellement textuelles, et où les informations fournies ne seraient d’ailleurs pas toutes indispensables. En somme, de l’information pour de l’information, dont le récit comme le lecteur pouvaient bien se passer. Le manque de « savoir-faire » qu’on reprochait à Shirow en son temps transpirait, au moins en partie, de cette narration particulière et parfois indigeste, que l’on retrouverait dans quasiment toutes les œuvres de l’artiste ; de l’info-dump8 massif venant casser le rythme de ses intrigues, allant de descriptions interminables aux explications superflues sur le fonctionnement d’une arme, d’un véhicule ou encore d’un insecte. Si Ghost in the Shell sera sans doute l’œuvre majeure de Shirow à avoir le plus recours à ce procédé, Black Magic présentait déjà ces interjections explicatives, que l’auteur tâchait de masquer, souvent de manière maladroite, dans des dialogues qui paraissaient finalement peu naturels. Shirow lui-même est bien au fait de ces critiques récurrentes : « Oui, des fois, les lecteurs se plaignent, en effet. Je me rends compte que mes histoires devraient être faciles à lire, alors j’essaie de faire en sorte qu’elles le soient. C’est vraiment un équilibre complexe : je ne veux pas écrire des histoires trop simples, mais pas trop compliquées non plus. J’ai du mal à trouver un bon équilibre… Je sais que c’est compliqué pour les lecteurs, parfois9… » Cette surabondance d’informations au détriment de la fluidité de la narration pourrait s’expliquer par le souhait manifeste, chez Shirow, de créer un monde avant de raconter une histoire, de dessiner un background riche avant de s’intéresser aux destinées individuelles, aux points de vue personnels. Là où même les plus récentes séries de science-fiction comme Mobile Suit Gundam utilisaient des codes du shônen, en mettant en avant des héros jeunes à la découverte d’un monde et/ou d’un conflit qui les dépassent, le centre de gravité des mangas de Shirow ne serait donc jamais un personnage en particulier, mais bien l’univers dans lequel il devait évoluer ; l’auteur se ferait ainsi meilleur worldbuilder que storyteller, plus architecte que conteur.
La version française des éditions Tonkam propose à la fin du manga un appendice où Shirow développe l’idée d’un nouveau modèle de M-66, cet androïde traqué pendant plusieurs chapitres, et l’y dissèque, littéralement, pour en expliquer le fonctionnement mécanique : aux longues explications verbeuses concernant la robotique en général, totalement hermétiques pour les profanes, se couple un inhabituel souci du détail dans le dessin. En effet, si Shirow, dans Black Magic en particulier, se contentait d’un trait assez large et sans grande finesse pour ses personnages, il s’assurait de la minutie du moindre détail pour ses machines. L’influence de Katsuhiro Ôtomo s’y fait sentir dans la complexité de l’anatomie mécanique du M-66 ; on a en tête ce plan terrifiant de Fireball (1979), où le corps du héros, déconstruit par des machines sur une table d’opération, se redresse spontanément en laissant entrevoir, comme dans une coupe transversale, toutes les couches et systèmes de son organisme. De son côté, l’appendice, censé détailler le fonctionnement interne du M-66, répond surtout à des questions que personne ne se pose, ce qui tend à faire entrer Masamune Shirow dans la catégorie des auteurs de hard-SF, quand bien même il s’agit là de pseudoscience. Saviez-vous que, parce que son poids peut devenir un problème en terrain marécageux, le M-66 dispose d’un mini-fusil à grappin ? Ou qu’il lui est difficile d’utiliser les protections des fantassins parce que son seuil de tolérance est de +P+45+acP ? Apparemment, Shirow tient à l’expliquer.
Peut-être est-ce caractéristique d’une première œuvre, mais Black Magic essayait sans doute d’être trop de choses à la fois. Chacun de ses six chapitres présente une intrigue n’ayant que peu de rapport avec la précédente, allant de la chasse à l’androïde devenu fou à l’espionnage industriel ou aux attentats terroristes, avec en toile de fond le conflit entre Némésis et Zeus – ce dernier n’apparaissant d’ailleurs jamais. Seul le personnage de Typhon, l’arme secrète de Némésis et femme fatale à mi-chemin entre une magical girl et la Nausicaä de Miyazaki, fait office de colle liant les différentes intrigues. On sent pourtant que Shirow avait des choses à raconter, car Black Magic abordait des thèmes qui détermineraient le ton de bon nombre d’œuvres de science-fiction japonaises des années 1980, en particulier dans le manga et l’animation : intelligence artificielle, lois de la robotique, superordinateurs, eugénisme et humains modifiés… Difficile encore de parler de cyberpunk lorsque l’on regarde Black Magic, mais Shirow flirtait déjà clairement avec certaines des idées majeures du genre, un an avant le Neuromancien de William Gibson qui en cristalliserait les codes. Une évolution logique de la science-fiction d’Astro, le petit robot, de Tetsujin 28-gô ou même de Space Battleship Yamato, qui gardaient en ligne de mire la fragilité de l’espèce humaine face à sa propre intelligence. Et si le sous-texte de ces œuvres laissait paraître les stigmates d’une génération traumatisée par la guerre du Pacifique, la propagande militaire et l’annihilation atomique, Shirow avait quant à lui le regard résolument tourné vers l’avenir. Black Magic jouait sur un ton pessimiste assumé ; le mangaka présentait son histoire comme celle d’une « décadence », et l’apparent happy ending se faisait vite démolir, en dernière instance, par un carton de texte expéditif, expliquant qu’une nouvelle guerre sur Vénus avait finalement rendu la planète inhabitable. L’idée de fin du monde restait prégnante chez les auteurs japonais, quarante ans après la fin de la guerre.
D’un point de vue iconographique, le manga de Shirow conservait quelques aspects de la science-fiction avec laquelle sa génération avait grandi : celle où l’on trouvait des extraterrestres ressemblant peu ou prou aux humains (à deux antennes près) et où l’on s’extasiait encore devant la démesure intimidante de grands cuirassés bravant les dangers de l’espace, menés par des capitaines charismatiques à la Harlock (Albator). Avec Black Magic, la science-fiction restait dans l’espace, quelques années encore avant de passer, notamment grâce à Ghost in the Shell, à l’infinité du cyberespace. Mais déjà avec sa première œuvre, Shirow abordait un élément important de ce qui allait caractériser le cyberpunk : la méfiance de l’homme vis-à-vis de sa propre création. Après tout, dans son préambule, Shirow évoquait bien la défaite de Cronos dans un combat avec Zeus, le dépassement du père par le fils ! Black Magic questionnait déjà l’évolution de notre espèce et la transcendance du modèle darwinien, en montrant une humanité aux prises avec une race supérieure qu’elle avait elle-même mise au monde, et qu’elle avait cru pouvoir asservir. Si le concept serait développé plus tard dans Appleseed, le mangaka n’avait pas peur d’aborder des questions d’envergure, avec peut-être l’arrogance de l’amateur inspiré ; l’un des chapitres de Black Magic réinterprétait le mythe de Prométhée (et, dans une moindre mesure, celui de Pandore), en remplaçant le feu donné aux hommes par un soleil artificiel. Le manga de Shirow est d’ailleurs bardé de termes empruntés à la mythologie (grecque, essentiellement), comme une prolongation de l’imagination humaine antique qui avait baptisé l’étoile la plus brillante du nom de Vénus, la déesse romaine de la beauté et de l’amour. Shirow n’était même pas loin d’unir la science et la magie, avec la présence d’un « bioroïde magicien », un concept qu’il développerait plus tard dans Orion (1990). Il confiait en 1998 : « Je pense en effet que la science et la technologie deviennent de plus en plus magiques. En d’autres termes, les experts savent ce qui se passe, mais le citoyen ordinaire n’en a pas la moindre idée. Pour la plupart des gens, les choses fonctionnent comme dans une sorte de boîte noire ; ils savent juste que s’ils insèrent quelque chose dans la boîte, un résultat spécifique va se produire. C’est surtout vrai pour les ordinateurs. Vous devez être un expert pour savoir pourquoi certaines choses se produisent et pour en comprendre les rouages ; mais les gens normaux ne sont pas des experts. La plupart des gens utilisent les ordinateurs parce qu’ils sont pratiques ; ils ne peuvent pas en expliquer les principes, alors en pratique, ils s’en servent comme d’un élément magique. Ça ne veut pas dire que les ordinateurs sont magiques en soi. Les mondes de la science et de la magie sont séparés, bien sûr ; mais dans la façon dont on perçoit les choses, ils convergent. C’est peut-être pour cette raison que dans mon travail, on pourrait croire que j’essaie de combiner technoscience et religion, parce que toutes deux semblent converger. Dans mon travail, l’approche religieuse est probablement plus proche de l’animisme. Quand je dis “religion”, je ne veux pas dire quelque chose contrôlé par une sorte de “dieu” omnipotent ; je veux juste dire “dieux” au sens de la nature10. »
Black Magic, en dépit de son amateurisme, tapa dans l’œil du président de la petite maison d’édition Seishinsha, Harumichi Aoki, qui, sentant le potentiel du jeune auteur, alla chercher Shirow de lui-même pour lui proposer de collaborer. Mais si quantité de jeunes artistes auraient tué père et mère pour une telle promotion, Shirow, lui, voulait faire les choses à son rythme. Il requit Aoki de quelques mois de patience, le temps qu’il terminât son éducation universitaire, après quoi seulement il accepterait de dessiner pour lui. En outre, il semblait hors de question pour le mangaka de se faire broyer par la machine impitoyable de la publication hebdomadaire : trop d’histoires d’horreur circulaient sur des dessinateurs séquestrés par leurs éditeurs, des pétages de plombs en règle et des conditions de travail à la limite de l’inhumain. Non, Shirow voulait garder un pied dans le « monde réel » et fournir ses travaux… quand ils seraient terminés. Pendant ce temps, des centaines de mangaka amateurs suppliaient les éditeurs de leur donner leur chance, en leur envoyant désespérément des cargaisons de dessins, quand ils n’attendaient pas leur heure en trimant dans l’ombre d’artistes bien installés, en tant qu’assistants.
Curieux de nature, Shirow ne comptait pas non plus quitter le monde académique et devint même pendant un temps professeur dans un lycée, un boulot dans lequel il pensait pouvoir s’épanouir : « J’adore dessiner, créer des histoires et faire des recherches, et je savais que je voulais intégrer une profession où je pourrais faire tout ça. Cela m’a pris un moment après mes débuts pour réaliser que c’était, après tout, ce que faisait un mangaka11. » La réalisation d’Appleseed, le premier chef-d’œuvre de Masamune Shirow, se fit donc dans des conditions assez particulières, et son emploi de professeur n’en serait pas l’unique raison, loin de là. Parce qu’il ne s’était pas soumis à l’enfer de la parution hebdomadaire, Shirow prit tout son temps pour dessiner le premier volume de sa série de science-fiction, sautant par la même occasion l’étape de la publication par chapitre – l’étape de « sélection naturelle » des nouveaux mangas – pour aller directement vers celle en tankôbon (format poche en couverture souple). Les quatre recueils d’Appleseed parurent de 1985 à 1989, laissant à Shirow un délai confortable pour parfaire son œuvre qu’il réaliserait finalement tout seul, refusant l’aide d’un assistant, tel un metteur en scène égocentrique et capricieux. C’était son manga, sa vision. Et grâce au succès d’Appleseed, couplé à un dégoût grandissant du système d’éducation japonais, Shirow décida en suivant de devenir mangaka à plein temps. Entretemps, il réaliserait aussi le désopilant Dominion, et la sortie du quatrième et dernier volume d’Appleseed coïnciderait avec la publication du premier chapitre de Ghost in the Shell. Mais nous y viendrons.
Appleseed, cybernétique et anticipation
Les deux ans séparant la sortie de Black Magic du premier volume d’Appleseed virent le trait de Shirow s’affiner considérablement, si bien qu’il serait difficile aujourd’hui, pour les profanes, d’imaginer que les deux œuvres proviennent du même auteur. Son dessin était devenu bien plus détaillé, son trait plus minutieux, et ses arrière-plans n’avaient plus rien à voir avec ces figures géométriques semblables à des tableurs Excel sans âme ; on y voyait au contraire la méticulosité chaotique d’un Ôtomo, ou les perspectives vertigineuses de Jean « Mœbius » Giraud. Il faut dire que le milieu des années 1980 marqua le moment où l’esthétique cyberpunk commencerait à capitaliser sur ses piliers les plus solides, le Blade Runner de Ridley Scott (1982) ayant certainement donné le la pour toute une génération d’auteurs et d’artistes visuels. Ce ne fut donc pas surprenant de voir dans l’Olympus de Shirow, où se déroule essentiellement Appleseed, des éléments communs avec le Los Angeles de Blade Runner. Mais plus évidents encore semblent les emprunts à l’œuvre qui avait elle-même grandement inspiré Scott pour le langage visuel de son film, à savoir The Long Tomorrow de Mœbius. Les perspectives très verticales dessinées par Shirow dans le premier volume d’Appleseed, avec ces routes se croisant et se chevauchant les unes les autres en plein centre-ville, paraissent bien renvoyer directement à la bande dessinée de l’artiste français. Ce nouveau souci du détail, qui ne se cantonnerait plus aux éléments mécaniques et aux fantasmes robotiques, était aussi pour Shirow l’une des raisons qui ne le faisait publier que rarement : « L’art détaillé est quelque chose d’inaccessible pour le mangaka dont l’œuvre est publiée dans un magazine hebdomadaire – il ne peut pas le faire sans un bataillon d’assistants talentueux. Pour un artiste tel que moi, qui publie aussi fréquemment que le passage de la comète de Halley, le sens du détail est essentiel pour que mes travaux soient plus lisibles. Et puis, plus simplement, j’aime remplir mes dessins de ces tout petits détails12. »
Appleseed se déroule dans un monde qui peine à se reconstruire après une troisième guerre mondiale sanctionnée d’un hiver nucléaire et une quatrième plus conventionnelle qui a pris fin au bout de trente ans de combats – un motif que l’on retrouverait dans Ghost in the Shell. L’histoire imaginée par Shirow se déroule en 2127, et le background longuement détaillé dans le manga lui-même et ses annexes publiées dans les années 1990 témoigne d’un procédé de worldbuilding soigneusement pensé, que ce soit en termes de géopolitique, de technologie ou même de psychologie. Les deux héros d’Appleseed, la jeune Deunan Knute et son amant cyborg Briareos Hecatonchires, sont d’anciens membres du SWAT de la police de Los Angeles (encore un clin d’œil à Blade Runner ?), recrutés dès le début du premier volume par la ville d’Olympus, sorte de nouvel Éden construit sur les ruines de l’ancien monde et gouverné par une race d’humains optimisés par la bio-ingénierie, les bioroïdes. La stabilité de la cité est assurée par un superordinateur baptisé Gaïa, et tout en apparence suggère qu’à Olympus, la vie est douce, et la coexistence entre humains et bioroïdes se fait sans heurts. Bien sûr, dans les coulisses de ce décor paradisiaque, tout n’est en fait pas si rose, et les héros comme le lecteur s’en rendront compte bien vite.
Appleseed reprenait donc le squelette de Black Magic, son ordinateur omniscient et ses humains artificiels, pour en faire quelque chose de beaucoup plus abouti, dans le fond comme dans la forme (on y retrouvait aussi beaucoup de termes associés à la mythologie, grecque en particulier). Le manga de Shirow posait déjà la difficile question de l’évolution de l’homme à l’ère de la cybernétisation et de la bio-ingénierie, quatre ans avant Ghost in the Shell, dans un récit bien plus cohérent que dans le brouillon Black Magic. Appleseed gardait toutefois une structure très procédurale, avant d’aborder de grandes questions philosophiques : les quatre volumes étaient aussi l’occasion pour Shirow d’exposer sa fascination grandissante pour l’outillage militaire, des armures mobiles futuristes et armes de poing avec leurs spécificités techniques jusqu’aux différences de calibres, tout en détaillant son cheminement pour justifier l’usage de telle ou telle pétoire. Ses interventions verbeuses et, la majeure partie du temps, totalement accessoires pour la bonne compréhension de l’histoire, seraient bien plus nombreuses encore dans Ghost in the Shell, mais on voyait déjà « l’auteur » Shirow s’inviter régulièrement dans les cases de son manga pour des sessions régulières d’info-dump, dont on peinait à deviner à qui elles étaient vraiment adressées. Les fanas de flingues ? Les maniaques du plot-hole13 ? Ou peut-être Shirow lui-même ? Dès le premier volume, l’artiste soumet à son lectorat une quantité faramineuse d’informations, chaque situation devenant un prétexte pour s’attarder longuement sur le lore technologique de l’univers d’Appleseed. Par exemple, lorsque Deunan monte sur la moto de sa « guide » Hitomi pour faire un premier tour dans la ville d’Olympus, là où il aurait été intéressant de se servir de cette balade pour présenter la cité et son histoire, Shirow s’étale sur une page entière pour détailler les spécificités techniques du deux-roues en question, que l’on ne reverra d’ailleurs jamais.
Toute occasion est bonne pour présenter accessoires, armes, prothèses, véhicules et armures mobiles comme on le ferait pour un showcase, une présentation commerciale. Appleseed est une vitrine de l’imagination de Shirow et de son obsession de l’exhaustivité ; il n’est pas exagéré de parler, dès le premier volume du manga, d’une vraie approche d’auteur sur le plan narratif. Shirow est dans son monde et ne cherche pas à brosser le lecteur dans le sens du poil : ses intrigues sont complexes et le resteront après Appleseed, et si tout peut paraître clair dans sa tête, il ne fera que peu voire pas d’effort pour simplifier sa diégèse. Le mangaka s’adresse à ses lecteurs comme s’ils étaient son reflet, dans le même état d’esprit, disposant des mêmes connaissances et ressources et comprenant déjà presque parfaitement sa leçon ; comme un professeur poursuivant nonchalamment son cours devant des élèves qui ne savent même plus quelle question poser. Il faut s’y faire, c’est le style de Shirow.
Au-delà de sa méticulosité technique, presque pédagogique, le mangaka racontait dans Appleseed une vraie histoire de science-fiction, avec en son centre les questions du déterminisme chez l’humain, celle du libre arbitre et, en bout de course, de l’importance de la nature humaine en tant que valeur existentielle. L’utopie incarnée par Olympus n’en a en fait que le nom, car le calme, la stabilité et l’absence totale de conflit ne correspondent pas à la nature profonde de l’être humain. En cela, le conseil de vieillards bioroïdes ira jusqu’à suggérer le remplacement progressif de l’humanité par les bioroïdes, car, comme ils le disent, « on ne peut pas avoir de société parfaite sans gens parfaits ». Et rapidement, on passe du paradis au cauchemar dystopique. Avant d’être largement développée dans Ghost in the Shell, la question de l’évolution humaine était donc déjà abordée dans Appleseed, qui suggérait que la prochaine étape dans notre évolution n’allait pas suivre les règles darwiniennes. Nous nous dirigerions au contraire vers une évolution auto-générée, artificielle, qui, comme dans le cas des bioroïdes, ferait de nous des êtres plus stoïques, moins sauvages… Comme des robots ? À ce sujet, Shirow expliquait : « Bien sûr que j’aimerais voir naître une utopie. La tendance générale de notre monde semble être à la destruction, mais il y a des poches isolées où se développe un vrai progrès. Cela dit, je ne peux pas être trop optimiste. La nature humaine paraît désespérément égoïste. […] Je pense vraiment que nous devrions nous tourner vers les énergies naturelles et renouvelables, géothermiques ou solaires, ce genre de choses. […] Ma vision de l’utopie n’est pas ce que vous appelleriez une vraie utopie, ou en tout cas pas comme l’avait imaginé Thomas More. Je ne pense pas qu’il puisse exister une utopie s’il nous est indispensable de changer notre personnalité ou notre attitude. […] Pour moi, le mot-clef serait “tolérance”. Si des gens différents sont capables de se montrer tolérants les uns envers les autres, l’utopie est possible. L’histoire des sociétés industrialisées est encore bien mince, en tant que morceau de l’épopée humaine ; on doit donc prendre beaucoup de recul et penser à long terme pour développer cette tolérance14. »
En optimiste pondéré, Shirow décrivait dans Appleseed les pièges de l’utopie sans y asséner la sentence de l’impossibilité absolue. Si le mieux est l’ennemi du bien, le parfait est un adversaire plus redoutable encore, en ce qu’il ne laisse rien dépasser du jugement et des faiblesses humaines. Alors, finalement, le mieux semble être une voie plus désirable, un juste milieu entre l’apathie stérile et la rigidité d’un ordre parfait. Pourtant, le système que Shirow aimerait voir naître de son vivant implique une forte dose de bureaucratie derrière l’oxymore « électrochoc délicat » : « Je crois qu’il y a quatre choses auxquelles nous devrions activement penser pour résoudre nos problèmes : l’innovation technologique, la création d’une société internationale où les profits pourraient être redistribués, des réformes sur notre mode de vie, et un sens de la préservation. Mais tout cela sonne un peu comme de la théorisation inutile. Ce ne sont pas vraiment des concepts que nous pouvons assimiler dans notre vie de tous les jours. Peut-être que ce dont nous avons besoin, aujourd’hui, c’est d’un électrochoc “délicat”. (Un peu comme la perestroïka. Ça n’a pas l’air de fonctionner, mais accrochez-vous, M. Gorbatchev ! Et tant qu’on y est, pourquoi pas une perestroïka aux États-Unis ou au Japon, aussi ?). Si c’était une performance de kabuki, l’électrochoc prendrait la forme d’une scène de transition dramatique et flamboyante, qui changerait le cours de l’histoire en un éclair. Mais comme nous le savons tous, pourtant, en réalité, les choses ne sont pas aussi simples15. » Alors, libéralisation de la société ou contrôle massif pour la redistribution des profits ? On aimerait prendre le meilleur dans chaque système, ou au moins ce qui sonne le plus séduisant en théorie, mais comme le dit Shirow, rien n’est simple. Et à l’instar de l’amour et de la haine, de l’utopie à la dystopie, il n’y a guère qu’un pas.
Dans Appleseed, il n’y a pas non plus de séparation nette entre humains et bioroïdes, puisque les personnages de Shirow ne sont pas étrangers à la technologie cybernétique ; le monde est rempli de cyborgs, avec en tête le compagnon de l’héroïne Deunan, Briareos. Presque entièrement cybernétisé au point de ne plus laisser paraître le moindre morceau de chair, celui-ci paraît pourtant extrêmement humain, Shirow parvenant à faire transpirer dans ses attitudes et sa gestuelle un comportement qui trahit sa « vraie nature ». De même, sa relation avec Deunan ne semble pas totalement platonique : on les voit régulièrement « s’embrasser » ou se coller l’un à l’autre comme n’importe quel couple. Après tout, comme le dit Deunan : « Une personne est une personne ! »
L’opacité d’Appleseed ne l’empêcha pas de connaître un important succès critique (il reçut le prix Seiun du meilleur manga en 1986) et commercial, qui transforma – à l’instar plus tard de Ghost in the Shell – le manga de Shirow en une franchise respectée et surtout très fertile, plus de trente ans après sa naissance. Avant d’aborder un peu plus loin les nombreuses adaptations animées d’Appleseed, attardons-nous un instant sur le cinquième volume avorté et les ouvrages supplémentaires détaillant son background, qui ouvraient une fenêtre supplémentaire sur la créativité de Shirow et son approche de la science-fiction. En 1990, juste un an après la publication du quatrième volume d’Appleseed, et tandis que celle de Ghost in the Shell se terminait dans les pages de Young Magazine Kaizokuban, sortait Appleseed Databook, un premier supplément présentant pêle-mêle une chronologie complète de son univers, des détails sur les personnages, d’interminables exposés sur l’arsenal high-tech, des monologues sur l’état du monde en 1989, et enfin un vingt-sixième chapitre inédit. Le livre se concluait par des excuses de la part de Shirow, promettant que l’aspect science-fiction d’Appleseed, un peu en veille dans les volumes 3 et 4, serait bien de retour pour le cinquième. Celui-ci ne verrait finalement jamais le jour dans son entièreté.
La carrière de Shirow est celle d’un être imprévisible, faisant les choses à sa manière, insensible aux injonctions d’une industrie en plein boom dont les éditeurs étaient devenus, à l’orée des années 1990, les impitoyables bourreaux du marché du manga papier. L’artiste n’en avait toutefois pas fini avec Appleseed, puisque parut en 1996 Appleseed Hypernotes, comprenant la version « bêta » inachevée du cinquième volume promis, une somme de croquis annotés et commentés par le mangaka, deux ou trois histoires courtes, et un monologue totalement surréaliste sur la possibilité d’une vie extraterrestre et l’intérêt qu’auraient ceux-ci à harceler nos vaches : « Qu’est-ce qui les intéresse chez les vaches ? […] Pensent-ils y voir le potentiel d’une arme biologique qui attaquerait et dévorerait un ennemi naturel “végétal” sur une certaine planète, ailleurs ? » Rappelons que nous sommes toujours dans un livre traitant d’Appleseed, une œuvre qui ne contient ni extraterrestre… ni vache. Enfin, Appleseed ID16, qui paraîtrait bien plus tard, en 2001, reprendrait la majorité du contenu du Databook en remplaçant les passages les plus verbeux par des illustrations en couleur, sans réelle nouveauté, donc. Et compte tenu de l’évolution de la carrière de Shirow et de son éloignement progressif du monde du manga après Ghost in the Shell et Orion, il paraît bien improbable de voir la franchise faire son retour en format papier (du moins de la part de Shirow lui-même).
Dominion, la bouffée d’air pollué
Petit retour en arrière. Comme nous l’indiquions plus haut, Masamune Shirow trouva du temps entre deux planches d’Appleseed et de digressions bovines pour s’atteler à la réalisation d’une autre série, moins ambitieuse mais qui connaîtrait malgré tout un joli succès d’estime, à savoir Dominion. Entamée très peu de temps après Appleseed, cette œuvre bien plus légère dans le ton trouva les grâces de la Hakusensha, un éditeur appartenant à la Shûeisha basé à Tokyo (aujourd’hui indépendant). Quelques pages furent publiées pour la première fois dans un supplément consacré à la science-fiction du mensuel ComiComi, avant d’intégrer le magazine lui-même pour trois chapitres. Enfin, l’intégralité de Dominion, en six chapitres, parut dans un unique tankôbon en octobre 1986.
Dans ce court manga désopilant, Shirow laissait parler sa fibre écologique de manière bien plus explicite et alarmiste que dans Black Magic ou même Appleseed. Dominion met en scène les opérations chaotiques de la Tank Police de la ville de New Port City (un nom que connaissent bien les fans de Ghost in the Shell), dans un futur où l’air de la Terre est devenu trop toxique pour être respiré sans équipement adéquat. Lorsqu’est découvert un être artificiel créé dans le plus grand secret et capable de purifier l’air alentour – une « fée » nommée Greenpeace Crolis –, une bande de voleurs la kidnappe, obligeant l’héroïne Leona et son tank Bonaparte à se lancer à leur poursuite. Dominion ne présentait pas la richesse du background d’Appleseed, mais ses thématiques n’en étaient pas si éloignées : évolution de l’humanité, progrès scientifique, androïdes et environnement… On retrouvait aussi la dichotomie mettant une héroïne jeune et plutôt sexy au milieu d’une débauche d’artillerie lourde, à ce moment-là devenue un véritable cliché de l’animation japonaise. Le mangaka s’était également inspiré du design révolutionnaire pensé par Naoyuki Katô de la « powered suit » décrite dans le Starship Troopers de Robert A. Heinlein, un dessin qui avait même orné la réédition du roman en 1977 sur le territoire japonais. Pilier de l’esthétique des nouveaux mecha, ce design novateur et sombre avait lui-même influencé les futures créations du studio Nue, dont Katô avait été l’un des fondateurs, parmi lesquelles les anime que Shirow appréciait, comme Macross ou Gundam17 ! Et si son trait était certes un peu plus brouillon que sur Appleseed, qui lui demandait manifestement l’essentiel de son énergie, Shirow pouvait se targuer de proposer avec Dominion une machinerie au rendu tout aussi grisant, d’autant que pour une fois, le mangaka se montrait un peu moins « bavard » en termes de digressions techniques. Moins de verbiages stériles, plus de poursuites loufoques avec des love dolls à l’apparence de chat !
À travers Dominion, Shirow tissait un lien évident entre la surconsommation de son temps et la dégradation de l’environnement : « J’étais convaincu qu’à moins que nous ne fassions quelque chose immédiatement, l’humanité courait à sa perte18. » Le principal antagoniste, Buaku, refuse à la fois de changer son mode de vie et l’idée qu’on touche à son organisme pour filtrer l’air : « Je veux respirer de l’air pur ! Je veux conduire ma propre voiture ! J’arrive pas à arrêter de fumer ! Je veux utiliser des produits industriels, chimiques, des additifs artificiels ! » Et quand Leona tente de lui suggérer que tout cela pèse dans la balance environnementale, il renchérit : « La ferme !! Et je veux pas qu’on me retouche ! » Shirow soulignait là à la fois l’inconscience et le faste de son temps, mais aussi l’égoïsme une fois le diagnostic établi, ce qui trouve un écho bien contemporain. Lorsqu’un scientifique de la police se laisse aller à une tirade écolo des plus inspirées, on peut imaginer Shirow parler à travers lui : « L’entièreté du vaisseau Terre, organique et inorganique, est un seul organisme vivant ! […] Nous vivons désormais au sein d’un nuage permanent fait de micro-organismes toxiques. C’est le prix à payer pour avoir touché cet immense et délicat écosystème. » Sur le t-shirt du scientifique est écrit « Jim E. Lovelock, Gaïa », référence à James Lovelock et sa théorie de Gaïa, avançant que la Terre serait effectivement un organisme qui s’autorégule. Nul doute que l’on trouverait cet ouvrage en fouillant la bibliothèque de Shirow.
Dominion connaîtra une suite, Conflict One





























