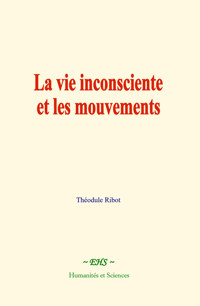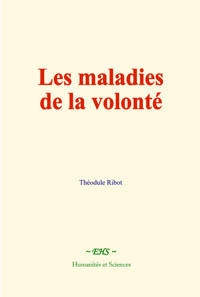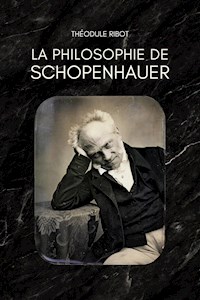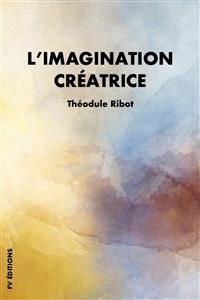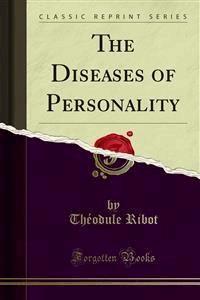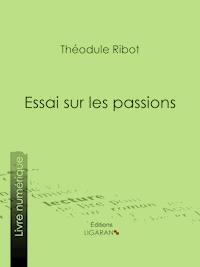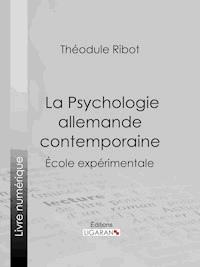
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Il y a une trentaine d'années au plus, si quelqu'un avait osé soutenir, dans ce pays, que la psychologie était encore à l'état d'enfance et peu disposée à en sortir, on l'eût accusé de paradoxe. On aurait conseillé au critique de relire les écrits consacrés, depuis Locke, aux diverses manifestations de l'esprit humain, et la réponse eût été jugée suffisante. Aujourd'hui, elle ne le serait plus pour tout le monde."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Il y a une trentaine d’années au plus, si quelqu’un avait osé soutenir, dans ce pays, que la psychologie était encore à l’état d’enfance et peu disposée à en sortir, on l’eût accusé de paradoxe. On aurait conseillé au critique de relire les écrits consacrés, depuis Locke, aux diverses manifestations de l’esprit humain, et la réponse eût été jugée suffisante.
Aujourd’hui, elle ne le serait plus pour tout le monde. Le point de vue a changé, et beaucoup sont disposés à penser différemment. Tout en reconnaissant – ce qui est juste – que les anciens psychologues ont rendu des services, établi définitivement quelques points, montré dans l’analyse une pénétration et une délicatesse difficiles à surpasser ; on se refuse à voir en tout cela mieux que des essais. L’esprit nouveau des sciences naturelles a envahi la psychologie et a rendu plus difficile. On s’est demandé si un assemblage de remarques ingénieuses, de fines analyses, d’observations de sens commun déguisées sous une exposition élégante, d’hypothèses métaphysiques, érigées en vérités précieuses qui ont le droit de s’imposer, constitue un corps de doctrines, une vraie science ; s’il n’y avait pas lieu de recourir à une méthode plus rigoureuse. Ainsi s’est établie cette séparation, qui devient chaque jour plus nette, entre l’ancienne et la nouvelle psychologie.
Bien qu’elle fasse encore assez bonne figure, l’ancienne psychologie est condamnée. Dans le milieu nouveau qui s’est fait autour d’elle, ses conditions d’existence ont disparu. Aux difficultés croissantes de la tâche, aux exigences toujours plus grandes de l’esprit scientifique, ses procédés ne suffisent plus. Elle en est réduite à vivre sur son passé. Vainement ses représentants les plus sages essaient des compromis et répètent bien haut qu’il faut étudier les faits, faire une large part à l’expérience. Leurs concessions ne sauvent rien. Si sincères qu’elles soient d’intention ; en fait, elles ne sont pas exécutées. Dès qu’ils mettent la main à l’œuvre, le goût de la spéculation pure les reprend. D’ailleurs, nulle réforme n’est efficace contre ce qui est radicalement faux et l’ancienne psychologie est une conception bâtarde qui doit périr par les contradictions qu’elle renferme. Les efforts qu’on fait pour l’accommoder aux exigences de l’esprit moderne, pour donner le change sur sa vraie nature, ne peuvent faire illusion. Ses caractères essentiels restent toujours les mêmes : on peut le montrer en quelques mots. D’abord elle est imbue de l’esprit métaphysique : elle est « la science de l’âme » ; l’observation intérieure, l’analyse et le raisonnement sont ses procédés favoris d’investigation ; elle se défie des sciences biologiques, ne puise chez elles qu’à regret, par nécessité et toute honteuse de ses emprunts. D’humeur peu envahissante, comme tout ce qui est faible et vieilli, elle ne demande qu’à se restreindre, à rester en paix chez elle.
Une conception pareille n’a plus de vitalité. Ses attaches métaphysiques excluent l’esprit positif, empêchent l’emploi d’une méthode scientifique, lui ôtent le bénéfice de la libre recherche. Elle n’ose pas être elle-même, c’est-à-dire une étude des seuls phénomènes psychiques, distincte et indépendante. Cependant, cette nécessité s’impose. À mesure que s’effaceront des habitudes d’esprit invétérées, on verra de mieux en mieux que la psychologie et la métaphysique, confondues autrefois sous une même dénomination, supposent chacune des aptitudes intellectuelles si opposées qu’elles s’excluent ; on comprendra que le talent métaphysique est en raison inverse du talent psychologique ; que désormais – à part quelques rares génies qui se rencontreront peut-être – le psychologue doit renoncer à la métaphysique et le métaphysicien à la psychologie.
Pour l’ancienne école, le goût de l’observation intérieure et l’esprit de finesse étant les signes exclusifs de la vocation du psychologue, tout le programme se résume en deux mots : s’observer et raisonner. – L’observation intérieure est sans doute un premier pas ; elle reste toujours un procédé nécessaire de vérification et d’interprétation ; mais elle ne peut pas être une méthode. Pour le soutenir, il faut totalement oublier ou méconnaître les conditions d’une méthode scientifique. Croire qu’avec elle on constituera la psychologie, c’est supposer que, pour faire de la physiologie, il suffit de bons yeux et de beaucoup d’attention.
L’esprit de finesse est aussi un instrument trop fragile pour pénétrer dans la trame serrée, compacte, des faits de conscience. Durant ces deux derniers siècles, il a donné sa mesure : on lui doit de bonnes descriptions, d’excellentes analyses ; mais son champ est moissonné. Il ne peut plus trouver que des détails, des nuances, des raffinements, des subtilités. Même à ce degré, où il touche à la profondeur, il ne fera que descendre plus avant dans des nuances plus délicates ou plus cachées. Il ne saisit pas le général : il n’explique pas. Dans ces conditions, le psychologue devient un romancier ou un poète d’une espèce particulière, qui cherche l’abstrait au lieu du concret, qui dissèque au lieu de créer : et la psychologie devient une forme de critique littéraire très approfondie, très bien raisonnée ; rien de plus. L’étude des phénomènes psychiques dans leur totalité, de la forme animale la plus basse à la forme humaine la plus haute, lui est interdite. Elle est incapable de rattacher ces manifestations aux lois de la vie : elle n’a ni ampleur ni solidité.
Ce qui frappe, en effet, dans l’ancienne psychologie, c’est son extrême simplicité : elle est simple dans son objet, simple dans ses moyens. Elle présente un caractère étriqué et, pour trancher le mot, enfantin. Elle manque d’air et d’horizon. Les questions sont posées sous une forme sèche et exiguë, traitées par une méthode verbale qui rappelle la scolastique. Tout se passe en déductions, en argumentations, en objections et en réponses. Dans ce raffinement toujours croissant de subtilités, on finit par ne plus agir que sur des signes : toute réalité a disparu. Dans cet esprit solitaire qui se creuse et se tourmente obstinément pour tirer tout de lui-même, qui s’étudie les yeux fermés, ne prenant du dehors que ce qu’il faut pour ne pas mourir d’inanition, il se forme une atmosphère raréfiée, traversée de visions à peine saisissables, mais où rien de vivant ne peut subsister.
Prenant toutes les questions l’une après l’autre, on pourrait montrer comment les préoccupations métaphysiques, l’abus de la méthode subjective et du raisonnement à outrance, paralysent les meilleurs esprits. L’état de conscience isolé de ce qui le précède, raccompagne et le suit, de ses conditions anatomiques, physiologiques et autres, n’est plus qu’une abstraction ; et quand on l’a classé sous un titre, rapporté à une faculté hypothétique qu’on attribue elle-même à une substance hypothétique, qu’a-t-on découvert, qu’a-t-on appris ? Si, au contraire, l’état de conscience est étudié comme faisant partie d’un groupe naturel dont les éléments se supposent réciproquement, dont chacun doit être étudié à part et dans son rapport avec les autres, on reste dans la réalité ; on ne se satisfait pas avec la formule chère aux anciens psychologues : « Ceci est de la physiologie ; » on prend son bien où on le trouve ; on reçoit de toutes mains ; on se renseigne de tous côtés, et l’on ne prend pas pour une science la nomenclature des fantômes qu’on a créés.
Trop de raisonnements : telle est l’impression que laisse l’ancienne psychologie aux partisans de la nouvelle. Le raisonnement, c’est la confiance de l’esprit en lui-même et la foi à la simplicité des choses. La nouvelle psychologie soutient que l’esprit doit se défier de lui-même et croire à la complexité des choses. Même dans l’ordre bien moins complexe des sciences biologiques, nos inductions et nos déductions reçoivent à chaque pas des démentis. Ce qui doit être n’est pas ; ce qui est inféré n’est pas vérifié ; où la logique dit oui, l’expérience dit non.
Les représentants de l’ancienne psychologie – et ils sont encore nombreux, quoiqu’à des degrés divers – voient-ils bien la situation qu’ils ont prise au milieu des sciences contemporaines ? Le physicien et le chimiste ne se croient forts que dans leur laboratoire ; le biologiste garnit chaque jour son arsenal de nouveaux engins, s’arme de toutes pièces, multiplie ses moyens de mesure et ses instruments, tend à substituer l’enregistrement passif et mécanique des phénomènes à leur appréciation subjective, toujours faillible et vacillante. En face, le psychologue, aux prises avec des faits d’une complexité extrême, ne pouvant recommencer l’œuvre de ses devanciers ni refaire ce qui a été bien fait, est réduit à « s’interroger lui-même », sans informations, sans expériences, sans outillage, sans moyens d’action. Si son œuvre est une science, il faut avouer qu’elle ne ressemble à rien qui porte ce nom.
La nouvelle psychologie diffère de l’ancienne par son esprit : il n’est pas métaphysique ; par son but : elle n’étudie que les phénomènes ; par ses procédés : elle les emprunte autant que possible aux sciences biologiques.
Nous avons essayé ailleurs de montrer les avantages d’une psychologie sans métaphysique, ou, comme on a dit depuis, « d’une psychologie sans âme. » Laissons de côté cet aspect négatif de notre sujet, pour le considérer aujourd’hui sous son aspect positif.
L’un des plus grands obstacles aux progrès de la psychologie, depuis longtemps signalé, c’est la nature même des faits de conscience, si vagues, si fuyants, si difficiles à fixer. Tandis que les phénomènes objectifs se distinguent les uns des autres par leurs qualités spécifiques, leurs rapports dans le temps et surtout leur forme, leur figure, leur position et toutes leurs déterminations quant à l’espace ; les états psychiques, pris en eux-mêmes et connus par la conscience seule, en sont réduits à des différences de qualité et de rapport dans le temps. Aussi la psychologie nouvelle a-t-elle dû tout d’abord s’efforcer d’augmenter leur détermination ou, ce qui revient au même, la somme de leurs rapports. C’est ici que les découvertes de la physiologie lui ont été d’un grand secours. Celle-ci, après avoir établi que les actions psychiques, d’une manière générale, sont liées au système cérébro-spinal, a montré plus récemment par des observations et des expériences répétées que tout état psychique est invariablement associé à un état nerveux dont l’acte réflexe est le type le plus simple. Ce principe est incontestable pour la plupart des cas, vraisemblable au plus haut degré pour les autres.
Il nous serait impossible de faire voir ici dans le détail que tout état de conscience est lié à un concomitant physique bien déterminé. Quelques indications suffisent. En ce qui concerne les cinq sens et les sensations viscérales, nul n’en doute. Quant aux images, ce n’est pas l’induction seule qui autorise à dire que la reproduction idéale suppose des conditions physiques, analogues à celles que la sensation réclame. Des faits pathologiques, et en particulier les hallucinations, prouvent que l’idéation est liée à un état déterminé des centres nerveux. – Si, d’un, autre côté, nous considérons les désirs, les sentiments, les volitions, nous les voyons liés, chacun suivant son espèce, à un concomitant physique : état de l’organisme, mouvements, gestes, cris, sécrétions, changements vasculaires, etc. – Il reste cependant, pour embrasser la vie psychique dans sa totalité, certains états de conscience sur lesquels on pourrait élever des doutes. La réflexion, les raisonnements abstraits, les sentiments de l’ordre le plus élevé, ne semblent-ils pas, comme disait l’ancienne psychologie, être la manifestation d’un pur esprit ? – Cette thèse est insoutenable. La vie psychique forme une série continue qui commence par la sensation et finit par le mouvement. Lorsqu’à un bout nous trouvons les sensations et les images liées à des états physiques ; à l’autre bout les désirs, sentiments et voûtions liés à des états physiques ; peut-on supposer au milieu l’existence d’une terra incognito, soumise à d’autres conditions, régie par d’autres lois ? « Il serait en contradiction avec tout ce que nous savons sur l’acte cérébral de supposer que la chaîne physique aboutit brusquement à un vide physique occupé par une substance immatérielle qui communiquerait les résultats de son travail à l’autre bout de la chaîne physique… En fait, il n’y a pas d’interruption dans la continuité nerveuse. » (Bain.) – Mais, si plausible que soit cette conclusion, la psychologie peut faire mieux que de recourir à un raisonnement par analogie, fondé sur la continuité des lois naturelles. D’abord, la réflexion la plus intime et la plus abstruse n’est pas possible sans signes qui supposent une détermination physique, si faible qu’elle soit. De plus, la physiologie générale nous enseigne que, si quelque chose apparaît, quelque chose se détruit ; que la période de fonctionnement est une période de désorganisation, et que cette loi biologique est applicable au cerveau comme à tout autre organe, au travail cérébral comme à toute autre fonction. Rappelons encore la production de chaleur qui accompagne l’activité psychique (Schiff), les modifications produites dans les excrétions par le travail intellectuel (Byasson) ; et, sans accumuler des détails qui rempliraient un volume, nous pourrons conclure : que tout état psychique déterminé est lié à un ou plusieurs évènements physiques déterminés que nous connaissons bien dans beaucoup de cas, peu ou mal dans les autres.
Ce principe admis, – et il est la base de la psychologie physiologique, – les questions se présentent sous un aspect tout nouveau et réclament l’emploi d’une nouvelle méthode. À la formule vague et banale des « rapports de l’âme et du corps », comme parle l’ancienne école, à l’hypothèse arbitraire et stérile de deux substances agissant l’une sur l’autre ; on substitue l’étude de deux phénomènes qui sont en connexion si constante pour chaque espèce particulière, qu’il serait plus exact de les appeler un phénomène à double face.
Par suite, le domaine de la psychologie se spécifie : elle a pour objet les phénomènes nerveux accompagnés de conscience, dont elle trouve dans l’homme le type le plus facile à connaître, mais qu’elle doit poursuivre dans toute la série animale, malgré les difficultés de la recherche. Du même coup s’établit la distinction entre la psychologie et la physiologie : le processus nerveux à simple face est au physiologiste ; le processus nerveux à double face est au psychologue. L’indécision ne peut exister que pour les cas où la conscience disparaît peu à peu pour devenir automatisme (habitude), et pour les cas où l’automatisme devient conscient. – L’âme et ses facultés, la grande entité et les petites entités disparaissent, et nous n’avons plus à faire qu’à des évènements internes qui, comme les sensations et les images, traduisent les évènements physiques, ou qui se traduisent en évènements physiques, comme les idées, les mouvements, les voûtions et les désirs. Un grand résultat est ainsi obtenu : l’état de conscience cesse d’être une abstraction flottant dans le vide. Il se fixe. Rivé à son concomitant physique, il rentre avec lui et par lui dans les conditions du déterminisme, sans lequel il n’y a pas de science. La psychologie est rattachée aux lois de la vie et à son mécanisme.
Ce n’est pas là, comme on le répète sans raison, absorber la psychologie dans la physiologie. Par une nécessité logique, la science supérieure s’appuie sur la science inférieure. La physiologie contemporaine ne descend-elle pas à chaque instant dans la chimie et la physique pour leur faire des emprunts ? Dira-t-on pour cela qu’elle se laisse absorber à leur profit ? Entre la science des phénomènes de conscience et la physiologie, il existe le même rapport qu’entre celle-ci et les sciences physico-chimiques. Si l’on objecte que le passage de la vie à la conscience est inexpliqué, on doit remarquer que le passage de l’inorganique au vivant ne l’est pas moins. La difficulté est donc la même dans les deux cas, et l’on ne s’explique pas comment une méthode, légitime dans un cas, serait illégitime dans l’autre.
Une vérité incontestable pour l’ancienne psychologie, résultant de sa nature même, c’est qu’elle devait rester une science de pure observation. La psychologie nouvelle au contraire a recours, en une certaine mesure, à l’expérimentation. Dès que les problèmes psychologiques sont posés sous la forme que nous avons indiquée plus haut ; dès que le phénomène interne, au lieu d’être pris pour la manifestation d’une substance inconnue, est considéré dans sa liaison naturelle avec un phénomène physique, il devient possible d’agir sur lui par le moyen de ce concomitant physique ; car celui-ci est, dans beaucoup de cas, sous la main de l’expérimentateur, qui peut mesurer son intensité, ses variations, le placer dans des circonstances déterminées, le soumettre à tous les procédés qui constituent une investigation rigoureuse. La psychologie devient ainsi, au sens strict du mot, expérimentale. À la vérité, ces expériences sont d’une nature psychophysique ; mais, l’externe et l’interne étant étroitement liés, elles sont, quant au but et au résultat final, psychologiques. Nous n’essayerons pas de les faire connaître pour le moment. Le but de ce livre est de les exposer longuement. Quelques phrases vagues et générales n’apprendraient rien. Qu’il suffise de savoir que cette méthode a été employée, qu’elle a porté ses fruits, et que, si difficile que soit la tâche, la voie est ouverte.
Pour exposer clairement en quelques mots la différence des deux procédés, nous pouvons recourir à la théorie des méthodes expérimentales, due à Stuart Mill, qui est devenue maintenant classique.
L’ancienne psychologie n’emploie comme procédé d’investigation que la méthode de concordance et la méthode des différences. Par leur moyen, elle atteint son but principal, qui est une classification naturelle des « manifestations de l’âme » groupées sous les titres de diverses facultés.
La psychologie nouvelle emploie aussi ces deux méthodes, mais en y ajoutant une troisième : celle des variations concomitantes. La physique ne peut pas, pour étudier la chaleur, la chasser d’un corps et l’y ramener. Elle procède par voie indirecte. Elle l’augmente, la diminue, la fait varier et étudie ces variations dans leurs effets visibles et tangibles. Il est de même impossible de supprimer et de rétablir une forme de l’activité mentale pour en étudier la nature et les effets ; mais il est possible de la faire varier par l’intermédiaire de son concomitant physique. Nous avons prise sur elle par lui. On étudie ainsi non le phénomène de conscience, mais ses variations. Pour être plus exact, on étudie indirectement les variations psychiques à l’aide des variations physiques qu’on étudie directement. Il n’importe que ce procédé soit compliqué, s’il est rigoureux. La connaissance des faits naturels ne s’obtient pas aisément, et c’est un tort de l’ancienne psychologie d’avoir confondu la connaissance naturelle des faits de conscience, qui est directe, avec leur connaissance scientifique qui est indirecte. De là cette simplicité de méthode que nous avons signalée chez elle ; de là son impuissance à dépasser de beaucoup le niveau du sens commun.
Il ne faudrait pas croire cependant que l’expérience, avec les procédés qui la constituent, – mesure, déterminations numériques, etc., – ait été appliquée à toutes les questions de la psychologie, ni même au plus grand nombre. Il n’y a eu jusqu’ici que des essais, des recherches fragmentaires ; mais ces essais marquent l’entrée de la psychologie dans une phase nouvelle, le passage de la période descriptive à la période explicative. Il ne lui suffit plus d’être une histoire naturelle ; elle s’efforce d’être une science naturelle. C’est ce qui explique comment, malgré la communauté de but, la psychologie anglaise et la psychologie allemande ont chacune une physionomie si distincte ; comment l’une est systématique, l’autre technique ; l’une riche en travaux d’ensemble, l’autre riche en travaux de détail. Pour bien mettre en lumière cette différence, le mieux est d’indiquer la place qu’occupe chacune d’elles dans l’évolution des études psychologiques.
Antérieurement à toute science, l’esprit humain, comme le fait remarquer Wundt, ne peut rassembler des expériences sans y mêler quelques spéculations. Le premier résultat de cette réflexion naturelle est un système d’idées générales qui se traduisent dans le langage. Lorsqu’elle commence son œuvre, la science trouve ces idées toutes faites. Ainsi, dans le domaine de l’expérience externe, la chaleur et la lumière sont des concepts immédiatement dérivés de la sensation. La physique actuelle ramène ces deux idées à un concept plus général : le mouvement. Mais elle n’a pu atteindre ce résultat qu’en acceptant tout d’abord, à titre provisoire, les inductions du sens commun. Il en est de même dans le domaine de l’expérience interne. Âme, esprit, raison, entendement, sont des idées qui préexistaient à toute étude scientifique et qui seules l’ont rendue possible. Le tort de l’ancienne psychologie a été de prendre ces créations de la conscience naturelle pour des vérités définitives. L’âme, par exemple, au lieu d’être considérée simplement comme le sujet logique, auquel nous attribuons à titre de prédicats tous les faits d’expérience intérieure, est devenue un être réel, une substance, manifestée par des « facultés ».
L’étude des phénomènes de conscience en eux-mêmes, indépendamment des idées générales dont le langage est encombré, marque les premiers essais de la psychologie nouvelle, et ils remontent à près de deux siècles. À travers beaucoup d’indécisions et de tâtonnements, Locke et ceux qui ont suivi sa tradition vont au but et se défient des idées toutes faites, comme de préjugés séculaires. Mais la psychologie restant encore attachée à la métaphysique, aucun progrès sérieux n’était possible. La rupture n’a eu lieu que de nos jours.
Toutefois les premiers représentants de la psychologie nouvelle faisaient la part beaucoup trop large à l’analyse verbale et au raisonnement. Ils n’entraient pas assez dans les faits eux-mêmes. En Angleterre, James Mill nous en offre le meilleur exemple. Même Stuart Mill, si éminent logicien, si profondément imbu des méthodes modernes, tout en reconnaissant l’utilité des études physiologiques, leur concède trop peu.
C’est avec des contemporains qu’il est superflu de nommer que la psychologie naturaliste arrive à la pleine conscience d’elle-même. On peut regarder Bain comme leur représentant principal, parce que sa méthode, entièrement descriptive, libre de toute hypothèse, évolutionniste ou autre, reste dans l’ordre des faits positifs et exclut tout ce qui peut donner prise à la critique. Les questions sont posées sous une forme naturelle, concrète. L’évènement interne n’est jamais séparé de ses conditions ou de ses effets physiques. La physiologie sert de guide. Les renseignements pathologiques sont mis à profit. Chaque groupe de phénomènes est minutieusement étudié, et les lois induites – loi d’association et lois secondaires – ne sont données que comme l’expression de rapports constants et généraux.
Tels sont les traits essentiels de la psychologie anglaise contemporaine. Elle est, au sens le plus large et le meilleur, une étude descriptive. En Allemagne, au contraire, ceux qui travaillent à la constitution d’une psychologie empirique, accordent peu de place aux descriptions. Pour caractériser leur œuvre, il faut employer un terme dont on a beaucoup abusé de nos jours, mais qui est ici à sa place : c’est une psychologie physiologique. Presque tous sont des physiologistes, qui, avec leurs habitudes d’esprit et les procédés propres à leur science, ont abordé quelques points de la psychologie.
Nous avons vu plus haut que la vie psychique consiste en une série d’états de conscience liés à des états physiques, qui commencent par la sensation pour finir par des actes. Nous avons vu aussi que, dans cette série ininterrompue d’états psychophysiques, ceux qui occupent le milieu de la chaîne forment un groupe plus difficilement accessible à l’investigation physique. D’ordinaire, les psychologues allemands ont négligé ce dernier groupe ou ne l’ont étudié que sommairement. Dans le champ restreint qu’ils se sont ainsi assigné, la psychologie a fait par eux un nouveau pas. Ils ont pratiqué des expériences. Ils ont placé le phénomène psychique dans des conditions déterminées, et ils en ont étudié les variations.
Toute méthode expérimentale reposant en définitive sur le principe de causalité, la psychologie physiologique n’a que deux moyens à sa disposition : déterminer les effets par leurs causes (par exemple la sensation par l’excitation) ; déterminer les causes par les effets (les états internes par les actes qui les traduisent). Il faut de plus qu’au moins l’un des deux termes de ce couple indissoluble qu’on appelle une liaison causale soit placé hors de nous, hors de la conscience ; soit un évènement physique, et comme tel accessible à l’expérimentation. Sans cette condition, l’emploi de la méthode expérimentale est impossible. Dans l’ordre des phénomènes qu’on appelle purement internes (la reproduction des idées, leurs associations, etc.), la cause et l’effet restent en nous-mêmes. Quoiqu’on ne puisse douter que la loi de causalité règne là comme ailleurs ; quoique, dans quelques cas, la cause puisse être déterminée avec certitude ; comme les causes et les effets sont en nous ; comme ils ne donnent aucune prise extérieure, leurs concomitants physiques étant mal connus ou inaccessibles ; toute recherche expérimentale en ce qui les concerne est nécessairement éliminée.
À la vérité, quelques représentants de la psychologie allemande ont pensé que, là même où l’expérimentation fait défaut, on n’en est pas réduit à observer et à décrire ; qu’on peut espérer des déterminations plus précises. Pour cela, ils ont eu recours au calcul. Ils ont traité les questions par la méthode mathématique. S’appuyant sur ce principe que tout évènement interne est une grandeur, et que par conséquent il renferme en lui un caractère mathématique, ils ont essayé de procéder en psychologie comme dans certaines branches de la physique mathématique. On part de principes posés à titre d’hypothèses probables : on en déduit des conséquences à l’aide du raisonnement et du calcul, et l’on compare les résultats avec les données de l’expérience. Pour que cette méthode soit acceptable, deux conditions suffisent : il faut que les principes hypothétiques soient préparés par l’induction et présentent un incontestable caractère de vraisemblance ; il faut ensuite que les déductions qui en sont tirées soient constamment soumises au contrôle de la réalité. – Nous trouverons dans le cours de cet ouvrage quelques essais de cette sorte. Si neufs, si ingénieux qu’ils soient, ils ne constituent certainement pas la partie solide de la psychologie allemande.
Par ce qui précède, on peut en saisir les traits essentiels et la juger par opposition à la psychologie anglaise. Elle présente, comme caractère général, un effort plus grand vers la précision ; comme caractères particuliers, l’emploi de l’expérimentation ; les déterminations quantitatives (l’expérience supposant les nombres et la mesure) ; un champ d’études plus limité ; une préférence pour les monographies au lieu des travaux d’ensemble. Beaucoup de ces recherches, nous le verrons, portent sur des questions très modestes, et il est probable que les partisans de l’ancienne psychologie trouveront que c’est beaucoup de travail pour un maigre résultat. Mais ceux qui sont pliés aux méthodes des sciences positives ne feront pas de même. Ceux-là savent combien d’efforts réclament les plus minces questions ; comment la solution des petites questions mène aux grandes, et combien il est stérile de discuter les grands problèmes avant d’avoir étudié les petits.
Si nous avons réussi à faire voir quelle place les travaux allemands occupent dans révolution générale de la psychologie moderne, il est presque superflu d’ajouter que, loin d’exclure les résultats dus à la méthode purement descriptive, ils les supposent. Les deux écoles, descriptive et expérimentale, ont le même but ; la dernière marque seulement une tendance croissante vers l’exactitude. Mais elle est si loin d’être une psychologie complète, armée de toutes pièces, qu’elle ne nous offre pour le moment que des essais. L’avenir seul pourra en fixer la valeur vraie et dire si la rigueur scientifique à laquelle elle aspire peut être atteinte partout. Grâce à l’emploi de l’expérimentation et de la mesure, elle présente une physionomie originale ; nous avons dû la mettre en relief. Cependant il y aurait erreur à s’exagérer les oppositions et les différences. Elle n’est qu’une branche de la psychologie empirique, naturaliste, qui, dans l’état actuel, reste pour la plus large part une étude descriptive.
Son grand mérite, c’est d’avoir déterminé, mieux que par des définitions toujours vagues, ce que doit être une psychologie physiologique. Par suite d’une confusion qui s’est produite dans beaucoup d’esprits, ce terme est souvent considéré comme strictement applicable à la psychologie nouvelle. Cela n’est pas vrai actuellement. Quand la physiologie, réalisant un progrès qu’elle n’ose encore rêver, sera capable de déterminer les conditions de tout acte mental, quel qu’il soit, aussi bien de la pensée pure que des perceptions et des mouvements ; alors la psychologie entière sera physiologique, ce qui sera pour elle un grand bien. Pour le présent, il y a tout un groupe de faits de conscience dont l’étude ne trouve dans les sciences de la vie qu’un soutien indirect et instable. Les procédés de l’ancienne psychologie – l’observation intérieure, l’analyse – sont ici à leur place ; mais la nouvelle école ne les emploie qu’en s’appuyant sur la psychologie physiologique et pour ne rechercher que deux choses : des faits et des rapports.
Le domaine et la place de la psychologie physiologique se trouvent ainsi délimités assez nettement.
Son domaine, qui doit insensiblement s’agrandir avec les progrès de la physiologie nerveuse, comprend : les actes réflexes et les instincts ; l’étude détaillée des sensations, avec les questions relatives au temps et à l’espace dans les limites de l’expérience ; les mouvements ; les modes d’expression et le langage ; les conditions de la volonté et de l’attention ; les formes de sentiments les moins complexes.
Sa place est au commencement de la psychologie. Elle étudie ce que les anciens appelaient les facultés inférieures de l’âme ; mais c’est en elle, seule que l’étude des manifestations plus hautes trouve un point d’appui. Elle constitue la partie la plus facilement accessible, la plus simple de la science mentale.
Cette simplicité est d’ailleurs toute relative. Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à feuilleter les ouvrages consacrés à l’ensemble ou à quelques parties de la psychologie physiologique. En face de cette masse toujours croissante d’observations, d’expériences, de mesures, de déterminations numériques, de faits empruntés aux sciences physiques, à la physiologie, à la pathologie, à l’ethnologie, de discussions minutieuses, d’hypothèses ou d’explications variant sans cesse au gré des découvertes nouvelles et qui dénotent une curiosité toujours en éveil sur tous les points, toujours inquiète d’oublier ou de négliger quelque, chose, on se sent dans un nouveau monde, et l’on ne s’étonne pas que les partisans de l’ancienne école refusent d’admettre une psychologie qui ressemble si peu à la leur. Ajoutez la fatigue des détails techniques, un mode d’exposition sec d’où tout agrément littéraire et tout effet oratoire sont exclus, et l’on comprendra que même de bons esprits se prennent à regretter cette psychologie d’autrefois, si simple, si commode, si maniable et qui s’exprimait en si beau langage.
Et cependant, s’il est permis de préjuger de l’avenir, cette complexité est simple au prix de celle qui doit se produire un jour, quand le domaine de la psychologie purement interne sera entamé. Posons comme constituée la psychologie physiologique, dont nous n’avons encore que d’informes ébauchés : alors seulement il sera possible d’entreprendre cette nouvelle conquête et de pénétrer dans le mécanisme intime de l’esprit, à l’aide de procédés qu’aujourd’hui nous ne soupçonnons pas. Que révélera cette future science ? C’est ce qu’on ne peut dire, même par conjecture ; mais à la difficulté de l’œuvre on peut mesurer l’immensité de l’effort et prévoir que cette psychologie ressemblera aussi peu à l’ancienne, que la physique de nos jours ressemble à celle d’Aristote.
Pour nous en tenir au présent, la grandeur de la tâche est de nature à faire réfléchir les plus hardis. Si l’on jette un coup d’œil sur les sciences de la vie et que l’on considère le nombre des travailleurs et des questions agitées, la nécessité d’une poursuite infatigable des détails, qui seule donne une connaissance solide, on comprendra que la psychologie doit entrer dans une phase analogue. L’ancienne école, pour le petit nombre d’informations qu’elle demandait aux sciences positives, avait érigé en axiome « que la connaissance des résultats suffit ». C’était une règle de conduite facile, mais de peu de profit ; car ces résultats et les propositions qui les expriment ne sont que des formules sans valeur pour qui ne connaît pas les faits qu’elles résument.
Ce prétendu axiome rejeté, on voit s’approcher le temps où la psychologie demandera les forces entières d’un seul homme, où l’on sera exclusivement psychologue, comme on est exclusivement physicien, chimiste, physiologiste. Dans toute science, lorsqu’elle est florissante et cultivée avec ardeur, une division du travail se produit nécessairement. Chaque question importante devient un domaine à part. La seule étude approfondie des perceptions, par exemple, ne pourrait-elle pas suffire à l’esprit le plus actif ? La psychologie empirique, unie aux autres sciences naturelles par un lien d’étroite solidarité, élargit son champ ; le travail incessant de l’analyse accroît la masse des détails. Là où le dernier siècle avait vingt faits à connaître, nous avons vingt lois ; puis viendront des lois de lois, c’est-à-dire une condensation de faits de plus en plus nombreux. Le cerveau humain ayant ses limites, la nécessité de se consacrer à cette seule étude s’imposera nécessairement.
Actuellement, le nombre de ceux qui sont préparés à cette œuvre est bien petit. La plupart des physiologistes sont trop peu psychologues, et la plupart des psychologues connaissent trop mal la physiologie. Nous vivons à une époque de transition dont les difficultés sont propres à lasser les meilleurs courages. Il n’est aucun de ceux qui ont à cœur les progrès de la nouvelle psychologie qui ne sente à chaque instant les lacunes d’une préparation insuffisante. Il faudrait, pour entreprendre avec fruit ces recherches, connaître les mathématiques, la physique, la physiologie, la pathologie, avoir une matière à manier, des instruments sous la main, et surtout l’habitude des sciences expérimentales. Tout cela manque. En France surtout, grâce aux idées courantes dont notre éducation première nous a imbus et aux mauvaises habitudes d’esprit qu’elle nous a fait contracter, la seconde moitié de notre vie se passe à désapprendre ce que nous avons appris dans l’autre.
La psychologie, en effet, a eu le malheur d’être jusqu’ici aux mains des métaphysiciens. Il s’est formé ainsi une tradition difficile à rompre. Par suite de préjugés invétérés, on a peine à admettre que le psychologue ne doit être qu’un naturaliste d’une certaine espèce. On s’obstine à le considérer comme un « philosophe » : dénomination aussi inexacte dans ce cas que s’il s’agissait d’un biologiste ou d’un chimiste.
Tant que cette opinion surannée subsistera, le mot psychologie donnera lieu à beaucoup de contresens. C’est ainsi que l’ancienne école reproche perpétuellement à la nouvelle de ne faire connaître que le mécanisme de la vie mentale : ce qui est vrai. Mais des métaphysiciens seuls peuvent réclamer davantage. Si connaître, c’est révéler une essence insaisissable, alors la psychologie nouvelle ne nous apprend rien. Si connaître, c’est étudier les faits, déterminer leurs conditions d’existence et leurs rapports, alors elle fait ce qu’elle doit : et elle ne veut ni ne peut autre chose.
Le but de cet ouvrage, qu’il nous reste à indiquer, n’est pas de faire une histoire de la psychologie allemande contemporaine. En Allemagne comme partout, il y a une psychologie « spiritualiste », qui, sous les noms divers d’anthropologie, de science de l’homme, répond aux traités classiques qui ont cours chez nous sur ces questions. Dans ces ouvrages, il y a deux parts à faire : celle des vérités positives, – il est juste de les restituer aux savants qui les ont trouvées ; celle des interprétations, – elles ne sont pas neuves et ne varient que sur des détails insignifiants. Nous n’en parlerons pas.
Nous avons éliminé les théories purement métaphysiques, idéalistes ou réalistes. Si large qu’elles fassent la part à la psychologie, elles n’ont rien à nous apprendre. Ici, comme dans toute autre partie de la science humaine, elles ne s’attachent qu’aux principes et aux caractères généraux ; nous, ce sont les particularités que nous cherchons.
Nous avons éliminé de même les « théories de la connaissance », nombreuses en Allemagne, intéressantes, dues le plus souvent à des esprits vigoureux ou subtils qui tous portent la marque de Kant. Elles constituent un domaine à part, celui de la critique générale. Leur exposition serait une grosse tâche et demanderait un volume distinct.
Ces exclusions faites, il reste un champ bien délimité : c’est l’étude des questions accessibles à la fois à l’observation de la conscience et à l’investigation scientifique, telle qu’on la pratique dans les laboratoires ; c’est la psychologie considérée comme science naturelle, débarrassée de toute métaphysique et s’appuyant sur les sciences de la vie. Nous restons confinés dans les régions inférieures de la vie psychique ; mais notre position n’est pas si humble qu’il peut sembler, car ces phénomènes servent de base et de point d’appui à tout le reste. La psychologie physiologique, nous le verrons, pénètre par des trouées imprévues jusqu’aux questions les plus hautes de la connaissance humaine : telle expérience modeste en apprend plus qu’un volume de spéculations.
Pour bien comprendre l’esprit de la psychologie allemande contemporaine, il faut avant tout se rappeler que les recherches qui vont être exposées ne sont pas l’œuvre de philosophes, de spéculatifs. Elles sont dues à des savants. La psychologie allemande nous offre ainsi un caractère particulier, original. Tandis qu’en Angleterre une tradition ininterrompue part de Locke et, passant par Berkeley, Hume, Hartley, James Mill, rejoint les contemporains ; en Allemagne il n’y a pas de tradition ni d’école psychologiques ; tout est nouveau.
Kant eut pour successeurs des métaphysiciens auxquels ont succédé, de nos jours, des criticistes. Seul, parmi ses nombreux disciples, Herbart doit être compté comme psychologue. Il part de principes a priori, donne peu aux faits, beaucoup au raisonnement et aux mathématiques ; mais il a eu des conceptions justes et neuves, et surtout une influence. Transformée par Beneke, continuée par d’autres, sa doctrine tend à se perdre dans les spéculations un peu vagues de l’anthropologie et de l’ethnologie. Mais, en même temps, la vraie psychologie empirique se produisait obscurément, peu à peu, suivant les hasards de l’expérience, dans les ouvrages ou mémoires de physiologie.
S’il fallait lui assigner un fondateur, Jean Müller mériterait ce titre. Dans ses livres, il fait la part très large aux questions psychologiques et les traite avec ampleur. Disciple de Kant, à sa manière, il voulut donner une base physiologique à la théorie des formes subjectives de l’intuition.
À chaque espèce de nerf sensoriel il attribua une énergie spécifique, en vertu de laquelle tout organe réagit d’une façon qui lui est propre, quelle que soit la nature de l’excitation qu’il reçoit. Il fit subir à la doctrine kantienne de l’espace une transformation physiologique, en admettant que la rétine a le sentiment inné de son étendue. Cette hypothèse, reprise, modifiée, rejetée, a donné lieu à un débat très vif qui dure encore et qui touche aux problèmes les plus élevés de la psychologie.
Après lui, chaque ordre de sensations devient l’objet de recherches approfondies. On étudia leurs différences qualitatives et intensives. En pénétrant de plus en plus dans la connaissance du mécanisme anatomique et physiologique, on put mieux déterminer ce qui, dans la sensation, est simple, immédiatement donné et ce qui est ajouté par un travail de l’esprit (induction, déduction, association d’images). Là où la conscience, à elle seule, ne voyait qu’un fait irréductible, l’expérience montrait qu’il y avait plusieurs éléments combinés en un tout. – Allant encore plus loin, Helmholtz fit voir, en particulier pour les sons, comment une sensation réputée absolument simple, dégagée même de ces additions psychologiques dont nous venons de parler, se décompose en sensations élémentaires qui cessent d’être démêlées par la conscience. Ses expériences ont servi de base aux interprétations ingénieuses de Taine et de Herbert Spencer
Le même savant, précédé dans cette voie par Dubois-Reymond, suivi plus tard par Donders, Exner, Wundt et beaucoup d’autres, essaya de déterminer la durée des actes psychiques. Les sensations furent étudiées d’abord ; plus tard, on étudia des actes d’une nature plus abstraite. Cette investigation, qui se continue, a jeté un jour nouveau sur le mécanisme et les conditions de la conscience, et l’on peut présumer qu’il en sortira des résultats inattendus.
En dehors des sciences biologiques, Fechner a poursuivi un ordre de recherches ayant pour but de mesurer l’intensité des sensations, dans leur rapport avec l’excitation qui les cause. Il s’est appuyé sur les mathématiques et la physique. Ses généralisations ont soulevé une polémique passionnée, donné lieu à des vérifications, à des contre-expériences. Il en est sorti un nombre déjà considérable de travaux qui, d’après la dénomination choisie par Fechner, sont compris sous le nom de psychophysique.
Tels sont les traits les plus généraux du mouvement qui s’est produit en Allemagne depuis trente ans. Outre Millier, il a eu pour principaux promoteurs, E.H. Weber. Volkmann, Dubois-Reymond, Helmholtz, Hering, Donders, Fechner, Lotze, Wundt. Bon nombre d’entre eux ont contribué aux progrès de la psychologie, sans se proposer ce but. On ne s’étonnera donc pas si leurs travaux, que nous avons à présenter, ont un caractère fragmentaire, s’ils suivent des directions différentes, s’ils se dispersent sur des sujets dissemblables. Il y a ici des travailleurs épars ; rien qui ressemble à l’œuvre d’une école, c’est-à-dire à l’œuvre d’hommes obéissant à une même discipline et suivant une même tradition. Il y a cependant des traits qui leur sont communs à tous et qui les distinguent de tout autre groupe de psychologues : les sciences expérimentales comme point de départ, l’habitude de leur méthode, une façon positive de traiter les questions.
Dans la plupart des cas, il eût été impossible de procéder ici comme pour la psychologie anglaise. On a dû souvent à la monographie d’un psychologue substituer la monographie d’une question, et mentionner même des travaux publiés ailleurs qu’en Allemagne. À notre avis, cette nécessité marque un progrès. À mesure que la psychologie, rompant ses vieilles attaches métaphysiques, s’habituera à la méthode des sciences qui la touchent de plus près, elle portera de moins en moins l’empreinte d’un homme ou d’une race, pour devenir l’œuvre commune de tous les pays.
Janvier 1879
HERBART
Les premiers essais de psychologie scientifique, en Allemagne, sont dus à Herbart. Ils forment une transition entre la spéculation pure de Fichte et de Hegel et la psychologie sans métaphysique. C’est ce qui explique comment ils peuvent être cités par des hommes tels que Helmholtz et Wundt, comment ils ont exercé sur eux une influence avouée et comment à tant d’autres égards ils n’ont plus guère qu’un intérêt historique.
Herbart a exposé sa psychologie dans deux ouvrages principaux qui ont pour titre : De la psychologie commescience, appuyée pour la première fois sur l’expérience, la métaphysique et les mathématiques, et Manuel de psychologie. Ce dernier, beaucoup plus court que le précédent, est d’une lecture plus difficile : il ne consiste guère qu’en un résumé de définitions et de formules.
Un point qu’il importe de noter tout d’abord, c’est que Herbart entend fonder la psychologie sur la métaphysique. Son point de départ est « dans l’être ». Le principe ontologique sur lequel tout s’appuie, c’est « l’unité de l’être ».
L’être, pour Herbart, « est absolument simple, sans pluralité, sans quantité ; il n’est qu’un quale. » Il dit ailleurs : « L’être est une position absolue ; son concept exclut toute négation et toute relation. » Et pour passer de ces considérations sur l’être en général à un être particulier : « L’âme, dit-il, est une substance simple, non seulement sans parties, mais sans pluralité quelconque dans sa qualité. » Sa qualité nous est inconnue ; mais son activité, comme celle de tout ce qui est réel, consiste à se conserver (Selbsterhaltung).
Si tout ce qui existe est absolument simple par nature et par définition, d’où vient donc la pluralité ? Elle ne vient que des rapports, déterminés qui s’établissent entre un être et les autres êtres. Par suite de ces rapports réciproques, les êtres se trouvent en lutte ; et par suite de cette lutte, l’effort pour la conservation, la Selbsterhaltung, qui constitue essentiellement chacun d’eux, devient une représentation (Vorstellung). Telle est l’hypothèse de Herbart. Les représentations (ou, comme s’exprime la psychologie contemporaine, les états de conscience) ne sont donc « que les efforts que l’âme fait pour se conserver ». En d’autres termes, nos sensations, nos idées, nos souvenirs, tout ce qui constitue notre vie psychologique, n’existe pour nous que comme un effet de notre tendance à la conservation, qui, par son rapport avec les autres êtres, se détermine et se spécifie.
Tout ce début métaphysique est bien hasardé, et rien de plus juste que cette remarque de Trendelenburg : Le concept de l’être, chez Herbart, repose simplement sur la spéculation, non sur l’expérience.
Quoi qu’il en soit, admettons cette hypothèse et tenons la genèse des états de conscience pour expliquée. Nous avons maintenant la matière de la psychologie, les phénomènes qu’elle veut étudier : voyons comment Herbart va s’y prendre. Il est certain que, malgré ce goût marqué pour l’abstraction qui se traduit chez lui par l’abus de la métaphysique et des mathématiques, il montre parfois un sentiment vrai du fait réel, de son évolution et de ses variétés spécifiques. On peut en douter d’autant moins que cette tendance qui n’est chez lui qu’à l’état de germe s’est développée chez ses disciples : c’est de l’école de Herbart que nous verrons sortir plus tard la psychologie ethnique.
« La matière de la psychologie, dit-il, c’est la perception interne, le commerce avec les autres hommes de tous les degrés de culture, les observations de l’éducateur et de l’homme d’État, les récits des voyageurs, des historiens, des poètes et des moralistes, les expériences fournies par les fous, par les malades et les animaux. » Ailleurs, il fait remarquer que « l’homme des psychologues, c’est l’homme sociable et cultivé (gébildete) qui représente l’histoire de son espèce parvenue à une grande hauteur » ; mais que les faits actuels ne peuvent pas nous dire ce qui est primitif, qu’il faut recourir pour cela à l’examen du sauvage et de l’enfant.
Aujourd’hui, ces vues peuvent paraître communes ; il n’en était pas de même en Allemagne, il y a soixante ans : alors que la métaphysique régnait sans contestation, elles ont dû paraître une originalité voisine du paradoxe. J’incline à croire pourtant qu’elles avaient été suggérées à Herbart moins par ses propres réflexions que par la lecture de Locke.
Le goût du fait réel en psychologie a fait de Herbart l’ennemi le plus acharné de l’hypothèse des facultés de l’âme. Il y revient sans cesse pour la combattre. La psychologie a reculé depuis Leibniz et Locke, grâce à Wolf et à Kant, qui sont des abstracteurs (Absonderer) de facultés de l’âme. Les deux premiers suivaient une meilleure voie en s’abstenant de ces hypothèses ; car, « dès qu’à la conception naturelle de ce qui se passe en nous on ajoute l’hypothèse de facultés que nous avons, la psychologie se change en mythologie. » La psychologie empirique, dit-il ailleurs, nous parle de trois facultés : penser, sentir, désirer ; à ces trois facultés, elle subordonne, comme à des genres, d’autres facultés (mémoire, imagination, raison, etc.) ; puis, à chaque espèce, elle subordonne des variétés (mémoire des lieux, des mots, etc. ; raison théorique et raison pratique, etc.). Mais le réel, le fait, est individuel ; ce n’est pas un genre ni une espèce. Le général ne peut sortir de l’individuel que par une abstraction en règle ; et comment tenter cette abstraction quand l’individuel est mal connu, insuffisamment établi ?
À ce sentiment de la réalité qui se trouve chez Herbart, quoiqu’il cite bien rarement des faits individuels, il faut ajouter une intuition très nette de la méthode scientifique. Il ne croit pas, comme c’était alors la mode en Allemagne, que l’on puisse construire la psychologie à l’aide de pures déductions et d’arguties logiques. Il se propose d’appliquer à la psychologie « quelque chose qui ressemble aux recherches des sciences de la nature » (welche der Naturforschung gleiche). Parfois même il semble dire que la psychologie ne peut se constituer comme science qu’à la condition de faire une part très large à l’inconnu et en se bornant aux phénomènes. « La physique expérimentale ignore les forces de la nature, et cependant elle a deux moyens de découverte, l’expérimentation et le calcul. La psychologie ne peut pas expérimenter sur l’homme, et elle n’a pas d’instruments pour cela ; elle doit d’autant plus s’attacher à employer le calcul. »
Il n’est pas sûr que Herbart soutînt encore de nos jours que l’expérimentation est impossible en psychologie. Les recherches de Fechner et de ses successeurs ont montré le contraire : tout un ordre de faits psychologiques est devenu accessible à l’expérience. Ce qui est sûr, c’est qu’il a une idée exacte des conditions de la science ; il sait qu’elle n’existe que là où il y a calcul, c’est-à-dire détermination quantitative, ou bien expérimentation, c’est-à-dire vérification objective, et qu’en dehors de ces conditions l’emploi du mot science est une usurpation et un abus.
La psychologie a quelque analogie avec la physiologie. « De même que l’une construit le corps avec des fibres, l’autre construit l’esprit avec des séries de représentations. » Les représentations ou faits de conscience dont les lois peuvent être connues, telle est la matière de la psychologie. « Mais ce que nous cherchons, ce n’est pas un simple registre de faits, c’est un savoir spéculatif, c’est une réduction à des lois. » Par exemple, « la psychologie répète que les états de conscience s’associent dans le temps et l’espace, et elle n’en est jamais venue à penser que le temps et l’espace ne sont que les déterminations prochaines de cette association, qui en réalité n’est pas vague, comme la description courante qu’on en donne pourrait le faire croire, mais qui se produit d’après une régularité strictement mathématique. » Il faut donc renoncer à rien comprendre à la psychologie, si l’on ne fait usage du calcul. Le sens intime, ce prétendu instrument scientifique de la plupart des psychologues, n’a pas pour Herbart « la plus légère prérogative comme valeur sur l’expérience externe, quelque supériorité imaginaire qu’on ait pu rêver pour elle. »
Jusqu’ici, nous ne savons qu’une chose : Les états de conscience, d’après l’hypothèse métaphysique de Herbart, seraient dus à l’effort que chaque être fait pour se conserver, dès qu’il entre en relation avec les autres êtres. Mais y a-t-il rien là qui ressemble à une propriété mathématique ? Oui ; car tout ce qui est perçu intérieurement a une propriété générale : c’est de se montrer « comme allant et venant, oscillant et flottant, en un mot comme quelque chose qui devient plus fort ou plus faible. » Chaque terme employé pour exprimer nos représentations renferme un concept de grandeur. Il faut donc admettre que dans les faits de conscience il n’y a aucun ordre, ou bien qu’il y a quelque chose qui présente un caractère mathématique et qu’on doit essayer d’analyser mathématiquement.
Pourquoi n’a-t-on pas essayé depuis longtemps cette analyse ? Herbart en donne plusieurs raisons. La principale est la difficulté de la mesure. Les grandeurs psychologiques sont des quantités variables qui ne peuvent être évaluées que d’une manière incomplète. « Mais on peut soumettre au calcul les variations de certaines quantités, et ces quantités elles-mêmes, en tant qu’elles sont variables, sans les déterminer complètement : c’est sur cela que repose toute l’analyse infinitésimale. Tant que le calcul de l’infini n’était pas inventé, les mathématiques étaient trop imparfaites pour cet objet. » Il est maintenant possible de s’en servir pour constituer la psychologie comme science.
Toute notre connaissance des faits internes a ce caractère qu’elle est nécessairement incomplète : notre esprit, par une opération qui lui est propre, doit la compléter (Ergänzung). Mais le plus souvent les données empiriques sont tellement insuffisantes que cette entreprise ne peut être tentée que par voie spéculative ; et, pour cela, il faut tout d’abord démontrer l’existence de certains rapports, établir que deux quantités sont en fonction l’une de l’autre, qu’elles sont liées ensemble comme un logarithme et son nombre naturel, comme une différentielle et son intégrale, etc.
En un mot, d’après Herbart, « la psychologie tout entière ne peut consister en rien autre chose qu’à compléter les faits perçus intérieurement ; qu’à démontrer, au moyen de ce que la perception n’atteint pas, la connexion de ces faits que la perception peut atteindre ; – et cela, d’après des lois générales. »
Tous les états de conscience sans exception étant pour Herbart des représentations, et les représentations étant des forces, en tant du moins qu’elles sont contraires les unes aux autres, il en résulte que la tâche de la psychologie consistera à établir une statique et une mécanique de l’esprit.
Nous entrons ici dans le cœur même de la psychologie de Herbart. Il nous faut donc insister sur ce qui en fait le caractère essentiel : l’emploi des mathématiques.
Toute représentation simple a une qualité déterminée, qui est invariable : la perception du rouge, par exemple, ne peut en aucune façon devenir celle du bleu. Mais toute représentation a aussi une valeur quantitative qui est variable, à savoir son degré d’intensité, de force, ou plus simplement de clarté. Un fait vulgaire montrera que nos représentations sont en réalité des forces qui luttent entre elles. Supposez, dit Herbart, qu’un homme vous parle une langue inconnue ; vous remarquerez que chaque mot, s’il n’est prononcé très lentement, sort aussitôt de votre mémoire. Les perceptions produites en vous par ces divers sons ont donc la propriété de se chasser les unes les autres. Au temps où nous ne connaissions aucune langue, chaque mot produisait sur nous le même effet. Par un résultat de l’habitude, la liaison des mots nous est devenue facile ; nous ne sentons plus que chacun d’eux fait obstacle à l’autre ; mais cet antagonisme n’en continue pas moins à exister : c’est un fait général.
Le principe qui sert d’appui à tout le reste, c’est donc l’antagonisme des représentations. Herbart, qui procède en mathématicien, fait remarquer que cette hypothèse doit être prise d’abord dans son sens le plus simple. « Il ne s’agit pas de représentations complexes désignant des objets avec leurs déterminations dans le temps et l’espace, mais de représentations très simples, telles que rouge, bleu, acide, doux ; en un mot, de celles qui peuvent être fournies par un acte sensoriel immédiat et d’un moment. » C’est un principe métaphysique – l’unité de l’âme – qui explique à la fois l’antagonisme des représentations et leur association. Comme, en vertu du principe de contradiction, deux contraires ne peuvent exister simultanément en un même point, les représentations contraires s’arrêtent réciproquement. Sans cet antagonisme, toutes les représentations ne constitueraient qu’un seul acte d’une seule âme ; et, en réalité, elles ne constituent qu’un seul acte, tant que des obstacles quelconques ne viennent pas introduire entre elles une séparation.
Cet antagonisme entre deux états de conscience n’appartient à aucun des deux pris seul ; il résulte d’un rapport. « Si nous entendons un ut seul, il ne s’oppose pas pour nous à un ré. Mais si nous entendons à la fois ut, ré, ou si ces deux représentations coexistent dans notre conscience, alors nous percevons non seulement la somme ut, ré