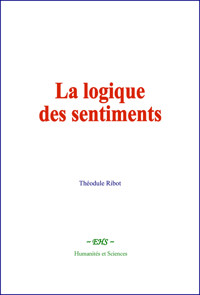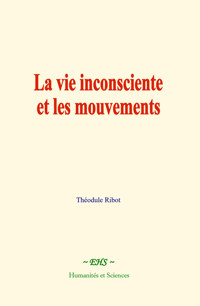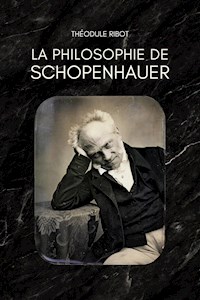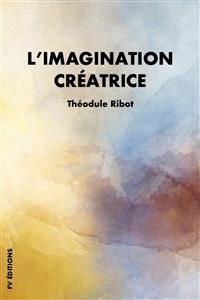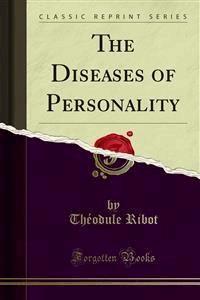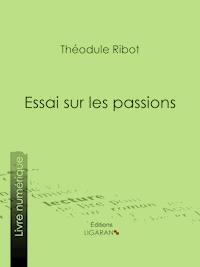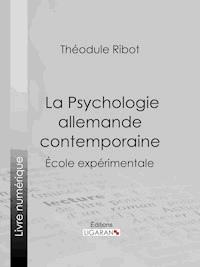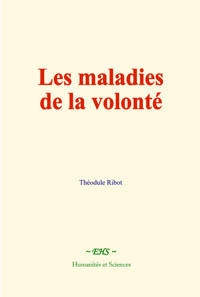
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
Dans tout acte volontaire, il y a deux éléments bien distincts : l’état de conscience, le « Je veux », qui constate une situation, mais qui n’a par lui-même aucune efficacité ; et un mécanisme psychophysiologique très complexe, en qui seul réside le pouvoir d’agir ou d’empêcher.
Cette étude permet d’analyser la volonté dans son double mécanisme d’impulsion et d’arrêt, et dans sa source, le caractère individuel.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Théodule Ribot est un philosophe, généralement considéré comme le fondateur de la psychologie française. Il a créé et dirigé la Revue philosophique.
En 1864, il est admis à l'École normale supérieure. Il est reçu agrégé en 1866, puis docteur en 1875.
Il est professeur de philosophie au Lycée Impérial de Vesoul (1875-1878), puis au Lycée de Laval (1878-1882). Las des insuffisances de l'enseignement officiel, il prend un congé, et retourne ensuite à Paris pour se consacrer à ses recherches en psychologie expérimentale. En 1885, il enseigne cette matière à la Sorbonne avant d'obtenir en 1889 la première chaire de psychologie expérimentale et comparée au Collège de France.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les maladies de la volonté
Les maladies de la volonté
Théodule Ribot
EHS
Humanités et Sciences
Introduction
Durant ces dernières années, plusieurs auteurs, surtout à l’étranger, ont exposé en détail certaines parties de la psychologie d’après le principe de l’évolution. Il m’a semblé qu’il y aurait quelque profit à traiter ces questions dans le même esprit ; mais sous une autre forme — celle de la dissolution.
Je me propose donc dans ce travail d’essayer pour la volonté ce que j’ai fait précédemment pour la mémoire, d’en étudier les anomalies et de tirer de cette étude des conclusions sur l’état normal. À beaucoup d’égards, la question est moins facile : le terme volonté désigne une chose plus vague que le terme mémoire. Que l’on considère la mémoire comme une fonction, une propriété ou une faculté, elle n’en reste pas moins une manière d’être stable, une disposition psychique sur laquelle tout le monde peut s’entendre. La volonté, au contraire, se résout en volitions dont chacune est un moment, une forme instable de l’activité, une résultante variant au gré des causes qui la produisent.
Outre cette première difficulté, il y en a une autre qui peut paraître encore plus grande, mais dont nous n’hésiterons pas à nous débarrasser sommairement. Peut-on étudier la pathologie de la volonté, sans toucher à l’inextricable problème du libre arbitre ? — Cette abstention nous paraît possible et même nécessaire. Elle s’impose non par timidité, mais par méthode. Comme toute autre science expérimentale, la psychologie doit rigoureusement s’interdire toute recherche relative aux causes premières. Le problème du libre arbitre est de cet ordre. L’un des grands services de la critique de Kant et de ceux qui l’ont continuée a été de montrer que le problème de la liberté se réduit à savoir si l’on peut sortir de la chaîne des effets et des causes pour poser un commencement absolu. Ce pouvoir, « qui appelle, suspend ou bannit, » comme le définit un contemporain qui l’a profondément étudié, ne peut être affirmé qu’à la condition d’entrer dans la métaphysique.
Ici, nous n’avons rien de pareil à tenter. L’expérience interne et externe est notre seul objet ; ses limites sont nos limites. Nous prenons les volitions à titre de faits, avec leurs causes immédiates, c’est-à-dire les motifs qui les produisent, sans rechercher si ces causes supposent des causes à l’infini ou s’il y a quelque spontanéité qui s’y ajoute. La question se trouve ainsi posée sous une forme également acceptable pour les déterministes et leurs adversaires, conciliable avec l’une et l’autre hypothèse. Nous espérons d’ailleurs conduire nos recherches de telle manière que l’absence de toute solution sur ce point ne sera pas même une seule fois remarquée.
J’essayerai de montrer au terme de cette étude que, dans tout acte volontaire, il y a deux éléments bien distincts : l’état de conscience, le « Je veux, » qui constate une situation, mais qui n’a par lui-même aucune efficacité ; et un mécanisme psychophysiologique très complexe, en qui seul réside le pouvoir d’agir ou d’empêcher. Comme cette conclusion générale ne peut être que le résultat de conclusions partielles fournies par la pathologie, j’écarterai provisoirement dans cette introduction toute vue systématique ; je me bornerai à étudier la volonté dans son double mécanisme d’impulsion et d’arrêt, et dans sa source, — le caractère individuel, — négligeant tous les détails qui n’importent pas à notre sujet.
I.
Le principe fondamental qui domine la psychologie de la volonté sous sa forme impulsive, à l’état sain comme à l’état morbide, c’est que tout état de conscience a toujours une tendance à s’exprimer, à se traduire par un mouvement, par un acte. Ce principe n’est qu’un cas particulier, propre à la psychologie, de cette loi fondamentale : que le réflexe est le type unique de toute action nerveuse, de toute vie de relation. À proprement parler, l’activité dans l’animal n’est pas un commencement mais une fin, une cause mais un résultat, un début mais une suite. C’est là le point le plus essentiel qu’il ne faut jamais perdre de vue et qui seul explique la physiologie et la pathologie de la volonté, parce que cette tendance de l’état de conscience à se dépenser en un acte psychologique ou physiologique, conscient ou inconscient, est le fait simple auquel se réduisent les combinaisons et complications de l’activité volontaire la plus haute.
Le nouveau-né n’est, comme l’a défini Virchow, « qu’un être spinal. » Son activité est purement réflexe ; elle se manifeste par une telle profusion de mouvements que le travail de l’éducation consistera pendant longtemps à en supprimer ou à en restreindre le plus grand nombre. Cette diffusion des réflexes, qui a sa raison dans des relations anatomiques, traduit dans toute sa simplicité la transformation des excitations en mouvements. Qu’ils soient conscients ou qu’ils éveillent un rudiment de conscience, en aucun cas ils ne représentent une activité volontaire ; ils n’expriment proprement que l’activité de l’espèce, ce qui a été acquis, organisé et fixé par l’hérédité ; mais ce sont les matériaux avec lesquels la volonté sera construite.
Le désir marque une étape ascendante de l’état réflexe à l’état volontaire. Nous entendons par désir les formes les plus élémentaires de la vie affective, les seules qui puissent se produire, tant que l’intelligence n’est pas née. Physiologiquement, ils ne diffèrent pas des réflexes d’ordre complexe. Psychologiquement, ils en diffèrent par l’état de conscience, souvent très intense, qui les accompagne. Leur tendance à se traduire en actes est immédiate et irrésistible, comme celle des réflexes. À l’état naturel et tant qu’il est encore pur de tout alliage, le désir tend à se satisfaire immédiatement ; c’est là sa loi, elle est inscrite dans l’organisme. Les petits enfants, les sauvages en fournissent d’excellents exemples. Chez l’adulte, le désir n’est plus à l’état naturel ; l’éducation, l’habitude, la réflexion le mutilent ou le refrènent. Mais souvent il reprend ses droits, et l’histoire nous montre que, chez les despotes que leur opinion et celle des autres placent au-dessus de toute loi, il les garde toujours.
La pathologie nous fera voir que cette forme d’activité augmente quand la volonté faiblit, persiste quand elle disparaît. Elle marque cependant un progrès sur la première période, parce qu’elle dénote un commencement d’individualité. Sur le fond commun de l’activité spécifique, les désirs dessinent vaguement le caractère individuel ; ils reflètent la façon de réagir d’un organisme particulier.
Dès qu’une somme suffisante d’expériences a permis à l’intelligence de naître, il se produit une nouvelle forme d’activité, pour laquelle l’épithète d’idéo-motrice est la plus convenable, les idées étant causes de mouvements. Elle a de plus l’avantage de montrer sa parenté avec les réflexes, dont elle n’est qu’un perfectionnement.
Comment une idée peut-elle produire un mouvement ? C’est là une question qui embarrassait fort l’ancienne psychologie, mais qui devient simple, quand on considère les faits dans leur vraie nature. C’est une vérité maintenant courante dans la physiologie cérébrale que la base anatomique de tous nos états mentaux comprend à la fois des éléments moteurs et des éléments sensitifs. Je n’insisterai pas sur une question qui a été traitée ailleurs en détail et qui entraînerait une digression. Rappelons simplement que nos perceptions, en particulier les importantes, celles de la vue et du toucher, impliquent à titre d’éléments intégrants des mouvements de l’œil ou des membres ; et que si, lorsque nous voyons réellement un objet, le mouvement est un élément essentiel, il doit jouer le même rôle, quand nous voyons l’objet idéalement. Les images et les idées, même abstraites, supposent un substratum anatomique dans lequel les mouvements sont représentés en une mesure quelconque.
Il est vrai que, en serrant la question de plus près, on pourrait dire qu’il faut distinguer deux espèces d’éléments moteurs : ceux qui servent à constituer un état de conscience, et ceux qui servent à le dépenser ; les uns intrinsèques, les autres extrinsèques. L’idée d’une boule, par exemple, est la résultante d’impressions de surfaces et d’ajustements musculaires particuliers ; mais ces derniers sont le résultat de la sensibilité musculaire et, à ce titre, sont des sensations de mouvement plutôt que des mouvements proprement dits : ce sont des éléments constitutifs de notre idée plutôt qu’une manière de la traduire au dehors.
Toutefois, cette relation étroite, établie par la physiologie entre l’idée et le mouvement, nous laisse entrevoir comment l’une produit l’autre. En réalité, une idée ne produit pas un mouvement : ce serait une chose merveilleuse que ce changement total et soudain de fonction. Une idée, telle que les spiritualistes la définissent, produisant subitement un jeu de muscles, ne serait guère moins qu’un miracle. Ce n’est pas l’état de conscience, comme tel, mais bien l’état physiologique correspondant, qui se transforme en un acte. Encore une fois, la relation n’est pas entre un événement psychique et un mouvement, mais entre deux états de même nature, entre deux états physiologiques, entre deux groupes d’éléments nerveux, l’un sensitif, l’autre moteur. Si l’on s’obstine à faire de la conscience une cause, tout reste obscur ; si on la considère comme le simple accompagnement d’un processus nerveux, qui lui seul est l’événement essentiel, tout devient clair, et les difficultés factices disparaissent.
Ceci admis, nous pouvons classer grossièrement les idées en trois groupes, suivant que leur tendance à se transformer en acte est forte, modérée, ou faible, et même, en un certain sens, nulle.
1o Le premier groupe comprend les états intellectuels, extrêmement intenses (les idées fixes peuvent servir de type). Ils passent à l’acte avec une fatalité, une rapidité presque égales à celles des réflexes. Ce sont les idées « qui nous touchent ». L’ancienne psychologie, affirmant un fait d’expérience vulgaire, disait dans son langage que l’intelligence n’agit sur la volonté que par l’intermédiaire de la sensibilité. En laissant de côté ces entités, cela signifie que l’état nerveux qui correspond à une idée se traduit d’autant mieux en mouvement, qu’il est accompagné de ces autres états nerveux (quels qu’ils soient) qui correspondent à des sentiments. Cette traduction faite, on comprend pourquoi, dans le cas actuel, nous sommes si près de la phase précédente, pourquoi l’action nerveuse est plus énergique, agit sur plus d’éléments.
La plupart des passions, dès qu’elles dépassent le niveau du pur appétit, rentrent dans ce groupe comme principes d’action. Toute la différence n’est qu’en degré, suivant que, dans le complexus ainsi formé, les éléments affectifs prédominent ou inversement.
2o Le deuxième groupe est le plus important pour nous. Il représente l’activité raisonnable, la volonté au sens courant du mot. La conception est suivie d’un acte après une délibération courte ou longue. Si l’on y réfléchit, on trouvera que la plupart de nos actions se ramène à ce type, déduction faite des formes précitées et des habitudes. Que je me lève pour prendre l’air à ma fenêtre, ou que je m’engage pour devenir un jour général, il n’y a qu’une différence du moins au plus : une volition très complexe et à longue portée, comme la dernière, devant se résoudre en une série de volitions simples successivement adaptées aux temps et aux lieux. — Dans ce groupe, la tendance à l’acte n’est ni instantanée ni violente. L’état affectif concomitant est modéré. Beaucoup des actions qui forment le train ordinaire de notre vie ont été à l’origine accompagnées d’un sentiment de plaisir, de curiosité, etc. Maintenant le sentiment primitif s’est affaibli, mais le lien entre l’idée et l’acte s’est établi ; quand elle naît, il suit.
3o Avec les idées abstraites, la tendance au mouvement est à son minimum. Ces idées étant des représentations de représentations, de purs schémas, des extraits fixés par un signe, l’élément moteur s’appauvrit dans la même mesure que l’élément représentatif. Si l’on considère toutes les formes d’activité que nous venons de passer en revue comme des complications successives du réflexe simple, on peut dire que les idées abstraites sont une ramification collatérale, faiblement rattachée au tronc principal et qui s’est développée à sa manière. Leur tendance motrice se réduit à cette parole intérieure, si faible qu’elle soit, qui les accompagne, ou au réveil de quelque autre état de conscience. Car, de même qu’en physiologie la période centrifuge d’un réflexe n’aboutit pas toujours à un mouvement, mais aussi bien à la sécrétion d’une glande ou à une action trophique ; de même, en psychologie, un état de conscience n’aboutit pas toujours à un mouvement, mais à la résurrection d’autres états de conscience, suivant le mécanisme bien connu de l’association.
L’opposition si souvent notée entre les esprits spéculatifs, qui vivent dans les abstractions, et les gens pratiques, n’est que l’expression visible et palpable de ces différences psychologiques que nous venons de signaler. Rappelons encore, à titre d’éclaircissement, des vérités banales : la différence entre connaître le bien et le pratiquer, voir l’absurdité d’une croyance et s’en défaire, condamner une passion et la sacrifier. Tout cela s’explique par la tendance motrice, extrêmement faible, de l’idée réduite à elle-même. Nous ignorons les conditions anatomiques et physiologiques nécessaires pour la naissance d’une idée abstraite, mais nous pouvons affirmer sans témérité que, dès qu’elle devient un motif d’action, d’autres éléments s’y ajoutent : ce qui arrive chez ceux « qui se dévouent à une idée ». Ce sont les sentiments seuls qui mènent l’homme.
II
À s’en tenir à ce qui précède, l’activité volontaire nous apparaît comme un moment dans cette évolution ascendante qui va du réflexe simple, dont la tendance au mouvement est irrésistible, à l’idée abstraite, où la tendance à l’acte est à son minimum. On n’en peut fixer rigoureusement ni le commencement ni la fin, la transition d’une forme à l’autre étant presque insensible.
À dessein et pour des raisons de clarté, nous n’avons pas examiné le problème dans sa complexité. Nous avons même éliminé l’un des éléments essentiels, caractéristiques, de la volonté. Telle qu’on l’a considérée jusqu’ici, elle pourrait être définie : un acte conscient, plus ou moins délibéré, en vue d’une fin simple ou complexe, proche ou lointaine. C’est ainsi que paraissent l’entendre des auteurs contemporains, tels que Maudsley et Lewes, lorsqu’ils la définissent « l’excitation causée par des idées » (impulse by ideas) ou bien « la réaction motrice des sentiments et des idées ». Ainsi comprise, la volition serait simplement un « laisser faire ». Mais elle est tout autre chose. Elle est aussi une puissance d’arrêt, ou, pour parler la langue de la physiologie, un pouvoir d’inhibition.
Pour la psychologie fondée sur la seule observation intérieure, cette distinction entre permettre et empêcher a peu d’importance ; mais pour la psychologie, qui demande au mécanisme physiologique quelque éclaircissement sur les opérations de l’esprit, — et qui tient l’action réflexe pour le type de toute activité, — elle est capitale.
La doctrine courante admet que la volonté est un fiat auquel les muscles obéissent on ne sait comment. Dans cette hypothèse, il importe peu que le fiat commande un mouvement ou un arrêt. Mais si l’on admet, avec tous les physiologistes contemporains, que le réflexe est le type et la base de toute action, et si, par conséquent, il n’y a pas lieu de chercher pourquoi un état de conscience se transforme en mouvement, — puisque c’est la loi — il faut expliquer pourquoi il ne se transforme pas. Malheureusement, la physiologie est pleine d’obscurités et d’indécisions sur ce point.
Le cas le plus simple du phénomène d’arrêt ou d’inhibition consiste dans la suspension des mouvements du cœur par l’excitation du pneumo-gastrique. On sait que le cœur (indépendamment des ganglions intra-cardiaques) est innervé par des filets venant du grand sympathique, qui accélèrent ses battements, et par des filets du nerf vague. La section de ce dernier augmente les mouvements ; l’excitation du bout central au contraire les suspend plus ou moins longtemps. Il est donc un nerf d’arrêt, et l’inhibition est généralement considérée comme le résultat d’une interférence. L’activité réflexe des centres cardiaques est ralentie ou suspendue par les excitations venant du bulbe. En d’autres termes, l’action motrice du pneumo-gastrique se dépense dans les centres cardiaques en activité et produit un arrêt. Tout ceci n’a pas une portée psychologique immédiate ; mais voici qui nous touche plus.
C’est un fait bien connu que l’excitabilité réflexe de la moelle augmente, quand elle est soustraite à l’action du cerveau. L’état des animaux décapités en fournit des preuves frappantes. Sans recourir à ces cas extrêmes, on sait que les réflexes sont bien plus intenses pendant le sommeil qu’à l’état de veille. Pour expliquer ce fait, quelques auteurs ont admis dans le cerveau des centres d’arrêt. Setschenow les plaçait dans les couches optiques et la région des tubercules quadrijumeaux. Il s’appuyait sur ce fait qu’en excitant, par des moyens chimiques ou autres, les parties précitées, il produisait une dépression des réflexes. — Goltz place ces centres d’arrêt dans le cerveau proprement dit.
Ces hypothèses et d’autres analogues ont été fort critiquées, et beaucoup de physiologistes admettent simplement que, à l’état normal, les excitations se répartissent à la fois dans le cerveau par une voie ascendante et dans la moelle par une voie transverse ; que, au contraire, dans les cas où le cerveau ne peut jouer un rôle, les excitations ne trouvant plus qu’une seule voie ouverte, il en résulte une sorte d’accumulation dont l’effet est une excitabilité réflexe exagérée.
Dans ces derniers temps, Ferrier, se plaçant à un point de vue dont l’importance psychologique est évidente, a admis dans les lobes frontaux l’existence de centres modérateurs qui seraient le facteur essentiel de l’attention.
Sans entrer dans plus de détails, on voit que, pour expliquer le mécanisme de l’inhibition, il n’y a aucune doctrine claire et universellement acceptée comme pour les réflexes. Les uns admettent que l’arrêt vient de deux tendances contraires qui s’entravent ou s’annihilent. D’autres admettent des centres d’arrêt (et même des nerfs d’arrêt) capables de supprimer une action transmise, au lieu de la renforcer. Il y a encore plusieurs hypothèses qu’il est inutile de mentionner. Dans cet état d’ignorance, examinons la question de notre mieux.
Dans tout arrêt volontaire, il y a deux choses à considérer : le mécanisme qui le produit, – nous venons d’en parler ; l’état de conscience qui l’accompagne, – nous allons en parler.
D’abord, il y a des cas où l’arrêt n’a pas besoin d’être expliqué, ceux où l’incitation volontaire cesse d’elle-même : quand nous jetons de côté, par exemple, un livre décidément ennuyeux.
D’autres cas paraissent s’expliquer, par l’une des hypothèses précitées. Nous arrêtons volontairement le rire, le bâillement, la toux, certains mouvements passionnés, en mettant en action, à ce qu’il semble, les muscles antagonistes.
Pour les cas où l’on ignore comment l’arrêt se produit, où le mécanisme physiologique reste inconnu, la psychologie pure nous apprend encore quelque chose. Prenons l’exemple le plus banal : un accès de colère arrêté par la volonté. Pour ne pas nous exagérer le pouvoir volontaire, remarquons d’abord que cet arrêt est loin d’être la règle. Certains individus en paraissent tout à fait incapables. Les autres le sont très inégalement ; leur puissance d’arrêt varie au gré du moment et des circonstances. Bien peu sont toujours maîtres d’eux-mêmes.
Il faut, pour que l’arrêt se produise, une première condition : le temps. Si l’incitation est si violente qu’elle passe aussitôt à l’acte, tout est fini ; quelque sottise qui s’ensuive, il est trop tard. Si la condition de temps est remplie, si l’état de conscience suscite des états antagonistes, s’ils sont suffisamment stables, l’arrêt a lieu. Le nouvel état de conscience tend à supprimer l’autre et, en affaiblissant la cause, enraye les effets.
Il est d’une importance capitale pour la pathologie de la volonté de rechercher le phénomène physiologique qui se produit en pareil cas. On ne peut douter que la quantité de l’influx nerveux (quelque opinion qu’on ait sur sa nature) varie d’un individu à l’autre, et d’un moment à l’autre chez le même individu. On ne peut douter non plus qu’à un moment donné, chez un individu quelconque, la quantité disponible peut être distribuée d’une manière variable. Il est clair que, chez le mathématicien qui spécule et chez l’homme qui satisfait une passion physique, la quantité d’influx nerveux ne se dépense pas de la même manière et qu’une forme de dépense empêche l’autre, le capital disponible ne pouvant être employé à la fois à deux fins.
« Nous voyons, dit un physiologiste