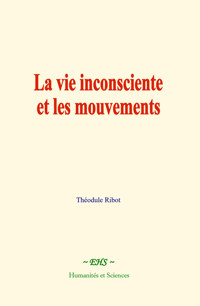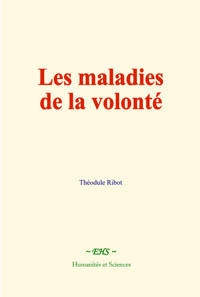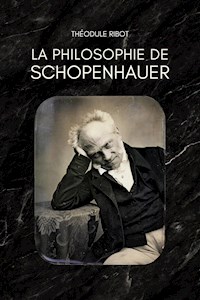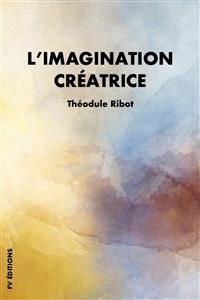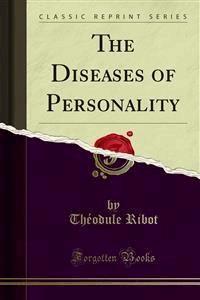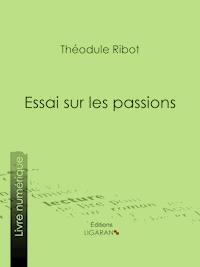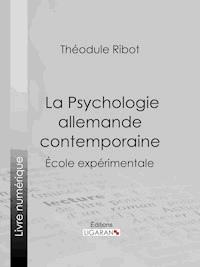1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Le but de cet Essai n’est pas une étude complète des représentations motrices. Même réduite à l’essentiel, elle serait très longue, car l’activité motrice pénètre la psychologie tout entière. De plus, comme elle a été faite partiellement ou en totalité par des auteurs très compétents, elle serait assez superflue. Notre unique but est d’appeler l’attention sur le rôle prépondérant des éléments moteurs dans l’activité inconsciente de l’esprit, et nos remarques préliminaires n’auront d’autre fin que d’y préparer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
La vie inconsciente et les mouvements
Théodule Ribot
1914
© 2022 Librorium Editions
ISBN : 9782383834687
TABLE DES MATIÈRES.
Préface
CHAPITRE ILe rôle latent des images motrices
Caractères généraux des mouvements comme éléments de la vie psychique : la primordialité, la diffusion. — Étude sommaire du sens kinesthétique. C’est un état complexe qu’il faut résoudre en les éléments distincts qui le composent : sens musculaire, sens articulaire, sens tendineux, sens labyrinthique, etc. — Les sensations de mouvement occupent une position intermédiaire entre les sensations spéciales et les sensations organiques. — Qu’est-ce qu’une image motrice au sens physiologique et au sens psychologique ? — Répartition en trois catégories suivant leur coefficient psychique. — Notre hypothèse sur la nature dernière de l’activité inconsciente ; elle dépend de la permanence des résidus moteurs. — Présence et nécessité des éléments moteurs dans la constitution de tous nos états de conscience : leur rôle dans la vision, l’audition, les sensations vocales, etc. — L’activité motrice est la réponse de l’individu aux excitations venant du dehors et du dedans. — Faits en faveur de notre hypothèse. Rôle de l’association : les mouvements sont la trame de soutien de la vie psychique. Le dynamisme. Expériences de Münsterberg, de Smith. Les associations médiates. Les « attitudes », leur nature : elles sont à la limite de l’inconscient. — Notre hypothèse échappe à deux difficultés. — Hypothèses analogues de Baldwin, Urban : la constante dynamique
CHAPITRE IILe mouvement et l’activité inconsciente.
Rôle des mouvements dans les états affectifs. L’origine des manifestations affectives est dans la tendance, non dans le plaisir et la douleur. — Émotions primaires et secondaires ; leur fond stable est dans les éléments moteurs. — L’activité motrice est-elle finalement affective ? — Thèse de Bazaillas. — L’affectif ne peut être la base de la vie inconsciente en raison de son instabilité. — L’inconscient, statique et dynamique, ne peut être explicable qu’en terme de mouvement. — La conservation. — L’invention selon la logique rationnelle, selon la logique des sentiments. — Faits physiologiques et pathologiques. — Hypothèses sur le travail inconscient : n’étant pas soumis, comme la conscience, à la succession dans le temps, il peut agir par abréviation, par interférence, par emboîtement, etc. — L’hypothèse d’un moi inconscient (Myers, Sidis, etc.). Elle est insoutenable. Impossibilité de nous connaître nous-même totalement. — Différence entre la cérébration inconsciente des anciens auteurs et notre hypothèse. — Les résidus moteurs sont la condition permanente d’une restitution intégrale de la conscience. — L’inconscient est un condensateur d’énergie
CHAPITRE IIILe problème de la pensée sans images et sans mots.
Le mot « pensée » étant vague, il faut fixer sa nature d’après son mécanisme : il se réduit à deux opérations, l’une préparatoire, l’analyse ; l’autre constructive, la synthèse, fondée sur la conscience des rapports. — La position actuelle (psychologie) de cette étude. — Théorie de Marbe : le jugement est une représentation modifiée. — L’anatomie, la physiologie et même la pathologie nous apprennent peu sur les conditions fondamentales de la pensée.
Examen des faits. Thèse radicale et sans preuve de Stout. — Recherches expérimentales de Binet. Elles n’établissent pas l’existence d’une pensée sans image. Les attitudes ne répondent pas non plus à la question. — Recours aux confessions des grand mystiques. Finesse de leurs observations. — La Vision intellectuelle, décrite par sainte Thérèse et autres. — Pour cet état de conscience vide de tout, n’y a-t-il pas un travail latent, inconscient ? — Le mysticisme métaphysique : Plotin, Spinoza, etc.
Problème de la pensée sans mots. — Antériorité prétendue de la pensée sur le mot. Discussion de cette thèse. — Cas de la lecture à haute voix. Analyse de ce cas et de la thèse générale. — Retour aux mystiques. — Ils distinguent entre les voix imaginaires et l’audition intellectuelle, équivalent de la vision intellectuelle : Mme Guyon, sainte Thérèse, Swedenborg, etc. Effort suprême du mystique pour atteindre la pensée pure par l’anéantissement intellectuel. — Thèse de Binet sur un prétendu antagonisme entre « l’imagerie » et la pensée. — La contemplation mystique est l’état qui se rapproche le plus de la pensée sans images et sans mots ; mais ce n’est plus une connaissance ; ils la placent eux-mêmes au-dessus. Cet état est une limite idéale qui s’évanouit au moment où elle est atteinte
CHAPITRE IVLe moindre effort en psychologie.
Étude de G. Ferrero : Critiques. — Étude de Gibson. — Division du sujet. — Formes générales : la paresse complète, la vieillesse : deux états de régression. — La tendance au moindre effort dans la connaissance : dans l’association des idées, dans la forme du raisonnement, misonéisme scientifique. — Confusion entre la disposition à la paresse et à l’économie raisonnée de l’effort. — Rapport entre la tendance au moindre effort et la lex parcimoniæ. Mach, Avenarius. — Avantages et défauts de l’abstraction : elle est une arme à deux tranchants. — Le moindre effort dans l’évolution du langage, dans les institutions sociales, dans les religions, dans les arts. — Répartition des hommes en trois catégories suivant leur disposition à agir : avec largesse, avec économie, avec parcimonie. — Causes de la tendance au moindre effort. 1o Physiologiques : insuffisance de la production et de la distribution de l’énergie. — 2o Psychologiques : aversion pour la douleur et par suite pour la fatigue. — Absence d’intérêt. — La résignation au travail, condition nécessaire de la civilisation, n’a été acquise que par des siècles de coercition violente. — À part les hommes grands dans l’action, la tendance au moindre effort est la règle pour la moyenne de l’humanité. — L’amour du travail est instable et précaire parce qu’il a été acquis tardivement, par un effet de la sélection. — Doctrines philosophiques et religieuses qui mettent l’idéal de la vie future dans le repos, l’ataraxie, le nirvâna
PRÉFACE
Jusqu’en ces derniers temps, l’étude des mouvements et de leur rôle dans la vie de l’esprit, sans être complètement oubliée, n’était guère en faveur. Les psychologues s’occupaient avec une préférence marquée des phénomènes intellectuels ou des états affectifs.
Il y a plus de trente ans, dans un article sur « Le rôle et l’importance des mouvements en psychologie »[1], j’avais essayé de signaler cette lacune. Mes remarques, sur ce sujet, me semblent aujourd’hui bien timides et bien insuffisantes. Beaucoup a été fait depuis dans cette direction.
Plusieurs fois je me suis demandé s’il n’y aurait pas lieu d’écrire un livre qui, sous le titre de « Psychologie des mouvements, » étudierait isolément et exclusivement les éléments de nature motrice dans toutes les manifestations de la conscience. Tous les traités didactiques de psychologie consacrent des chapitres aux instincts, aux tendances, à l’activité volontaire, aux mouvements qui expriment les émotions : dans notre livre supposé, on ferait davantage. On aurait à étudier les mouvements dans les perceptions, les images, les concepts, les opérations logiques, dans la genèse des sentiments, dans les formes multiples de la « facultas signatrix », car le mouvement est dans tout, partout, et peut être la base de tout.
Ce serait une œuvre de longue haleine, et les Essais qui suivent ne visent pas si haut. Ils se concentrent sur une question unique : les rapports de l’activité inconsciente avec les mouvements.
En m’appuyant sur des faits et des raisons, j’ai proposé une hypothèse qui me paraît ressortir des explorations dues à des auteurs nombreux et bien connus, dans le monde souterrain de l’esprit, notamment aux études récentes désignées depuis Freud sous le nom de « Psycho-analyse ». Cette hypothèse, c’est que le fond, la nature intime de l’inconscient ne doivent pas être déduits de la conscience — qui ne peut l’expliquer —, qu’ils doivent être cherchés dans l’activité motrice, actuelle ou conservée à l’état latent.
TH. RIBOT.
↑
Revue Philosophique
, octobre 1879
.
CHAPITRE PREMIER
LE RÔLE LATENT DES IMAGES MOTRICES
I
Le but de cet Essai n’est pas une étude complète des représentations motrices. Même réduite à l’essentiel, elle serait très longue, car l’activité motrice pénètre la psychologie tout entière. De plus, comme elle a été faite partiellement ou en totalité par des auteurs très compétents, elle serait assez superflue. Notre unique but est d’appeler l’attention sur le rôle prépondérant des éléments moteurs dans l’activité inconsciente de l’esprit, et nos remarques préliminaires n’auront d’autre fin que d’y préparer.
« Nul ne contestera, écrit un auteur récent, que le progrès le plus important dans la psychologie théorique, durant ces dernières années, est la valeur toujours croissante attribuée au mouvement dans l’explication des processus mentaux. Ce développement a été remarquable surtout en Amérique. Dans ce pays, l’explication en termes de mouvement a été poussée[1] systématiquement et jusqu’à l’extrême. »
Tout d’abord, le mouvement s’impose à l’observateur par deux caractères fondamentaux : primordialité, généralité.
En venant au monde, le nouveau-né est muni d’aptitudes motrices qui entrent d’elles-mêmes en exercice : mouvements automatiques (de la respiration, de la digestion, etc.), mouvements réflexes (sucer, crier, etc.), mouvements instinctifs. Il est une machine qui produit des mouvements, mais leur apparition est primaire. Comme ils dépendent des centres inférieurs de l’encéphale, ils sont vides de conscience ou tout au moins de connaissance[2]. Plus tard, avec le développement des centres supérieurs de l’écorce corticale, l’organisation du système moteur sera achevée.
Mais un fait plus important pour la psychologie et pour notre sujet en particulier, c’est la diffusion ou généralisation des mouvements. W. James[3] n’hésite pas à écrire : « Si l’on veut bien ne pas tenir compte des exceptions possibles, on peut formuler cette loi : “Tout fait de conscience détermine un mouvement et ce mouvement irradie dans tout le corps et dans chacune de ses parties. Une explosion nous fait tressaillir des pieds à la tête. La moindre sensation nous donne une secousse identique quoique invisible : si nous ne la sentons pas toujours, cela tient à ce qu’elle est trop fine ou que notre sensibilité ne l’est pas assez.” » Il y a déjà longtemps que Bain a remarqué ce phénomène de décharge générale et l’a exprimé dans la loi de diffusion : « Toutes les fois qu’une impression est accompagnée de conscience, les courants excités se diffusent dans le cerveau tout entier et vont ébranler tous les organes du mouvement et jusqu’aux viscères eux-mêmes. » Il y a donc une irradiation de mouvements qui s’étend à toute notre vie psychique : dans la vie affective, elle éclate avec évidence ; dans la vie intellectuelle, elle n’est pas moindre. L’origine de notre connaissance est dans nos sensations et il n’y en a aucune, quelle que soit son espèce, qui ne suppose et n’implique des mouvements. Nous reviendrons plus tard sur ce point important.
On a proposé plusieurs classifications des mouvements. Je crois inutile de les relater ici. Il sera plus profitable de rappeler leur diversité d’origine. Au terme ancien de sens musculaire — trop étroit et par suite inexact — on a substitué celui de sens kinesthétique qui n’est lui-même qu’un terme général qu’il faut résoudre en sens kinesthétiques particuliers. Ce procédé est celui qui maintenant prévaut dans l’étude de la kinesthésie. Titchener (Psychology, § 44-55) en donne une énumération qui me semble la plus complète. Je la présente en résumé.