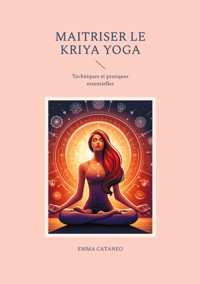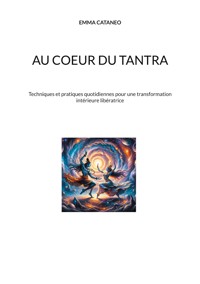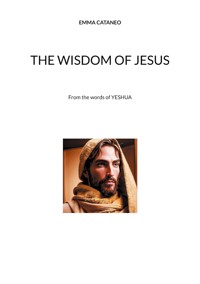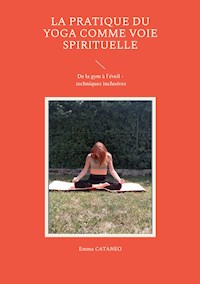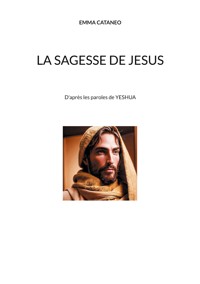
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Französisch
Dans "La Sagesse de Jésus", plongez dans une exploration historique et spirituelle des enseignements originels de Yeshua, révélés à travers des textes anciens et mystérieux. Ce livre unique dévoile des perspectives neuves sur le christianisme primitif, en se concentrant non seulement sur l'Évangile selon Thomas mais aussi sur les écrits de Jacques, Marie-Madeleine, et Philippe, ainsi que sur le fascinant "Discours du Sauveur". Découvrez comment ces textes, y compris le papyrus 87.5575, éclairent les paroles de Jésus d'une lumière différente, souvent en contraste avec les versions canoniques. Ce livre est une invitation à redécouvrir les enseignements de Jésus, en les libérant des dogmes établis pour révéler leur sagesse profonde et universelle. "La Sagesse de Jésus" n'est pas juste une étude historique ; c'est un guide pour ceux en quête de sens, offrant une perspective renouvelée sur la spiritualité et la nature humaine. Un voyage fascinant qui transforme la perception des enseignements de Jésus, adapté à tous, croyants, sceptiques ou simplement curieux. Rejoignez cette aventure spirituelle pour explorer la sagesse intemporelle de l'un des plus grands sages de l'humanité.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PLAN
Avant-propos
I. Introduction et contexte historique
A)Importance de la découverte du papyrus 87.5575 et son impact sur la compréhension du christianisme primitif
B)Ancienneté du manuscrit et implications pour la compréhension des enseignements de Jésus
C)Approche et objectifs du livre
D) Le personnage Jésus
II. Origines et influences de l'Évangile selon Thomas
A)Influence de l'Évangile de Thomas sur la compréhension de la source Q
B) Évangile de Thomas et Tradition orale Primitive
III. La formation du canon du Nouveau Testament
IV) L'Évangile selon Thomas
V) L'Evangile de Marie de Magdala
VI) Le discours du Sauveur
7)Conclusion
8) Bibliographie
Avant-propos
Au cœur de l'histoire du christianisme se trouve un ensemble complexe de textes et d'enseignements, parmi lesquels l'Évangile de Thomas occupe une place souvent contestée. La récente traduction d'un papyrus datant de la seconde moitié du 1er siècle et mêlant des éléments des Évangiles de Matthieu, de Luc, et de Thomas, offre une perspective renouvelée et profonde sur la compréhension du christianisme primitif. Cette découverte souligne l'importance de revisiter les enseignements de Jésus, non pas à travers le prisme des doctrines établies, mais en tant que source de sagesse et de réflexion spirituelle.
Dans cette exploration, nous nous penchons sur la figure de Jésus, non seulement comme figure centrale du christianisme mais aussi comme un sage humain dont les paroles transcendent les frontières religieuses et temporelles. L'analyse approfondie de l'Évangile de Thomas ainsi que de plusieurs autres textes, en comparaison avec les textes canoniques, révèle une dimension souvent insoupçonnée de la tradition chrétienne. Elle invite à une réévaluation de la formation du canon du Nouveau Testament, à une reconnaissance de la pluralité des interprétations des enseignements de Jésus, et à une appréciation de la diversité des traditions chrétiennes primitives.
Cette étude vise à dévoiler les strates de la tradition chrétienne, en mettant en lumière les différentes façons dont les premières communautés chrétiennes ont compris et transmis les enseignements de Jésus. Il s'agit d'un voyage dans le temps et en Esprit, révélant non seulement la complexité de l'histoire chrétienne, mais aussi la richesse et la profondeur des enseignements de Jésus, qui continuent à inspirer et à guider plus de deux milliards de personnes à travers le monde.
L'histoire du christianisme est marquée par une richesse textuelle qui dépasse largement les frontières des Évangiles canoniques. Cette étude approfondie ne se limite pas à une réévaluation de l'Évangile de Thomas, mais s'étend à une exploration plus vaste de textes apocryphes (Evangile de Marie de Magdala, Evangile de Philippe, Discours du Sauveur,..), souvent marginalisés ou négligés dans l'histoire officielle de l'Église.
Ces découvertes remettent en question les processus de canonisation et les décisions de l'Église qui ont façonné le Nouveau Testament tel que nous le connaissons. Elles soulignent les erreurs potentielles et les choix subjectifs qui ont influencé la préservation et la transmission des enseignements de Jésus. En explorant ces textes, nous découvrons une diversité de voies et d'interprétations qui enrichissent notre compréhension de la figure de Jésus et des croyances des premières communautés chrétiennes.
Cette étude vise donc à non seulement réhabiliter des textes longtemps écartés, mais aussi à reconnaître leur valeur dans la constitution d'un nouveau corpus qui offre une perspective élargie sur la sagesse et les enseignements de Jésus. Elle invite à une réflexion critique sur l'histoire de l'Église et sur la manière dont la tradition chrétienne a été façonnée au fil des siècles.
Dans cette étude, nous débutons par une exploration détaillée de la découverte significative du papyrus 87.5575, analysant sa signification et son impact. Ce document, mélangeant des éléments des Évangiles canoniques avec ceux de l'Évangile de Nous verrons que Thomas, remet en question les frontières traditionnellement établies entre les écrits "canoniques" et "apocryphes". Cette découverte suggère une période de formation du canon du Nouveau Testament moins rigide et plus inclusive que ce que l'histoire officielle de l'Église a longtemps affirmé.
Nous nous pencherons ensuite sur les implications de ce manuscrit et d'autres textes apocryphes pour une compréhension plus complète des enseignements de Jésus, mettant en lumière leur potentiel à enrichir et diversifier la tradition chrétienne. Cette approche critique soulève des questions sur les décisions et les erreurs potentielles de l'Église dans son processus de canonisation.
À travers ces explorations, notre objectif est de réhabiliter certains textes longtemps négligés et de reconnaître leur valeur dans la constitution d'un nouveau corpus, offrant ainsi une perspective élargie sur la sagesse et les enseignements de Jésus.
Emma CATANEO, Boulogne-Billancourt (France) le Dimanche 14 janvier 2024.
"En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu" (Jean 3:3)
I. Introduction et contexte historique
A)Importance de la découverte du papyrus 87.5575 et son impact sur la compréhension du christianisme primitif
La découverte à la fin du XIXème siècle puis la traduction récente du papyrus 87.5575, dans les papyri d'Oxyrhynchos, datant de la seconde moitié du 1er siècle, est significative de la nécessité d'étudier le christianisme primitif et ses textes. La mention d'une version du sermon sur la montagne qui combine des éléments des Évangiles de Matthieu et de Luc avec une citation de l'Évangile de Thomas est particulièrement intrigante. La version du sermon sur la montagne dans ce papyrus diffère de celles de Matthieu et de Luc. L'utilisation du mot grec "ornea" pour "oiseaux" au lieu de "peteina" (Matthieu) ou "korakas" (Luc), indique une variation dans le texte, ce qui implique soit des variations dans les traditions orales, soit des différences dans la transmission des textes. Ces variations linguistiques pourraient être dues à des influences régionales ou à des choix délibérés des transcripteurs pour véhiculer des nuances spécifiques.
"Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent ni n'amassent dans les greniers, et votre père céleste les nourrit; ne valez vous pas beaucoup mieux qu'eux?"
L'inclusion d'une citation de l'Évangile de Thomas dans ce manuscrit suggère une période de préformation du canon du Nouveau Testament où les frontières entre les textes "canoniques" et "apocryphes" n'étaient pas clairement établies. Cela indique une fluidité dans la transmission des enseignements de Jésus et une acceptation plus large de divers textes au sein des communautés chrétiennes primitives.
"Si vous ne jeunez pas au monde, vous ne trouverez pas le royaume de Dieu, si vous n'observez pas le sabbat comme un sabbat vous ne verrez pas le Père".
Si ce manuscrit est daté de la seconde moitié du 1er siècle, il se place avant la rédaction des Évangiles canoniques, habituellement datés de la fin du 1er siècle et du début du 2e siècle. Cela en fait potentiellement le plus ancien écrit chrétien connu. Cette ancienneté pourrait remettre en question les idées traditionnelles sur la formation du canon du Nouveau Testament, la primauté des Évangiles canoniques, mais aussi la réalité du message de Yeshua, qui pourrait être l'enseignement d'un homme sage à des élèves ou disciples afin de trouver, en eux, à leur tour, le chemin de la libération, comme cela s'enseigne depuis des millénaires par exemple en Inde.
B)Ancienneté du manuscrit et implications pour la compréhension des enseignements de Jésus
.
Cette découverte pourrait avoir des implications importantes pour notre compréhension des enseignements de Jésus. Elle suggère que les textes connus comme "apocryphes" pourraient avoir joué un rôle plus important dans les premiers temps du christianisme. dans le christianisme primitif, que ce que l'histoire officielle a retenu. Ces textes pourraient contenir des éléments authentiques des enseignements de Jésus qui n'ont pas été inclus dans les Évangiles canoniques. La présence de textes antérieurs aux Évangiles canoniques remet en cause l'idée que ces derniers sont les témoignages les plus précis ou les plus authentiques ou même les plus anciens sur la vie et les enseignements de Jésus.
Or, ce papyrus citant l'Évangile de Thomas, pourrait dès lors impliquer que cet évangile représente toute ou partie de la "source Q", une source jusqu'à présent hypothétique suggérée par des chercheurs pour expliquer les similitudes entre Matthieu et Luc. Cela suggérerait une proximité plus grande de l'Évangile de Thomas avec les enseignements originaux de Jésus. Cela pourrait indiquer que d'autres écrits, comme ceux trouvés dans le papyrus 87.5575, étaient également respectés et valorisés dans les premières
communautés chrétiennes. Cela pourrait signifier aussi que les enseignements oraux de Jésus étaient plus axés sur la sagesse pratique et la recherche spirituelle personnelle, plutôt que sur la formulation de doctrines rigides.
Si les textes comme ceux de l'Évangile de Thomas étaient plus répandus dans le christianisme primitif, cela pourrait indiquer que l'accent était mis sur la recherche intérieure et la libération spirituelle, une approche plus personnelle et mystique de la "foi". Cela contraste avec l'approche plus dogmatique et institutionnelle qui a prévalu dans le christianisme ultérieur.
Cette découverte pourrait donc potentiellement transformer notre compréhension du christianisme primitif, en soulignant la diversité des interprétations des enseignements de Jésus et en remettant en question la primauté et l'exclusivité des Évangiles canoniques. Elle invite à une réévaluation de la nature des enseignements de Jésus, peut-être en tant qu'invitation à une quête personnelle de sagesse et de libération spirituelle.
C)Approche et objectifs du livre
D'où l'idée de rédaction d'un livre axé sur les enseignements de Jésus en tant que source de sagesse et de libération spirituelle, indépendamment des controverses religieuses, dépouillé des aspects biographiques, iconographiques et des éléments miraculeux, afin de présenter une approche novatrice et inclusive, ou plutôt tenter de redécouvrir la Parole du Rabbi.
Ce livre se distingue en explorant les paroles de Yeshua (Jésus) d'une manière qui transcende les interprétations traditionnelles. Il vise à dévoiler la sagesse profonde de ses enseignements, les rendant accessibles et pertinents pour un public moderne. La Sagesse de Jésus est conçu comme un guide neutre et inclusif, s'adressant à ceux qui cherchent la sagesse et
la spiritualité au-delà des barrières religieuses. Il est destiné à un large éventail de lecteurs, qu'ils soient athées, croyants, ou simplement en quête de compréhension spirituelle.
Ce livre offre une nouvelle perspective sur les enseignements de Jésus, en les plaçant dans un contexte contemporain. Il encourage une réflexion personnelle et propose une voie vers une spiritualité enrichie et renouvelée. La Sagesse de Jésus invite à un dialogue respectueux et enrichissant entre différentes croyances, différentes traditions, en mettant aussi en lumière les parallèles entre les enseignements de Jésus et diverses traditions spirituelles.
Ce livre se concentre sur l'exploration des enseignements de Jésus, qui ont d'abord été transmis oralement puis consignés par écrit. L'objectif est de rechercher ces enseignements, sans les ajouts, modifications, et légendes qui pourraient obscurcir le message original. Ce qui est primordial ici, c'est le message lui-même, les paroles de Jésus, qui, bien qu'ayant une signature reconnaissable et unique, trouvent des échos et des résonances dans les enseignements d'autres sages et maîtres spirituels à travers l'histoire et les différentes cultures du monde.
D) Le personnage Jésus
Jésus est la figure centrale du christianisme, considéré par la majorité des chrétiens comme le fils de Dieu et le sauveur de l'humanité.
Né à Bethléem au début de l'ère chrétienne, il a vécu principalement en Galilée et en Judée. Ses enseignements, ses miracles, sa crucifixion et sa résurrection sont au cœur des croyances chrétiennes.
Ces événements sont principalement documentés dans les Évangiles du Nouveau Testament de la Bible.
Sa vie et ses enseignements, tels que présentés dans ces textes, ont eu un impact considérable sur l'histoire et la culture, influençant l'art, la philosophie, la politique et divers aspects de la société.
Mais qu'en est-il réellement ?
L'étymologie du nom "Jésus" traverse plusieurs langues et cultures :
En Français "Jésus" vient du latin "Iesus".
"Iesus" est la forme latine du nom grec (Iēsous).
En Grec (Iēsous) est la translittération de nom hébreu et araméen. Ce nom grec est utilisé dans le Nouveau Testament, écrit en grec ancien.
En Hébreu le nom est (Yeshua) ; "Yeshua" est une forme tardive, abrégée du nom hébraïque (Yehoshua), qui signifie "Yahweh sauve" ou "Yahweh est le salut".
En Araméen la forme araméenne du nom est également (Yeshua), similaire à l'hébreu.
L'araméen était la langue courante en Judée au temps de Jésus.
Le nom "Jésus" et le terme "Emmanuel" (ou "Immanuel" en hébreu) sont tous deux associés à la figure de Jésus.-
Emmanuel (Immanuel) vient de l'hébreu (Immanuel), qui signifie "Dieu avec nous".
Ce terme apparaît dans le livre d'Isaïe de l'Ancien Testament (Isaïe 7:14) et est interprété par les chrétiens comme une prophétie de la naissance de Jésus.
L'Évangile selon Matthieu (1:23) cite cette prophétie d'Isaïe pour montrer que la naissance de Jésus est l'accomplissement de cette promesse, signifiant la présence de Dieu avec son peuple par l'incarnation de Jésus.
"Jésus" et "Emmanuel" sont donc des noms utilisés pour désigner la même figure centrale du christianisme, mais avec des significations différentes : "Jésus" souligne son rôle de sauveur, tandis qu'"Emmanuel" met en lumière sa nature divine et sa présence parmi les hommes.
Comme mentionné précédemment, notre exploration dans "La Sagesse de Jésus" se concentre moins sur les détails de l'iconographie, les légendes, l'historicité, et les aspects miraculeux ou merveilleux, réels ou supposés, associés à la figure de Jésus Yeshua. Notre démarche vise à plonger dans la profondeur de ses enseignements, en écartant les couches d'interprétations et de mythes qui ont souvent enveloppé sa figure au fil des siècles.
Nous noterons cependant certaines observations qui peuvent éclairer notre compréhension du contexte dans lequel ces enseignements ont été dispensés. Par exemple, il est possible que Jésus soit né à Nazareth plutôt qu'à Bethléem, une hypothèse qui s'appuie sur une analyse des textes et des traditions historiques. De plus, la date exacte de sa naissance soulève des questions, compte tenu des incohérences entre les recensements de l'époque (Hérode aux alentours de -7 ou -6, Quirinus vers +3) et des phénomènes astronomiques notables. Ces éléments ne sont pas de simples détails triviaux ; ils nous aident à situer Jésus dans un cadre historique et culturel réel, nous permettant ainsi de mieux comprendre le contexte de ses paroles et actions.
Cependant, l'accent principal de ce livre reste fermement sur l'essence et la portée universelle des enseignements de Jésus. En déplaçant notre attention des détails historiques vers la substance de son message, nous découvrons une sagesse qui transcende le temps et l'espace, offrant des réflexions et des orientations pertinentes pour notre époque. C'est dans cet esprit que nous invitons le lecteur à explorer "La Sagesse de Jésus", en cherchant à comprendre comment ses paroles peuvent éclairer notre chemin personnel vers la compréhension et la croissance spirituelle au quotidien.
Nous avançons l'hypothèse que l'Évangile selon Thomas ainsi que d'autres "apocryphes" pourrait préserver de manière plus fidèle les enseignements originels de Jésus Christ dans le contexte du christianisme. Pour soutenir cette idée, notre démarche consistera à examiner et comparer minutieusement les paroles de Jésus telles qu'elles sont présentées dans l'Évangile selon Thomas avec celles des Évangiles canoniques comme Matthieu et Marc.
Tout d'abord, nous étudierons les similitudes et les différences dans les thèmes abordés, le langage utilisé et les structures narratives. Cette analyse nous permettra d'évaluer si les enseignements présents dans l'Évangile selon Thomas représentent une forme plus primitive ou non interprétée par rapport aux textes canoniques.
Ensuite, nous plongerons dans le contexte historique de l'Évangile selon Thomas. Nous chercherons à déterminer quand il a été écrit, qui pourrait en être l'auteur, et comment il se compare, en termes de style, de contenu et de forme, non seulement aux Évangiles canoniques mais aussi à d'autres écrits apocryphes.
Considérant que les enseignements de Jésus ont d'abord été transmis oralement, une partie de notre étude se concentrera sur la manière dont ce mode de transmission aurait pu influencer la conservation de ses paroles dans l'Évangile selon Thomas, en comparaison avec les Évangiles canoniques.
Nous évaluerons également la cohérence des enseignements de Thomas avec les croyances et les pratiques du judaïsme du 1er siècle, ainsi que le contexte culturel dans lequel Jésus a vécu. Cette approche nous aidera à comprendre si l'Évangile selon Thomas reflète fidèlement l'environnement historique et religieux de Jésus.
Enfin, nous analyserons les éléments de langage utilisés dans l'Évangile selon Thomas. En particulier, nous examinerons l'usage de paraboles et d'aphorismes, qui sont des éléments caractéristiques des enseignements de Jésus. Cette analyse linguistique pourra donner des indices sur la proximité de Thomas avec les formes originales d'enseignement de Jésus.
"On ne dira pas il est ici ou il est là : Car voici, le Royaume de Dieu est au milieu de vous" (Luc 17:21)
II. Origines et influences de l'Évangile selon Thomas
A)Influence de l'Évangile de Thomas sur la Compréhension de la Source Q
Impact de la découverte de l'Évangile de Thomas sur les hypothèses concernant la source Q et les origines des textes évangéliques
Découvert en 1897 sur le site d'Oxyrhynque en Égypte, la redécouverte récente du manuscrit copte (papyrus 87.5575), par sa retranscription à présent disponible, apporte une nouvelle lumière sur la datation et l'origine de l'Évangile selon Thomas, ainsi que sur sa relation avec les Évangiles synoptiques et la source hypothétique Q. Auparavant, les estimations de la datation de l'Évangile selon Thomas variaient entre le milieu du 1er siècle et le milieu du 2ème siècle après J.-C. Cependant, cette nouvelle découverte pourrait indiquer une origine plus précoce, peut-être aussi tôt que le milieu du 1er siècle, ce qui placerait Thomas comme l' écrit chrétien le plus ancien.
En considérant la collection de citations comme une forme littéraire courante dans la première période de l'activité littéraire chrétienne, l'Évangile selon Thomas pourrait représenter la forme primitive des enseignements de Jésus. Cette perspective pourrait même peut être aboutir à ce que Thomas et la source Q soient en fait la même source. La découverte du papyrus 87.5575 renforce l'hypothèse selon laquelle Thomas pourrait être contemporain ou même précéder les Évangiles synoptiques.
En analysant la structure et le contenu de l'Évangile de Thomas, nous pouvons examiner son lien possible avec la source Q. Si Thomas et Q partageaient effectivement une source orale commune, cela impliquerait que les enseignements de Jésus préservés dans Thomas sont plus proches de leur forme originale que ceux des évangiles canoniques. Cette hypothèse est soutenue par les similitudes entre les deux sources, indiquant qu'ils pourraient être des rédactions ultérieures d'une source orale unique.
L'Évangile de Marc, étant le plus court des synoptiques, présente un style plus simple et moins élaboré, ce qui pourrait indiquer une forme plus primitive du récit évangélique. En revanche, les Évangiles de Matthieu et Luc semblent être des développements ultérieurs. La fréquence des phrases en araméen dans l'Évangile de Marc, souvent accompagnées de traductions en grec, suggère une proximité avec les événements et les paroles originales de Jésus. Matthieu et Luc, quant à eux, ne suivent pas cette pratique et sont probablement des arrangements ultérieurs.
L'hypothèse selon laquelle l'Évangile selon Thomas pourrait être la source Q, si elle était avérée, aurait des implications profondes pour la compréhension des évangiles canoniques et de l'histoire du christianisme primitif. Cela mettrait en lumière la possibilité que les enseignements de Jésus aient été transmis de manière plus variée et moins structurée qu'on ne le pensait auparavant, remettant en question les notions traditionnelles de la formation du canon du Nouveau Testament et ouvrant la voie à une compréhension renouvelée des origines du christianisme.
Le papyrus récemment traduit présente une combinaison unique d'éléments des Évangiles de Matthieu, de Luc et de l'Évangile de Thomas dans un seul manuscrit oblige à réexaminer minutieusement certains textes "apocryphes", afin de mettre fin à l'autodafé.
B)L'Évangile de Thomas et la tradition orale primitive
La place potentielle de l'Évangile de Thomas dans la tradition orale primitive et son influence sur les textes canoniques ultérieurs
Si ce manuscrit se révèle être l'un des plus anciens écrits chrétiens, cela impliquerait que l'Évangile de Thomas est peutêtre plus proche des enseignements originaux de Jésus que nous ne l'avions supposé. Cette perspective nous invite à reconsidérer la nature des enseignements de Jésus, suggérant un accent sur la libération intérieure et la quête personnelle de sagesse, plutôt que sur une doctrine rigide et formaliste insistant sur la croyance et le miraculeux.
La découverte du papyrus 87.5575 révèle une facette du christianisme primitif axée sur la sagesse pratique, contrastant avec l'approche plus dogmatique et institutionnelle du christianisme ultérieur. Elle nous encourage à revisiter les enseignements de Jésus avec un regard neuf, explorant les valeurs universelles et la sagesse intemporelle présentes dans ses paroles.
Nous avançons l'hypothèse que l'Évangile selon Thomas pourrait préserver de manière plus fidèle les enseignements originels de Jésus Christ dans le contexte du christianisme. Pour soutenir cette idée, notre démarche consistera à examiner et comparer minutieusement les paroles de Jésus telles qu'elles sont présentées dans l'Évangile selon Thomas avec celles des Évangiles canoniques de Matthieu et de Marc. Cette analyse approfondie nous permettra de déterminer si Thomas représente une forme plus primitive des enseignements de Jésus, en comparaison avec les textes canoniques.
Nag Hammadi
La découverte de l'Évangile de Thomas en 1945 à Nag Hammadi a déjà significativement influencé notre compréhension de la source Q et des origines des textes évangéliques. Cette découverte a brisé l'idée préconçue qu'un évangile ne pourrait consister uniquement en paroles sans éléments narratifs. L'Évangile de Thomas, avec son focus sur les enseignements et paraboles, offre un parallèle intrigant avec ce que les chercheurs supposent être la nature de la source Q, renforçant l'idée qu'une telle compilations de paroles du Maître aurait pu exister dans le christianisme primitif.
.Cette hypothèse est renforcée par la datation précoce potentielle du papyrus, qui suggère que Thomas aurait pu être contemporain, voire antérieur, aux Évangiles synoptiques.
Si Thomas est proche de la source Q, cela pourrait impliquer que les enseignements de Jésus conservés dans cet évangile sont plus proches de leur forme originale que ceux des évangiles canoniques. Cela soulève des questions sur la manière dont Matthieu et Luc ont pu évoluer à partir d'une source plus primitive, intégrant des ajouts et des modifications pour s'adapter à leurs besoins théologiques et contextuels.
L'analyse scientifique, telle que celle de Helmut Koester, suggèrait déjà que l'Évangile de Thomas pourrait avoir évolué indépendamment des paraboles synoptiques, à partir d'une source orale distincte. Cette idée appuie la théorie que Thomas et Q partageaient une tradition orale commune, plutôt que Thomas dépendant directement de Q ou des Synoptiques.
Dans mon hypothèse, Jésus est envisagé principalement comme un sage humain, avec un accent sur ses paroles et enseignements. L'Évangile de Thomas, mettant l'accent sur les enseignements directs de Jésus, sans les éléments surnaturels ou miraculeux présents dans les Évangiles canoniques, correspond davantage à l'idée d'un sage dont les enseignements ont été transmis oralement puis soigenusement consignés.
Les Évangiles canoniques, avec leurs récits de miracles et d'événements surnaturels, semblent alignés sur la croyance en Jésus comme une figure messianique et divine exclusive. En contraste, l'Évangile de Thomas offre une perspective plus humaine, centrée sur les enseignements et maximes de Jésus, en phase avec la parole d'un sage ou d'un enseignant.
Les Évangiles canoniques ont été rédigés dans un contexte où les communautés chrétiennes interprétaient et comprenaient Jésus non seulement comme un enseignant mais aussi comme le Messie et le Fils de Dieu. Ces interprétations sont ancrées dans les croyances et les attentes juives de l'époque où les prophètes, guérisseurs et magiciens pullulaient.
L'Évangile de Thomas, avec son absence de narration et son focus sur les enseignements, pourrait refléter une tradition où Jésus est principalement vu comme un sage. illuminé.
Il est largement reconnu que les enseignements de Jésus ont été transmis oralement avant d'être consignés par écrit. Cela est vrai tant pour les Évangiles canoniques que pour l'Évangile de Thomas.
La forme orale de la transmission peut expliquer certaines des variations et des différences dans les récits et les enseignements.
Si nous envisageons Jésus principalement comme un sage humain, les récits de miracles dans les Évangiles canoniques pourraient être interprétés comme des embellissements ou des interprétations théologiques de ses disciples dans certaines communautés chrétiennes qui ont essaimé.
Dans cette optique, l'Évangile de Thomas, avec son absence de récits surnaturels, apparaît comme une source potentiellement plus 'pure' ou authentique des enseignements de Jésus. Cette perspective critique des Évangiles canoniques suggère qu'ils pourraient avoir incorporé des éléments merveilleux pour susciter l'adhésion, éventuellement en trahissant le message originel de Jésus. Cette idée, bien que controversée, soulève des questions essentielles sur l'authenticité historique et la fidélité théologique des textes évangéliques.
Les Évangiles canoniques, en combinant récits historiques, enseignements, paraboles et éléments surnaturels, reflètent la foi de communautés chrétiennes. Les miracles y sont souvent perçus comme des illustrations de la nature divine de Jésus et de sa mission. Dans le contexte de l'époque, ces récits étaient culturellement pertinents pour communiquer des vérités théologiques ou morales.
L'interprétation des Évangiles, y compris la présence de miracles, varie largement. Pour certains, ils sont littéraux, pour d'autres, des métaphores. Les critiques des Evangiles canoniques, telles que les miennes, suggèrent que ces textes pourraient éclipser le message originel de Jésus au profit d'une narration plus contrôlée ou séduisante à l'intention des masses.
Les évangiles canoniques seraient ainsi des retouches des enseignements originaux destinées à servir une institution en plein développement et lui donner un cadre adapté.
C'est l'arme de Rome et la victoire du dessein de Pierre.
Le débat sur la nature et l'interprétation des Évangiles reste vivant dans les cercles académiques, religieux et laïques. L'hypothèse selon laquelle l'Église a trahi le message originel de Jésus est une opinion fréquente dans l'histoire, souvent exprimée dans le cadre de critiques envers les institutions ecclésiastiques et leurs pratiques.
"Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences; mais, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches". (Matthieu 13 : 31-32)
III. La Formation du Canon du Nouveau Testament
Exploration du processus de canonisation des textes chrétiens et l'exclusion de l'Évangile de Thomas
L'Église a traversé diverses phases et évolutions. Parfois, elle a été critiquée pour des actions en contradiction avec les enseignements de Jésus, notamment en termes de richesse, de pouvoir et d'abus d'autorité. La Réforme protestante en est un exemple, motivée par une critique de la corruption et des pratiques jugées non conformes aux enseignements de Jésus au sein de l'Église catholique romaine.
L'Église comprend une grande diversité de traditions et de dénominations, certaines s'efforçant de revenir aux enseignements originaux de Jésus, avec un accent sur la justice sociale, l'aide aux pauvres et la simplicité. Les enseignements de Jésus ont été interprétés et adaptés de différentes manières, certaines pratiques ecclésiastiques pouvant être comprises comme des adaptations de ces enseignements à des contextes culturels et historiques spécifiques.
L'approche de revenir aux racines des enseignements de Jésus, en le considérant comme un sage humain et non exclusivement comme une figure divine, représente un effort pour distinguer les aspects historiques et culturels des textes bibliques des interprétations théologiques ultérieures développées au sein de l'Église. Cette perspective est renforcée par la découverte récente du papyrus 87.5575, qui semble mélanger des éléments des Évangiles de Matthieu, Luc et l'Évangile de Thomas, indiquant une diversité des traditions chrétiennes primitives et une possible source commune au Ier siècle pour ces textes.
Considérer Jésus principalement comme un enseignant (Rabbouni) ou un sage met l'accent sur le contenu de ses enseignements , tels que l'amour, la compassion, l'humilité et la justice sociale. L'Évangile de Thomas, qui se focalise sur les paroles attribuées à Jésus sans inclure de récits narratifs ou miraculeux, semble offrir une vision plus directe de ces enseignements.
C'est d'ailleurs ce qu'intuitivement certains chrétiens ont cherché à recréer à travers des ordres monastiques.
Les Évangiles canoniques, tout en soulignant la divinité de Jésus, contiennent également des enseignements fondamentaux sur l'amour du prochain et la vie dans le royaume de Dieu. Ces thèmes résonnent avec l'idée d'un chemin ouvert à tous pour devenir 'enfants de Dieu'.
Cette approche critique les écarts entre les enseignements de Jésus et certaines pratiques de l'Église, soulignant un appel à une compréhension et une pratique plus authentiques et fidèles à l'esprit des enseignements de Jésus.
L'Évangile de Thomas est donc vu ici comme une source de sagesse spirituelle, mettant l'accent sur la connaissance intérieure et la relation directe avec le divin, en accord avec l'idée de Jésus comme sage.
L'approche historico-critique cherche à comprendre les enseignements de Jésus dans leur contexte d'origine, séparant les interprétations ultérieures ajoutant des couches de théologie et de doctrine.
Considérer Jésus comme un enseignant et sage permet de voir ses paroles comme offrant une sagesse universelle, applicable au-delà des frontières religieuses.
Cette interprétation favorise l'utilisation pratique des enseignements de Jésus dans la vie quotidienne et encourage une exploration personnelle et introspective.
La découverte du papyrus 87.5575 et son mélange unique de textes soulève des questions sur la relation entre l'Évangile de Thomas et la source hypothétique Q. Si Thomas et Q partagent une tradition orale commune, cela pourrait indiquer que Thomas représente une forme plus ancienne de la tradition chrétienne, antérieure aux Évangiles canoniques.
L'évangile selon Thomas est attribué à Thomas, identifié comme Didyme Judas Thomas, un des apôtres de Jésus.
Contrairement aux Évangiles canoniques, l'Évangile selon Thomas ne raconte pas la vie ou la mort de Jésus. Il est composé de déclarations attribuées à Jésus, présentées sous forme de paroles de sagesse ou d'aphorismes nommées Logia.
L'Evangile de Thomas contient des éléments gnostiques, qui étaient souvent en désaccord avec les doctrines de l'Église chrétienne émergente.
Le gnosticisme mettait l'accent sur la connaissance (gnose) personnelle et secrète (d'où le terme apocryphe) comme voie de salut, contrairement à l'approche plus institutionnelle et dogmatique de l'Église.
Ces enseignements gnostiques pouvaient être perçus comme menaçant l'autorité de l'Église et la structure hiérarchique en place, en favorisant une expérience religieuse individuelle et intérieure.
L'Évangile selon Thomas ne mentionne pas la crucifixion, ni la résurrection, ni le concept de rédemption par le sacrifice de Jésus, qui sont pourtant des piliers du christianisme officiel. Cette omission pouvait être interprétée dès les premiers siècles du christianisme comme une remise en question de la base même de la foi chrétienne.
Bien que l'Évangile selon Thomas partage certains logia ou déclarations avec les Évangiles canoniques, il les présente souvent dans un contexte différent ou avec des interprétations qui divergent des enseignements traditionnels.
Ces différences pouvaient semer le doute ou la confusion parmi les fidèles quant à la véritable nature et aux enseignements de Jésus.
En proposant une version différente des paroles de Jésus, l'Évangile selon Thomas pouvait être vu comme contestant l'autorité et la légitimité des Évangiles canoniques.
Cela aurait pu conduire à une remise en question des textes choisis pour le Nouveau Testament et, par extension, de l'autorité de l'Église qui les avait canonisés.
Certains passages de l'Évangile selon Thomas suggèrent une approche plus égalitaire en termes de spiritualité, y compris le rôle des femmes dans la vie religieuse, ce qui pouvait être en opposition avec les normes patriarcales de l'Église romaine.
En encourageant une relation directe et personnelle avec le divin, l'Évangile selon Thomas pouvait être vu comme menaçant la hiérarchie ecclésiastique établie et le rôle des prêtres et des évêques comme médiateurs nécessaires entre Dieu et les fidèles.
D'ailleurs ces derniers pouvaient être mariés aux temps du christianisme primitif.
Dans la culture juive de l'époque, être marié était souvent la norme, en particulier pour les rabbins et autres figures religieuses.
Pour les premiers clergés chrétiens, il est documenté que le mariage était permis dans les premiers siècles du christianisme, et de nombreux prêtres, évêques, et même des papes étaient mariés.
Le célibat a été exigé des prêtres catholiques romains seulement à partir de 1075,