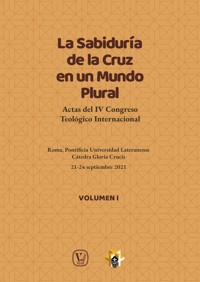24,50 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Velar
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Du 21 au 24 septembre 2021, s'est tenu à Rome, à l'Université Pontificale du Latran, le IV Congrès Théologique International des Passionistes sur le thème : La Sagesse de la Croix dans un Monde Pluriel". Il se déroule dans le cadre des célébrations jubilaires du troisième centenaire de la Fondation de la Congrégation passioniste et vise à approfondir l'actualité de la Croix dans le contexte des nombreux aréopages contemporains. Pendant les quatre jours, plus de 100 intervenants, universitaires et spécialistes de nombreux milieux académiques et culturels de portée internationale, des universités romaines ainsi que de nombreuses nations des différents continents, se sont succédés. La riche expérience scientifique, culturelle et spirituelle du Congrès est recueillie en trois volumes (plus de 1 100 pages), dont le premier a également été traduit de l'italien en quatre langues (anglais, français, espagnol et portugais).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
La Sagesse
de la Croix
dans un Monde
Pluriel
Actes du IV Congrès
Théologique International
Rome, Université Pontificale du Latran
Chaire Gloria Crucis
21-24 septembre 2021
édité par
Fernando Taccone et Ciro Benedettini
TOMEI
Message du Pape François aux participants au Congrès
Au R.P. Joachim REGO CP.
Supérieur Général de la
Congrégation de la Passion de Jésus Christ
J’adresse une cordiale salutation aux Participants au Congrès Théologique International, qui aura lieu près de l’Université Pontificale du Latran du 21 au 24 septembre prochain, sur le thème « la Sagesse de la Croix dans un Monde Pluriel ». Ce Congrès se situe dans le Contexte des Célébrations Jubilaires pour le Troisième Centenaire de la Fondation de la Congrégation passioniste et se propose d’approfondir l’actualité de la Croix au cœur des multiples aréopages contemporains. Il répond en un sens au désir de Saint Paul de la Croix de travailler pour que le Mystère pascal, centre de la foi chrétienne et charisme de la Famille religieuse passioniste, rayonne et se diffuse, en réponse à Charité divine et pour venir à la rencontre des attentes et des espérances du monde.
L’Apôtre Paul parle de la largeur, de la longueur, de l’hauteur et de la profondeur de l’amour du Christ (cf. Ep 3,18). En contemplant le Crucifié, nous voyons tout ce qui est humain embrassé par la miséricorde de Dieu. Son amour de kénose et de compassion désire toucher, à travers la Croix, les quatre points cardinaux et rejoindre à l’extrême notre condition, reliant d’une manière indissociable le rapport vertical avec Dieu et celui horizontal avec les hommes, en une fraternité que la mort de Jésus a définitivement rendu universelle.
L’immense puissance salvifique qui surgit de la faiblesse de la Croix indique à la théologie l’importance d’un style qui sache unir la hauteur de la pensée à l’humilité du cœur. Face au Crucifié, elle est donc invitée à se tourner vers la condition la plus fragile et concrète de l’homme, renonçant à toutes formes et d’intentions polémiques, partageant joyeusement la fatigue de l’étude et recherchant avec confiance les précieuses semences que le Verbe répand dans la pluralité morcelée et parfois contradictoire de la culture.
La Croix du Seigneur, source de salut pour l’homme de tout lieu et de tout temps, est en cela actuelle et efficace, surtout en une situation comme celle d’aujourd’hui, caractérisée par des changements rapides et complexes. C’est donc opportunément que le Congrès théologique se propose de décliner la Sagesse de la Croix en divers milieux – comme les défis de la culture, la promotion de l’humanisme, le dialogue interreligieux et les nouvelles formes de l’Evangélisation – associant à la réflexion scientifique une série de manifestions qui en attestent l’incidence bénéfique en diverses situations.
Je souhaite donc que l’initiative, tout en promouvant de féconds échanges théologiques, culturels, et pastoraux, contribue à une lecture renouvelée des défis contemporains à lumière de la Sagesse de la Croix, pour favoriser une évangélisation fidèle au « style » de Dieu et proche de l’homme. En formulant mes souhaits cordiaux pour ces journées d’étude, j’invoque la protection de la Vierge Sainte et de Saint Paul de la Croix, et de cœur je donne aux intervenants, aux organisateurs, et à tous ceux qui prennent part à cette Assise importante, la Bénédiction Apostolique, en demandant à tous de continuer à prier pour moi.
Rome, Saint Jean de Latran, le 1er juillet 2021
Présentation
Taccone Fernando1
« Merci » est le mot qui convient pour présenter les Actes du IVème Congrès théologique international La Sagesse de la Croix dans un monde pluriel, célébré à Rome auprès de l’Université pontificale du Latran du 21 au 24 septembre 2021, à l’occasion du 3ème Centenaire de la fondation de la Congrégation passioniste (1720-2020). Le remerciement s’adresse avant tout au Supérieur général, le père Joachim Rego, qui a fortement voulu ce Congrès, et à son Premier Consulteur, le père Ciro Benedettini. Ce « Merci » va ensuite au Recteur magnifique de l’Université pontificale du Latran, le professeur Vincenzo Buonomo, pour sa grande cordialité et son accueil chaleureux.
Ce remerciement s’étend au Conseil général, à la Commission pour le Jubilé, à l’Université pontificale du Latran, au Comité de la Chaire Gloria Crucis, au Comité du Congrès, aux traducteurs, au Secrétariat que j’évoquerai plus en détails par après. Merci à l’agence Else Elettronica Servizi de Salvatore Spinella pour la transmission en ligne en italien, anglais et espagnol et à l’Agence de communication Q Group de Elena Borghide, Rimini, pour la diffusion sur les réseaux sociaux.
1. Le Congrès
Les buts formatifs et apostoliques du Congrès ont été indiqués très clairement par le Supérieur général dans sa lettre de convocation : « Puisse le Congrès international organisé par notre Chaire Gloria Crucis à l’Université pontificale du Latran sur La Sagesse de la Croix dans un monde pluriel présenter éminemment et scientifiquement le salut offert à l’homme d’aujourd’hui, assoiffé de rédemption et à la recherche constante de la vérité ».
Je le présente en 6 flashs.
Le premier estune intervention concernant la Chaire Gloria Crucis. Elle a été fondée par les Passionistes italiens en 2003 en pleine harmonie d’intention avec les autorités académiques de l’Université pontificale du Latran. « La Chaire vise à promouvoir la mémoire de la Passion du Christ et à approfondir la conscience de son sens et de sa valeur pour chaque homme et pour la vie du monde. La Passion du Christ – ‘l’œuvre la plus grande et la plus merveilleuse de l’amour divin’ (saint Paul de la Croix) –, devient le remède le plus efficace contre les maux du monde. En cela se trouve toute la force de la mission particulière dans l’Église : ‘nous prêchons le Christ crucifié’ (1Co 1,23), dont nous proclamons aussi : ‘Il est ressuscité’ (Mt 28,6). La connaissance de la Passion du Christ et des hommes constitue le seul mystère du salut » (Constitution de la Chaire, n. 2).
Le second estl’engagement pris depuis environ 50 ans par la Congrégation passioniste, conformément à son charisme, dans la promotion de l’étude et de la recherche sur le Mystère de la Croix au niveau scientifique, à l’écoute attentive et critique des instances et des défis du monde contemporain. À ce jour, trois Congrès théologiques internationaux ont été organisés pour lesquels l’on a choisi comme dénominateur commun, clé herméneutique et point d’appui, la formule programmatique « La Sagesse de la Croix aujourd’hui ».
Le premier Congrès, intitulé « La Sagesse de la Croix aujourd’hui », a été organisé à l’occasion du 3ème Centenaire de la mort de saint Paul de la Croix ; il a eu lieu à Rome, auprès de l’Athénée pontifical Antonianum, du 13 au 18 octobre 1975. Le thème a été examiné sous l’angle de la révélation, de l’œcuménisme, de la spiritualité, de la culture et de la pastorale. Le deuxième Congrès, organisé pour commémorer le 1950ème anniversaire de la Rédemption, eut lieu presque 10 ans plus tard, toujours à l’Athénée Antonianum, du 6 au 9 février 1984, et le thème général s’est interrogé surtout sur le salut chrétien et les cultures modernes. Le troisième Congrès, tenu à l’Antonianum du 9 au 13 janvier 1995, a été centré sur le thème « La Croix du Christ, l’unique espérance » ; il figura dans le programme des célébrations du 3ème Centenaire de la naissance de saint Paul de la Croix.
Le troisième flash porte sur notre 4ème Congrès. Il est légitime de se demander, pourquoi encore un autre congrès sur la Sagesse de la Croix ? La réponse vient toute seule, de la ferme conviction que la puissance et la sagesse de Dieu sont présentes et révélées, pour le salut du monde, dans le mystère de la Croix du Seigneur Jésus-Christ. C’est de ce mystère qu’elles doivent sans cesse puiser, par des accents nouveaux et actuels, les réponses rigoureuses et les propositions résolutives inhérentes à la vérité qui sauve, en tous les temps. Cela est tout particulièrement vrai à notre époque fortement troublée, ces dernières années et ces derniers jours, par tant d’événements dramatiques qui provoquent souffrances, doutes, incertitudes et craintes. La crise écologique, la pandémie, les conflits qui déchirent les peuples et les nations, l’écroulement de tant de valeurs humaines et religieuses, le drame des pauvres et des migrants, constituent autant de défis cruciaux pour la foi, la théologie et l’évangélisation. Des défis qui sont sans aucun doute marqués par des connotations nouvelles et plus dramatiques que dans les décennies précédentes. Tout cela exige une réflexion rigoureuse, ouverte au don de la sagesse et attentive aux impulsions de la prophétie, docile à la voix et aux suggestions du Saint-Esprit. Une réflexion caractérisée d’une manière toujours plus incisive par l’écoute, le dialogue, la synodalité, la solidarité, la fraternité universelle et le partage à l’égard de bien d’autres voix, questions, propositions et critiques provenant des quatre coins du monde, ainsi que des situations existentielles de personnes et de peuples qui se retrouvent en marge de l’histoire contemporaine et dans les périphéries les plus reculées.
Le Congrès actuel aborde directement la question suivante : quelle est cette Parole de la Croix, pleine de Sagesse, qui annonce et communique l’espérance et le salut au monde pluriel ? La proposition théologique et formative est discutée d’abord dans les interventions de base qui ont lieu pendant les sessions générales du matin, puis dans les interventions sectorielles de l’après-midi, par des communications ultérieures prévues dans les sections linguistiques en italien, anglais, espagnol et français.
À la lumière d’une proposition aussi riche et polyvalente, la contribution des participants au cours des espaces prévus pour le dialogue a été très utile, car ils sont devenus les porte-parole et les protagonistes d’une « réflexion » plus approfondie et stimulante, dont les résultats essentiels ont été présentés lors de la table ronde qui a clôturé les travaux les 21, 22, 23 et 24 septembre.
Le quatrième flash indique les 103 intervenants qui se sont relayés pendant les quatre jours du Congrès. Ce sont des savants et des spécialistes d’envergure internationale issus de différents milieux académiques et culturels, des universités de Rome ainsi que de nombreux Pays des différents continents, de même que de nombreuses nations de divers continents. Ont participé quelques Cardinaux Préfets des Dicastères et Fonctionnaires du Vatican. Les nations les plus représentées étaient : Argentine, Australie, Brésil, Colombie, Indonésie, Angleterre, Irlande, Italie, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République démocratique du Congo, Espagne, États-Unis, Suisse.
Certains intervenants n’ont pas pu être présents en raison de la pandémie.
L’apport scientifique d’un groupe d’intervenants aussi qualifiés constitue, entre autres, le signe concret d’une collaboration interuniversitaire, interdisciplinaire et interculturelle fructueuse et stimulante.
Par le cinquième flash, je signale trois initiatives présentées directement par les protagonistes des présents Actes.
Le « Concert sur les chants de la Passion » organisé par le Chœur du Diocèse de Rome dirigé par le Maître Mgr. Marco Frisina. Cette initiative a vu la première exécution de l’hymne pour le Chemin de la Croix pour 1 ou 4 voix : paroles et musiques composées par le Maître Frisina.L’exposition d’art Gloria Passionis organisée par le critique d’art Giuseppe Bacci, et tenue auprès de la Scala Santa de Rome.L’exposition photographique de l’artiste Stefano Guindani, organisée par le professeur Francesca Turci, centrée sur l’activité sociale et apostolique que le père passioniste Richard Frechette, médecin, mène à Haïti, soutenu par la fondation Francesca Rava de Milan.Le dernier flash concerne deux publications :
Le Dictionnaire de la Passion de Jésus-Christ. Il a été mis au point en espagnol par les confrères Luis Diez Merino, Robin Ryan et Adolfo Lippi. L’édition italienne a été réalisée grâce à la participation de la Chaire Gloria Crucis. C’est le premier ouvrage encyclopédique centré sur la Croix et son annonce au monde moderne. Les 166 articles qui le composent ont été rédigés par des experts du monde entier en employant un langage clair, convaincant et accessible à tous. Différentes disciplines sont prises en compte : des Saintes Écritures à la théologie, de la spiritualité à la mystique, de la liturgie à la dévotion et à la piété populaire, de l’histoire à l’archéologie, de la philosophie à la culture, de l’art à l’écologie.Je fais mien le vœu exprimé dans cet ouvrage par notre Supérieur général : « Nous souhaitons que cet ouvrage, fruit de tant d’efforts dans les domaines les plus divers de la connaissance humaine, centré sur la Passion de Jésus, contribue grandement à la connaissance et à la vénération du mystère de la Passion et de la Mort de Jésus-Christ, mystère central du message chrétien ». Éditions Messaggero Padova – Velar.1200 pages, couverture cartonnée avec étui.
« Pèlerins avec le Christ dans un monde pluriel ». Un titre évocateur, qui représente une importante initiative concrète et pratique sollicitée par le Congrès. Le but, c’est d’offrir un guide touristique culturel et spirituel mettant en valeur, dans un ensemble harmonieux, l’architecture, l’art et la vie chrétienne à travers un parcours qui rejoint 13 basiliques ou lieux sacrés de la vieille Rome. La Scala Santa, la Basilique Santa Prassede, la Basilique Sainte-Marie-Majeure, le Colisée, la Basilique Saint-Clément-du-Latran, l’église Saint-Grégoire au Celio, la Basilique Saints-Jean-et-Paul, l’église Saint-Étienne-le-Rond, la Basilique Saint-Jean-de-Latran, la Basilique Sainte-Croix-de-Jérusalem : autant de lieux où nous revivons le « chemin » du Christ jusqu’à la Croix.2. Trois tomes
La riche expérience culturelle et spirituelle du Congrès est recueillie en trois tomes dont voici le contenu synthétique.
Premier tome
Il contient les interventions officielles du matin du premier jour sur La Sagesse de la Croix et les défis des cultures ; du deuxième jour sur La Sagesse de la Croix dans la promotion de l’humanisme et du dialogue interreligieux ; du troisième jour sur La Sagesse de la Croix dans les nouveaux contextes de l’évangélisation ; et du quatrième jour sur La Sagesse de la Croix dans le charisme de saint Paul de la Croix pour le présent et l’avenir du monde.
Il réunit également les interventions présentées dans les différentes sections linguistiques de l’après-midi et les thèmes essentiels résumés lors des Tables Rondes.
Deuxième tome
Il contient 32 interventions. Le premier groupe de 16 se réfère au thème : La Sagesse de la Croix comme facteur de provocation et de défi dans les aréopages culturels d’aujourd’hui. Le deuxième groupe de 16 explore, sous plusieurs perspectives, une question fondamentale : Le mystère de la souffrance, obstacle ou chemin pour la recherche de la sagesse dans les religions ?
Il s’agit des contributions présentées par les chercheurs dans les sections linguistiques en italien, anglais, espagnol et français.
Troisième tome
Il contient 16 autres interventions traçant des perspectives d’étude et de recherche sur l’Église « émergente » entre nouveaux défis et urgences cruciales : la famille et les jeunes, l’humanisme et la postmodernité, la culture numérique, les périphéries existentielles, l’écologie intégrale.
Dans ce cas aussi, les interventions ont été présentées dans les quatre sections linguistiques.
Le troisième tome présente en annexe la Chaire Gloria Crucis, la liste des Orateurs, les événements culturels qui ont eu lieu pendant le Congrès. Dans la dernière section contient le Chemin de la Croix touristique, les Échos de la presse et la Gratitude pour tous ceux qui ont collaboré au succès du Congrès.
Tu peux tout enlever au chrétien, pas la croix
Parolin Card. Pietro2
Chers amis,
J’ai accepté volontiers l’invitation à participer à cette conférence de présentation du Congrès : La Sagesse de la Croix en un monde pluriel. Il s’agit en effet de la principale initiative publique de la Congrégation de la Passion de Jésus liée au Jubilée vécu pour le troisième centenaire de la fondation, que j’ai eu la joie d’inaugurer le 22 novembre avec l’ouverture de la PorteSainte dans la Basilique des Saints et Paul.
Ce n’est pas seulement une motivation, disons « extrinsèque », qui m’a porté ici aujourd’hui, mais la conviction que ce thème de la Croix est le thème central du christianisme ; thème central et combien actuel, parce que la tentation est forte d’évacuer la croix du Christ – un ami m’écrivait à ce propos : « Mais en ces temps n’y a-t-il pas un christianisme sans la croix ? N’est-ce pas la tentation de la voie large ? » D’autre part, il y le fait que nous vivons dans une monde troublé, « crucifié » par une transition d’époque difficile, à laquelle s’est jointe dernièrement l’épreuve de la pandémie.
Je pense alors que ce Congrès est plus qu’opportun, il est nécessaire. Il nous aide, nous chrétiens, et je l’espère aussi pour tous, à tourner notre regards vers la croix du Christ, qui interpelle, provoque et, comme une boussole, indique « sagement » d’anciens et nouveaux parcours, comme l’apôtre Paul l’enseigne : « Nous prêchons le Christ Crucifié : scandale pour les Juifs et folie pour les païens ; mais pour ceux qui sont appelés, les Juifs comme les Grecs, le Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu » (1Co 1,23-24).
Il est surprenant que Jésus attribue à la croix sa plus grande capacité d’attraction : « Et moi quand je serai élevé de terre, j’attirerai tous les hommes à moi » (Jn 12,32). Dieu a choisi de sauver l’humanité dans la faiblesse et dans l’impuissance de la croix, car elle seule permet de démontrer l’amour les plus total et radical : donner sa vie pour ses amis (Jn 15,13). Le Pape François, dans son homélie en la divine liturgie byzantine de Saint Jean Chrysostome à Presov, en Slovaquie, affirme : « La croix était un instrument de mort, et c’est d’elle qu’est venue la vie. Elle était ce que personne ne voulait regarder, et pourtant elle a révélé la beauté de l’amour de Dieu »(14 septembre 2021).
On peut dire que le Crucifié parle en se taisant, car il ne veut pas s’imposer, mais seulement se manifester dans la nudité et la vérité de son amour. Il parle surtout aux chrétiens, car c’est ici la preuve la plus tangible et crédible de l’amour de Dieu pour l’humanité : Dieu en Jésus Christ donne sa vie pour chaque homme et chaque femme de cette terre. Je me rappelle que Saint Jean-Paul II en une occasion, s’exprimant spontanément, a dit : « Au chrétien vous pouvez tout retirer, mais non pas la croix ». Retirer la croix au chrétien serait le priver du signe tangible de l’amour de Dieu pour chaque être humain et occulter la résurrection, la victoire définitive de l’amour sur la haine, sur le mal, sur la souffrance, sur le péché, sur la mort.
Le Crucifié parle à chaque personne et à chaque culture, car il n’est rien dans le Crucifié qui discrimine, qui sépare, qui « écarte ». Sur la croix Jésus a pardonné aussi à ceux qui l’ont crucifié. Ces jours derniers est apparue un avis du Conseil d’Etat qui n’a pas écouté la demande d’enlever le crucifix des classes d’école, en raison du fait que le crucifix est le juste symbole pour exprimer les fondements civils de notre société. Ce fut l’occasion de d’évoquer un article fameux de Natalia Ginzburg paru dans l’Unità en 1988. Elle écrivait : « Le Crucifié ne génère aucune discrimination. Il est l’image de la révolution chrétienne, qui a répandu dans le monde l’idée d’égalité entre les hommes, jusqu’alors absente. La révolution chrétienne a changé le monde. Voudrions-nous peut-être nier qu’elle a changé le monde ? »Et elle termine en affirmant : « Je ne connais pas d’autres signes qui donnent avec autant de force le sens de notre destinée humaine... le Crucifié fait partie de l’histoire du monde »(N’enlevez pas ce crucifix, l’Unità, 22 mars 1988).
Le Crucifié est mémoire et annonce de la « sacralité » de tout homme, il est l’emblème de la solidarité. Malgré son injuste condamnation, il ne cherche pas la vengeance, mais il offre la vie pour l’humanité, pour tous, bons et mauvais, en enseignant que la véritable signification de la vie, c’est de se donner et non pas d’utiliser l’autre et le soumettre pour ses propres intérêts. Le Crucifié est un cri qui condamne toute violence, toute injustice, toute oppression, en manifestant avec la résurrection l’inévitable faillite de toute action contre la dignité de la personne. Le Crucifié est de tous, il se donne à tous, il est contre personne, si non contre l’injustice et le mal.
Une parole particulière doit être adressée à l’Italie et à l’Europe où le culture est tellement liée intrinsèquement au christianisme que si on leur enlève le Crucifié on risque de rayer l’identité d’un peuple. Je ne sais pas si la chanteuse italienne (Gianna Nannini) pensait à tout cela, quand dans une de ses chansons, elle parle, non pas des crucifix fixés sur les murs, mais des « murs fixés sur les crucifix ». Toute notre civilisation est fixée sur le Crucifié.
Au n° 1 des Constituions des Passionistes il est écrit que saint Paul de la Croix « discernant avec acuité les maux de son temps, proclama sans se lasser comme remède très efficace la Passion de Jésus, ‘la plus grande, la plus merveilleuse des œuvres de l’amour de Dieu’ ». Comment pourrait-on lui donne tort ? La Passion de Jésus est le remède aux maux du monde, même au sens dans lequel celui qui accepte le message du Crucifié se sent appelé au respect de tous, à la non-violence, à la justice, à l’amour. Cette méditation sur la Passion de Jésus est spécifique du christianisme et par-dessus tout des Passionistes, mais il y a place aussi pour une « méditation » de tous sur le Crucifié : ce serait vraiment une démarche salutaire pour soigner les maux du monde.
C’est dans l’ambiance passioniste que nait la parole « les crucifiés d’aujourd’hui », une expression que le Pape François a utilisée récemment et qui équivaut à l’expression :« les expropriés » : les pauvres, les personnes âgées, les malades, les réfugiés, les victimes de l’injustice, de la violence, du pouvoir politique excessif, etc... En effet la Passion du Christ continue dans les souffrances des personnes de notre temps. Là où un homme ou une femme souffre, là est le Crucifié. Lui le premier s’est identifié à tous « les crucifiés » ; et donc chaque souffrant peut s’identifier à Lui, trouver un sens à sa douleur, et avoir la force de résister et de lutter contre le mal. En toute personne souffrante le chrétien s’engage à voir le visage du Christ, comme disait saint Paul de la Croix : « les pauvres portent, gravé sur leur front, le Nom de Jésus Christ ».
C’est là un thème cher au Pape François, qui affirme : « Quand nous sommes en face de Jésus Crucifié, nous reconnaissons tout son amour qui nous rend dignes et qui nous soutient ; mais, en même temps, si nous ne sommes pas aveugles, nous commençons à découvrir que ce regard de Jésus s’étend et se retourne plein d’affection et d’ardeur vers son peuple tout entier. Ainsi découvrons-nous qu’Il veut se servir de nous pour se rendre toujours plus proche de son peuple qu’il aime. Il nous prend au milieu de son peuple, et il nous envoie vers son peuple, au point que notre identité ne peut se comprendre dans cette appartenance » (EG n° 268).
Le Pape François, encore une fois, dans son homélie à Budapest, pour la conclusion du 52ème Congrès Eucharistique International, a dit : « Comme Celui qui règne en silence sur la Croix est distant du faux dieu qui nous voudrions voir régner par la force, réduisant nos ennemis au silence ! Comme le Christ, qui se propose uniquement avec amour, est différent des messies puissants et qui, parce qu’ils gagnent, sont adulés par le monde ! Jésus nous secoue, il ne se contente pas des déclarations de foi, il nous demande de purifier notre religiosité devant sa croix, devant l’Eucharistie. Il nous fait rester en adoration devant l’eucharistie pour contempler la fragilité de Dieu. Consacrons du temps à l’adoration » (12 septembre 2021).
Ce Congrès international est donc providentiel, pluraliste, multiculturel en son thème : « La Sagesse de la Croix en un monde pluriel », car il stimule les chrétiens à trouver le langage actuel pour expliquer le Crucifié et il aide la culture à mettre le Crucifié en juste lumière. Souvent le refus du Crucifié vient du fait qu’il n’est pas compris en sa signification : il est perçu comme une arme contre quelqu’un. Bien au contraire, ses bras accueillent, source inexorable d’amour qui console, guérit et communiqué la vie. Il est perçu comme un signe de division alors qu’il est le signe le plus crédible de l’unité, car l’homme-Dieu qui meurt sur la croix donne la vie pour tous, personne n’est exclut, car il se forme dans le monde une seule famille.
Je remercie les Passionistes et l’Université de Latran qui, ensemble, ont organisé ce Congrès. J’espère que ces initiatives continueront dans l’avenir, pour contribuer à découvrir toujours davantage le force prophétique, critique, pédagogique de la Sagesse de la Croix. Cette réflexion sur le Crucifié est utile aux chrétiens tout autant qu’à tous.
Je conclue avec la vieille devise des Chartreux, en nous rappelant la stabilité de la croix dans le cours des événements d’un monde qui voudrait la supprimer ou qui tout simplement l’ignore : « Stat Crux dum volvitur orbis ! » A notre époque « plurielle » également, – époque qui connaît tant de changements sociaux, politiques, climatiques, en ce changement de civilisation – le Crucifié s’élève, bien ferme, pour garantir que Dieu veille avec amour sur l’humanité ; pour demander à tous de s’engager pour que les droits de chaque personne, sans exception, soient garantis et pour que se réalise, dans l’amour, la fraternité universelle. La Croix reste ferme tandis que le monde s’agite.
Le Crucifix est l’expression de l’amour infini de Dieu
De Aviz Card. João Braz3
Avant tout, je suis et je me sens vraiment privilégié du fait d’être parmi vous aujourd’hui au début de ce Congrès. Ce que je veux surtout, c’est de vous saluer très fraternellement.
Nous faisons tous partie de cette grande et unique famille qu’est l’Eglise. Il est toujours plus évident, vraiment, que c’est la fraternité qui compte ; elle se réalise avant tout à partir de notre baptême, en regardant qui nous sommes : des frères et des sœurs. C’est là une prise de conscience qui ne s’acquière pas en un seul jour ni même en une seule année, car nous sommes habitués à un autre style de rapports entre nous principalement sur les « crêtes » de l’Eglise. Cependant nous devons nous diriger vers la fraternité. Le Pape nous invite tous à cheminer ensemble : ce n’est pas là une simple pensée, c’est une expérience concrète qui se vit au long de l’itinéraire du Synode qui s’est ouvert en octobre et qui nous conduira jusqu’à 2023, dans un exercice synodal qui nous implique tous, en partant de nos Eglises particulières et de nos réalités charismatiques, pour progresser ensemble vers la fraternité.
Nous sommes très heureux de pouvoir rester avec vous et admirer la beauté du charisme que Dieu a suscité dans l’Eglise il y a 300 ans, pour nous aider à orienter notre cœur vers la racine d’où naît cette fraternité, racine où nous pouvons apprendre vraiment à la réaliser : la Passion du Christ. Comme cela nous a été rappelé dans l’introduction par saint Paul de la Croix : dans la Passion du Christ il y a tout. C’est un don immense que votre charisme offre à nous tous et que votre père et notre père, nous a aidés à comprendre : dans la Passion il y a tout.
Il y a une autre chose qui me semble importante, car elle nous aide aujourd’hui à bien mettre au centre cette affirmation de saint Paul de la Croix. Le sens de la passion ne se trouve qu’en ce qu’elle exprime l’amour infini de Dieu. On ne comprend pas la Passion si nous ne découvrons pas que Jésus a donné sa vie, a souffert en son corps et en son âme, a souffert notre expérience humaine jusqu’a la mort, non par un châtiment de Dieu mais parce que Dieu est amour. « Dieu est amour » ; voici la grande affirmation de la première lettre de saint Jean (Jn 4,8-13) : Dieu est amour et c’est là que nous le comprenons pleinement. Cela nous aide à dépasser une spiritualité trop appuyée sur le sacrifice et sur la privation : c’est encore valable pour le disciple, cependant le sens [de la Passion] n’est perçu que dans son lien à l’amour, comme expression de l’amour qui va jusqu’à donner sa vie. Et c’est cela qui compte : donner sa vie pour Dieu, car il a donné sa vie pour nous.
Nous vivons présentement un temps dans lequel nous devons renouveler totalement le tissu de nos rapports entre nous, en tous ses aspects, mettant l’amour à la base de tous ces rapports. Cela nous amènera à changer beaucoup de choses dans notre façon d’être, à commencer par nous-mêmes, par la hiérarchie, par tous ceux qui ont des responsabilités de coordination.
Nous devons éloigner de nous, avec décision, la tentation du pouvoir, pour exercer l’autorité et vivre l’obéissance dans le sens que Jésus nous a indiqué. Jésus sur la croix vit une obéissance qui crie, une obéissance immergée dans l’angoisse car elle expérimente l’abandon. Ce cri de Jésus sans réponse du Père nous impressionne énormément : c’est un cri de fidélité à l’humanité. Le don de soi que fait pour nous Jésus sur la croix est sans limites : il renferme tous les cris de l’humanité, et même ceux que nous entendons aujourd’hui, en ce temps si éprouvé. C’est un patrimoine que nous ne devons pas perdre, un héritage à accueillir et à mettre en pratique.
Je vous souhaite donc un excellent Congrès : que toutes les méditations que nous accueillerons puissent nous amener vraiment à un amour toujours plus grand envers le Crucifié, pour accueillir la Sagesse qui vient de la Croix, sur laquelle le Congrès doit réfléchir.
Ce matin nous entendrons encore quelques interventions de nos supérieurs, auxquelles succèderont les relations. Le thème : la Sagesse de la Croix et le défi des cultures aura deux approfondissements : partant de l’aspect biblique, qui pour nous est fondamental, on passera à aspect théologique. Ces deux relations sont pour nous importantes, car elles nous aideront à mieux comprendre ce qu’est le défi d’envisager la croix à partir de perspectives culturelles diverses. Nous sommes habitués à un style d’approche des cultures, un style qui maintenant a besoin d’être perfectionné. Ce n’est plus possible de penser qu’il y a des cultures hégémoniques et des cultures subalternes. Cela n’est pas selon l’Evangile ; tous les peuples renferment des richesses, chacun d’entre eux a quelque chose qui enrichit l’autre à partir de sa propre identité. Tous ensemble nous nous approchons des valeurs de l’Evangile et c’est ainsi que nous nous rapprochons entre nous. C’est là un travail à réaliser et je pense qu’en le faisant nôtre le mystère de la Croix nous y fera parvenir.
Puissions-nous porter beaucoup de fruits en cette direction !
Discours inaugural
Buonomo Vincenzo4
En souhaitant la bienvenue de la part de l’Université du Latran à tous ceux qui, de différents pays et expériences, prennent part à ces travaux, je désire adresser mes remerciements aux personnes qui ont participé à l’itinéraire de préparation du Congrès. Je repense à la première rencontre avec le Père Fernando Taccone, CP, en septembre 2018, qui posa d’une manière définitive les bases et la structuration de cette rencontre internationale. À ce moment-là, nous n’attendions pas de pandémie, nous ne prévoyions pas les situations telles qu’elles se sont présentées par la suite et qui ont conduit à reporter ce rendez-vous, à modifier sa programmation et à adapter son agencement. Mais, malgré tout, la ténacité et les efforts du P. Taccone sont parvenus à maintenir ce souffle universel, avec des « voix » qui viennent de toute part, avec une variété non seulement linguistique, mais aussi d’approches du thème de la Croix. Un résultat important qui confirme que les plans de Dieu ne sont pas les nôtres ou ceux dans lesquels nous voudrions nous réfugier.
Nos remerciements vont aussi à la Chaire « Gloria Crucis » qui constitue une partie active de l’Université, afférente non seulement à la Faculté de Théologie et à l’Institut pastoral Redemptor Hominis, mais à l’ensemble de l’Athénée, comme structure qui engage à la recherche et qui approfondit la recherche. Au cours de toutes ces années, la direction du Père Taccone l’a aussi modelée et fait progresser en lien avec une revue spécialisée : La Sapienza della Croce (La Sagesse de la Croix) qui confère un certain prestige et qui véhicule la doctrine nécessaire qui s’élabore à l’intérieur d’une réalité universitaire.
À travers l’expérience de cette Chaire, un parcours a ensuite été conçu, une exposition artistique construite autour de l’image du mystère de la Croix dans le « quotidien des derniers », c’est-à-dire de ceux qui ont besoin d’assistance et de coopération. C’est ce dont témoignent les images de la situation en Haïti, à travers les mots et l’œuvre du Père Richard Frechette, CP, qui, par sa phrase – « nous faisons tout ce qui est possible » – nous permet de ne pas oublier que, dans les situations de besoin, il est toujours possible de faire quelque chose de plus : c’est l’expérience de la Croix. En regardant les images d’Haïti, grâce à l’exposition attenante au Congrès, nous avons un exemple concret de la façon dont l’esprit de la Croix peut être lié à l’indice de pauvreté et au domaine des missions de paix qui œuvrent dans ce pays, à l’activité de l’après-tremblement de terre d’il y a 11 ans et à l’ensemble des flux de solidarité qui risquent toutefois de demeurer incomplets en l’absence d’agents capables d’agir efficacement et d’embrasser la Croix. Cela n’a rien de rhétorique, du moment que souvent notre perspective de coopération est définie dans un bureau, sans se concrétiser dans le rapport avec et pour les gens. L’exposition fournit au Congrès la visibilité immédiate du langage et de l’action mise en œuvre avec un esprit évangélique d’un côté et un esprit d’humanité de l’autre, ce qui signifie unir croyants et non-croyants. À la lumière de cette perspective, parler aujourd’hui de la Croix, peut aussi signifier, tant pour ceux qui croient que pour ceux qui ont d’autres visions de la foi, non seulement une image, non seulement un exemple, mais la possibilité de continuer à tourner notre attention vers les autres.
Pour le chrétien, la Croix est un commencement, pas une fin, car il naît nécessairement quelque chose de positif de la souffrance. La coopération internationale se prête précisément très bien comme exemple. De fait, tous les objectifs qui sont atteints dans ce contexte, qui concerne les gouvernements, les Organisations internationales, la société civile, se réalisent mais toujours avec des souffrances : quand on s’aperçoit que le projet ne fonctionne pas ou que les financements ne suffisent pas. Mais il y a aussi une souffrance de devoir partager un objectif, un aspect qui n’est pas toujours facile, mais qui doit être surmonté face au risque de superpositions au lieu d’un nécessaire partage.
L’image de la Croix, dans son étreinte qui semble englober tout le monde, se présente comme partage. Ceci explique pourquoi le Congrès a accordé une place et une visibilité non seulement à des thèmes strictement théologiques, mais a voulu lire l’actualité en partant de ces thèmes : tel est le sens des images de Haïti et de tant d’autres situations analogues. Penser à l’actualité signifie se référer à des thématiques qui peuvent être juxtaposées à l’agenda sur le développement, en ne la reliant pas seulement ainsi à la croissance économique à laquelle, souvent par commodité, le mot développement est rattaché. Le partage, comme effet de la Croix, est par contre une autre chose, car il met en évidence le besoin de foi dans l’humanité et dans la personne. Si cela fait défaut, on peut évidemment créer des structures et de grands projets, mais les œuvres resteront limitées car, probablement plus que satisfaire les exigences des bénéficiaires, elles seront liées à des intérêts partisans ou, du moins, aux exigences de ceux qui pratiquent la coopération. Un danger auquel cherchent à échapper des organisations qui ont multiplié leur présence là où la souffrance est une donnée objective, comme le montre l’exemple de la Fondation Rava, présente à ce Congrès, pour offrir l’expérience de ceux qui sont attentifs aux exigences des minorités, des plus petits et pour qui elle pense et construit un futur.
Partageant ces présupposés, l’Université a apporté sa contribution au Congrès, avec ses professeurs et sa structure. Certes, cette initiative signifie pour tous la première reprise d’activité « en présentiel » et, en ce sens aussi, la Croix devient un symbole de renaissance, de nouveau départ après le blocage qui s’est produit depuis mars 2020. Nous pouvons bien dire que ce Congrès aussi doit être considéré comme quelque chose qui repart sur la base de la souffrance que nous avons vécue et qui impose aujourd’hui de regarder vers le futur d’une façon différente. Nous ne pouvons pas dire : « tout sera comme avant », car nous espérons clairement en une conversion personnelle pour pouvoir comprendre qu’il faut renverser des équilibres et même revoir, peut-être, notre sens du quotidien et de nos activités. Il suffit de penser à la nécessité de nous libérer d’une croissance tendant exclusivement à un profil économique et donc essentiellement lié au profit ou, au contraire, mettre en relief la dignité de la personne humaine.
Un grand merci au Père Joachim Rego CP, Supérieur Général et, à travers lui, à toute la Congrégation Passioniste pour son vaste engagement et pour l’attention accordée à l’Université du Latran en insérant ce Congrès, c’est-à-dire une initiative plus directement académique, dans le Jubilé des fils de saint Paul de la Croix.
Généralement, lorsqu’on affronte une thématique à travers un temps d’études et d’approfondissement, on demande à une Université de fournir des clefs de lecture, une méthode et un apport nouveau à la doctrine et au savoir. Je ne vous cache pas que, dans ce cas aussi, la première réaction a été du style : mais que peut-on bien dire de nouveau sur la Croix ? Cela motive la nécessité de penser à quelque chose qui soit en mesure de répondre aux attentes d’aujourd’hui.
Il en est ressorti, entre autres, l’idée de ce qu’on appelle la géopolitique de la Croix où le symbole de la Rédemption devient un instrument pour parler dans le cadre d’un processus en acte, non seulement dans le domaine de débats à caractère culturel, mais aussi à caractère politique et juridique, dans les organisations internationales ou dans l’activité diplomatique, dans les négociations. Et ceci à travers l’identité de la Croix, c’est-à-dire sans en modifier la signification, la portée et le mystère, sans l’adapter aux besoins, mais plutôt en ajustant la géopolitique à l’expérience, à la signification et aux paroles qui jaillissent de la Croix. Il s’agit d’une sorte de pastorale de la Croix où se situe aussi l’élément de la géopolitique, avec la capacité de comprendre et d’affronter, à travers sa propre méthode, les problèmes d’aujourd’hui de la vie des peuples ou la culture contemporaine pour en comprendre le sens, les contenus et le langage. Il s’agit d’affronter les diverses situations où la Croix est présente, où elle ne s’exprime pas seulement comme souffrance, mais aussi comme effort pour surmonter certaines situations et pouvoir ainsi les gouverner. C’est sur cette conviction que se structure également le programme du Congrès, en cherchant comment la Croix se situe, avec son mystère et ses paroles, dans la société contemporaine.
Cette approche est importante pour l’Université et naît aussi d’un antécédent : ces dernières années, en effet, la Chaire « Gloria Crucis », s’est occupée de thématiques liées à une actualité et à une contemporanéité touchant à l’émigration, aux bouleversements à caractère politico-juridique à l’intérieur des États, et même aux situations liées à la coopération internationale et aux problèmes de développement, à savoir : la Croix incarnée dans les situations concrètes. Des situations que le Congrès reprend en les expliquant d’une façon systématique, au-delà des disciplines spécifiques, en permettant ainsi d’avoir une lecture multidisciplinaire et interdisciplinaire, capable d’intéresser et d’impliquer la pastorale, la théologie fondamentale et la philosophie ; ou de devenir pour le droit une modalité permettant d’exprimer des règles et des normes à travers une expérience directe. Au fond, du moment où la Croix est considérée non seulement comme un symbole, mais aussi comme une espérance, il est possible de bâtir un futur en oubliant le « on a toujours fait comme ça » et en imposant de revoir les pratiques, les contenus et les actions.
Cela signifie avoir la capacité d’apporter la Croix dans les situations concrètes où l’individuel et le communautaire se fondent : la pandémie a montré cela avec encore plus d’évidence. S’il n’y a pas de changement dans la vie individuelle, il est impossible qu’il y ait des changements à caractère communautaire et général. C’est ce que montrait bien l’image du Pape François, le 27 mars 2020, place Saint-Pierre, qui regardait la Croix, non seulement comme un instrument capable d’« opérer dans l’urgence », mais comme un signe pour comprendre qu’il est possible de gouverner des situations, même très graves comme la pandémie. Gouverner à travers la Croix, qui est par ailleurs le défi majeur.
Pour l’Université, le parcours et la réflexion liés au Congrès signifient s’interroger face à la fragmentation du savoir qui est aujourd’hui un des éléments les plus préoccupants pour ceux qui s’occupent d’activités culturelles ou pour ceux qui s’adonnent à la vie universitaire. La fragmentation du savoir est la grande limite qui pèse sur notre quotidien et sur notre action. L’idée de la Croix est aussi de nous reconduire à l’unité du savoir, conscients toutefois que cette unité n’est pas donnée gratuitement : le savoir est quelque chose dans lequel on peut et on doit puiser, mais qui exige sacrifice et efforts, capacité d’imaginer et de créer quelque chose. Et ceci, dans une phase de reprise, est essentiel pour distinguer et discerner.
Il suffit de penser que la reprise post-pandémie concerne une petite partie de l’humanité car, si nous approchons les 8 milliards d’habitants dans le monde, les bienfaits des soins et des vaccins ne concernent, pour l’heure, qu’environ un milliard et demi de personnes. Cela veut dire que, pour la majorité de la famille humaine, le drame, une Croix comprise comme souffrance, se poursuit. En même temps, la Croix impose de faire des choix afin que les soins puissent aussi s’étendre au reste de la famille humaine : il nous est demandé de partager.
Pour une Université, le choix de partager signifie disséquer et réfléchir sur la Sagesse sous ses différentes formes, sous ses différentes manifestations et dans ses multiples savoirs, parmi lesquels le Congrès situe notamment la Sagesse de la Croix, c’est-à-dire tout ce en quoi la personne est impliquée. Avant le Christ, la Croix était essentiellement un symbole de pouvoir, d’un pouvoir non seulement vécu mais exercé. Le Fils de Dieu fait d’elle un instrument de rédemption et de passage ; de passage non seulement de la mort à la vie, mais aussi dans la dimension spirituelle, culturelle et, non des moindres, institutionnelle. Mais que peut bien représenter la Croix dans l’aujourd’hui du monde ? Est-ce quelque chose qui ne concerne que les croyants ou qui s’étend aussi à ceux qui ne croient pas ou dont l’attitude est celle d’une recherche quotidienne ? La Croix peut-elle être un instrument pour eux aussi ?
Face à un tel défi, il revient à l’Université de fournir des clefs de lecture et il revient au monde de la science et aux réflexions académiques de fournir des évidences pour éviter des conflits, pour faire en sorte que la « culture du déchet » ne devienne pas une colonne portante de nos sociétés, qui lui serait presque connaturelle. Nous avons tant de fois entendu dire que, sur la Croix, nous perdons tout, mais que c’est de la Croix que nous repartons ! Cela est encore plus évident dans l’Université au milieu des difficultés quotidiennes et des progrès, car l’étude et la recherche sont souvent difficiles ; mais ils procurent en même temps de grandes joies grâce aux résultats obtenus, avant de rencontrer la difficulté de devoir les communiquer ou de partager le poids de la recherche et la nécessité de diffuser ses contenus.
Voici donc la Croix qui, en ce sens, devient certitude, car elle permet d’aller au-delà des obstacles ou de refermer les blessures et les plaies liées aux efforts quotidiens, à l’engagement, au sacrifice. La Croix est également une réponse, car elle est un exemple : celui du Christ et de ceux qui, aujourd’hui encore, souffrent de diverses façons, à différents titres, à cause de la Croix.
La Croix est amour de soi et amour de l’autre et des autres. Les paroles que Luc insère dans l’Évangile, dans l’épisode du bon Samaritain, demeurent lapidaires, lorsque celui-ci dit à l’aubergiste : prends soin de lui. À l’Université, il s’agit de prendre soin de l’autre, qui devient objectif et instrument si cela est vécu à travers la Croix. Ainsi le professeur, l’étudiant, l’agent administratif, la communauté tout entière agissent en raison d’une attention réciproque qui, si elle vient à manquer, fait disparaître le concept d’Universitas, en le limitant à une coexistence de personnes, plus ou moins intéressées par des objectifs ou des intérêts communs.
Enfin, la Croix demeure un signe pour tous ceux qui travaillent à l’Université, car elle nous aide à redécouvrir les diverses vocations : celle de professeur qui doit être humblement redécouverte chaque jour pour échapper à la tentation de proposer simplement un enseignement déjà usé. L’idée de la Croix nous impose, au contraire, de revoir chaque matin ce que nous communiquons à ceux qui sont confiés à nos soins ; celle de l’étudiant qui trouve le moyen de construire sa formation, en l’orientant déjà vers quelqu’un ou quelque chose, pour devenir la continuation d’une pensée, d’une méthode, d’une façon d’œuvrer dans l’Église et dans la Communauté politique.
En conclusion, ce Congrès a pour tâche d’inspirer l’Université du Latran à s’abandonner à la Croix pour comprendre ce qui lui est demandé afin de pouvoir, avec beaucoup d’humilité, rechercher, enseigner et agir.
I. LA SAGESSE DE LA CROIX ET LES DEFIS DES CULTURES
La Sagesse de la Croix comme chemin pour la reconciliation en un monde pluriel
Rego Joachim5
Au nom de la famille passioniste répartie à travers le monde, bienvenue à vous tous en ce IVème Congrès Théologique qui a pour thème : « La Sagesse de la Croix en un monde pluriel ». Nous, les Passionistes, nous célébrons cette année le jubilé des 300 ans de la fondation de la Congrégation de la Passion qui fut l’œuvre de Paul Danei, aujourd’hui connu comme saint Paul de la Croix. En tant que Congrégation nous avons voulu consacrer cette année à renouveler notre mission dans l’Eglise et pour le monde. Ce congrès représente une expression de notre engagement.
L’année jubilaire a coïncidé avec la terrible pandémie du Covid 19, qui a fait plus de trois millions de victimes et a affligé des dizaines de millions de personne dans le monde entier. Il est certain que chacun de ceux qui sont ici a été touché par cette pandémie au niveau personnel de quelque manière. Pendant notre réflexion et notre approche de la sagesse dans le mystère de la Passion prions pour que la pandémie puisse se terminer bien vite ; nous voulons aussi exprimer notre solidarité pour toutes les victimes et pour leurs familles.
C’est une grâce de que pouvoir nous réunir comme membres de l’Eglise universelle. En regardant autour de moi, je peux voir des personnes de diverses nations et je sais aussi qu’ils sont très nombreux, sur tous les continents, ceux qui participent on-line, tous unis dans une commue recherche de la sagesse et de la grâce. C’est l’unique Esprit qui nous réunit ; il déverse en abondance ses dons pour bénir l’Eglise, et cela à travers la variété des services et des expressions de l’amour. Cela aussi fait partie de ce que nous sommes en célébrant en ce congrès sur la « Sagesse de la Croix en un monde pluriel ».
1. Pluralisme
En donnant le bienvenue à vous tous – à ceux qui sont présents en personne et à ceux qui participent on-line – je le fais dans le respect de votre diversité et de la pluralité, pour venir à la rencontre d’autres familles religieuses, d’autres pays, d’autres religions et confessions chrétiennes, car nous savons combien nous pouvons, comme un don, bénéficier de la science de tous et de l’écoute respectueuse des intuitions des autres. Cela représente déjà une expression importante du pluralisme dans lequel nous vivons et dans lequel nous célébrons ce Congrès.
Bien plus qu’avant, désormais le monde éntier est en mouvement pour de nombreuses raisons variées, et c’est ainsi que notre monde est une réalité toujours davantage plurielle. Les diversités religieuses et culturelles sont devenues une caractéristique majeure de notre monde, comme jamais auparavant. On appelle pluralisme le monde dans lequel nous rencontrons et répondons à cette diversité.
Diana Eck qui enseigne le « Projet sur le Pluralisme » à l’Université de Harvard décrit le pluralisme comme « une réalité basée sur le dialogue et concentrée sur une forte confrontation avec la diversité, en une recherche active d’une compréhension qui dépasse les lignes tracées par les différences et la rencontre des convictions ». Elle explique par conséquent : tout d’abord que le pluralisme n’est pas la simple diversité, mais une confrontation décisive avec la diversité ; et en second lieu que le pluralisme n’est pas la simple tolérance, mais la recherche active d’une compréhension au-delà des limites tracées par les différences ; en troisième lieu, que le pluralisme est la rencontre des « positions » variées ; il n’exige pas d’abandonner notre identité ou que nous abandonnions ce dont nous sommes convaincus. Il signifie plutôt tenir ferme nos plus profondes différences, même celles religieuses, mais sans s’isoler, et bien plutôt en se mettant en relation les uns les autres. En quatrième lieu, le pluralisme se base sur le dialogue et la rencontre ; il s’agit de « donner » et de « recevoir », dans un esprit de critique et d’autocritique.
Les chrétiens dans la quasi totalité du monde vivent dans des sociétés religieusement plurielles qui ont un impact sur leur vie quotidienne, les obligeant à trouver de nouveaux modes de compréhension et de coexistence avec des personnes d’autres cultures, d’autres traditions religieuses et voire même avec l’animisme spirituel. Toute nouvelle rencontre, toute nouvelle relation nous remodèle et nous présente un défi : celui de vivre en communauté globale dans le respect réciproque, entre frères et sœurs, et dans la paix. Le Pape François, de nos jours, est particulièrement engagé pour construire une « culture de la fraternité » ; il nous pousse tous à vivre selon les valeurs de la solidarité, du respect des différences et à prendre en charge ceux qui sont dans le besoin. C’est cela qui rend crédibles nos églises et nos communautés religieuses, comme des force et des acteurs à même de fomenter la justice et la réconciliation dans un monde fractionné.
Il y en a qui réagissent négativement face la parole « pluralisme », car ils l’identifient avec « relativisme ». Mais, évidemment, pluralisme n’est pas relativisme. Le pluralisme est la reconnaissance de la riche variété des cultures, des langages, des religions, des spiritualités et des modes de penser et de vivre ; c’est une variété qui déjà existe dans le monde. C’est une célébration de la « variété » en tant qu’expression merveilleuse du génie et de la créativité des êtres humains. Le pluralisme est une éthique du vivre ensemble en une société diversifiée : non pas la tolérance ou le relativisme, mais plutôt une réelle rencontre des convictions.
Le pluralisme ne s’oppose pas à l’objectivité ; il s’oppose à la vieille version classique de l’unique et seule culture supérieure à laquelle chacun doit aspirer. Dans la pratique, cela signifierait en vérité imposer les normes d’une culture type à tout le reste du monde ! Historiquement nous savons tous qu’avec la diffusion du colonialisme, on en était venu à exporter et souvent à imposer aux autres peuples des modes [de vivre et de penser] européens et occidentaux : se vêtir à l’européenne, langues européennes, religions et éducation européennes... Tout cela était imposé aux autres comme un système pour les « civiliser ». Ce genre de normativité était une forme d’impérialisme qui ouvrait la route à la domination, à la supériorité et, pour finir, à la suprématie de la race blanche, s’appuyant sur l’idée de l’unique nature humaine comme unique culture, un unique mode de penser et un unique mode d’être pour tous. Aujourd’hui, heureusement, ou, encore mieux, on espère avoir abandonné une telle idée ; nous nous sentons en phase avec la réalité de beaucoup de cultures, langues, religions et modes de vie diversifiés. : il s’agit d’une pluralité qui exprime les nombreuses possibilités que renferme la nature humaine. Mais nous savons tous que même aujourd’hui le désir de la part de quelques-uns d’imposer la vision d’une unique culture et religion reste une force contre laquelle nous devons lutter.
En réfléchissant sur le pluralisme dans le monde chrétien nous sommes arrivés à reconnaître la diversité des rites, des théologies et des traditions qui forment l’unique Eglise catholique. Avec respect nous nous efforçons de comprendre la riche variété des expressions de la foi et de la liturgique présente dans les églises catholique-orientales, catholique-romaine et dans les églises orthodoxes.
La vie que nous vivons jour après jour est marquée par la pluralité religieuse et il existe un besoin pastoral qui exige que nous soyons préparés à vivre dans un monde religieusement pluriel. Prenant en considération la question de l’approche théologique de la pluralité religieuse, le Conseil Mondial des Eglises, dans un document intitulé « Pluralité religieuse et auto-compréhension »a écrit :
« En tant que chrétiens nous cherchons à construire un nouvelle relation avec les autres traditions religieuses, car nous croyons que cela est intrinsèque au message évangélique et inhérent à notre mission de collaborateurs de Dieu pour la guérison du monde. En conséquence, le mystère de la relation de Dieu avec le peuple de Dieu tout entier, et les divers modes dans lesquels les peuples ont répondu à ce mystère, nous invitent à explorer davantage la réalité des autres traditions religieuses et notre identité de chrétiens dans un monde religieusement pluriel ».
2. Sagesse
En réfléchissant sur la Sagesse de la Croix, nous pouvons dire, à première vue, que la croix que porte le corps de Jésus n’est pas très attirante. Comme dit le prophète Isaïe, « il n’a pas de beauté qui attire les yeux » (Is 53,2). Historiquement, la croix était un instrument de torture et celui qui était cloué à la croix était un criminel condamné. Qu’est-ce donc que la sagesse dans la croix de Jésus ? Nous le savons, Saint Paul, dans la Lettre aux Corinthiens, a quelque chose à dire sur ce point face aux juifs et aux grecs. Mais que dire de nous aujourd’hui ?
Jésus a terminé sa vie sur la croix à cause de sa confrontation avec la puissance de Rome et avec la « sagesse » de Caïphe et des chefs des juifs. Ironie ! Ce sont ceux justement qui se sont opposés à lui, qui, sans s’en rendre compte, l’ont élevé sur la croix pour que le monde entier puisse le contempler durant toute l’éternité. Aujourd’hui on ne peut contempler la croix sans reconnaître, en même temps, ce que furent ces soi-disant puissants ou sages en ce monde qui y ont mis Jésus ; et que sont eux qui, par après, se sont réunis autour de lui pour fêter sa mort.
La sagesse des sages, effectivement, a manifesté leur folie ; et la folie de Jésus s’est manifestée comme étant la vraie Sagesse. Sagesse et folie, puissance et force, lumière et ténèbres sont données ensemble.
La Sagesse de la Croix signifie que nous sommes avec Jésus ; et nous savons que la puissance et la sagesse humaine ne sauveront pas le monde. Avoir la Sagesse de la Croix, c’est savoir que Dieu a choisi de se révéler lui-même dans l’humiliation de la croix et avec l’unique pouvoir que Dieu connaît, la puissance de l’amour, de la guérison et du salut. Cela est contraire à la raison humaine, souvent instinctive, qui répond par la violence, le dépit et la vendetta. La Sagesse de la Croix de Jésus nous montre le chemin de la réconciliation et les moyens pour parvenir à l’unité et la paix.
3. Reconciliation
Comme on sait, dans le monde pluriel d’aujourd’hui il y a une tendance mauvaise vers la division, qui est motivée par la suspicion et par la peur de ce qui est différent. Même la foi religieuse, hélas, est souvent invoquée pour justifier un extrémisme plein de haine. Nous, cependant, au nom de Dieu et du Fils de Dieu, Jésus, nous sommes engagés personnellement pour le shalom du Règne de Dieu, un règne qui unira toute l’humanité dans l’unique famille de notre Dieu et Père. Comme dit Saint Paul dans sa Lettre aux Colossiens : « Car Dieu a voulu que dans le Christ, toute chose ait son accomplissement total. Ila voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans le ciel, en faisant la paix par le sang de sa croix » (Co 1,19-20).
Par sa mort et sa résurrection, Jésus, le messie, a inauguré l’ère de messianique de la paix. La « paix » a été le don pascal du Seigneur ressuscité à ses amis. La mission de l’Eglise est celle d’être signe, instrument et préfiguration du Règne du Dieu de la paix sur la terre comme au ciel. En tant que Passionistes, nous aussi nous partageons cette mission de l’Eglise en étant instruments de la paix de Dieu et en indiquant le Règne.
Nous croyons que la croix, dans laquelle est renfermé le mystère de la sagesse divine, est l’instrument de Dieu pour la paix et la réconciliation. Nous retenons que notre mission est d’aller en nom de Jésus porter la Bonne Nouvelle à la multitude des souffrants de notre temps. Nous voulons être les témoins et les instruments de sa paix qui libère chaque génération de la division, de la séparation, des conflits et des injustices. Tout cela nous l’accomplissons en mettant la croix au centre de notre vie et de notre mission, nous rappelant les paroles de Jésus : « Quand je serai élevé de terre, j’attirerai tout à moi » (Jn 12,32). Jésus dépasse toute division, réconcilie les juifs et les gentils ; il unit toute chose dans le ciel et sur la terre et donne la paix en versant son propre sang sur la croix (cf. Col 1,20).
La mission des Passionistes fait partie de la mission universelle de l’Eglise. Le Concile Vatican II décrit l’Eglise comme étant le signe et le sacrement de l’unité de tous les peuples. Dans Gaudium et Spes, 92, nous lisons : « En vertu de mission que est la sienne, d’éclairer l’univers entier par le message évangélique et de réunir en un seul Esprit tous les hommes, à quelque nation, race, ou culture qu’ils appartiennent, l’Eglise apparait comme le signe de cette fraternité qui rend possible un dialogue loyal et le renforce ».
Les Passionistes partagent cette mission de promouvoir l’unité de tous les peuples en cultivant la culture de la fraternité et de la compassion, en promouvant le respect et l’acceptation réciproque, en travaillant pour apaiser et réconcilier face à toute division. C’est là un chemin privilégié, un chemin de paix. Comme dit le Pape François dans sa lettre encyclique Fratelli tutti, 225,
« En de nombreuses parties du monde il faut des parcours de paix dans le but de guérir les blessures ; il faut des artisans de paix disposés à mettre en route, avec intelligence et audace, des processus de guérison et de rencontre renouvelé ».
Nous croyons que cela peut se réaliser en restant ouverts à la puissance de Dieu révélée dans la Sagesse de la Croix de Jésus.
4. L’Eglise aujourd’hui
Ainsi, comment présenterons-nous et annoncerons-nous la Sagesse de la Croix du Christ face à notre monde pluriel ?
L’Eglise tout entière, aujourd’hui, est appelée à une nouvelle vie missionnaire. Chaque chrétien baptisé est missionnaire par nature ; il est invité à faire connaître Jésus et la joie de l’évangile à son voisin, à ses amis et à tous. Le Pape François a été en première ligne pour cette impulsion missionnaire ; il nous aide à approfondir la signification de l’évangélisation sous des formes nouvelles. En ce moment, le Pape nous demande d’être particulièrement sensibles à la crise clinique qui menace toute la vie de la planète, une crise qui touche déjà la vie des personnes vulnérables. Il a insisté sur le fait que le système économique dominant a partout des conséquences très négatives pour les plus pauvres. Il a ouvert nos yeux et nos esprits à la réalité de ceux qui pensent, qui croient et adorent d’une manière différence de la notre. Il a tendu la main à l’amitié et il a ouvert son cœur par la rencontre et le dialogue aux autres chrétiens, avec le peuple hébreu, avec les musulmans, les bouddhistes et les autres. En tout cela le Pape François témoigne de l’amour de Dieu notre Père pour toute l’humanité et de la volonté de Dieu d’unir tous les hommes en une seule famille humaine. En son action, il met en pratique la Sagesse de la Croix.
La prière de Jésus pour l’unité – prière qu’il fit la nuit avant de mourir – me vient à l’esprit : « Que tous soient un ! » (Jn 17,21). Ces paroles de Jésus peuvent être considérées comme une affirmation officielle de la mission qu’il a reçue de son Père. Cette unité ne peut pas être imposée par la force politique ou militaire, ni ne peut être achetée par le pouvoir économique. L’unité pour laquelle Jésus prie et que tous les hommes désirent peut être atteinte uniquement par l’amour miséricordieux de Dieu. C’est cet amour que nous voyons sur la croix quand Jésus étend ses bras pour embrasser l’humanité tout entière. C’est aussi l’amour que nous aussi nous donnons au monde au nom de Jésus tandis que nous annonçons la Bonne Nouvelle et que nous travaillons pour l’instauration du Règne de Dieu sur la terre comme au ciel.
Il y a trois cents ans Saint Paul de la Croix rassembla des compagnons et fonda une congrégation « pour maintenir vivante la mémoire de la Passion de Jésus », à travers la contemplation de l’amour souffrant du crucifié sur la croix. Dans la contemplation, Paul eut le don de l’intuition de voir révélée sur la croix et dans la passion de Jésus « la plus grande et stupéfiante œuvre du divin amour » : sagesse de Dieu pour toute l’humanité et pour la création.