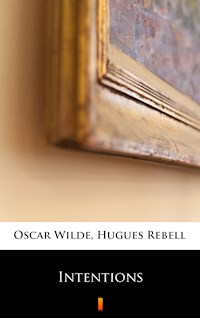Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Tu veux des nouvelles de Baia ; et je ne t'en donne point. Je ne puis te dire qu'un mot : Cythéris ne s'y trouve pas. Que t'importent alors les larges ou délicates poitrines qui viennent cette année se faire caresser par les vagues amoureuses, et étreindre dans le flot des passions trop ardentes ? Cythéris veut brûler encore, et elle ne tient pas à ce que tu connaisses son refuge."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 79
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À GEORGE EEKHOUD
Martius Festus à Caius Cominius
La Saison à Baia
Λγαθòς, άνὴρ λέγοιτἃν ό ψέρων τάαθά
Ce petit livre, œuvre d’un parasite romain qui courait de maison en maison mendier un souper, et, par suite, connut assez bien la vie patricienne, fut écrit ou du moins vendu quelques années après les évènements qu’il nous retrace. Le papyrus, d’où nous l’avons traduit, porte sur son rouleau d’ivoire le nom du libraire Silanus, et nous savons, par des tablettes retrouvées à Herculanum, que Silanus installa sa librairie dans une boutique appartenant à un certain Lacon, la seconde année du règne de Vespasien. L’auteur, par prudence sans doute, attendit la mort de Néron et laissa passer les dictatures militaires avant de publier un écrit qui aurait pu, à une époque antérieure, lui valoir de sérieux désagréments.
Son récit a surtout l’intérêt d’un document exact. Par exemple, sur l’arrivée de saint Paul en Italie, il nous donne des détails caractéristiques qu’ont négligés les Épitres et les Actes des Apôtres. On regrettera seulement de ne pas y trouver ces professions de foi sublimes, ces causeries éloquentes des premiers chrétiens que M. Sienkiewicz, dans son beau livre : Quo Vadis, nous a rapportées avec tant d’à-propos. Notre parasite, en présence d’un homme mal vêtu, dont une mimique bizarre et des gestes exagérés étaient toute l’éloquence, ne s’avisa pas qu’il était devant un saint. À dire vrai, on n’en connaissait pas encore. La civilisation antique était plus attachée aux finesses du discours et aux agréments de la personne, que sensible aux inspirations divines. Il lui eût fallu une sagesse moins terre à terre pour reconnaître, dans un être d’extérieur si inélégant, les vertus géniales de seconde vue et penser, avec un grand écrivain contemporain, que « ce fou allait sauver le monde ».
Aujourd’hui le sourire impie de notre auteur nous semble plus que déplacé. Les mœurs qu’il nous décrit avec une complaisance si incongrue ne sont plus possibles. Ce prophète méprisé, traité comme un charlatan vulgaire, a réellement changé les hommes et hâté le règne du Bien. L’envie, l’avarice servile, les trahisons criminelles, les basses complaisances pour le pouvoir, les désirs effrénés des sens, rien de tout cela n’a survécu, que je sache, au paganisme. Ce sont, pour ainsi dire, des vices archéologiques dont nous sommes si loin que la peinture même en paraît extraordinaire.
En même temps que les mœurs se sont purifiées, l’intelligence a reçu des clartés nouvelles. Personne à notre époque – et je parle des plus incultes – n’oserait traiter de jargon et de bégaiement la haute morale des Épîtres. Les docteurs éminents de toutes les sectes ont commenté à l’envi ces œuvres sublimes ; et il ne se passe point de jour que quelque vénérable pasteur, voire quelque historien sans religion, qui cherche la vérité pour son compte, ne se demande avec angoisse devant tel verset : « Qu’a voulu dire le saint ? » humiliant ainsi devant le souvenir de cet homme sans lettres, l’orgueil d’un excellent philologue, d’un humaniste distingué, membre de l’Institut, professeur à Bonn ou à Oxford.
Triomphe touchant des simples ! Avec son langage rude et obscur, Paul s’est fait plus d’admirateurs que s’il se fût exprimé clairement. Tout le monde s’est piqué de connaître une vertu si abrupte, et les plus belles intelligences des siècles ont pris, pour collaborer à leurs doctes fantaisies, un saint d’un crédit si général qu’il n’est personne qui ne lui prête.
C’est réellement un don admirable que possède l’humanité moderne de découvrir, dans les paroles et les actes à première vue insensés, les vertus secrètes dont elle a besoin. Même racontée par un païen sceptique et libertin qui préfère aux maximes profondes d’impures images, la vie de Paul est féconde en enseignements. C’est pourquoi nous remercions les aimables savants de la Bibliothèque et du Musée de Naples, qui ont bien voulu mettre à notre disposition le précieux papyrus et nous aider de leurs lumières pour mener à bonne fin cette traduction. La seule interpolation que nous nous soyons permise, n’a pour but que de rendre la lecture de ce récit plus facile : elle rétablit un passage que le déroulement du papyrus avait quelque peu endommagé ; partout ailleurs nous nous serions fait scrupule de rien changer au texte. L’humanité a le devoir de regarder intégralement ses origines. Loin de l’humilier, ce tableau d’une société sans principes lui permet de songer avec orgueil à l’avenir. Depuis le jour où l’on pouvait demander au pauvre juif chrétien : « Où vas-tu ? » quel chemin il a fait avec sa doctrine ! Le monde progresse de lui-même et d’un pas si hardi, que saint Paul, s’il revenait parmi nous, n’aurait plus à le convertir, bien au contraire : il lui faudrait se mettre au courant de la morale nouvelle, peut-être renvoyer Lydia, et apprendre de ses biographes ce qu’il a réellement pensé.
Tu veux des nouvelles de Baia ; et je ne t’en donne point. Je ne puis te dire qu’un mot : Cythéris ne s’y trouve pas. Que t’importent alors les larges ou délicates poitrines qui viennent cette année se faire caresser par les vagues amoureuses, et étreindre dans le flot des passions trop ardentes ? Cythéris veut brûler encore, et elle ne tient pas à ce que tu connaisses son refuge.
Console-toi, très cher. Comme je te sais mauvais buveur et incapable de trahir pour d’autres enfants ton infidèle, j’essaie de te consoler moi-même en te racontant ce qui se passe dans notre villa. Pour être loin de Rome, on n’y dort point trop lourdement et les aventures du jour vous font d’aimables rêves.
Ce n’était pas sans terreur que j’accompagnais à Baia ce gros Flavius Scévinus, dont les yeux ne se lèvent pas de terre, qui ne dit pas trois mots par heure, et qu’on s’attend, à tout instant, à voir crever dans sa graisse. Que veux-tu ? notre père ne fut pas concussionnaire, et il faut vivre. Mais si Scévinus est un être insupportable, sa maison est charmante. Bien exposée, dominant le golfe, fraîche et en belle lumière, elle renferme des cuisines, une cave, des esclaves, comme je n’en avais pas encore rencontré. Enfin trois êtres, qui ne sont pourtant pas les Grâces, forment à cet illustre imbécile un cortège enchanteur. C’est Cadicia, une vieille juive qu’on appelle Pétronia, et ce Vatinius, tu sais, dont le père a gagné gros dans le commerce des gladiateurs, sans que ces richesses profitent beaucoup à son fils, qui en est réduit à présent à écornifler toute la ville. Aujourd’hui il ronge Scévinus, qui se laisse faire parce que, pour chasser l’ardélion, il faudrait avoir un moment d’énergie, et ce courage coûte à Scévinus, plus que l’or qu’il laisse fuir de ses coffres.
Tu ne connais pas Cadicia ? Je vais te la présenter : une petite affranchie dont les grands yeux étonnés et les dents riantes vous tiennent en bonne humeur. Elle est fraîche comme le matin. Dans ma vie j’ai soulevé des toges. Eh bien ! tu ne croiras pas mon vieux vice : je me sens près d’elle un adolescent. Elle est hargneuse comme un chien corse, joueuse comme une chatte, voluptueuse comme une chèvre ; à toutes ces qualités animales, elle joint l’avidité d’un usurier et la rapacité d’un marchand d’esclaves, et, malgré tout, c’est une candeur. J’ajouterai même qu’elle ne manque pas de dignité quand elle daigne y songer. Notre philosophe – car nous avons un philosophe parmi nous : le célèbre Démétrius – notre philosophe, avec toute son expérience du monde, l’a prise longtemps pour une matrone. Ce n’est que l’autre soir qu’il s’est avisé d’avoir des doutes sur sa vertu romaine. À table, sur le lit, la voici qui se penche vers mon sage, et à l’oreille : « Mon âme, j’ai une méchante puce qui me mange l’épaule, soulève un peu ma robe, et cherche-la dans mon dos. Je t’aimerai. » Il a obéi avec une conscience et une insensibilité dignes des meilleurs stoïciens, tandis que Cadicia étouffait de rire.
Pétronia est la servante, quelques-uns disent la nourrice de l’enfant. Elle l’habille, la coiffe elle-même, lui donne médecine lorsqu’elle est malade, ramasse et compte son argent, lave, détache et parfume ses robes, fabrique des enchantements, recherche pour elle, sur la plage, des pierres qui portent chance, l’instruit de la religion des siens, lui enseigne des recettes pour retenir ses amants et les moyens d’être immortelle. Cadicia l’aime, dit-elle, comme sa cuisse gauche ; Pétronia voit dans sa maîtresse sa fille, sa bienfaitrice et la banque dont elle tire sa subsistance.
Elles ne se séparent jamais.
Pétronia a le teint et l’aspect d’une tomate qui aurait longtemps mariné dans de la saumure. Ajoute à ces avantages, qu’elle porte des manteaux à fleurs et des socques de bois très épais de peur d’être piquée par les serpents. Quand elle marche, tout Baia en est averti.
La première fois qu’elles vinrent à la villa, Scévinus fut effaré. À la vue de la vieille Juive collée au dos de sa maîtresse, il dit à Cadicia :
« Par Pollux ! est-ce ta jumelle ?
– Oui, mon cœur, répondit l’enfant. Qui a l’une de nous a l’autre. Si tu ne veux pas de Pétronia, Cadicia te laissera le soin de fourbir toi-même ta dernière jeunesse. »
Scévinus arrêta sur elle ses yeux ternes, puis secoua la tête, haussa les épaules, jeta à terre une coupe de verre fin, cracha par trois fois, et eut un éternuement plus fort qu’un appel de trompettes.
« Par Pollux ! entrez toutes deux, puisque… puisque je ne sais plus ce que je voulais dire. »