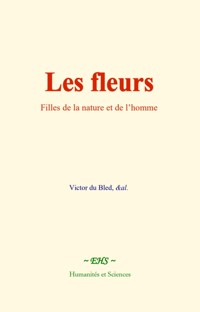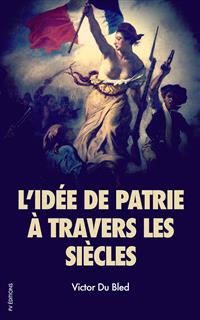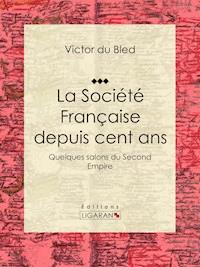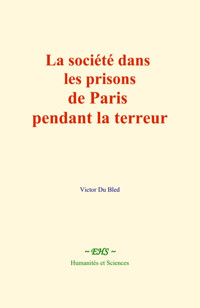
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Au temps du mauvais papier et de la grande épouvante , lorsque la Convention mettait les lois hors la loi, se décimait elle-même, créant une partie des obstacles dont elle devait triompher si durement, accomplissant aveuglément son œuvre, lorsque nos armées, gardiennes de la tradition et du véritable héroïsme, héritières du génie libéral de 1789, préservaient dans un élan sublime l’honneur, agrandissaient le patrimoine de la France ; lorsque, chacun se sentant au pied de l’échafaud, la vie était devenue un art et la pitié un crime, un homme d’esprit, interrogé sur ce qu’il pensait, répondit avec une douloureuse ironie : « Ce que je pense ! J’ose à peine me taire ! » Alors, en effet, l’esprit est suspect, le silence lui-même une protestation, la noblesse, les gens riches se cachent, émigrent, se battent en Vendée ou à Lyon ; l’Académie française, le premier salon de France, calomniée par Chamfort, un de ses membres, disparaît ; le salon de Mme Roland, celui de Mme de Sainte-Amaranthe, se ferment pour cause de proscription, de guillotine, et le peuple a son spectacle de prédilection, le travail du fonctionnaire Sanson, le Gratis de la Convention. On parle à la tribune, on vocifère dans les clubs, on agit dans la rue ; emportés par la haine, par l’enthousiasme et la peur, haletants sous un labeur surhumain, les vainqueurs éphémères n’ont ni le temps ni le goût de la conversation, science délicate qui exige des loisirs, une culture raffinée, des mœurs élégantes auxquelles, sauf de rares exceptions, les terroristes demeurent étrangers. Ne leur demandez ni la politesse aimable, ni la malice piquante, ni la grâce : pour les trouver encore, il faut les chercher dans les endroits où l’on est le moins accoutumé à les rencontrer, dans les prisons de Paris, les véritables, les seuls salons de cette époque tragique, devenus le dernier rendez-vous de la bonne compagnie…
À PROPOS DE L'AUTEUR
Victor Du Bled, romancier et historien français, spécialiste des questions politiques et économiques et de la société française, rédacteur à la "Revue des deux mondes" (1848–1927)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 71
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La société dans les prisons de Paris pendant la terreur
La société dans les prisons de Paris pendant la terreur
I.
Au temps du mauvais papier et de la grande épouvante, lorsque la Convention mettait les lois hors la loi, se décimait elle-même, créant une partie des obstacles dont elle devait triompher si durement, accomplissant aveuglément son œuvre, lorsque nos armées, gardiennes de la tradition et du véritable héroïsme, héritières du génie libéral de 1789, préservaient dans un élan sublime l’honneur, agrandissaient le patrimoine de la France ; lorsque, chacun se sentant au pied de l’échafaud, la vie était devenue un art et la pitié un crime, un homme d’esprit, interrogé sur ce qu’il pensait, répondit avec une douloureuse ironie : « Ce que je pense ! J’ose à peine me taire ! » Alors, en effet, l’esprit est suspect, le silence lui-même une protestation, la noblesse, les gens riches se cachent, émigrent, se battent en Vendée ou à Lyon ; l’Académie française, le premier salon de France, calomniée par Chamfort, un de ses membres, disparaît ; le salon de Mme Roland, celui de Mme de Sainte-Amaranthe, se ferment pour cause de proscription, de guillotine, et le peuple a son spectacle de prédilection, le travail du fonctionnaire Sanson, le Gratis de la Convention. On parle à la tribune, on vocifère dans les clubs, on agit dans la rue ; emportés par la haine, par l’enthousiasme et la peur, haletants sous un labeur surhumain, les vainqueurs éphémères n’ont ni le temps ni le goût de la conversation, science délicate qui exige des loisirs, une culture raffinée, des mœurs élégantes auxquelles, sauf de rares exceptions, les terroristes demeurent étrangers. Ne leur demandez ni la politesse aimable, ni la malice piquante, ni la grâce : pour les trouver encore, il faut les chercher dans les endroits où l’on est le moins accoutumé à les rencontrer, dans les prisons de Paris, les véritables, les seuls salons de cette époque tragique, devenus le dernier rendez-vous de la bonne compagnie.
Au début, et surtout dans les prisons muscadines, faites à la hâte avec d’anciens palais, hôtels, couvents ou collèges, et d’abord affectées au service des détenus politiques, ceux-ci pouvaient entretenir quelques illusions. La commune n’a pas encore pris à son compte cette administration, le tribunal révolutionnaire accorde des mises en liberté, les parents, les amis ont le droit de visiter les prisonniers, de leur écrire ; ils jouent à toutes sortes de jeux, lisent, étudient à leur gré. On commande sa nourriture au dehors et le dieu assignat fait merveille. D’ailleurs les riches donnent en raison de leurs facultés, et tout s’exécute à leurs dépens : à Port-Libre, par exemple, ils paient la nourriture des indigents, les frais de garde qui atteignent chaque jour cent cinquante livres, même le chien destiné à les surveiller ; un trésorier, choisi par eux, fait la collecte, ordonnance toutes les dépenses. Le soir, on se réunit au salon, où chacun apporte sa lumière : les hommes lisent, écrivent, les femmes brodent, tricotent ; on termine par un petit souper ambigu, quelquefois on organise des concerts ; à défaut de Boufflers ou de Ségur, voici le poète Vigée, l’auteur de la Fausse Coquette et de l’Entrevue : les dames proposent des bouts-rimés et décernent une récompense au vainqueur, les champions ne manquent pas, et l’on se croirait presque revenu au temps de l’hôtel de Rambouillet, à la fameuse Journée des Madrigaux. La lecture du journal a lieu à haute voix, et « à la nouvelle d’une victoire, on voyait passer le bout de l’oreille : les figures pâlissaient, des soupirs étouffés, des contractions de nerfs, des trépignements de pieds annonçaient l’aristocrate incorrigible. » Le 23 nivôse an II, chants d’église, le Gloria in excelsis, le Credo, enfin la messe complète, observe Coittant, épicurien et libre-penseur. En revanche, le 4 prairial, fête de l’Être suprême, hymnes patriotiques, prières chantées par les dames, danses, chœurs, Marseillaise, vers de Guillaume Tell déclamés par Larive. Il y eut même une prison où les détenus sollicitèrent la permission de planter dans la cour un arbre de la liberté, et le concierge dut leur faire observer que l’endroit ne semblait guère propice à une telle cérémonie : peut-être voulaient-ils planter l’arbre de la liberté pour en avoir l’ombre. Concerts et fêtes durent se passer de musique instrumentale, car la Commune proscrivit impitoyablement violons, violes d’amour, basses et quintes ; les cris de la populace hurlant autour des victimes qu’on entraîne en prison, ou qui en sortent pour mettre leurs têtes à la lunette de l’éternité, voilà sans doute la musique qu’elle leur réservait.
On trompait par d’autres moyens l’inquiétude et l’ennui : par exemple, la manie de tirer les cartes devient au Plessis l’occupation de bien des prisonnières. Une vieille porteuse d’eau avait conquis la vogue et tenait ses assises dans un corridor obscur, une planche appuyée sur deux chaises lui servant de tréteau. Survient une jeune femme qui lui lance ce défi : « Voyons si tu es aussi habile que moi ; point d’amour, de mariage, ni d’argent ; les ci-devant rois seront des accusateurs publics, les reines de bonnes républicaines, le neuf de pique l’échafaud. Tire les cartes pour toi, je les expliquerai. » Et elle jette sur la table une pièce de 5 francs. La porteuse d’eau se trouble, hésite, enfin elle se décide, retourne le neuf et l’as de pique : « Eh bien ! que dis-tu de cette accolade ? Tu pâlis ! Ce soir au tribunal, demain guillotinée. » Le hasard ayant confirmé cette prédiction, la divination par les cartes eut plus d’adeptes que jamais.
L’art de la miniature était fort en honneur dans les salons de la Terreur, et, moyennant finances, les guichetiers consentaient à transmettre aux parents un portrait, un médaillon. Roucher, l’auteur de ce Poème des Saisons que Rivarol appela le plus beau naufrage du siècle, Roucher envoie aux siens un portrait peint par Leroy, avec ces quatre vers :
Ne vous étonner pas, objets charmants et doux,
Si quelque air de tristesse obscurcit mon visage ;
Lorsqu’un savant crayon dessinait cette image,
On dressait l’échafaud et je pensais à vous.
Le portrait de M. de Broglie venait d’être terminé, lorsqu’il reçut la nouvelle qu’il serait exécuté dans deux heures. Vigée était chez lui et lisait ses ouvrages ; il tira sa montre et dit : « L’heure approche, je ne sais si j’aurai le temps de vous entendre jusqu’à la fin ; mais n’importe, continuez toujours en attendant qu’on vienne me chercher. »
L’amitié naissait, grandissait rapidement dans cette atmosphère de sincérité forcée, loin des conventions sociales, comme dans un naufrage l’isolement, la nécessité, l’oubli de l’étiquette, le dévouement créent des affinités subites, des sentiments profonds entre des personnes que le cours ordinaire de la vie eût laissées toujours indifférentes les unes aux autres. Là se réalisait l’apologue de l’aveugle et du paralytique ; là chacun se montrait bon, charitable, fraternel pour son semblable : une quarantaine de cultivateurs, envoyés au Luxembourg, étant tombés malades faute de ressources, les détenus font aussitôt une collecte, et en vingt-quatre heures les voilà habillés, couchés, chauffés, nourris.
La hache a moissonné tant d’êtres innocents
Qu’elle semble du reste avoir fait des parents.
L’amitié, qui souvent prend sa source dans la reconnaissance, qui vit de déférences et d’attentions, devait naturellement fleurir et s’épanouir en un milieu où les théories de Hobbes n’avaient plus de raison d’être. Le nouvel arrivant trouvait dans les habitants de la chambre commune des consolateurs, des camarades : chacun, à tour de rôle, balayait la chambre, allait à l’eau, faisait la cuisine.
L’amour marchait de conserve avec l’amitié, parfois d’un pas plus rapide. En pleine Terreur, en prison, en dépit des portes à doubles verrous et des grilles, malgré les guichets et les défenses de jour en jour plus sévères, on s’aime, on se réjouit, on corrompt les gardiens à prix d’or, on semble vouloir vivre toute une vie en un jour, en quelques heures, et paraphraser le mot de l’ancien : aujourd’hui le plaisir, demain l’échafaud ! A côté de grands exemples chrétiens comme ceux des dames de Noailles, combien de chutes dans la galanterie, combien de scènes dignes d’un Parny, d’un Dorat ! Madrigaux, bouts-rimés, tendres œillades, rendez-vous sous l’acacia, vont leur train.
Ma muse, éveille-toi ! Comment ! tu dors encore !
Sous ta fenêtre, au lever de l’aurore,
Arrivent de tous les côtés,
Des groupes de divinités
Aimant des mortels la présence.
Où sommes-nous ? En prison, en 1794, Robespierre régnant, ou bien dans les salons de la Régence ? « On ne s’y ennuyait pas, disait plus tard un de ceux que sauva le 9 thermidor, on y filait même de jolis romans d’amour qui avaient cet avantage de ne pas durer. L’appel de neuf heures et celui de trois heures mettaient bon ordre aux idylles trop prolongées. » Et Mercier la Source, frère de lait de Louis XV, logé à la Force, dans une chambre bien meublée, encore mieux habitée, la chambre du conseil