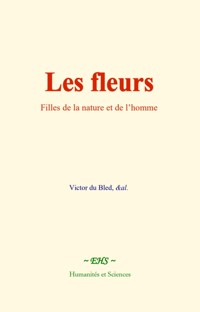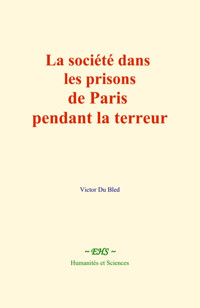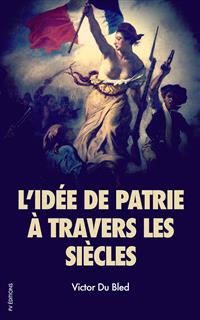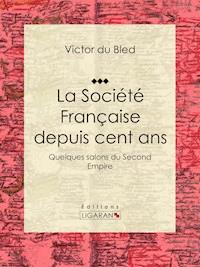
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Qu'est-ce qu'un Salon ? Peut-on le définir d'une manière qui satisfasse l'esprit, tout en répondant clairement à l'idéal que nous concevons de l'objet ? Suffit-il de dire que le salon est une école de civilisation, une sorte de thermomètre moral de la politesse, un foyer de vie intellectuelle, de causerie, d'amitié, de tendres sentiments, le cadre où s'épanouissent la beauté et l'élégance, l'auxiliaire le plus actif des modes, du goût, de la science sociale ?"
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 710
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335048056
©Ligaran 2015
À MADAME CHARLES HAYEM-FRANCK
Hommage très respectueux d’un ami fidèle.
VICTOR DU BLED.
En 1916, lorsque j’entrepris de composer un tableau de la société française depuis cent ans, à travers mes aînés, ma vie et mes contemporains, je me proposais un triple but :
D’abord de rendre hommage, de payer mon tribut de gratitude à ce monde poli qui m’a accueilli avec tant de bienveillance pendant cinquante huit ans, qui, en dépit de ses défauts collectifs ou individuels, reste le paradis, la patrie des bons cœurs, où j’ai appris à apprécier les riens charmants qui sont l’apanage des compagnies d’élite ; et ces riens s’appellent : l’amitié, l’idéal, l’admiration, la courtoisie, le tact, l’esprit, qui sont le décor de la vie humaine.
Ensuite je voulus apporter mon grain de sable à l’édifice social, plus que jamais battu en brèche, par les apôtres de l’évangile du néant et leurs complices, qui raisonnent comme Caliban contre Prospéro, et veulent tout détruire au nom d’une théologie communiste fondée, elle aussi, sur l’absolu, au nom d’une égalité chimérique qui serait la misère pour tous. Ces emmurés de l’instinct matérialiste ont heureusement pour adversaires la force des choses, la loi d’ironie, le bon sens, la science, les Vingt-cinq soldats de Gutenberg ; mais ils possèdent la puissance de la haine, l’envie, de la force sauvage, puissance décuplée, centuplée, à certaines heures, par la défection des pouvoirs publics, l’inertie des modérés, leur défaut d’organisation, et cette espèce de prestige quasi mystique que consacre une habitude séculaire de s’incliner devant les coups d’État, d’en haut ou d’en bas, partis d’une Capitale. Ne sont-ce pas d’infimes minorités qui ont installé, prolongé la Terreur en 1793, 1794, renversé la Monarchie en 1848, proclamé la Commune de 1872 ? Ceux qu’en Berry on appelait les meneux de loups du socialisme, ont-ils manifesté quelque repentir ? Ne prophétisent-ils pas sans cesse leur prochaine victoire, une dictature sans pitié dont les Russes nous donnent un modèle si accompli ? C’est toujours, comme dit Dante, l’erreur des aveugles qui se font ou prétendent être guides, ou, pour parler net, l’illusion des incendiaires qui s’imaginent que la négation universelle, l’instinct des primaires, des analfabetos, recèlent des vertus supérieures de Gouvernement. Comme si les brutalités de l’athéisme ne pouvaient pas devenir plus tyranniques que les dogmes de la religion ! Cela ne peut se produire en France, et d’ailleurs cela ne durerait pas, ricanent nos endormeurs et nos endormis. Qu’ils daignent cependant se souvenir que quelques bidons de pétrole ont brillé les Tuileries, la Cour des Comptes en 1871, sous l’œil amusé des Prussiens ; qu’ils se remémorent ce proverbe du pays de Lénine : Une chandelle d’un sou a suffi pour brûler Moscou ! Et surtout cette réflexion du Comte Alfieri qu’un ami s’étonnait de retrouver assagi sous le Consulat, après l’avoir connu presque révolutionnaire avant 1789 : « J’avais vu les grands, je ne connaissais pas les petits. » Un mot qui, appliqué aux grandes villes, contient toute une philosophie politique. On peut comparer ceux-ci aux Barbares qui, pendant des siècles, assaillirent l’empire romain : ils avaient en fait tous les vices de l’ennemi, sans ses qualités, sans la civilisation, et tout ce que celle-ci comporte d’élégances, de capital artistique, littéraire et scientifique.
L’histoire de la société française, histoire intime, toute en portraits, en tableaux, en anecdotes, plus vivante, plus vraie que la grande histoire, m’a fortifié, et je voudrais ardemment qu’elle fortifiât mes lecteurs, si j’en ai maintenant ou plus tard, dans cette conviction que l’homme vaut en proportion de ce qu’il croit, mais que les croyances valent par les vertus qu’elles suscitent et développent, que le sentiment religieux, patriotique, est à lui seul une distinction, que la sécurité est la première des libertés, que l’Univers n’est pas seulement une usine, une étable, un phalanstère, mais aussi, comme dit Carly, une église, une âme et un poème. J’ai rencontré beaucoup de nobles esprits qui étaient, ainsi que madame de Sévigné, entre Dieu et le diable ? je me suis aperçu qu’ils vivaient malgré eux, à l’ombre de la religion, du parfum d’un vase brisé. Parfois ils entendent monter, du fond de la mer, le chant mystérieux des cloches de la ville d’Ys, et, comme la petite mouette qui vole autour du vieux moutier perché sur la falaise, leur âme, soucieuse, frissonnante, bat des ailes aux portes de l’éternité. L’un d’eux m’a écrit cette parole touchante : « Je ne crois peut-être à rien, mais j’espère tout. Oui, j’espère que la tombe est un berceau et la mort une aurore. »
Ce qui doit cependant rassurer, c’est que cette théologie soviétique comporte des nuances, des sectes à l’infini ; c’est que ses théoriciens, ses hommes d’actions, d’accord sur le but, et encore pas complètement, ne le sont ni sur la tactique ni sur la stratégie du succès.
Par la conversation, par le rôle que joue soi élite, la société qui pénètre la vie tout entière d’un peuple est aussi pénétrée par lui, tour à tour effet et cause, reflet et rayon, juge et partie, recevant et suggérant les inspirations. C’est une énorme éponge qui s’imprègne des courants divers que lui apportent passions, volontés, habitudes, traditions, engouements nationaux ; un prodigieux alambic où le chimiste mêle cent ingrédients pour en tirer son elixir, où parfois l’alchimiste cherche la pierre philosophale.
Ainsi rien de ce qui touche l’humanité ne demeure étranger aux gens de goût qui fréquentent les salons : j’y ai entendu discuter les problèmes les plus graves aussi doctement, plus finement surtout que dans les Chambres politiques, et même dans les Académies ; on y cisèle en perfection le trait décisif, l’anecdote représentative, le mot qui résume et illumine le débat, le mot qui est l’économie d’un livre. On y apprend aussi que les mots sont du pain ou du poison ; ils coûtent bien cher, ils peuvent rapporter beaucoup, s’ils sont prononcés à certaines heures. On y apprend la douceur de vivre, et que la sagesse, comme dit Spinoza, doit être une méditation, non de la mort, mais de la vie.
Dans le salon de madame Aubernon, Ernest Renan nous disait des choses profondes sur ce double besoin des peuples, qui compose le panorama de l’histoire ; avancer et durer, sur les écueils qui menacent les hommes politiques engagés dans une voie ou dans l’autre. Car les digues, qui contiennent longtemps les violents, finissent aussi par amener les révolutions. D’une part, si l’on veut avancer, on doit choisir des gens capables de ne pas conduire l’attelage dans les abîmes ; d’autre part, quand le progrès n’est plus à la mode, il importe de ne point s’endormir dans un sommeil d’Epiménide. Il y a des idées, justes ou fausses, qui vaincues, mises au rancart, se recueillent, cheminent, insensiblement, reprennent faveur, enivrent de nouveau les cœurs, les intelligences, subjuguent les volontés. Hélas ! concluait Renan, avec un sourire résigné, un sourire d’historien et de prophète, aussi bien au nom du droit divin ou du droit monarchique constitutionnel, que du droit révolutionnaire, les chefs d’État de tous les pays n’ont pas laissé de lancer leurs peuples dans de mortelles aventures ; et il est à craindre que les cruelles expériences du passé ne servent pas à grand-chose.
Chez Hippolyte Taine, chez Emile Ollivier, chez madame Charles Buloz, chez Gaston Pâris et dans vingt autres cénacles, j’ai assisté à de somptueux tournois d’éloquence sur le suffrage universel et le régime parlementaire, que presque tous les causeurs-orateurs jugeaient organisés d’une façon rudimentaire et barbare. Êtes-vous donc l’adorateur du crocodile ? demandait Taine à ceux qu’il soupçonnait de pencher vers la démocratie avancée. La plupart estimaient, qu’après avoir battu en brèche le despotisme d’en haut, le libéralisme a le devoir étroit de combattre le despotisme parlementaire et le despotisme d’en bas. Le second a pris la place du premier, en attendant, dont le ciel nous préserve ! qu’il soit renversé par le troisième, ou plutôt par ses propres fautes. Car il est monstrueux que le suffrage dit universel commence par se mutiler en excluant la moitié de la population française. Il est monstrueux qu’un alcoolique, un dément avéré, aient devant le scrutin autant de droits qu’un Thiers, un Guizot, un Jules Ferry, un Pasteur, un Victor Hugo, un Branly. Il est monstrueux que madame Roland, madame de Staël, madame de Girardin, la duchesse de Duras, Arvède Barine, n’aient pas pu voter, que mesdames de Martel-Mirabeau (Gyp), madame Henri de Régnier, la comtesse Mathieu de Noailles, mademoiselle Juliette de Reinach, madame Charles Hayem, la duchesse de Rohan, ne puissent pas voter. Il est monstrueux que les professeurs des lycées de jeunes filles, nos institutrices communales, nos sœurs de Charité, soient réputées incapables de déposer un bulletin dans l’urne. Il est monstrueux qu’une veuve, mère de six enfants, faisant valoir une exploitation agricole, commerciale ou industrielle, soit privée du privilège que la loi confère à ses employés et domestiques mâles. Il est monstrueux qu’une femme mariée, mère de famille, n’ait pas le suffrage plural, ni même personnel ; et elle devra pouvoir voter autant de fois que son mari, le jour ou les yeux de nos législateurs s’ouvriront à la lumière. Il est monstrueux que des socialistes, des fanatiques d’égalité, osent repousser une telle réforme, qui sans doute dérangerait leurs calculs en leur enlevant le monopole de certaines sottises ; car les femmes électrices auraient parfois plus de bon sens, de droiture et d’intuition que les électeurs. Il est monstrueux que des républicains modérés, des conservateurs fassent chorus, au nom de je ne sais quelle infirmité féminine, alors que l’infirmité masculine est attestée par tant de votes lamentables depuis bien des siècles, alors qu’ils sont les mieux placés pour sentir tout ce qu’il y a de divination, de grandeur morale, de raison pratique chez tant de femmes, tout ce qui peut résulter d’un progrès pareil, ce qu’il apporterait d’autorité au suffrage universel, au régime parlementaire. Il est monstrueux enfin que les forces intellectuelles de la France, l’institut et les Académies de province, les Chambres de Commerce, les Chambres d’Agriculture, l’Armée, les Mutilés de la Guerre, les Facultés de Médecine, les Facultés de Droit, l’Université, nos différents cultes, n’aient pas leur représentation directe au Parlement. Aussi bien la question est posée, et l’on ne saurait trop souhaiter que les excellents républicains qui président aux destinées du pays, M. Raymond Poincaré et ses collaborateurs, aient à cœur de la résoudre : ils sont à la hauteur d’une telle entreprise, capables de la mener à bonne fin.
Ce tableau fragmentaire de la société française que j’essaie d’esquisser, j’ose croire que je l’ai conçu dans un esprit de modération, de mesure, d’impartialité et d’optimisme, que je me tiendrai à égale distance entre le dénigrement et l’apothéose, entre la satire et l’adoration. À vrai dire, le problème est plein d’aspérités, il m’a souvent angoissé, et personne ne peut se flatter de l’avoir résolu d’une manière satisfaisante : il y a là de ces rochers à fleur d’eau qu’aucune carte marine n’a relevés, et contre lesquels se brisent les meilleures intentions.
D’aucuns m’ont conseillé de dire la vérité, toute la vérité, de la dire poliment, mais avec fermeté. Les trois grands modèles du genre, Retz, Saint-Simon, Chateaubriand, expliquent-ils, ne se sont pas fait faute de composer des portraits étincelants, chargés de haine, de colère, mensongers et même calomniateurs, lorsqu’ils présentent surtout l’envers de la médaille. Or le public leur en a su bon gré, et certes ces exagérations ont contribué au succès séculaire de tels ouvrages. D’autre part, les morts n’ont pas d’amis, ou s’ils en gardent, c’est dans la proportion de un sur mille. Et l’on serait étonné, si je disais les noms de ceux qui m’ont ainsi encouragé à ne pas mettre de coussins sous les épaules des pêcheurs.
Les choses ne vont pas aussi simplement. D’abord, parce que les rapports, sociaux sont fondés, non certes, sur l’hypocrisie, mais sur une certaine réserve, et des égards réciproques qui forment, à la longue, des espèces de concordats, des rites, des étiquettes qu’on ne viole pas impunément. Ces concordats constituent l’architecture, ou si l’on veut, l’armature morale de la société, le code, d’urbanité qui se transmet, non certes sans changements, de génération en génération. Ils jouent ici le même rôle que les habits pour les convenances : celles-ci sont déjà des demi-vertus. Une nation ne resterait pas longtemps debout si chacun avait le droit de dire à son voisin ce qu’il pense de lui. Aussi bien nous avons besoin d’indulgence réciproque, et ce n’est peut-être pas un si grand paradoxe de prétendre que les gens comme il faut valent autant par leurs défauts que par leurs vertus. Favart va jusqu’à affirmer : « Nous sommes environnés de torts, ils sont nécessaires, ils sont les fondements de la société. » Seulement il faut s’entendre sur la portée de ces deux mots : les défauts, les torts ; de même qu’on pourrait épiloguer sur cet autre aphorisme : Il n’y a que le don de se laisser tromper qui rende la vie supportable. J’ai connu une chanoinesse qui soutenait que l’existence serait intolérable sans les péchés. Lesquels ? Convenons d’ailleurs que certains défauts portent en eux-mêmes leur excuse, ou des circonstances atténuantes qui justifient parfois l’acquittement. Ainsi une coquette fait damner son mari, ses mourants, mais contribue beaucoup au charme des salons où elle fréquente. La galanterie est amorale, mais l’abbé Galiani prouve qu’elle est la pierre ponce qui polit les nations. La paresse offre des dangers qui sautent aux yeux ; et toutefois les paresseux ne sont souvent paresseux qu’en apparence, ils ont leur façon de travailler qui s’écarte des définitions classiques ; le grave Royer-Collard n’a pas craint de déclarer qu’ils sont peut-être, avec ceux qu’il appelait les bambocheurs, la réserve de la France : demain n’est pas toujours un paresseux. L’économie extrême a des aspects fort déplaisants, mais elle est aussi une seconde récolte, elle entretient le crédit des particuliers et du pays : un penseur trop peu connu, le Lyonnais Clair Tisseur, proclame les avares : le sel de la terre. L’égoïsme, à juste raison, semble odieux : cependant il conserve l’individu, la famille ; sans lui ceux-ci viendraient à rien, et la folie du dévouement, dans l’autre sens, compromet parfois les plus nobles causes. L’égoïsme intelligent développe la puissance nationale : voyez l’Angleterre qui en a fait sa divinité ; l’Angleterre, la plus magnifique et la moins reconnaissante de nos colonies.
Amiens Plato, sed magis amica veritas. Mais quelle vérité ? Il n’a pas manqué de beaux esprits pour affirmer, plus ou moins sincèrement, que l’amour de la vérité est l’amour de nos opinions, que chaque principe a deux vérités, que celles-ci sont des phares à feux changeants, que le bien et le mal, le juste et l’injuste, le vrai et le faux, le beau et le laid, se confondent les uns dans les autres par des nuances aussi indiscernables que celles du cou d’une colombe. Faut-il prendre au pied de la lettre cette boutade du moraliste italien Raiberti ? « Malheur à qui se fait le don Quichotte de la vérité, la plus décevante des Dulcinées, et celui du bon sens qui est un serviteur plus ridicule et plus rétif que Sancho Pança ! » En tout cas, une vérité adoucie devient parfois la justice, une façon de tenir compte des bonnes intentions dont, paraît-il, l’enfer est pavé. L’âme d’autrui fait songer à une forêt en montagne, avec des chemins d’exploitation, de rudes sentiers connus des chasseurs et des alpinistes, des coulées pour chaque sorte de gibier ; des grottes, des souterrains, des précipices et des avalanches.
Il ne faut pourtant pas que la bienveillance dégénère en faiblesse, en amnistie générale des grands comme des petits délits ; et j’avoue ne rien comprendre à certaines absolutions, dans le genre de celle où Victor Hugo, après avoir énuméré les effroyables forfaits de Zim-zizimi, lui ouvre le royaume céleste, parce qu’un jour il se détourna de son chemin pour ne pas écraser un pauvre crapaud. De cette indulgence poussée à l’extrême, s’inspirait-il, ce prêtre spirituel, l’abbé M. dans sa réponse à madame S… lorsque, mi-taquinerie, mi-curiosité, elle demanda s’il croyait à l’enfer ? « Sans doute, dit-il, mais Dieu est bonté infinie, et au jugement dernier il n’y aura personne en enfer ». Du moins l’abbé faisait-il toutes réserves pour le Purgatoire.
Les morts n’ont pas d’amis, mais ils ont des héritiers, et ceux-ci parfois se montrent très susceptibles : l’esprit de clan, l’orgueil familial, remplacent au besoin l’affection.
D’où la nécessité de ouater, tamiser, filtrer la vérité par l’euphémisme, la courtoisie, de pratiquer le précepte formulé par le poète Roy :
Glissez, mortels, n’appuyez pas !
Mais où commence, où finit la mesure ?
Tout dépend ici du critique et du critiqué. Tel, moralement, a le cuir d’un hippopotame, tel autre pousse des hauts cris si le pli d’une rose l’effleure. Avec celui-là vous auriez beau farder la vérité, l’envelopper de prudentes réserves, comme les Égyptiens entouraient leurs morts de bandelettes : il ne manquera pas de vous prodiguer les injures les plus sanglantes, de développer, à grand renfort d’arguments captieux, la thèse connue : à savoir que les Mémoires ne sont qu’une entreprise de diffamation, une façon de mentir par les cent mille voix du livre, de dévelouter les belles âmes, de faire un métier d’Arétin, de sycophante, qui relève des tribunaux. Beaucoup raisonnent à la façon de ce grand seigneur d’autrefois qui, surpris en flagrant délit de tricherie, croyait s’en tirer en appelant le plaignant ; et comme celui-ci s’exclamait : « Je ne me bats pas avec vous qui êtes un fripon ! » Il reprit : « C’est possible, mais je n’aime pas qu’on me le dise ! » En dehors des grincheux honnêtes, des grincheux malhonnêtes, que d’autres catégories de mécontents ! Les timides qu’épouvante la moindre indépendance de langage ; les diplomates qui raisonnent comme Marphurius, dénoncent dans chaque phrase une perfidie calculée ou involontaire ; les bavards qui blâment pour blâmer, ou se donnent des airs d’habiter une région supérieure aux contingences humaines ; les flatteurs qui s’indignent qu’un écrivain ose émettre des réserves sur celui dont ils attendent des avantages majeurs ou mineurs ; ceux-là n’admettant que l’apothéose, ne peuvent concevoir qu’on laisse entendre, par exemple, que leur chef est le mari ou l’amant de ses défauts, même très anodins. Et enfin, d’une manière générale, l’immense armée des vaniteux, qui se sent atteinte par l’affirmation ou l’omission. Car la vanité est un sentiment impérissable, comme l’envie, comme l’ingratitude, et, les saints exceptés, j’imagine qu’il n’existe point de gens exempts de vanité, que les prétentions le plus souvent sont en raison inverse des mérites. Écume de l’orgueil, la vanité s’appuie sur des talents minuscules, ou sur des zéros accumulés. Massillon confessait l’éternelle piperie de l’amour-propre, lorsqu’il répondit à un ami qui le proclamait le premier prédicateur du siècle : « Le diable me l’avait déjà dit ». Pour un Paganini, que de violons d’Ingres !
Et aussi, que de gens à qui ne suffit pas la gloire d’être réputés premiers dans leur spécialité ! Ils veulent encore être uniques, comme cette coquette navrée de n’être pas la seule très jolie femme d’un bal ; les éloges décernés à d’autres leur semblent de véritables insolences. Quel personnage représentatif, ce coiffeur qui, ayant payé d’avance un article laudatif, s’indigne parce que le journaliste a seulement célébré « ce demi-dieu de la coiffure. » Pourquoi demi ?
Chacun se fait un dieu de son brûlant désir.
Résignons-nous : à propos du même chapitre, un historiographe sera traité de Philinte et d’Alceste, de bénisseur et d’indiscret sans vergogne. On ne saurait contenter tout le monde, mais on ne mécontente pas tout le monde, en observant les règles d’une prudente impartialité, en laissant parfois entrevoir la vérité même en la dessinant légèrement. Recherchons seulement le témoignage de notre conscience, avec l’approbation de cet aréopage d’honnêtes gens, qui, en fin de compte, font la véritable opinion universelle, transmettent de siècle en siècle les saines doctrines du goût, composent le tribunal de cassation de la postérité. S’ils ont toujours estimé que la bonté, la modération, le bon sens, sont les plus grands courages sociaux, ils les veulent clairvoyants, armés, militants : ils ne sont pas loin de penser comme madame Geoffrin, à qui on vantait la bonté de quelqu’un : « Est-il sévère aux méchants ? » questionna-t-elle.
Depuis 1865, je prends régulièrement des notes, et, à défaut d’autres qualités, cette persévérance donne peut-être quelque crédit aux pages où je reproduis une partie de ce que j’ai vu, entendu, ressenti. Une partie, la Moindre partie certes, car j’avais réuni énormément de notes, et me vois obligé d’en laisser beaucoup de côté. Ce qui m’a aussi encouragé à rapporter mes impressions, d’est que j’ai eu la bonne fortune de rencontrer un assez grand nombre de gens célèbres, et, le jour même, ou le lendemain, je m’efforçais de consigner les paroles, les attitudes qui m’avaient frappé. J’ai ainsi rempli plus de cinq cents carnets dont je résumais la quintessence sur de grands cahiers. Certes, je ne savais pas avant 1870, et même longtemps après, que je composerais des espèces de Mémoires ; mais j’avais le pressentiment que, de ce travail préparatoire, il sortirait pour moi quelque chose d’utile, ne fût-ce que le goût de la précision, une solide discipline intellectuelle, je voudrais, pouvoir ajouter quelque agrément pour le lecteur. Au gré de celui-ci, dit un ancien moraliste, les livres ont leurs destins.
Voici la liste des chapitres aujourd’hui terminés, qui feront partie des prochains volumes.
– Dans les Vosges et en Haute-Saône. – Le Lycée Louis-le-Grand. – La Faculté de droit de Paris. – M. Thiers. – Madame Edmond Adam, – Le salon de madame Aubernon. – Les grands élégants. – M. et madame Emile Ollivier.
Mes quatre Sous-Préfectures. – Le Ballet de l’Opéra. – Dîners mondains et Dîners de Sociétés. – Le salon de la Revue des Deux-Mondes.
– Artistes et gens du Monde. – Madame Barratin. – La marquise de Blocqueville. – Madame Charles Cartier. – Madame Alexandre Singer. – La baronne de Lareinty. – Édouard Pailleron. – La Comtesse de Loynes. – Madame Charles Hayem. – M. et madame de Chambrun. – La princesse Alix de Francigny-Lucinge. – Une amitié célèbre : Anatole France et madame Armande Caillavet.
Autour du Parlement. – Salons poétiques. – Les Préfets du XIXe siècle. – Impressions de Clinique. – La Société des gens de Lettres.
Derniers Salons. – Ma vieille province. – Stéphen Liégard. – Modes et travers mondains.
D’autres chapitres sont sur le chantier, et à pied d’œuvre : La danse mondaine. – Les Albums. – Amitiés et relations. – Stations thermales. – Conférences et voyages. – La jeune fille française. – L’idée de patrie à travers les siècles. – L’amour au XIXe siècle. – Médecins. Prédicateurs, Diplomates. Magistrats. Avocats. – Petites Anthologies.
Il me faudrait environ trois ans pour mettre au point ces derniers morceaux, mais je suis né en 1848, à mon âge les années n’ont plus que six mois, et j’attends avec sérénité l’impératif catégorique prohibitif ou facultatif. En fait le plus gros de l’ouvrage est achevé.
Ayant déjà entendu sonner l’Angélus du soir, bien près de connaître le pourquoi du pourquoi, j’aurai du moins pu évoquer des amis admirables, et, dans l’humble mesure de mes forces, tenté de mettre en relief le charme d’une civilisation élégante, encouragé nos descendants à suivre la voie des grands disparus. L’amitié est une foi, une religion : d’elle aussi on peut dire :
La foi qui n’agit pas, est-ce une foi sincère ?
Le culte de la patrie, de ces fées bienfaisantes qui s’appellent la science, l’art, l’urbanité, n’est-il pas, à son tour, une foi, une religion ?
VICTOR DU BLED.
Avril 1923.
Château du Larrey, Boissise-la-Bertrand, Seine-et-Marne.
Ou est-ce qu’un Salon ? Peut-on le définir d’une manière qui satisfasse l’esprit, tout en répondant clairement à l’idéal que nous concevons de l’objet ? Suffit-il de dire que le salon est une école de civilisation, une sorte de thermomètre moral de la politesse, un foyer de vie intellectuelle, de causerie, d’amitié, de tendres sentiments, le cadre où s’épanouissent la beauté et l’élégance, l’auxiliaire le plus actif des modes, du goût, de la science sociale ? Ne convient-il pas d’ajouter qu’il constitue une des principales différences entre les peuples de haute culture et les peuples barbares ou enfants ? N’est-ce pas lui qui consacre l’influence de la femme, qui, grâce à elle, donne le pas aux mœurs sur les lois, facilite ces dictatures de l’éventail, parfois aussi désastreuses que celles de l’épée ? Car il n’existe pas plus de salon sans femme que de printemps sans roses. Il est des salons où les femmes règnent, il en est où elles gouvernent, il n’y on a point où leur trône, visible ou invisible, n’ait sa place. Un salon sans femmes semble une espèce de monstre : qu’on l’appelle Club, Académie, Chambre parlementaire, que son directeur donna des dîners non pareils, qu’on y dise de fort belles choses, que d’aucuns le préfèrent, j’y consens : mais, puisqu’on n’y respire point le parfum de l’éternel féminin, puisque la liberté en exclut forcément la grâce, les coquetteries de la parole et les raffinements délicats que suscitent l’art et le désir de plaire, ne l’appelez pas un salon.
Et cela signifie aussi qu’un salon est une cour minuscule, avec sa reine constitutionnelle ou absolue, ses favoris, des ministres, des courtisans, les amis de la veille, d’aujourd’hui, de demain, les amis de tout temps, les utiles, les agréables, les ennuyeux qui troublent la solitude et n’apportent point la compagnie, les indifférents qui parfois montent en grade après un stage, font troupe aux jours de fête, comme les figurantes à l’Hippodrome ou à l’Opéra, ceux qu’une de mes amies appelle ; les chaises louées. Cela signifie qu’il importe de proscrire les âpres discussions elles grands éclats de voix, qu’on ne saurait trop rappeler aux discoureurs le mot de Madame Geoffrin au comte de Coigny qui se servait d’un petit couteau pour découper le poulet du souper, en même temps qu’il se noyait dans un coûte interminable : « Monsieur, dans cette maison, on aime que les couteaux soient longs et les histoires courtes. » Point de querelles, beaucoup de sous-entendus, peu de gestes, pas de rabâchages, rien qui ressemble aux débats de la tribune. Un sourire ne vaut-il pas une phrase, un mot spirituel une dissertation, une inflexion de voix ne révèle-t-elle pas à l’initié des pensées de derrière la tête, toutes différentes des paroles prononcées ? Notre langue française n’est-elle pas souple comme un solliciteur, rusée comme un diplomate blanchi sous le harnais ? Ajoutez-y la présence réelle de la maîtresse de maison, la certitude de la rencontrer souvent, le salon appuyé à une salle à manger, celle-ci adossée à une bonne cuisine. D’assez nombreuses directrices de grands salons du XVIIIe siècles donnent deux dîners par semaine, et l’on sait le mot, de Madame du Deffand : « Le souper est une des quatre fins de l’homme : j’ai oublié les trois autres. » Il y a aussi de l’esprit à contenter la guenille, car la plupart des hommes demandent trois choses aux femmes : d’être ou de paraître jolies, de savoir faire ou faire faire la cuisine, et d’avoir l’air de les écouter : n’en déplaise aux féministes, longtemps encore ces qualités conserveront leur attirance.
Depuis quatre cents ans et plus, nous avons en France des salons, et ceux-ci revêtent la livrée des personnes qui les président. La cour fut le premier salon, sur lequel se modelèrent princesses du sang, grandes dames, femmes de magistrats, simples bourgeoises. Marguerite de Navarre, première femme de Henri IV, accrédite le fameux principe de la conversation générale à table, principe renouvelé des Grecs et des Romains, très contesté d’ailleurs au XVIIIe siècle et de nos jours, prôné et mis en pratique par Madame Aubernon de Nerville et ses émules. Le cercle de la marquise de Rambouillet contribue à réformer la langue et les mœurs, les bureaux d’esprit du XVIIIe siècle ont dirigé l’opinion publique, exercé une influence sur les destinées de la nation.
Il y a bien des sortes de salons, presque autant que de sortes d’amour : et de là l’erreur des pessimistes qui affirment que le salon n’existe plus. Comme s’il était facile de comparer le présent au passé ! Comme si chaque époque n’avait pas eu ses détracteurs, aussi exclusifs, aussi présomptueux en général que ceux de l’époque précédente et postérieure ! Faut-il prendre au sérieux l’impertinente jérémiade de Guy Patin en 1666 : « Nous sommes la lie de tous les siècles ? » celle d’une femme de l’ancien régime : « Et dire que ce que nous voyons sera un jour de l’histoire ! » Nous sommes en présence du vaste panorama contemporain comme l’ouvrier dans une usine, comme le soldat dans la bataille : le simple troupier, le lieutenant lui-même ne voit qu’un petit coin, celui où il combat – tel Fabrice del Dongo dans la Chartreuse de Parme ; – seul le général en chef, posté en haut de la colline, embrasse l’ensemble de l’action, je remarque, en passant, que les croyants raisonnent de la même façon en face de la Providence ; les peuples gémissent, s’indignent, se disent injustement frappés, nient Dieu qui permet tant d’horreurs ; les croyants répondent que les nations sont simplement les pions de l’échiquier céleste, le grand joueur de là-haut les fait marcher dans l’intérêt de la partie merveilleuse qu’il conduit sur tous les points de l’univers ; questions, doutes, sophismes, blasphèmes n’obtiennent pas de réponse ; le général en chef garde le secret de la manœuvre et de la victoire future.
Déjà, vers 1840, on répétait cette bourde sur la prétendue mort du salon : Madame de Girardin répondit dans un de ses spirituels courriers de la Presse, et elle énuméra vingt grands salons. Tant pis pour vous, Madame ou Monsieur, si les salons ne vous plaisent pas : vos dédains ne les empêchent pas de vivre.
J’ai connu beaucoup de cénacles, j’y ai perdu pas mal de temps, et m’y suis ennuyé quelquefois ; j’y ai noué des amitiés charmantes, fait d’exquises découvertes d’âmes et d’esprits. Salons sans épithète, salons où l’on cause et salons où l’on pose, salons d’ostentation, salons politiques, académiques, diplomatiques, littéraires, musicaux, artistiques, religieux, salons où l’on joue la comédie, où l’on danse, où l’on dîne, où l’on s’amuse, où l’on se morfond, salons d’opposition et de gouvernement, voilà quelques variétés, et chaque variété se subdivise à l’infini. Il y a autant de salons que de maîtresses de maison, et chaque maîtresse de maison a plusieurs salons, suivant l’heure de la journée, le nombre des visiteurs, la quantité de lumière s’il fait nuit, l’état du ciel s’il fait jour. Chez la marquise de Lambert, le mardi appartient aux gens de lettres, le mercredi aux mondains ; quelques-uns, comme Fontenelle, Hénault, font partie des deux ateliers.
Ce que je vous conseille, cher lecteur, de fuir comme la peste, c’est l’endroit où les conversations roulent sur des personnes que la maîtresse de maison et deux ou trois interlocutrices sont seules à connaître ; j’en sais un où ces snobinettes parlent de leurs amies et amis en les appelant par leurs prénoms, où l’une d’elles nous a raconté pendant vingt minutes ses goûters chez Colombin et à l’Élysée Palace : j’avais envie de la battre, j’ai juré qu’on ne m’y prendrait plus, et j’ai tenu parole. Je ne veux pas nommer cette dinde exquise, comme disait Jules Lemaître ; ses fidèles ne me le pardonneraient pas : elle a un si bel hôtel, elle donne de si bons dîners, son mari gagne tant d’argent, a une si belle chasse ! Pensez donc : elle a tout l’esprit de ses truffes, de ses foies gras, de ses fleurs, de ses loges, des artistes qui viennent chanter chez elle. Et c’est pourquoi quelques gens de mérite, de talent même, continuent d’y fréquenter ; l’un d’eux me l’a confessé sans fard, ajoutant : oui, les sots, les ignorants, les philistins des deux sexes y tiennent le haut du pavé, mais je ne les écoute pas, je leur réponds au besoin avec mon moi mondain, et mon autre moi pense aux choses qui l’intéressent.
Cinquante-sept ans de vie de salon me donnent peut-être le droit de répéter aux débutants le conseil de Madame Cuvier : Souvenez-vous qu’on vous goûtera bien plus dans le monde pour les qualités que vous découvrirez aux autres, que pour celles que vous possédez vous-même. Autrement dit : parlez beaucoup aux gens d’eux-mêmes, le moins possible de vous-même. Et encore, et surtout, sachez écouter : c’est là une science dont on ne soupçonne pas la valeur, où bien peu excellent. Il y a des gens qui tout haut, ou tout bas, raisonnent comme ce brillant causeur : « Oui, je resterai chez les X…, si on m’écoute. » Et ce sont parfois des gens aussi pleins d’eux-mêmes, que vides d’idées originales. Certes, à écouter on risque d’entendre neuf cent quatre-vingt-dix-neuf niaiseries ou balivernes pour un mot rare, ou seulement plaisant ; mais d’autre part, s’écouter, c’est se prendre sur le fait, se trahir, se confesser à soi-même et aux autres. D’ailleurs bien écouter instruit, coûte peu, charme l’éternelle tribu des bavards ; et la directrice du salon vous en sait gré, pourvu que, sur un signe d’elle, vous soyez toujours prêt à ravitailler la causerie lorsqu’elle tombe, s’égare vers des thèmes dangereux, ou se noie dans des riens par trop insipides. Et puis les sots sont instructifs ; ne fournissent-lis pas des comparaisons lumineuses, des exemples à éviter, comme ces ilotes que les Spartiates enivraient pour détourner la jeunesse de l’ivrognerie ? La conversation n’est pas seulement l’art de se faire apprendre des choses que l’on sait par des gens qui ne les savent pas : avec elle on acquiert plus encore, ne fût-ce qu’un peu de patience à supporter ceux qui entrent dans les rites, et violent les lois du goût, comme un hippopotame entrerait dans un magasin de vieux Saxes, ou dans les vitrines de cloisonnés de mon ami Gustave Berly. Et c’est proprement un des principaux impératifs catégoriques – pour parler comme les philosophes, – de la science du monde.
Cette science du monde, les initiés en goûtent pleinement le charme dans les salons de la première partie du XIXe siècle, alors que les traditions de l’ancienne société française se maintiennent à peu près intactes, grâce aux personnes qui l’avaient cultivée, à leurs descendants directs. Principes politiques, élégance des manières, semblent alors solidaires, et les demeurants d’un autre âge en conservent du moins les grâces. Mais, de même que la liberté, la démocratie, la science, les voyages, le chemin de fer, le télégraphe, le téléphone, l’aviation, modifient l’atmosphère de la grande société européenne, ces facteurs influent aussi sur cette société restreinte qui s’appelle le monde poli. Les salons se sont multipliés à l’infini, à Paris, en province, et en même temps ils se sont imprégnés d’exotisme : ils ont perdu en partie leur prestige, leur crédit, où plutôt ce prestige, à force de s’éparpiller, semble se dissoudre, comme un flacon d’essence qui parfume une barrique, et devient presque insensible dans un foudre. Cependant il garde sa flamme, cette flamme qui ne saurait pas plus s’arrêter que le feu des hauts fourneaux, pas plus que la civilisation elle-même, dont la société polie est une sorte d’élixir. C’est dans une oasis de celle-ci que George Sand répondit à un brillant causeur qui, la rencontrant chez une amie, trahissait naïvement sa déception de la trouver très silencieuse : « Vous venez ici pour travailler, Monsieur ; j’y viens pour me reposer. »
Une autre classification des salons du XIXe siècle consisterait à les classer par époques ; elle soulève mainte objection. De même qu’un salon peut présenter plusieurs aspects, – d’aucuns semblent tour à tour un caravansérail, une académie, un concile, un club, un séminaire, une Chambre des Députés, un boudoir, un temple de Gnide, – de même il n’appartient pas exclusivement à telle ou telle période. Le salon de madame de la Briche commence avant 1789, traverse le Directoire, le Consulat, l’Empire, la Restauration ; celui de madame de Staël plonge ses racines dans l’ancien régime, et meurt avec elle en 1817 ; celui de madame Récamier se prolonge pendant la Monarchie de Juillet ; le salon de madame de Nerville et de sa fille madame Aubernon va de 1840 à 1899 : « Ah ! disait Gounod, embrassant un ami longtemps absent, combien de gouvernements se sont succédé depuis notre dernière causerie ! » Jusqu’en 1870, nos régimes politiques, hélas ! ont duré moins que les salons : ce sont ceux-ci qui, avec l’Église et la Science, l’Académie et la bureaucratie, ont représenté l’esprit de stabilité, l’ordre et le respect.
Je plaide pour les salons, parce qu’ils sont un de nos derniers refuges contre l’invasion des barbares ; par celle-ci j’entends la poussée socialiste, la tyrannie parlementaire, plus dangereuse parfois que la tyrannie d’un seul, car elle échappe à toute responsabilité ; j’entends l’envie, le débraillé moral, la courtisanerie démocratique, maux connus des républiques de l’antiquité, le fléchissement du principe d’autorité dans tous les ordres, la moquerie universelle, le progrès de l’argot dans l’art et la littérature. Ma conviction est profonde, et, j’ose le croire, bien fondée. Mais il faut aussi confesser que les salons ont leurs taches, ou si l’on veut leurs tares, que beaucoup d’entre eux appartiennent au type du salon de pacotille ; or celui-ci fait naître de fâcheuses confusions, qui permettent aux critiques de mauvaise foi ou aux ignorants de prononcer une condamnation en bloc, sans distinguer, sans établir de catégories. Il y a toujours eu, il y a, il y aura toujours des salons de pacotille, surtout parmi les salons officiels et parmi les salons purement mondains : ils sont représentatifs d’un état d’esprit, d’un état de frivolité, d’indifférence, reflètent nettement la vanité, l’égoïsme, ou les mesquines ambitions des directrices et des invités.
Cinquante rimeurs pour un poète, vingt parleurs pour un orateur, dix salons de pacotille pour un salon véritable ! C’est l’histoire de l’éternelle médiocrité, de l’éternel mouton de Panurge, de la grenouille qui veut égaler le bœuf, c’est l’application de cette loi générale qui exige que beaucoup de glands soient nécessaires pour produire un chêne, beaucoup d’officiers pour former un grand chef de guerre. Un salon est une fragile œuvre d’art, de patience, et peu de gens sont artistes, très peu ont la persévérance, dont Buffon faisait la condition principale du génie. Aussi les galons à la minute, les salons à la douzaine fourmillent-ils dans Paris la Grand-Ville.
Quels sont les caractères du salon de pacotille ?
Tout d’abord, il sent l’improvisation ; il lui manque cette première vertu, la durée ; on est tenté de répéter la réflexion qui venait à l’esprit de chacun, devant ces chatoyants palais de la Rue des Nations à la dernière Exposition Universelle : « Tout cela sera détruit l’an prochain ! » Et puis, l’observateur note une foule de dissonances : les invitations sont trop facilement accordées, et je sais même certaines maîtresses de maison qui les font offrir ; elles ont des racoleurs qui vont à la chasse de l’homme célèbre, ou seulement connu, de la beauté professionnelle, des personnes très bien nées. Les dîners manquent d’harmonie, on met les uns à côté des autres des gens qui sont aux deux pôles du monde intellectuel, ou même qui se détestent. S’agit-il d’une soirée, on invite huit cents personnes pour un appartement qui peut en contenir deux cents ; je me rappelle certain raout, chez madame B… où nous faisions littéralement la queue dans l’escalier. Trop de monde, aucune intimité, des concerts interminables où les hommes restent debout, et ne songent qu’à s’évader de cette geôle, des amphitryons qui vous connaissent à peine, des invités qui viennent des quatre coins de l’horizon, la confusion des langues et des esprits, l’absence universelle de tact et de goût, voilà les traits distinctifs du bazar mondain à vingt-neuf sous.
Quant aux moyens d’élever ces éphémères châteaux de cartes, rien de plus simple, et, en vérité, la recette est à la portée de tous ceux qui ont un portefeuille bien garni. Des fêtes, encore des fêtes, toujours des fêtes ! Seulement, comme dit l’autre, il y a la manière. Nous jouerons le même air, concluait un homme d’État, seulement nous le jouerons mieux. Il y a des degrés, comme il y a des quarts de talents, des demi-talents. Avec de l’argent, beaucoup d’argent, on arrive déjà à un résultat, et je veux signaler la belle théorie d’un vieux comte de Béthune-Sully, à qui une dame proposait de le conduire chez une amie ; – Donne-t-elle des dîners ? – Non. – A-t-elle une loge à l’Opéra ? – Non. – A-t-elle un château, une chasse, pour les réceptions d’automne ? – Non. – Alors, pourquoi voulez-vous que je fasse sa connaissance ? » Grande leçon pour les apprenties directrices de salons !
N’exagérons rien cependant. De même que certains députés ont une fois dans leur vie, des minutes, des quarts d’heure d’éloquence, de même ces salons snobs vous ménagent parfois une rencontre exquise et imprévue, l’audition d’un artiste qui remue soudain toutes les fibres de votre âme, une sensation de beauté collective. On y voit, amenés par des raisons de flirt ou de convenance, des gens très spirituels, et l’on y entend des propos réjouissants : telle naïveté a son prix, telle fatuité s’épanouit en paroles comiquement sonores. Savourons par exemple la remarque de cette étourdie lorsque son mourant annonce qu’on a distribué le Livré Jaune à nos très hauts et tout-puissants seigneurs du Parlement : « Les malheureux ! Ils ont aussi un annuaire ! » Et ce gros banquier distrait que l’on interrogeait sur la santé de sa femme, et qui répond machinalement : « Molle et offerte ! » Toujours dans un salon de pacotille, une arriviste vaniteuse interpelle madame de… : « On m’assure, madame, que vous avez prétendu que j’étais la maîtresse de Son Altesse le prince… – Je m’en suis bien gardée, car cela vous aurait trop charmée ; puisque vous faites tout ce qu’il faut pour qu’on le croie. » Et j’ai grapillé bien d’autres traits dans des maisons de cet acabit, qui d’ailleurs finissant quelquefois par jouer à peu près le personnage des autres.
Raconter la Vie intime des salons du XIXe siècle constituerait une sorte de travail encyclopédique : je me Bornerai pour l’initiant à égrener mes souvenirs sur quelques-uns de ceux où j’ai fréquenté.
Le baron Ernouf, historien de talent, petit-gendre du baron Bignon, ministre plénipotentiaire de Napoléon Ier, m’avait conduit chez son ami Latour du Moulin, député, qui n’était ni grand orateur, ni grand politique, mais, comme eût dit le maire de ma commune, il voyait pousser l’herbe à quinze pas devant lui. Or, il avait très bien remarqué que l’opinion publique évoluait, que la guerre de 1866, entre la Prusse et l’Autriche, avait porté un coup redoutable au prestige napoléonien ; et, après avoir été un des mamelucks ministériels, il préparait doucement sa conversion vers le tiers-parti, même vers la gauche ouverte que dirigeait Ernest Picard.
Et il essayait d’amadouer les uns et les autres en donnait d’excellents dîners. Les dîners n’ont-ils pas été de tout temps un très utile instrument de règne ? Et peut-être aurait-il réussi à devenir ministrable, comme certains cardinaux deviennent papables, sans le coup de tonnerre de 1870.
Madame Latour du Moulin avait la grâce de son hospitalité, et son accueil corrigeait certaines bévues du mari, qui manquait d’attirance, de rayonnement sympathique, de tact mondain, n’avait, pas non plus le secret des paroles ou des gestes retentissants, ne s’imposait donc, ni par un talent élevé, ni par un sens diplomatique supérieur. Au fond les collègues invités par lui ne prenaient pas au sérieux ses petites manœuvres, ses tentatives de ralliement, et je me rappelle avoir entendu l’un d’eux paraphraser le mot si plaisant d’un grand seigneur sur le trop fameux épicurien Grimod de la Reynière : « On mange Grimod, on ne le digère pas. » Mais des sourires et des plaisanteries ne sont passés raisons en politique, et, de voir à qui le Destin, depuis que le monde est monde, distribue la fortune, les honneurs, les places, les dignités, c’est de quoi justifier les intrigues de Latour du Moulin s’essayant, plus ou moins adroitement, aux grâces d’un libéralisme timide, afin de décrocher la timbale au haut du mât de cocagne éternellement dressé pour tenter la convoitise des ambitieux de tout poil et de tout plumage. J’ai eu le plaisir de rencontrer chez lui Gudin, le célèbre peintre de marine, avec sa fille, qui me paraissait un peu froide, un peu distante, toute recueillie dans sa rare beauté ; celle-ci éveillait le souvenir des belles châtelaines et ladies peintes par Gainsborough et Reynolds ; sa mère était anglaise, et elle avait hérité d’elle une taille idéale, avec une carnation où le duvet de la pêche, les couleurs de la rose, se fondaient harmonieusement.
Gudin était aimable causeur, quand on arrivait à lui inspirer un peu de sympathie ; il contait ses débuts, son rude et persévérant effort, comment il se faisait attacher au mât d’un navire pour observer la mer quand celle-ci se soulevait, emporter en quelque sorte avec lui l’âme de cette mer, et la traduire sur la toile, en même temps que les attitudes du vaisseau, le travail silencieux, discipliné, des matelots luttant contre la tempête. Et puis des récits de voyages, des portraits causés de gens célèbres, des farces d’atelier, mais toujours avec le ton, les manières et les nuances d’un parfait gentleman.
C’est encore chez les Latour du Moulin que je connus la baronne Blaze de Bury avec ses filles, Yetta et Fernande de Bury ; et ce fut le point de départ de relations qui s’épanouirent en amitié, avec une note admirative de ma part pour tant de dons originaux concentrés dans une seule famille. Tous ces Bury avaient du talent où presque du talent, un esprit vif, primesautier, indépendant, une ferveur d’activité extraordinaire dans l’ordre intellectuel, le besoin inextinguible de goûter les fruits de l’arbre de la science, parfois si amers, et d’y faire mordre les autres, Blaze de Bury a écrit vingt volumes, pleins d’érudition élégante, de grâce pénétrante et incisive, sur les sujets les plus variés : certaine étude de lui, dans la Revue des Deux Mondes, sur Bianca Capello, grande duchesse de Florence, m’a émerveillé, et n’est jamais sortie de ma mémoire ; je la relis encore de temps en temps. Avec cela, beau-frère de François Buloz, critique musical de la célèbre Revue, Pourquoi n’a-t-il pas décroché la timbale d’académicien ? Qui sait ? Peut-être trop de fantaisie, de papillonne dans la conduite de la vie. Mais cela ne suffirait pas. Tant d’autres réussissent, malgré la fougue de leur tempérament littéraire ou moral ; tant d’autres échouent avec les qualités qui devraient les désigner aux suffrages des Warwicks faiseurs d’immortels ! Il y a la chance, le petit gravier dont parle Pascal à propos de Cromwell, le je ne sais quoi où se combinent dans la grande marmite du destin, les ingrédients variés, volonté, persévérance, talent, protecteurs efficaces, adversaires maladroits, opinion publique, succès oratoires ou littéraires, qui font l’homme arrivé ou parvenu.
Madame de Bury m’invita gracieusement à ses réceptions du samedi. La situation de son mari amenait chez elle beaucoup d’artistes désireux de témoigner leur reconnaissance, ou de se créer des titres particuliers à la gratitude effective du maître de maison. Et je ne pourrais citer tous ceux qui se firent entendre dans le cénacle, de 1867 à 1870 ! Ce n’était rien moins que les premiers sujets de l’Opéra, de l’Opéra-Comique, et de ce Théâtre Lyrique où nous autres jeunes gens, nous accourions avec empressement pour applaudir Nilsson et Miolan Carvalho dans la Flûte Enchantée : ces jours-là, nos modestes parterres nous semblaient des places d’honneur que les rossignolades des cantatrices transformaient en paradis, selon la formule. Ce qui me séduisit au moins autant chez madame de Bury, c’est la présence assidue de nombreux collaborateurs de la Revue des Deux Mondes, professeurs à la Sorbonne, au Collège de France, mondains et mondaines à la-mode. Ma joie était extrême de frôler des littérateurs ayant leurs entrées dans cette Revue qui me semblait le saint des saints. Si j’avais eu huit oreilles et autant d’yeux, comme Brahma dans certaines de ses statues, je les aurais dardés sur ces personnages ; si imposants devant mon imagination, qui disaient, le plus simplement du monde, des choses très simples, parfois aussi semaient des perles et des rubis dans leur causerie. C’est là que j’ai appris à écouter et à regarder avec les yeux de l’âme les gens célèbres. Parmi eux. Villemain était très fêté, et son esprit scintillait d’autant mieux qu’il se sentait plus entouré. Madame de Bury me présenta un jour à lui : mon émotion fut si grande, qu’il s’en aperçut, et je crois que cet hommage involontaire ne lui déplut pas ; il me demanda plusieurs fois des nouvelles du monde des étudiants, et je savais être agréable en racontant quelque frasque ou boutade de mes camarades contre le gouvernement. Il ne pouvait le sentir, ses coups de langue couraient les salons, se colportaient dans les cafés du Quartier Latin, je le lui disais, et il paraissait enchanté. Comme Doudan, il ne cessait d’annoncer la catastrophe finale, et, par instants, sa parole sonnait comme le Mané, Thécel, Pharès de l’Empire. Un jour, dans une matinée d’enfants, la marquise de Grammont, après avoir causé avec lui, propose : « Si nous allions voir danser l’avenir ! – J’aimerais mieux voir sauter le présent, prononce-t-il ».
Quel délice de l’entendre égrener ses souvenirs sur le comte de Narbonne, la Restauration, la Monarchie de Juillet ! Il était intarissable. Un ministre d’autrefois, renversé par une sorte de conspiration du silence, constatait mélancoliquement : « Nous avons été étranglés entre deux portes. – C’est souvent le sort des eunuques, riposte Villemain. »
Cependant il trouva un jour son maître, Saint-Marc Girardin, orléaniste lui aussi, qui rétorqua une diatribe de Villemain s’indignant de la prodigieuse fortune de Napoléon III : « Boulogne et Strasbourg, qui cachèrent Napoléon aux classes élevées, le montrèrent au peuple. » Le mot fut applaudi, comme il le méritait. Plus tard, dans le salon du duc de Broglie, le même Saint-Marc Girardin répliquait à un détracteur forcené : « Vous ne me ferez pas croire, malgré tout, que trente-six millions de Français se soient laissés gouverner pendant dix-huit ans par un imbécile. » Et, en terminant un couplet spiritualiste : « L’homme ne s’appuie que sur ce qu’il n’a pas créé »
Voici un autre fidèle du salon Bury, grand ami de la maîtresse de céans, Quesnay de Beaurepeire, magistrat éminent, auteur de trois remarquables romans, le Berger, le Forestier, le Marinier. Quesnay de Beau repaire était un causeur d’intimité, de pénombre, comme beaucoup d’autres homme ? du premier ordre comme cet admirable Victor Cherbuliez, que l’éloquence genre Diderot et madame de Staël, la conversation à grand orchestre, inquiétaient, agaçaient peut-être, en tout cas réduisaient au rôle de muet, lui qui, soit la plume à la main, soit devait deux ou trois amis, mettait un mot, un trait, une pensée dans chaque phrase, Madame de Bury me conta plus tard une remarque, magnifiquement modeste, de Quesnay de Beaurepaire qu’elle essayait de consoler de n’avoir pu convaincre le jury dans une affaire capitale. – Qu’importe, puisque vous avez montré beaucoup de talent et de courage ? – Non, je n’ai pas eu de courge, puisque je n’ai pas su ça inspirer. »
Madame de Bury, anglaise de paissance, avait de bonne heure appris, chez un de ses parents, lord B. le métier de maîtresse de maison, métier infiniment plus difficile qu’on ne croit, puisque tant de femmes s’y essaient, y méritent à peine un accessit, et sont aux modèles du genre ce qu’un peintre d’enseignes est à Gustave Moreau, un ménétrier de village à Rubinstein, un gâcheur de plâtre au sculpteur Mercié. Son talent était avant tout aiguillé par sa volonté, et j’imagine qu’il y avait en elle une politicienne cosmopolite, presque une femme d’État qui, malgré son ardente recherche, n’avait pu trouver son cadre ou son tremplin. Elle avait plutôt le sens des idées générales, de leur logique et de leur enchaînement, que celui des idées brillantes, phosphorescentes, où se complaît le goût français. Avec cela, une aptitude universelle à comprendre, un grand orgueil, le désir assez naturel d’imposer ses conceptions, et de ne se subordonner en aucun cas : ces derniers traits expliquent peut-être l’insuccès relatif d’une femme si bien douée. Âgée de quatre-vingts ans, elle écrivait de grands articles pour des revues anglaises, tant la vieillesse avait peu de prise sur ce cerveau si vaillent. Une de ses prétentions, était de s’y connaître supérieurement dans cet art, trop négligé de nos jours par les jeunes femmes, que Rabelais appelle la Science de Gueule : « – Mon cher ami, me dit-elle souvent, savez-vous distinguer l’aile gauche du poulet de l’aile droite ? – (C’était son critérium). Non certes, répondais-je. – Alors vous ne savez rien en cuisine ; moi, je fais la distinction les yeux fermés, et mon goût ne me trompe jamais. » – J’objectais alors que, Nomentanus, Apicius, Grimod de la Reynière, Cambacérès, Brillat-Savarin, ignoraient aussi cette distinction. Et nous disputions sur ce problème majeur. D’ailleurs, elle appliquait à la rigueur son principe, et son mari rivalisait de ce chef avec elle, si bien que chacun d’eux achetait son poulet chez le marchand de son goût, l’apportait chez lui, le faisait rôtir à part, mangeait d’abord l’aile droite, puis l’aile gauche, puis la patte droite, puis la patte gauche : chacun avait son buffet, et après l’accomplissement du rite gastronomique, renfermait le reste de sa volaille avec une clé spéciale. Et je ne me suis jamais risqué à demander quelle était la part de mesdemoiselles de Bury ; mais je me suis à ce propos rappelé la question d’une de mes amies, qui attachait, elle aussi, la plus grande importance à la réfection de dessous le nez, et donnait deux dîners consécutifs, afin sans doute, que les fleurs et le dessert servissent le second jour. « Voyons, me dit-elle, voulez-vous être du dîner des ailes ou du dîner des pilons ? » Et elle se scandalisa fort, parce que je répondis que je voûtais être du dîner où l’esprit de ses convives aurait des ailes. »
Le salon de madame Auguste Laugel était certes moins brillant, moins capiteux que celui de madame de Bury, mais il eut plus de continuité, plus d’homogénéité aussi. Savant distingué, psychologue social, historien sagace, voyageur, polémiste, poète même, métaphysicien subtil et collaborateur de la Revue des Deux Mondes, du Temps, membre de nombreux Conseils d’Administration, Secrétaire des Commandements du duc d’Aumale qui l’honorait de sa confiance absolue et de son amitié, Auguste Laugel, tout en écrivant sur la France, l’Angleterre, l’Italie, l’Allemagne, des livres qui auraient dû lui ouvrir les portes de l’institut, ne chercha jamais à violenter le succès ; au contraire, il semblait préférer la pénombre. À l’encontre de tant de gens qui tirent plusieurs moutures du même sac, il laissait ses livres parler pour lui, et, même dans le monde, observait une attitude réservée, discrète, écoutant beaucoup, parlant peu, mais ne parlant que pour émettre quelque réflexion valant la peine d’être retenue. J’ai rarement vu quelqu’un ayant à tel point la pudeur de son talent, et par exemple j’ai ignoré pendant trente ans qu’il avait publié de remarquables traités sur l’Optique et les Arts, l’Œil et la Visions, la Voix, l’Oreille et la Musique. Quelqu’un disait du ministre Villèle ! « C’est une grande lumière qui brille à peu de frais. » On pourrait dire de Laugel : « C’est une grande lumière qui éclaire les cénacles et les initiés. » J’imagine qu’il eût été un admirable ambassadeur, et, bar son dévouement plein de tact, il a rendu de précieux services à la cause qu’il aimait. Il avait en 1854, épousé miss Chapmann, nièce de M. Sylvain Van de Weyer, ministre de Belgique à Londres, appartenant à une famille considérable de Boston : de là sans doute l’allure un peu bigarrée du salon Laugel, où, en même temps que l’élite politique et littéraire des États-Unis du Nord, de passage à Paris, affluaient des amis tels que Reeves, Klatzko, la Rive, lord Acton, lord Lytton, la marquise ; de Montagu, M. et madame Mohl, Mrs. Gaskell, lady Elgin, les Quatrefages, X. Doudan, Ampère, Villemain, Louis de Loménie, Souvestre, Geoffroy Saint-Milaire, Tourguénieff, le duc de Broglie, le comte de Mérode, le comte de Ségur, le baron Claude de Barante etc… C’est à ce dernier que Laugel confia son journal inédit depuis 1848, et sa correspondance avec le duc d’Aumale, auquel il écrivait presque tous les jours ; ils sont en bonnes mains, seront publiés en temps et lieu, et contiendront maint dialogue révélateur sur les coulisses politiques de 1871 à 1873. Je laisse à penser quelles conversations on entendait dans ce salon de la rue de la Ville l’Évêque, où de tels étrangers apportaient à de tels français le parfum de leur civilisation, et recevaient en retour l’initiation aux grâces de l’esprit, aux comédies et tragédies intimes de notre vie sociale. C’est là qu’on ciselait les plus fines épigrammes contre le Second Empire, qu’on se consolait des défaites du présent et des échecs… de l’avenir par des railleries élégantes, par ces Lettres de Verax, longtemps attribuées au duc d’Aumale, écrites en réalité par le maître de céans ; là encore qu’on s’intéressait si vivement aux brillantes chroniques d’Arthur de Boissieu, qu’on savourait ses mots sur le règne de Napoléon III : un sphinx qui n’a pas d’énigme, un rêve des Mille et une Nuits réalisé ; celui d’un autre adversaire : le 2 décembre 1851, c’est la bataille de Clichy des insolvables. La Lanterne d’Henri Rochefort, ses plaisanteries un peu vulgaires, ses traits féroces, les ridicules du gouvernement si âprement dénoncés, les trente-huit millions de sujets sans compter les sujets de mécontentement, ne laissaient pas d’alimenter la conversation, fournissant à tant de beaux esprits des corrasions de faire pleuvoir mille flèches acérées sur le chef de l’État et ses collaborateurs. Parmi ces causeurs, le comte Werner de Mérode, avant et après 1870, était un des plus charmants, ayant la grâce avec la finesse souriante, et la simplicité du grand seigneur qui se répand sans se soucier aucunement d’emmagasiner son miel pour conquérir une réputation devant ses contemporains ou devant la postérité. Ses boutades couraient de salon en salon, se colportaient dans la presse, démarquées et souvent attribuées à d’autres ; il n’y prenait pas garde, et continuait de plus belle. À propos d’un ministre qui venait de passer de vie à trépas, il nous dit gaiement : « Son meilleur discours est celui qu’on vient de prononcer sur sa tombe. » Un magistrat fort connu rendait plus de services que de véritables arrêts : « Sa conscience juridique murmure bien un peu, observa M. de Mérode, mais son intérêt personnel crie si fort qu’il n’entend plus le bêtement d’icelle. » Il estimait qu’en politique on se fait une conviction par les coups qu’on donne ou qu’on reçoit, que la charité est le droit des riches ; il reprochait aux gouvernants de se guider d’après cette maxime : je dépense, donc je suis, – et insistait souvent sur cette vérité redoutable. « Paris fait la loi à la province, et l’émeute fait la loi à Paris. » Nul mieux que lui ne m’a offert l’image des grands seigneurs d’autrefois, un Nivernais, un Narbonne, un prince de Ligne. Nous étions un peu compatriotes, il avait un château historique à Maîche dans le Doubs, et il m’invita à faire connaissance avec ses chasses dans les Ardennes belges : d’hésitation en hésitation, d’ajournement en ajournement, des obstacles surgirent, et je ne connus ni Maîche, ni les chasses des Ardennes.
Je fis chez madame Laugel la connaissance des Mohl. Le mari, professeur au Collège de France, membre de l’institut, parfaitement bon, désintéressé, spirituel et aimable ; il a la grâce d’une femme, disait-on. Sa femme, née Clarke, originale, excentrique au premier chef, si gaie qu’elle seule parvenait à dérider Chateaubriand chez madame Récamier. Elle avait cinquante-sept ans quand elle épousa Mohl, lui quarante-sept, et ils cachèrent assez longtemps leur mariage, comme on dissimule une mauvaise action. Contraste piquant : elle portait des toilettes effroyables, et montrait une susceptibilité extrême au sujet de son âge. Le jour de ses épousailles, lorsque le maire lui demanda son âge : « Monsieur, répondit-elle, cela ne vous regarde pas, et si cela vous regardait, je sauterais par la fenêtre plutôt que de vous le dire. » Même à quatre-vingt-treize ans, peu avant sa mort, elle ne pouvait se décider à avouer plus de soixante-huit printemps, et recourait à tous les artifices pour tromper ses amis là-dessus. Quelqu’un lançait-il ? « Il y a de cela cinquante ans. – Oui, précisément, reprenait-elle, je venais d’avoir dix-huit ans. » M. Thiers la rencontre chez un ami, et se plaint de ne l’avoir pas vue depuis quarante ans ; fort ennuyée, elle se penche vers la maîtresse de maison, et sotto voce : « Ce vieux fou a perdu la tête, il ne sait pas ce qu’il dit ; il se trompe de vingt ans. »