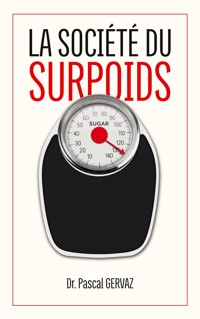
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Französisch
`La Société du Surpoids` explique comment la révolution industrielle a transformé les modes de production, de distribution et de consommation de la nourriture. Le livre décrit l'apparition de maladies métaboliques nouvelles apparues à la fin du XXème siècle. Cet ouvrage dresse un triste constat : partout sur la planète, les êtres humains évoluent au sein d'un environnement alimentaire devenu toxique. Ces lignes serviront d'avertissement : si l'on n'entreprend rien, la génération de nos enfants vivra moins longtemps que celle de nos parents. En cela, le combat contre l'épidémie d'obésité se rapproche de la lutte contre le réchauffement climatique : la modification des comportements individuels constitue une condition préalables, certes nécessaire, mais insuffisante. De la part des autorités, on attend une prise de conscience rapide et des décisions fortes ; c'est à ce prix que les plus fragiles conserveront l'espoir d'échapper aux tentacules des multinationales de la malbouffe. Halte au dérèglement calorique ! Je déclare l'état d'urgence métabolique !
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pour Raphaël et David, les deux hommes de ma vie.
Pour Marlyse et Cristina, les deux femmes de ma vie.
TABLE DES MATIÈRES
PROLOGUE
PREMIÈRE PARTIE
1. GLOBÉSITÉ
2. SUCRE
3. MAÏS
4. BIG FOOD
DEUXIÈME PARTIE
5. NASH
6. TOP CHEF
7. UN IMC À 47
8. GROSSOPHOBIE
9. ELVIS
TROISIÈME PARTIE
10. HARA HACHI BU
11. SAMOA
12. 980 GRAMMES
13. BYPASS
14. OAXACA
15. LOI 2031-866
EPILOGUE
À PROPOS DE L’AUTEUR
« Si j’avais été médecin avec diplôme, j’aurais d’abord fait une bonne monographie de l’obésité ; puis j’aurais établi mon empire dans ce recoin de la science ».
J-A. Brillat-Savarin. Physiologie du goût (1825)
PROLOGUE
Les experts de l’Organisation mondiale de la santé se montrent unanimes, pour une fois : « L’obésité, prédisent-ils, sera le grand fléau du XXIe siècle ». Les chiffres donnent le vertige : la planète compte aujourd’hui deux milliards d’individus en surpoids, dont 700 millions d’obèses, soit trois fois plus qu’en 1980. Plus d’un million de citoyens européens décèdent chaque année d’une maladie qui n’épargne plus personne, pas même les plus jeunes ; les pédiatres sonnent l’alarme au nom des 340 millions d’enfants et d’adolescents atteints de surcharge pondérale.
Pourtant, le constat interroge : l’embonpoint est une affection dont on connaît la cause. Progressant à visage découvert, l’ennemi apparaît quotidiennement dans nos assiettes. Pour grossir, il suffit de consommer plus de calories qu’on en dépense : un simple déséquilibre énergétique, en somme, qu’on pourrait corriger. On explique aux patients qu’il est, sinon facile, du moins possible de maigrir : « Mangez moins ! Bougez plus ! Un peu de volonté, nom d’un chien ! »
Les scientifiques se veulent rassurants : « On peut guérir de l’adiposité, affirment-ils. Ou tout au moins s’en prévenir ». À ce jour, cependant, personne n’a réussi à endiguer l’épidémie. Bien que non transmissible, la maladie se propage à la manière d’une vilaine dysenterie. Faut-il dès lors considérer l’obésité comme un phénomène inéluctable ? Sommes-nous condamnés à engraisser ?
Les dirigeants de l’OMS sont d’autant plus préoccupés que la lutte semble inégale ; face aux géants de l’industrie agroalimentaire, le destin des plus fragiles d’entre nous paraît joué d’avance. Les victimes ne peuvent miser sur le soutien de la société : l’affection excite peu les convoitises, hormis celles d’innombrables Diafoirus dissimulant leur ignorance sous d’obscurs amphigouris. En obtenant le label « Problème de Santé publique », l’obésité s’est transformée en bonne affaire : elle excite la gourmandise de thérapeutes surtout soucieux d’approvisionner leurs comptes en banque. Le surpoids est devenu un eldorado ; il peut rapporter gros.
*****
Après avoir essayé tous les régimes, on a rejoint le Groupe de Réflexion sur l’Adiposité qui propose à ses clients une approche psychosensorielle. On s’entretient avec Cindy, diététicienne comportementaliste : « Ma spécialité, avoue-t-elle d’emblée, c’est la restriction cognitive ». Prometteuse selon ses promoteurs, la méthode s’inspire des Alcooliques anonymes. On est accueilli au sein d’une équipe dynamique et bienveillante qui, chaque jeudi soir, réunit une douzaine d’individus. On ne rencontre pourtant aucun ancien obèse dans cette loge où, à l’exception de Cindy, tout le monde est trop gros. Qu’importe : ce cadre fraternel offre la possibilité d’exprimer son mal-être tout en nouant des relations. Pourtant, après deux ans de confidences, on doit bien admettre que la thérapie n’a pas entraîné de modification morphologique notable : seul notre portefeuille s’est allégé.
Sur le conseil d’une collègue, on prend place dans un vol low cost à destination du Maghreb. Une agence de voyages spécialisée a tout organisé : le transport, l’intervention et l’hébergement. À l’aéroport de Tunis, notre chauffeur porte un short aux couleurs du Real Madrid ainsi qu’une petite pancarte sur laquelle on lit :
MEDÉVASION ! POUR UN NOUVEAU DÉPART !
Trois heures plus tard, on touche au but : le véhicule fait halte dans les quartiers nord de Sfax, à proximité du marché aux poissons. À la Clinique Renaissance Esthétique, 42, allée des Martyrs, on fait la connaissance du chirurgien. Formé au CHU de Poitiers, ce dernier excelle dans la réalisation du bypass gastrique : c’est du moins ce que revendique sa page Instagram. Quoique simples sur le plan médical, les suites opératoires sont pénibles en raison de la chaleur. On déplore une panne d’électricité dans le bâtiment : par chance, le forfait all inclusive à 4 200 euros comprend une convalescence de trois jours et deux nuits à l’hôtel Royal Carthage, où l’on profite d’une atmosphère parfaitement climatisée avant d’embarquer dans l’avion du retour.
Rendu sur le sol français, on pense avoir réalisé le plus dur. Alors qu’en vérité, les soucis ne font que commencer ; sur le tarmac de l’aéroport de Beauvais, le comité d’accueil a mauvaise mine. La douleur, puis la nausée gâchent la fête ; ces invitées de dernière minute exigent qu’on admette sa défaite : qu’on rende les armes ; qu’on s’abandonne aux hoquets du désespoir ; qu’on cède aux larmes. Bref, qu’on ravale sa fierté : et sans attendre, car le besoin se fait impérieux. La pituite qui clapote au fond de nos entrailles déclenche un spasme atroce : une marée montante de mauvaise bile met un terme au supplice. Mincir, la belle affaire : mais vomir… vomir…
*****
Paresseux et gourmands ; ces pécheurs-là n’ont aucune excuse. Les obèses doivent assumer seuls les conséquences de leurs vices. « Ces goinfres n’ont que ce qu’ils méritent », affirmaient les thérapeutes du siècle passé. Les anesthésistes souhaitaient proscrire la chirurgie bariatrique, cette modalité à la fois inédite et source de redoutables complications. Ils rechignaient à endormir les malades : « La surcharge pondérale ne s’opère pas, disaient-ils ; elle se soigne avec le régime et l’activité physique ». Grossophobes ? Nous l’étions sans doute, même si le terme n’existait pas à l’époque. Jugé discriminatoire depuis 2001, ce type de comportement est passible d’une peine de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende. La stigmatisation du surpoids constitue désormais un délit : faut-il pour autant s’en réjouir ? S’agit-il vraiment d’un progrès ? Et cette loi sera-t-elle suffisante pour battre en brèche les stéréotypes et les idées reçues ?
D’autres voix se font entendre, porteuses d’un message opposé : « Les obèses sont victimes d’un environnement nutritionnel malsain », affirment certains. Dès lors, le débat franchit les parois de l’abdomen pour s’épanouir dans un cadre philosophique. Faut-il penser, à la manière de Voltaire, que l’homme civilisé est celui qui se retient de trop manger ? Ou doit-on plutôt privilégier la version de Rousseau : les êtres naissent naturellement minces, c’est la société qui corrompt leur pharynx ?
Tout bien considéré, l’obésité apparaît comme la conséquence logique d’un déséquilibre entre deux systèmes. D’un côté, l’appareil digestif des individus dont le fonctionnement n’a pas changé depuis des millénaires : face à lui, l’industrie agro-alimentaire qui, grâce aux technologies modernes, produit de plus en plus de calories à un coût toujours plus bas. Les deux systèmes produisent de l’énergie, mais leur relation repose sur un paradoxe : pour que l’un fasse des bénéfices, il faut que l’autre engraisse. La bonne santé économique de l’une s’accompagne forcément de la décrépitude métabolique de l’autre. Sur une longue période, il est impossible que les deux parties fassent bon ménage : ce livre raconte une histoire d’amour qui finit mal.
Les êtres humains ont toujours entretenu une passion pour la nourriture : hélas, au XIXe siècle, l’irruption du sucre a intoxiqué les rapports du couple. L’avènement de la malbouffe industrielle a envenimé encore les désaccords, avant que le divorce ne soit prononcé au début des années 1980 avec la mise sur le marché des édulcorants de synthèse enrichis en fructose. Les choses auraient pu en rester là. Or, la séparation n’a rien arrangé, bien au contraire : les anciens amants s’affrontent en un combat violent. Désormais ennemis, les ex-époux se rendent coup pour coup. La partie lésée porte plainte pour tentative d’empoisonnement ; le rêve s’est transformé en cauchemar.
Un cauchemar qui nous transporte dans les plaines du Midwest des États-Unis. Sur ce territoire grand comme l’Angleterre, on ne cultive plus qu’un seul végétal : du maïs transgénique de la marque Pioneer 34H31 (H signifiant « hybride »). Au milieu de ce décor monotone, un essaim de moissonneuses-batteuses géantes apparaît à l’horizon. Vu la taille des engins, il doit s’agir du dernier modèle X9 de John Deere, capable de récolter 100 tonnes de grains à l’heure. À travers le vent et la poussière, on distingue mal le visage des conducteurs, ces agriculteurs d’un genre nouveau qui ne quittent jamais le cockpit de leurs tracteurs ; arrosés tous les trois mois d’engrais azotés à base de nitrate d’ammonium (NH4NO3), les champs sont devenus toxiques pour la peau, les yeux et les poumons.
Cette année, la moisson a permis de récolter trois cents millions de tonnes de grains qu’on a transformés en un torrent de bouillie jaunâtre qui s’écoule vers le nord, à rebours des flots marrons du Mississippi. Puis, la rivière d’amidon rejoint son estuaire : un no man’s land où, dans une lumière crépusculaire, on hume plus qu’on ne voit de grandes bicoques sombres et odorantes à la façon des camps de concentration.
L’aube venue, on distingue les contours d’une ferme industrielle abritant un million de dindes exclusivement nourries de cette fécule synthétique à des doses et intervalles calculés par ordinateur afin que chaque bête pèse 12 kilogrammes au début de l’automne. L’impératif est d’ordre socioculturel : le quatrième jeudi de novembre, 300 millions d’Américains se réuniront dans leurs foyers pour déguster 45 millions de gallinacés charnus et rôtis à point. Thanksgiving ! Jour béni où la Nation repue remercie dame Nature de sa générosité !
À la fin de ce mauvais rêve, les volailles prennent une forme humaine ; ce ne sont plus des animaux qu’on gave ainsi, mais des enfants retenus prisonniers d’enclos high-tech couverts d’écrans tactiles sur lesquels clignotent des publicités pour des boissons gazeuses. Une génération de gamins ventripotents et joufflus qui ne surferont que sur Internet : des centaines de millions d’adolescents en surpoids, dont l’avenir se profile sous des contours bien sombres. Les plus malchanceux rejoindront la cohorte des adultes obèses à 30 ans, diabétiques à 40 et cirrhotiques à 50 : avec au bout du tunnel, comme seule lueur d’espoir, une double transplantation foie-rein. Dans l’attente d’un organe, les malheureux se demandent : « Comment avons-nous pu en arriver là » ? Question cruciale, à laquelle ce livre tente d’apporter une réponse.
*****
Sublime incarnation de la femme puissante, la chanteuse de rap Lizzo figure en couverture du magazine Vogue d’octobre 2020. À demi entrouverte, la robe Valentino de satin rouge sang laisse deviner le galbe des cuisses, tandis que les mules à talons Manolo Blahnik révèlent la grâce de pieds étonnamment petits, si l’on considère le gabarit de l’artiste : Lizzo pèse en effet 139 kilos. On ne lui a pas demandé de maigrir pour la photo : la rappeuse afro-américaine n’éprouve aucune honte vis-à-vis de son apparence, au contraire. Le regard, le port de tête, la position des bras ; tout indique que la chanteuse est fière de son corps. Nous sommes en présence d’une séductrice, une femme de 32 ans qui compte profiter au maximum de son physique. Bien sûr, il y aura toujours des esprits chagrins pour expliquer comment un logiciel a gommé le triple menton, affiné la taille et supprimé les bourrelets au niveau des aisselles. Mais l’histoire retiendra que Melissa Viviane Jefferson, née le 27 avril 1988 à Detroit, fut la première obèse morbide à occuper une place traditionnellement dévolue au culte de la minceur féminine.
Lizzo ne se contente pas d’être belle : elle s’exprime avec talent sur les principaux sujets de société. Ainsi, la rappeuse a-t-elle pu constater la disparition des filles sveltes parmi son public : « Mes chansons s’adressent à vous, mes sœurs, avec vos plis de graisse dans le dos, vos gros bides, vos gros culs et vos grosses cuisses. Je vous en supplie : soyez fières de votre corps ! N’ayez pas honte de vos vergetures, de la cellulite et des mycoses : moi aussi, j’en ai ! Tout le monde en a, même Rihanna ! » s’exclame-t-elle, avant de conclure sur un mode plus sérieux :
– Être gros de nos jours, vous savez, c’est normal.
Les chiffres donnent raison à Lizzo : un quart seulement de la population des États-Unis échappe aujourd’hui au surpoids. Les citoyens américains ont engraissé à l’insu de leur plein gré. Certains, à l’instar des coureurs cyclistes convaincus de dopage, tentent de se justifier en affirmant : « On a fait comme les autres ».
Ce livre révèle comment la société industrielle a transformé les méthodes de production, de distribution et de consommation de la nourriture. Il explique pourquoi des maladies métaboliques nouvelles sont apparues à la fin du XXe siècle. Il dresse un triste constat : nous évoluons désormais au sein d’un environnement alimentaire toxique. Ces lignes serviront d’avertissement : si l’on n’entreprend rien, la génération de nos enfants vivra moins longtemps que celle de nos parents. En cela, le combat contre l’obésité se rapproche de la lutte contre le réchauffement climatique : la modification des comportements individuels constitue une condition préalable, nécessaire mais insuffisante.
De la part des autorités, on attend une prise de conscience rapide et des décisions fortes : c’est à ce prix que les plus fragiles conserveront une chance d’échapper aux tentacules des multinationales de la malbouffe. Les dirigeants de l’OMS le savent bien, eux qui, dès 2013, lançaient cet avertissement : « La bataille contre le surpoids exigera du courage et de la volonté politique. En effet, les gouvernements seront forcés d’imposer des mesures contraires aux intérêts de puissants acteurs économiques ».
Réagissons afin qu’à l’avenir personne ne puisse prétendre qu’« être gros, c’est normal », sans risquer d’être contredit.
Halte au dérèglement calorique !
Je déclare l’état d’urgence métabolique.
PREMIÈRE PARTIE
LA SAGA DU SUCRE
La monoculture du goût exige l’uniforme et le contrôle.Michael Pollan, Botany of Desire
1. GLOBÉSITÉ
L’obésité s’exporte ; la maladie se transmet par le négoce. On peut dresser des comparaisons entre nations, établir une hiérarchie : ça n’est pas compliqué, à condition de connaître le poids et la taille des citoyens. Dans cette discipline, la France occupe un rang en milieu de tableau, au sein de ce que les commentateurs sportifs nomment « le ventre mou du classement ». Notre pays compte aujourd’hui, selon l’Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE), huit millions et demi d’obèses, soit 17% de la population. Ce qui nous situe à équidistance du meilleur élève de la classe, le Japon, et des cancres habituels que sont les États-Unis et le Mexique, solidement accrochés à la dernière place avec 50% d’obèses. Globalement, la palme dans le domaine revient aux petites nations du pacifique sud : Palau, Nauru, Samoa et Tonga. Dans ces îles aux noms évocateurs, 90% des adultes sont trop gros. Ravagés par le diabète et les maladies cardio-vasculaires, leurs habitants ne font pas de vieux os : la Polynésie est le paradis des pharmacies.
L’épidémie de surpoids dans ces atolls constitue un phénomène inédit : apparu dans les années 1970, il retient désormais l’attention des scientifiques. En 2019, une équipe de médecins néo-zélandais entreprit de réaliser une étude à la fois simple et originale. Pour connaître les habitudes alimentaires des enfants polynésiens, ils décidèrent d’espionner 35 écoliers en les équipant d’une caméra portable habillée d’un objectif grand-angle de 136 degrés. Filles et garçons devaient conserver les appareils autour du cou durant toute la journée, mais impérativement les enlever lors de leurs visites au petit coin. L’expérience se déroula dans le cadre enchanteur de Ha’apai ; un îlot de l’archipel des Tonga peuplé de 6125 habitants et relié à la capitale Nuku’Alofa par un ferry quotidien. Le bout du monde, en somme.
Les investigateurs, avec à leur tête le docteur Loma Veatupu, souhaitaient étudier le comportement des enfants vis-à-vis de la nourriture ; non seulement savoir ce qu’ils mangeaient, mais où, quand et comment. Les 35 volontaires respectèrent à la lettre les instructions en arborant fièrement leurs caméras sur la poitrine 12 heures par jour pendant une semaine. Les scientifiques purent ainsi collecter 300 000 images qu’ils analysèrent durant huit mois avant d’aboutir à une conclusion stupéfiante : la géographie et les traditions culturelles influencent de moins en moins la conduite alimentaire des individus. Le lieu de résidence n’a plus d’importance : Tongatapu copie Pontault-Combault. Telle une gigantesque épicerie, la planète débite partout les mêmes confiseries.
Les écoliers tongiens privilégient le grignotage et s’accordent trois ou quatre collations quotidiennes. Des bonbons, des biscuits, des gâteaux et des glaces qu’ils consomment le plus souvent à l’extérieur. Les repas pris au domicile familial se composent à parts égales de nourriture traditionnelle (poissons, fruits frais et légumes) et de denrées industrielles (chips, pizzas, nuggets de poulet). Hors de chez eux, les enfants mangent exclusivement des produits importés des États-Unis ou d’Australie. Pour les responsables de l’étude, le constat ne fait aucun doute : même dans les régions les plus reculées, les gamins sont exposés à un environnement qui prédispose au surpoids. Ce dernier constitue une forme d’adaptation à un milieu corrompu par un excès de calories.
Ce contexte obésogène est omniprésent : personne sur cette planète ne saurait échapper à l’emprise tentaculaire de l’industrie agro-alimentaire. Bienvenue donc dans le monde global de l’obésité. Un monde né à l’aube du vingtième siècle dans un laboratoire de Karlsruhe, alors qu’il aurait dû voir le jour à Paris : mais pour cela, il eût fallu que Rüfenacht fasse gaffe.
*****
William Crookes, le président de la British Association for the Advancement of Science, ne cache pas son inquiétude ; l’avenir de l’humanité paraît compromis. Il n’y a pourtant rien de nouveau dans ce triste constat : en 1803 déjà, le révérend Thomas Malthus prédisait la catastrophe. Sa théorie, selon laquelle les populations croissent de façon exponentielle (1, 2, 4, 8, 16, 32) alors que les ressources alimentaires n’augmentent que de manière arithmétique (1, 2, 3, 4, 5, 6), semblait en passe de se réaliser. Une vieille préoccupation, quasi ontologique ; depuis la nuit des temps, l’être humain vivait dans la peur. Peur du froid, peur de la maladie, peur de la guerre, mais surtout peur d’avoir faim. Sir William souhaite aborder dans son discours inaugural le thème du pain, ou plutôt du manque de pain. Très digne avec son col cassé, sa barbichette et ses moustaches à l’anglaise, l’orateur a pris place sur le podium et considère gravement l’audience constituée d’un aréopage des plus éminents savants européens. Ces derniers ont conscience de la solennité du moment : dans le City Hall de Bristol, le silence règne, en ce mercredi 7 septembre 1898.
Le président commence son allocution en remarquant que les données démographiques, hélas, vont toutes dans le même sens et que la communauté scientifique se doit d’examiner la réalité des faits. Si les choses continuent à ce rythme, les habitants du continent européen n’auront bientôt plus assez à manger ; les bouches à nourrir se multiplient, alors que la production de céréales stagne. Les sols s’avèrent peu fertiles ; quant au climat, il n’aide pas. William Crookes a refait plusieurs fois ses calculs, avant d’arrêter une date :
– Dans 30 ans, affirme-t-il, les ressources de la planète seront insuffisantes pour nourrir l’humanité. Mes chers collègues, la famine s’annonce inéluctable.
Les termes de l’équation étaient limpides : peuplé à l’époque de 500 millions d’individus, l’Occident dépendait pour sa survie de la culture du blé. Les gens ne mangeaient pour ainsi dire que du pain : 400 grammes par jour, soit une consommation annuelle de 130 kilos de céréales par habitant. La production mondiale s’élevait à 70 millions de tonnes, ce qui permettait tout juste de couvrir les besoins, mais ne suffirait bientôt plus si la population continuait à croître. La pénurie trouvait son origine dans les faibles rendements des sols qui rapportaient à peine plus d’une tonne par hectare. Pourtant, le président Crookes retrouve son optimisme légendaire au moment d’aborder ses thèmes favoris : la Science et les forces de l’esprit.
– Un grand défi nous attend : inventer, au cours des vingt prochaines années, un engrais capable de doubler, voire de tripler la productivité des sols. Le salut viendra des laboratoires ; les chimistes sauveront l’humanité de ce terrible péril. Car, pour croître et prospérer, les végétaux ont besoin d’azote. Or, les réserves d’azote dans l’univers sont infinies : l’air que nous respirons n’est-il pas constitué à 78% de ce gaz ?
Dans le public, la consternation règne. En outre, l’heure du déjeuner approche et des considérations pratiques commencent à se faire sentir ; ces grands savants sont aussi de vieux messieurs qui tolèrent mal la double contrainte d’une vessie pleine et d’un estomac vide. Quant à Sir William, conscient que ses propos ont fait mouche, il jubile, d’autant plus qu’il a gardé le meilleur pour la fin. L’orateur tient à respecter la règle d’or dans ce genre d’adresse : toujours conclure sur une note optimiste.
– Et donc mes chers collègues, je vous pose la question : ne pourrait-on pas utiliser tout cet azote atmosphérique et le combiner avec de l’hydrogène pour fabriquer des engrais ? L’ammoniac, mes amis ! Je vous le dis : sur cette molécule repose le destin de l’humanité ! Le vingtième siècle sera azoté ou ne sera pas !
À cette époque, deux scientifiques tenaient la corde dans la course à la synthèse de l’ammoniac : Fritz Haber et Henri Le Châtelier. Ce dernier s’était passionné très tôt pour la chimie industrielle : « Mon plaisir, écrivait-il, consiste à étudier les lois de l’Univers, à en étendre les applications et à en découvrir de nouvelles conséquences ». Henri semblait proche de réaliser l’exploit, avant qu’une grossière erreur de manipulation ne cause une formidable explosion qui détruisit l’aile sud de la Sorbonne. L’incident fut fatal au commis maladroit, un certain Gilbert Rüfenacht qui devint ainsi le premier martyr de l’ammoniac ; personne, à vrai dire, ne regretta la victime, un grand garçon au regard fuyant dont les manières brusques trahissaient des origines suisses allemandes. Quant à Le Châtelier, vingt ans plus tard, il n’avait toujours pas digéré son échec :
– Si cet imbécile de Rüfenacht n’avait pas tout fichu en l’air, c’était dans la poche… J’aurais réussi la synthèse de l’ammoniac bien avant le Boche ! Quand j’y pense… Le prix Nobel me tendait les bras !
En effet, pendant ce temps, l’état-major allemand ne cachait pas son intérêt pour les propriétés explosives de la substance. Le gouvernement du Reich concentrait son attention sur les recherches conduites dans ce domaine par Fritz Haber, chef du département de chimie de la Technische Hochschule de Karlsruhe. Parmi la foule des visiteurs qui se pressait pour rencontrer le professeur Haber, on remarquait la présence de généraux en uniforme gris et casque à pointe, ce qui flattait Fritz. Car Haber chérissait la Science autant que l’Allemagne : il avait d’ailleurs renié son judaïsme pour mieux épouser les idéaux de cette dernière. Mise au point en 1910, l’invention allait révolutionner la production agricole, et par conséquent l’alimentation :
La découverte de la synthèse de l’ammoniac (NH3) à partir de ses éléments, l’azote (N) et l’hydrogène (H) valut à son inventeur le prix Nobel de Chimie en 1918. Haber avait trouvé le moyen de produire industriellement des engrais ; l’usage de ces derniers permettait de multiplier par dix le rendement des sols. Sans ammoniaque (NH4OH - la forme liquide) ni ammoniac (NH3 - la forme gazeuse), les ressources actuelles de l’agriculture suffiraient tout juste à nourrir quatre milliards d’individus. Fritz mérite donc le titre posthume de meilleur cuisinier de tous les temps ; sans lui, aujourd’hui, la moitié de l’humanité crèverait de faim.
Fritz Haber aurait dû, dans la grande Histoire des Sciences, occuper un rang prestigieux aux côtés d’Albert Einstein, prix Nobel de Physique en 1921. Issus du même milieu social, les deux hommes entretenaient une amitié et une admiration réciproques : pourtant, leurs opinions politiques divergeaient. Emporté par ses sentiments patriotiques, Fritz mit dès 1914 son génie au service de la guerre chimique ; il inventa le gaz moutarde, ce poison neurotoxique qui causa la perte d’un million de soldats durant le premier conflit mondial. Certains l’accusent d’avoir contribué à la mise au point du Zyklon B, le pesticide utilisé deux décennies plus tard dans les camps d’extermination.
En dépit de tous ses efforts et de la petite moustache hitlérienne qu’il arbora fièrement dès 1933, le professeur Haber ne fut jamais considéré comme un « bon Allemand » par les nazis. Ses collègues eurent beau plaider sa cause auprès du Führer, ce dernier refusa toujours de déroger à la règle : « Si la science ne peut se passer des juifs, affirmait-il, alors l’Allemagne se passera de la science ». Fritz Haber dut s’avouer vaincu : malgré son génie, malgré sa moustache, malgré sa nouvelle religion, un apostat tel que lui ne trouverait jamais sa place parmi les élites du Troisième Reich. Il ne lui restait qu’une possibilité : quitter Karlsruhe et rejoindre la diaspora des scientifiques allemands en exil.
Le 28 janvier 1934, Fritz boucla ses valises et prit le train du matin à destination de Bâle. Le séjour de l’inventeur de l’ammoniac dans la cité rhénane fut de courte durée ; victime d’une crise cardiaque, Haber mourut le lendemain de son arrivée à l’Hôtel des Trois Rois. Dans ses effets personnels, les policiers découvrirent une traduction en allemand du Talmud ; une brochure intitulée « A Tourist’s Handbook for Palestine and Syria » ; une lettre en hébreu portant la signature de Chaïm Weizmann, recteur de l’Université de Rehovot ; et une réservation pour une cabine de première classe sur le vapeur SS La Providence qui devait appareiller de Marseille le 15 juin à destination de Jaffa, via Naples et Alexandrie. Fritz Haber n’était pas pressé : dans son agenda, cette année-là, il n’avait coché qu’une seule date, le 18 septembre, jour de Yom Kippour qu’il espérait célébrer à Jérusalem. Mais l’inventeur de l’ammoniac et du gaz moutarde aurait-il obtenu, de son Dieu originel, le Grand Pardon ?
*****
La fabrication d’engrais s’accéléra au cours des années 1950. Le monde entier avait besoin de la molécule miracle, en particulier les agriculteurs soucieux de rejoindre le train de « la révolution verte » ; terme mal choisi, puisque la révolution en question reposait principalement sur la chimie. Aujourd’hui, 467 usines (dont 394 en Chine) produisent chaque année 200 millions de tonnes d’ammoniac, dont les trois-quarts sont réservés à la synthèse de fertilisants azotés, le reste servant à confectionner des explosifs. La France compte trois ou quatre unités de production, mais les autorités communiquent peu à ce sujet : le stockage de cette substance comporte des risques équivalents à ceux d’une centrale nucléaire. L’ammoniac est d’ailleurs la cause de trois des pires catastrophes industrielles du XXIe siècle : la destruction d’AZF à Toulouse en 2001, de West Fertilizer au Texas en 2013 et du port de Beyrouth en 2020.
L’agriculture compte de plus en plus sur l’apport des engrais azotés. Grâce à eux, le rendement des terres n’a jamais été aussi élevé ; les résultats varient en fonction du type de végétal et du climat, mais on estime que l’ammoniac a permis de multiplier par dix la production de céréales. D’un hectare, on tirait en 1945 à peine une tonne de blé ; aujourd’hui, les exploitants sont déçus lorsque la même surface en rapporte moins de huit. Afin d’augmenter encore les profits, on planifie des doubles voire des triples récoltes de riz en Chine et en Inde. La terre pourtant se fatigue et flirte parfois avec le burn-out tant les exigences sont grandes. Les sols sont devenus des esclaves auxquels on impose toujours plus d’efforts. La nature, telle une athlète dopée aux anabolisants, observe, effarée, l’effet de l’ammoniac sur sa morphologie.
Les prévisions du Révérend Malthus se sont révélées fausses : grâce à l’ammoniac, l’humanité mangerait toujours à sa faim. C’est même l’inverse qui s’est produit ; on manque d’estomacs pour consommer toute la nourriture fabriquée sur la planète. Les engrais, les pesticides, les méthodes modernes d’irrigation, l’utilisation de semences génétiquement modifiées : tous ces facteurs ont contribué à ce que l’industrie agro-alimentaire puisse désormais fournir 3 700 calories par jour à chaque habitant de la planète. Or, on n’en demande pas tant : 2 200 calories suffiraient à couvrir les besoins quotidiens d’un individu de 70 kilos. À l’origine de la surconsommation de nourriture, on trouve donc un phénomène agricole : la surproduction de blé, de maïs et de soja. L’ammoniac est donc responsable de deux explosions qui survinrent simultanément au début des années 1980 : celle du surpoids et celle du surplus. La molécule inventée par Fritz Haber allait agir à la façon d’une bombe à retardement.
À cette époque, les fonctionnaires du Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) furent confrontés à un problème nouveau : comment écouler les excédents de céréales résultant de l’exploitation intensive des sols dans le Midwest ? La solution apparaissait pourtant simple : exporter. Mais comment s’y prendre, avec toutes ces frontières et ces taxes barrant l’accès aux marchés étrangers ? Comment se débarrasser de toute cette fécule ? Jusqu’au jour où les experts de l’USDA firent une découverte. Au sud du Rio Grande se trouvait un pays peuplé de 100 millions d’individus, dont la survie dépendait d’un végétal millénaire que les Aztèques vénéraient à la façon d’une idole : Zea mays.
Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estadios Unidos : « Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis », proclamait Porfirio Diaz au terme de ses 35 années de règne. En 1994, le gouvernement mexicain choisit d’ignorer la prophétie du dictateur : funeste erreur ! L’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange nord-américain (ALENA, NAFTA en anglais) fut une catastrophe diététique pour le pays. Les fermiers du Midwest, eux, se frottaient les mains ; leurs surplus avaient enfin trouvé preneurs. La levée des taxes de douane permit de multiplier par quatre les exportations de maïs. Des millions de tonnes de céréales produites aux USA inondèrent le marché mexicain et firent chuter les prix de cette denrée de base, entraînant la faillite d’une multitude de petits paysans. Ces derniers n’eurent pas d’autre choix que d’émigrer vers le nord pour embrasser la carrière de jardinier : la culture du maïs ne rapportant plus rien, autant aller tailler des thuyas à Tampa.
En parallèle, l’industrie du fast-food décida de cibler ce nouveau marché de 100 millions d’estomacs réticents au premier abord, mais qu’un marketing efficace saurait convaincre d’adopter les coutumes alimentaires en vigueur aux USA. McDonald’s inaugura son premier restaurant à Mexico City en 1985 ; aujourd’hui, la firme compte plus de 500 enseignes implantées dans 57 localités. Les Américains eux-mêmes n’en revenaient pas : leurs profits surpassaient les prévisions les plus optimistes. Le peuple mexicain raffolait de tout ce qui provenait du nord : de la nourriture, bien sûr, mais aussi des boissons. Avec 225 litres par an et par habitant, cette nation détient toujours la palme du premier consommateur mondial de Coca-Cola. Les gens étaient pris d’une passion dévorante pour ces calories importées à bon marché : ils en payent aujourd’hui le prix.
Selon une enquête conduite en 2016, 76% des Mexicains sont trop gros : 39% sont en surpoids et 37% sont obèses. Le pays compte 16% de diabétiques. Le gouvernement s’inquiète à juste titre : trois citoyens sur quatre souffrent d’une ou de plusieurs maladies chroniques en relation avec l’alimentation. Les modifications de l ’environnement et du mode de vie sont survenues si rapidement que leur impact sur la santé des habitants ne s’est pas fait attendre. La transformation morphologique de la population frappe les touristes : contrairement au diabète, sournois par nature, le surpoids s’observe à l’œil nu. Suite à l’adoption des accords de libre-échange, il a suffi d’une génération pour que les citoyens mexicains développent les mêmes maladies que leurs voisins du nord. L’ALENA avait pour objectif de faciliter les transactions entre ses pays membres, ce qui fut réalisé : avec en parallèle, la propagation du surpoids.





























