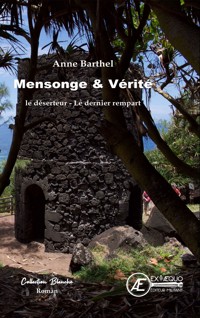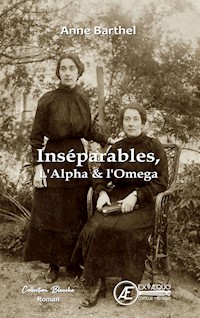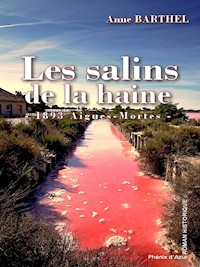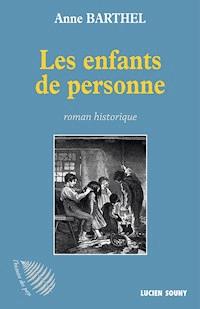Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ex Aequo
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La fin du moyen âge est proche. Des migrants de la province d’Imperia, l’actuelle Italie, viennent repeupler Banulhs, aujourd’hui, Bagnols en forêt. Là-haut sur la montagne, retranchée dans sa grotte, se cache depuis de longues années une vieille femme, survivante du massacre commis par la horde barbare de Raymond de Turenne, il y a quatre-vingts ans. Comment, celle qui n’était alors qu’une petite fille a-t-elle survécu seule à cette tragédie, et quels sont les liens qu’elle va nouer avec Caterina, frêle fillette émigrée, ne parlant pas sa langue, elle, la vieille Strega ? Histoire de transmission du savoir, à l’heure où, seuls, quelques hommes, moines ou médecins, sont censés détenir le savoir en particulier celui des plantes. Que vont devenir Margot la Strega et La petite Caterina à qui elle enseigne ce savoir interdit ?
Un roman historique envoûtant sur fond de passation des savoirs à une époque où les femmes doivent rester dans l’ignorance.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Anne Barthel, vit dans le Var abandonnant ses histoires Cévenoles, mais toujours attirée par des faits historiques ou des personnages de la grande Histoire. La Strega est son onzième roman publié, inspiré par le vieux village de Bagnols en forêt, son passé chargé d’histoire, et ses habitants accueillants.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anne BARTHEL
La Strega
Roman
ISBN : 979-10-388-0292-6
Collection : Blanche
ISSN : 2416-4259
Dépôt légal : février 2022
© couverture Ex Æquo
©2022 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays. Toute modification interdite.
Éditions Ex Æquo
L’automne s’installait. La plaine jaunie par la canicule tremblait à l’horizon. Monseigneur, confortablement installé sur la litière, essuyait son front où perlait la sueur avec un mouchoir de soie brodé à son chiffre. Mandaté par le pape et enfin autorisé à exercer sa mission par le roi de France, il avait quitté Rome et venait à contrecœur juger de la qualité de la terre qui s’étalait devant lui au pied du rocher rouge sombre menaçant qui dominait ce coin de campagne. Reçu avec tous les honneurs dus à sa charge au pied de l’évêché et de l’église de Fréjus, le menu peuple prosterné l’avait ovationné pour l’honneur qu’il leur faisait par sa simple présence. Arrivé épuisé depuis cinq jours par trois semaines de déambulation sur des chemins inconfortables, brinqueballé de droite et de gauche par des porteurs pourtant précautionneux — ce n’était pas n’importe qui — à l’abri de la chaleur et des intempéries, dans sa cage noire et dorée, aujourd’hui il allait enfin réaliser la mission pour laquelle le pape, Sixte IV l’avait mandaté, bien qu’il n’ait que très peu de connaissances concernant les terres agricoles. De lui, dépendrait l’avenir d’une trentaine de familles de migrants de la province d’Imperia bientôt rattachée à l’Italie et chargée de repeupler la vallée dévastée voilà plus de quatre-vingts ans par Raymond de Turenne et sa horde de barbares. Depuis lors, nul ne s’était aventuré à réinvestir les terres laissées en jachère depuis ce sinistre épisode.
Les cris du massacre résonnaient encore les nuits sans lune sur la plaine, et, à Fréjus, il se disait même que dans les ruines calcinées des fermes incendiées de Banuhls, un fantôme, celui d’une femme, errait parmi le chaos. Certains chasseurs s’y étaient aventurés, et juraient qu’ils l’avaient vu et bien vu, aller et venir parmi les éboulis et avaient même entendu un chant monotone planer au-dessus de l’ancien village. Depuis lors, seuls les renards, les lapins de garenne et les chouettes hantaient les lieux où aucun humain ne s’aventurait plus.
L’église avait besoin d’argent et il était peut-être temps après quelques processions et désenvoûtements spectaculaires de réhabiliter la vallée formée par le fleuve Argens, le Blavet, et les cours d’eau qui serpentaient, sauvages, dans la plaine. Enfin, Louis XI, le roi de France, nommé comte de Provence, venait d’autoriser l’évêque Urbano di Fieschi, à récupérer sa charge au sein de l’évêché de Fréjus, droit que lui avait contesté jusqu’à sa mort celui que l’on nommait Le bon roi René.
Peu d’habitants pouvaient se vanter de se souvenir des terribles massacres perpétrés par les troupes cruelles de Raymond de Turenne, et les rares survivants, alors enfants, ceux qui avaient pu s’enfuir et se réfugier à Fréjus, n’avaient en mémoire que les cris de terreur et une odeur tenace de chair grillée. Les casques en métal brillant, les côtes de maille et les éperons d’argent des montures des pillards hantaient les cauchemars des vieillards qu’ils étaient devenus par la grâce du Saint-Esprit. Aussi, lorsque l’éventualité d’un repeuplement de la région fut évoquée, aucun volontaire ne se présenta malgré l’assurance du clergé, de bénir, d’exorciser et d’encenser les lieux maudits.
Sous un doux soleil automnal Urbano di Fieschi suivi de Luigi son serviteur, découvrait avec ennui la campagne française. Qu’elle était loin sa Province et les somptueux jardins de Toscane ! Tout était à faire dans ce fouillis inextricable d’où émergeaient quelques ruines noircies. Il peinait à imaginer que cette terre ait pu être habitée et fertile un jour.
Monseigneur Urbano di Fieschi, un être grand et sec, brun de peau et de poil, vêtu de la robe rouge et de la toge de la même couleur incarnat liées à sa charge, parlait un français parfait inspiré du latin qu’il pratiquait couramment sans difficulté apparente, même lorsqu’il s’adressait à Luigi, négligeant de regarder le jeune abbé qui avait l’insigne honneur de l’accompagner dans sa mission de reconnaissance. L’argent manquait à Rome et Sa Sainteté Sixte IV peinait à réunir les sommes nécessaires au bon fonctionnement de la cour, à la construction de nouvelles églises somptueuses, et aux besoins exorbitants des cardinaux, des évêques et de la valetaille qui les entourait. On lui avait dit grand bien de l’arrière-pays de Fréjus en évoquant sa richesse passée, aussi, il fondait de grands espoirs sur les revenus que son exploitation pourrait engendrer loin des marais insalubres qui longeaient la côte. Toutes ces terres riches en friches rendues enfin en totalité à l’église après leur confiscation par l’ancien roi de France, pouvaient-elles cacher une source de revenus si abondante qu’elle justifiait à elle seule que Monseigneur vint de si loin constater par lui-même que le projet fou qu’il mûrissait depuis des mois, peut-être même des années, était réalisable ? Et si tel était le cas, la reconnaissance du souverain pontife le mènerait peut-être avec la grâce de Dieu jusqu’à la charge suprême de cardinal.
À cette idée, Urbano di Fieschi, oublia la chaleur, les chaos du chemin et l’ennui profond de ce voyage loin du confort et de l’ambiance feutrée de l’évêché. Avec son escorte, et avec l’accord du Roi Louis XI, il réinvestissait le comté de Provence, tandis que le Roi rétabli dans son titre de Comte de Provence y rétablissait les droits de l’église. Un chariot plus rustique suivait la litière de l’évêque transportant deux moines en robe de bure noire et sandales qui devaient, en connaisseurs, lui servir de conseil. Ils semblaient apprécier la qualité de la terre brune chargée d’alluvions, inexploitée depuis des décennies. La plaine paraissait fertile, et pour éviter les fantômes du passé, ils trouvèrent judicieux de suggérer à l’évêque de reconstruire le village sur les hauteurs et non sur les ruines dans la plaine que l’on consacrerait aux cultures.
Monseigneur se frotta les mains de satisfaction sans daigner descendre du carrosse de peur de salir ses jolies poulaines de satin assorties à sa tenue. Il suffirait donc de quelques familles courageuses pour rendre vie à la vallée et rapporter des subsides au comté de Provence et à l’église ! Il se tourna vers Luigi pour lui faire part de ses impressions. Luigi, bouleversé par la confiance que l’évêque lui témoignait, acquiesça à tout.
— Et si, comme Monseigneur le suggère ce sont des familles de chez nous, Dieu nous accompagne…
Urbano di Fieschi en avait assez vu. L’ordre fut donné à la petite troupe de porteurs de regagner Fréjus pour retrouver le confort de l’évêché.
Dans le petit village de Pieve di Tecco perché sur un promontoire entre mer et montagnes, l’heure était aux adieux. L’émotion étreignait les cœurs. Trente familles constituées de jeunes couples, les plus pauvres de la paroisse, devaient quitter leur village aujourd’hui même, pour gagner le pays voisin. Regroupés en caravane, quinze chariots, en fait de vulgaires plateformes de bois chargées jusqu’à la gueule et recouvertes de toile grossière attendaient le signal du départ. Afin d’éviter les risques de brigandage et les hasards du voyage, les hommes convinrent de rester groupés. Quelques enfants, trop jeunes pour faire le chemin à pied étaient perchés au milieu du pauvre mobilier et des ballots de linge sans cacher leur excitation. Il y avait là, Stefano, Mario et la petite Caterina que ses jambes grêles n’auraient pu mener aussi loin. Fille unique de Giovanni le maréchal ferrant et de Maria, elle était pour ses parents leur bien le plus précieux. L’église avait fourni à certains, une mule, afin que, sitôt arrivés ils pussent se mettre au travail et il ne serait venu à l’esprit de personne de refuser une offre aussi généreuse ! Le travail manquait sur les terres arides de Pieve di Tecco, constituées de rochers, de forêts de pins et de châtaigniers, ainsi que de quelques vignes, et lorsque l’évêque demanda au prêtre de la province d’Imperia de lui fournir une liste de personnes susceptibles d’accepter cette migration définitive sur des terres riches et cultivables moyennant un petit pécule non négligeable, aucune d’entre elles ne fut en mesure de refuser. Elles n’en avaient pas les moyens !
Ainsi commença leur périple risqué, sur des routes peu sûres. Il allait durer plus d’un mois à marche forcée afin d’éviter d’être repérés et dépouillés par des brigands malgré la crainte qu’auraient pu leur inspirer tout au long des chemins et à l’approche des villages dominant la mer, les « pilone di giustizia ». Ils en avaient déjà croisé plusieurs de ces potences de fortune, constituées de deux piliers de pierre hauts de plusieurs coudées, réunis par une poutre transversale à leur sommet. Censées dissuader les détrousseurs, elles inspiraient surtout tant de crainte aux voyageurs, qu’ils ne manquaient jamais de se signer à leur approche en accélérant le pas avant de s’éloigner au plus vite, imaginant sans peine, avec terreur, un corps suspendu au bout d’une corde les yeux crevés par les vautours.
Les migrants fuyaient la pauvreté et la malaria qui ravageait les campagnes, mais n’ignoraient pas qu’il y avait encore plus pauvres et plus démunis qu’eux. Aussi, pour éviter tout risque de dispersion et de détroussement, avaient-ils convenu que, quoiqu’il advînt, ils ne se sépareraient jamais. Et c’est une petite colonie à bout de forces et de résistance qui parvint avec soulagement, au grand complet dans la plaine de Banuhls aux portes de l’évêché de Fréjus. Ils avaient évité le pire. La peste. Elle se propageait, vidait par vagues successives certaines petites villes, puis disparaissait comme elle était venue sans que l’on sût comment, quand elle avait eu son lot suffisant de victimes. Miraculeusement, la petite Caterina, dont la silhouette diaphane s’effaçait chaque jour un peu plus, au point de devenir évanescente avec ses cheveux si blonds et ses yeux de poupée de cire, avait survécu aux aléas du voyage. Tous les prétextes étaient bons pour que son père, invoquant les dangers du chemin, la hisse en riant sur ses épaules. Comment cet homme aux allures et à la musculature de bête de foire avait-il pu concevoir un être aussi fragile et délicat ? Cela dépassait son entendement. Mais comme Caterina était depuis cinq années de mariage la seule enfant que Maria ait pu mettre au monde, vivante, bien que de santé fragile, il vénérait la petite comme un vase précieux ou une relique.
Les habitants de Fréjus et de Fayence, une fois la crainte d’une épidémie apportée par les migrants dissipée, commencèrent peu à peu, à établir avec eux des contacts prudents. Leurs dialectes respectifs assez semblables semblèrent tout à coup, avec l’aide et le soutien des membres du clergé, en faire des voisins très acceptables. N’étaient-ils pas de la même confession, et leur premier chantier n’était-il pas celui de la reconstruction de la chapelle Saint Domnin dont seul, le chœur très endommagé avait résisté à la horde de Raymond de Turenne. Le mois de mars touchait à sa fin, les amandiers en fleurs illuminaient les collines et malgré quelques dernières gelées matinales la campagne s’éveillait augurant bien de la richesse des terres. Un doux parfum embaumait l’air, et le léger bourdonnement des abeilles annonçait une future récolte de miel abondante. Giovanni dut ferrer de neuf toutes les mules dès leur arrivée, les chemins accidentés parcourus depuis l’Italie avaient usé jusqu’à l’extrême leurs sabots pourtant ferrés avant leur départ. Les enfants italiens un peu livrés à eux-mêmes tant leurs parents avaient à faire, semblaient apprécier la découverte de la forêt sauvage et des terres inexploitées.
La nuit, allongée à l’abri sous la toile du chariot — ils n’avaient pas encore de maison — la petite Caterina, rassurée par la présence et la chaleur du corps de sa mère, se laissait bercer par le hululement des chouettes auquel se mêlait une voix monotone qui lui parvenait depuis la colline encore inexplorée dominant le promontoire où les migrants commençaient la reconstruction du village. Ses parents harassés ne percevaient rien de tout cela, chaque couple n’ayant en vue que l’achèvement d’une première bâtisse de taille très modeste pour affronter l’hiver prochain. Fort heureusement la récupération de pierres sur les ruines dans la plaine s’accélérait maintenant que les hommes avaient débroussaillé le site. Un va et vient incessant de chariots animait la campagne du lever au coucher du soleil, tandis que les enfants découvraient avec prudence leur nouveau territoire et la forêt, avec pour mission, le ramassage de bois mort pour alimenter les foyers, afin de se rendre utile.
Pourtant, leur installation ne laissait pas tout le monde indifférent. Dans la montagne qui dominait le promontoire où les migrants s’occupaient à la reconstruction du village sacrifié, depuis la petite plate-forme proche de l’entrée de la grotte où elle s’était réfugiée voilà presque quatre-vingts ans, une vieille femme, tendait l’oreille et observait toute cette agitation avec crainte même si aucun bruit de guerre ou de bataille ne parvenait jusqu’à elle. Seulement quelques cris ou des chants d’enfants. Voûtée, maigre et grise de peau et de cheveux, elle survivait là, entourée de quelques chèvres, se nourrissant de baies, de plantes sauvages et de bouillons ! Savait-elle encore son nom ? Rien n’était moins sûr ! Elle s’était appelée, ou plutôt, personne ne l’avait plus jamais appelée Marguerite depuis qu’un jour d’automne d’une douceur infinie, elle avait découvert les corps calcinés de ses parents, de ses frères et de ses sœurs, massacrés dans leur ferme incendiée.
Elle était partie tôt le matin ramasser des châtaignes dans la forêt, menant avec elle leurs chèvres dans les éboulis de rochers au bord du ruisseau. Là où l’herbe et les fleurs poussaient dru, donnant au lait, un goût et un parfum uniques. Miraculeusement épargnée, paisible, la fillette chantonnait, quand des hurlements de terreur et le crépitement d’un incendie lui parvinrent et se propagèrent jusque sur la montagne. D’abord à l’affût depuis l’orée de la forêt de châtaigniers, les cris d’horreur l’avaient chassée, plus haut toujours plus haut, et sans réfléchir, après avoir sifflé le chien et rassemblé les bêtes, elle avait grimpé encore et encore, sautant de rocher en rocher dans les gorges qui se resserraient autour d’elle. Quand elle avait découvert l’entrée de la grotte, elle s’y était enfoncée, avalée et protégée tel Jonas dans le ventre de la baleine, et s’y était cachée avec son petit troupeau, comme un enfant dans le ventre de sa mère. Elle n’était alors qu’une fillette d’une dizaine d’années.
Combien de temps y resta-t-elle ainsi prostrée ? Nul ne saurait le dire, mais elle ne dut son salut qu’à la chienne, dont elle ne se séparait jamais, et qui, arrivée au terme de sa grossesse avait mis bas à l’abri de la roche. En adoration devant les chiots, et la chienne refusant de quitter ses petits, Margot ne se décida à sortir de leur abri que lorsque le silence revint sur la plaine et que la chienne accepta de la suivre ! Jamais l’enfant n’oublierait que les hommes, ces êtres supérieurs dont l’église affirmait qu’eux seuls avaient une âme, étaient les bourreaux de sa famille, et que c’était grâce à un animal à qui les autorités religieuses refusaient de leur en accorder une qu’elle avait été épargnée !
Ivre de cris et de sang, quand il n’y eut plus rien à égorger ni à brûler, la horde barbare entraînée par Raymond de Turenne repartit, emportant avec elle les bêtes réchappées du massacre, et les biens des gens exterminés. La petite n’avait donc plus rien. Ni famille ni maison !
Se pourrait-il que Marguerite soit le fantôme que tous évoquaient encore des années plus tard ? Et les chants mélancoliques que certains croyaient entendre parfois la nuit sous la voûte étoilée, pouvaient-ils être le fruit de son esprit hanté par les images fulgurantes du massacre ? Personne alors ne songea à l’éventualité qu’une enfant ait pu survivre à une telle tuerie ! C’était impossible ! Seuls quelques-uns, miraculeusement épargnés, avaient pu gagner la ville la plus proche en se dissimulant dans les fossés avant que la horde barbare n’y mette le feu pendant son retrait.
Celle qui, enfant, folle de douleur, avait fui ses semblables, était à présent cette vieille femme échevelée, semblable à un cadavre, aimantée par l’agitation qui régnait sur la colline que dominait le territoire sur lequel elle régnait depuis des décennies. Seule à emprunter avec précaution des sentiers mille fois parcourus, sa vue baissait et un flou dangereux l’entourait, mais elle voulait savoir. Les barbares étaient-ils revenus ?
Alors, bien qu’elle connût la forêt et la montagne parfaitement, et qu’elle s’éloignât de moins en moins de la grotte qui l’abritait depuis si longtemps, aujourd’hui elle avait pris le risque de s’avancer en limite des gorges pour tenter de distinguer ce qui se passait dans la vallée. Elle avait quitté la caverne, le ventre qui l’abritait depuis qu’elle en avait réduit l’entrée béante, bâtissant de ses mains d’enfant, un mur en pierres, pour faire rempart à la peur et au froid. Elle s’y réfugiait l’été, fuyant la chaleur, et l’hiver, quand le gel poudrait la plaine et les collines de sucre glace, réchauffée par ses bêtes, elle y attendait patiemment, perdant toute notion du temps qui passe, l’arrivée du printemps. D’autres fois, elle entrait en léthargie comme un ours au fond de sa tanière quand l’eau du torrent tout proche grondait en dévalant entre les falaises et qu’un rideau de pluie lui cachait la forêt de chênes liège. Il était loin le temps, où, reproduisant les gestes qu’elle avait vu faire à sa mère, la fillette oubliée de tous, avait grandi loin des humains. Elle avait bu le lait à même le pis des chèvres, s’était nourrie de châtaignes hiver comme été, avec pour seule protection, ses chiens, et la pierre aux reflets roux de la grotte et des falaises. Aujourd’hui, elle l’abandonnait, prête au moindre cri à s’y replier.
Plus elle approchait de la frontière entre la sortie des gorges et les bois qui cascadaient en pente raide vers la vallée, plus ses souvenirs affluaient. Elle ne savait plus qui elle était de la vieille femme ou de la petite fille. Elle revivait les évènements. Tout lui revenait en mémoire. Les bruits, les odeurs…
Des jours durant, éperdue de douleur, de chagrin et de faim, la petite avait repoussé l’idée de redescendre dans la vallée sur les restes fumants de la ferme. Mais une nuit, portée par l’espoir fou du retour impossible de ses parents, elle avait parcouru jusqu’à l’aube les ruines noircies imprégnées de l’odeur pénétrante de la mort qui rodait encore, avant que, désespérée, elle ne réalisât et comprît enfin. Abandonnée, elle était abandonnée ! Elle ne les reverrait jamais !
Elle avait rampé, pleuré, crié, juré qu’elle se vengerait. En elle tout était mort.
Elle ne sentait plus la chaleur, mais le froid, un froid glacial, emportant là-haut dans son antre, comme un trésor, un pot de terre épargné par les envahisseurs qu’elle remplit de braises rougeoyantes, et depuis, telle une vestale, elle entretenait entre deux grosses pierres ce survivant du foyer disparu, ravivé chaque matin avec des bogues sèches de châtaignes amoncelées précieusement au fond de la grotte.
À plusieurs reprises, dans le silence sidéral qui planait sur les ruines après la fureur du massacre, elle y avait fait de brèves incursions pour récupérer ce que les sauvages avaient épargné. Jamais, il ne lui vint à l’esprit de rejoindre les hommes, ses semblables, ceux que le curé appelait autrefois ses frères ! La nature, les plantes et les animaux, eux, ne lui feraient jamais de mal, voilà ce que l’enfant avait compris au soir de la tuerie. Retirée du monde des humains, telle un ermite, sa jeunesse, sa vie de femme, elle ne les avait pas vues passer. Entourée d’animaux familiers, elle avait survécu. Comment ? Elle n’aurait su le dire, mais, par la force des choses, elle avait acquis une parfaite connaissance des plantes et une prudence instinctive. Et, aujourd’hui, cette très vieille femme qu’elle est devenue, qui vieillit inexorablement est attirée par les cris des enfants qu’elle n’a jamais eus, qui montent jusqu’à elle portés sur les ailes du vent depuis la vallée.
En particulier la voix douce d’une petite fille dont elle distingue à peine la silhouette grêle auréolée d’or qui lui rappelle la sienne lorsqu’enfant elle se mirait dans les eaux de la rivière Argens où elle allait pécher avec son père. Comme il était loin ce temps ! Margot ne se regardait plus, sauf bien malgré elle, dans l’eau glacée ferrugineuse au goût de sang, qui s’écoulait, goutte à goutte de la fente du rocher à l’entrée de la grotte, dans le vieux chaudron récupéré sur les ruines calcinées. Et ce qu’elle y voyait ne l’étonnait plus. Elle s’y était habituée. Cette image froissée à travers le voile léger qui obscurcissait sa vue de plus en plus floue, Margot, ne savait plus si c’était la sienne ou celle de sa grand-mère qui tremblotait à la surface de l’eau frémissante à chaque goutte qui en ridait la surface.
Jusqu’à ces derniers jours, jusqu’à l’arrivée de ces gens dans la vallée, elle n’avait pris conscience du temps qui passe qu’à travers la vieillesse et la mort de ses chiens, creusant le sol de ses mains avec des cailloux pour les enterrer. Elle n’avait pensé qu’à survivre. La présence de ces enfants au bas de la montagne réveillait-elle sa part enfouie d’humanité ? Elle regarda à nouveau l’eau au fond du chaudron. Qui était cette vieille échevelée qui la fixait intensément ? Elle passa ses mains sales aux ongles longs et noirs sur ses joues. Mais oui, c’était elle Marguerite. Un rire hystérique la secoua. La dernière fois qu’elle avait ri, c’était il y a longtemps, si longtemps ! Peut-être quand la chienne lui avait déposé son dernier petit au creux de son tablier ! Elle était encore une enfant. Des larmes roulèrent sur ses joues. Elles suivaient les sillons noircis autour de sa bouche édentée et Marguerite les laissa couler. C’était doux et chaud.
Avait-elle été belle ? Elle l’ignorait, perdant le jour du massacre, jusqu’à son identité puisque personne plus jamais n’avait prononcé son nom. Et même le son de sa propre voix la surprenait toujours lorsqu’un mot lui échappait. Et cette langue dont elle devinait quelques bribes qui montaient jusqu’à elle, pourquoi ne la comprenait-elle pas, même si parfois, il lui semblait en saisir le sens ? Deux mois avaient passé depuis l’arrivée des Italiens. Les fleurs des amandiers neigeaient sur l’herbe vert tendre, et dans la forêt, les châtaigniers à leur tour s’épanouissaient en nuages odorants. Caterina dont la santé fragile lui interdisait de s’éloigner du village en construction, s’enhardissait chaque jour un peu plus. C’était une fillette sauvage et douce qui supportait mal l’énergie des deux garçons arrivés avec elle de Pieve di Tecco. Elle évitait leurs jeux guerriers en trouvant sur la colline le silence et la quiétude dont elle avait besoin. Aussi, grimpait-elle le plus souvent seule à la recherche des trésors précieux que la nature dispensait généreusement. Sa silhouette menue et ses cheveux d’ange blond éclairaient les sous-bois et les clairières et chaque jour elle progressait dans son ascension, cueillant des mûres et des pissenlits, fière de participer à l’approvisionnement de sa famille lorsque le soir, elle déposait son panier sur la planche qui leur servait de table auprès du chariot où ils dormaient encore chaque nuit.
L’été éclatait dans la campagne. Les journées commençaient à l’aurore et s’achevaient quand le soleil disparaissait derrière le rocher brun fauve de Rocca Bruna. Au sud du futur village, à l’horizon, c’est à peine si l’on devinait une ligne bleue. La mer. Caterina y pensait souvent avec un brin de nostalgie, mais les cascades et les ruisseaux qu’elle franchissait avec méfiance lors de ses excursions en solitaire comblaient son besoin d’aventure et d’évasion. Avec l’indépendance, peu à peu, sa santé s’améliora. Et puis un jour, chacune prenant de plus en plus de risques, la vieille pour descendre de la montagne, l’autre pour l’escalader, elles se trouvèrent nez à nez. Impossible de se croiser sans que l’une ne laissât le passage à l’autre sur le sentier étroit et escarpé qui bordait Le Blavet. À la vue de la vieille, Caterina horrifiée par la crasse, les oripeaux, et les cheveux hirsutes de Margot fit un bond sur le côté pour tenter de fuir, mais la petite portait des sabots, son pied droit roula sur un caillou et elle dégringola dans le Blavet en contrebas.
Son cri retentit entre les parois rocheuses, répercuté par l’écho, tandis que Margot incapable de bouger dénouait la corde qui lui servait de ceinture et la balançait dans sa direction. Le ruisseau n’était pas très profond à cet endroit, l’été était bien avancé, et l’eau peu abondante, la petite avait de la chance, elle saisit la corde. Pétrifiée, Margot en tenait une extrémité et la regarda escalader les rochers, jusqu’à ce qu’elle fût en sécurité sur le sentier, grelottant de peur et de froid. Ses vêtements étaient trempés, ses cheveux mouillés pendaient comme des tentacules de poulpe et quand la vieille lui empoigna le bras et l’entraîna vers sa tanière d’une main crochue aux ongles longs et noirs comme des griffes, la petite pensa sa dernière heure arrivée ! Elle se mit à sangloter. La sorcière allait la manger, même si elle n’avait plus de dents !
En plus elle ne comprenait rien à ce qu’elle racontait.
Depuis quatre-vingts ans, Margot n’avait pas croisé un seul être humain et le souvenir qu’elle en avait gardé venait de faire irruption dans sa vie de recluse avec une violence inouïe même s’il s’agissait d’une enfant. Tout ce qu’elle possédait se trouvait à deux pas d’ici dans la grotte. Un chaudron, une écuelle, une cuillère en bois, une couverture réchappée des décombres, et quelques nippes qu’elle avait trouvées et qui avaient appartenu à sa mère et à son père. Il y avait si longtemps de cela qu’elle n’avait aucune notion du temps qui s’était écoulé depuis ces terribles journées.