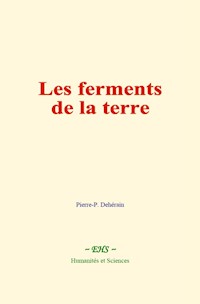Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
L’expérience a montré depuis un temps immémorial que toutes les terres n’ont pas la même valeur ; que, s’il en est de fertiles, d’autres sont ingrates ; et cependant il faut arriver jusqu’à la moitié de ce siècle pour voir la science agricole se constituer et l’étude méthodique de la terre arable servir de guide aux praticiens...
Une terre fertile n’est donc pas seulement un magasin bien pourvu de matières alimentaires, c’est surtout un réservoir, un régulateur d’humidité. La terre doit, pendant les périodes pluvieuses, emmagasiner l’eau et la conserver, afin que les plantes traversent les sécheresses, sans en pâtir. Une terre chargée de nitrates, de phosphates, etc…, ne donnera que des récoltes misérables, si elle est incapable de former d’importants approvisionnerions d’eau. Cette faculté maîtresse du sol, condition essentielle de fertilité, dépend de sa constitution même, des proportions dans lesquelles sont réunis les divers éléments dont il est formé ; elle est liée, en outre, à l’épaisseur de la couche ameublie, à la nature du sous-sol sur lequel elle repose.
C’est à l’étude des terres arables, de la constitution physique du sol et des qualités ou des défauts qui en dérivent que nous consacrons ce traité.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Pierre-Paul Dehérain (1830–1902) est un agronome et physiologiste végétal français. Formé au Muséum et au Conservatoire des arts et métiers, il étudie l’assimilation des minéraux, la respiration végétale et la culture du blé à haut rendement. Professeur à Grignon puis au Muséum, il devient membre de l’Académie des sciences en 1887. Ses recherches ont fortement influencé l’agriculture moderne. Il a donné son nom à un pavillon de l’École AgroParisTech, où un centre d'information lui est dédié.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La terre arable
La terre arable
Traité de science et d’agriculture
Pierre-P. Dehérain
Humanités et Sciences
Chapitre I
L’expérience a montré depuis un temps immémorial que toutes les terres n’ont pas la même valeur ; que, s’il en est de fertiles, d’autres sont ingrates ; et cependant il faut arriver jusqu’à la moitié de ce siècle pour voir la science agricole se constituer et l’étude méthodique de la terre arable servir de guide aux praticiens.
Les progrès de cette étude ont découlé d’abord de la connaissance, lentement acquise, des conditions d’existence de la plante, notamment de son alimentation ; nous savons aujourd’hui que les végétaux ne prospèrent qu’autant qu’ils trouvent à portée de leurs racines des matières azotées solubles : nitrates, ou sels ammoniacaux, et en outre, certaines substances minérales : phosphates, sels de potasse, de chaux, et de magnésie. De ces notions nouvelles, est né le commerce des engrais. On a compris que, pour tirer de la terre d’abondantes récoltes, il fallait ajouter les aliments végétaux qui y font défaut, et on a constaté, en effet, que leur épandage élevait les rendements dans une mesure inespérée.
On a cherché des gisements des matières premières propres à la fabrication de ces engrais ; on les a trouvés, et comme notre pays est aujourd’hui couvert d’un réseau de chemins de fer à mailles serrées, il est facile de faire arriver les engrais jusqu’aux champs où ils doivent être épandus.
Le commerce de ces matières fertilisantes s’est moralisé, par suite accru, et on peut dire, sans aucune exagération, qu’aujourd’hui la question des engrais est résolue. Elle est résolue au point de vue scientifique, et à ce point de vue seulement ; si la science a ouvert la voie, les praticiens sont encore bien loin de s’y engager partout, et si l’emploi des engrais commerciaux est fréquent dans la région septentrionale et en Bretagne, il est très restreint dans le centre et une grande partie du midi de la France. Cependant la vulgarisation des nouvelles méthodes se poursuit ; les professeurs d’agriculture, disséminés dans tous les départements, s’y emploient activement ; ils multiplient les champs d’expérience et de démonstration, ils entraînent les praticiens à utiliser les nouveaux engrais : les cultivateurs s’instruisent peu à peu, et comme les syndicats qu’ils ont établis leur vendent les matières fertilisantes à bas prix, et les mettent à l’abri des fraudes dont ils ont été si longtemps victimes, l’utilisation des engrais commerciaux s’accroît chaque année. La marche en avant est lente, mais continue, et les agronomes, tranquilles de ce côté, peuvent porter leur attention sur d’autres sujets.
Si la plante, en effet, s’alimente de nitrates, de phosphates, de sels de chaux et de potasse, elle consomme de l’oxygène pour sa respiration et, en outre, elle transpire d’énormes quantités d’eau ; elle ne se développe normalement qu’à la condition d’enfoncer sa racine dans un sol aéré, et d’y trouver de puissantes réserves d’humidité.
Des expériences de laboratoire, faciles à répéter, ont montré que les végétaux périssent, bien que leurs tiges et leurs feuilles s’épanouissent dans l’air, quand la terre où pénètrent les racines est privée d’oxygène. Ces expériences démontrent, en outre, qu’une graminée comme l’orge, l’avoine, ou le blé, transpire de 250 à 300 grammes d’eau pendant le temps qu’elle met à élaborer 1 gramme de matière sèche ; d’où l’on déduit que : lorsque I hectare a produit 30 quintaux de grains de blé et 60 quintaux de paille (c’est-à-dire 9000 kilos, se réduisant à 8000 kilos de matière sèche), il a dû fournir à cette récolte 2400 mètres cubes d’eau environ. La hauteur de la pluie sous le climat de Paris atteint de 500 à 600 millimètres, ce qui représente de 5000 à 6000 mètres cubes par hectare. La quantité d’eau tombée est donc supérieure à celle que consomment les récoltes, mais elle est très inégalement répartie entre les saisons, et la pluie que reçoivent les plantes pendant leur période de végétation est très souvent insuffisante pour fournir à la transpiration végétale ; or, aussitôt que les racines n’envoient plus aux feuilles assez d’eau pour que sa transformation incessante en vapeur empêche leur échauffement au soleil, elles se dessèchent et cessent tout travail.
A bien des reprises différentes, nous avons répété ici même que la feuille est la petite usine dans laquelle s’élabore la matière végétale. C’est dans les cellules à chlorophylle dont elle est formée que se réduisent acide carbonique et nitrates, et que prennent naissance, d’une part, les hydrates de carbone : sucres, amidon, cellulose, etc., et, d’autre part, les matières azotées. Si la feuille se flétrit, l’usine chôme, sa production s’arrête et la récolte s’amoindrit.
Une terre fertile n’est donc pas seulement un magasin bien pourvu de matières alimentaires, c’est surtout un réservoir, un régulateur d’humidité. La terre doit, pendant les périodes pluvieuses, emmagasiner l’eau et la conserver, afin que les plantes traversent les sécheresses, sans en pâtir. Une terre chargée de nitrates, de phosphates, etc., ne donnera que des récoltes misérables, si elle est incapable de former d’importants approvisionnerions d’eau.
Cette faculté maîtresse du sol, condition essentielle de fertilité, dépend de sa constitution même, des proportions dans lesquelles sont réunis les divers éléments dont il est formé ; elle est liée, en outre, à l’épaisseur de la couche ameublie, à la nature du sous-sol sur lequel elle repose. C’est à l’étude de la constitution physique du sol et des qualités ou des défauts qui en dérivent que nous consacrons ce premier article.
I. FORMATION DES TERRES ARABLES
A l’origine, la Terre formait une masse fluide, fondue, qui lentement, au cours de son éternel voyage à travers des espaces célestes, s’est refroidie. Les substances de faible densité formant la surface de la masse liquide s’y sont figées et ont fini par former une croûte continue.
On désigne sous le nom de roches primitives les pierres qui ont recouvert le liquide en fusion, comme le laitier couvre la fonte dans le creuset d’un haut fourneau. Si nous prenons, comme exemple de ces roches primitives, une pierre bien connue par sa dureté, le granit, nous le trouvons formé par l’association de divers minéraux : le quartz, en masses grises ; le mica, en paillettes brillantes ; le feldspath, souvent en cristaux isolés, reconnaissables à leur couleur rosée.
L’acide silicique ou silice (formé par la combinaison d’un corps simple, le silicium, avec l’oxygène) fait partie intégrante du mica et du feldspath ; isolé, il constitue le quartz. C’est parfois une matière admirable, transparente, bien cristallisée et désignée sous le nom de cristal de roche; dans les petites paillettes feuilletées du mica, la silice est unie à de l’alumine, à de l’oxyde de fer, à de la chaux ; et dans le feldspath, encore à de l’alumine, mais, en outre, à de la potasse, de la soude, de la magnésie, ou de la chaux. Le feldspath est fusible aux températures élevées et quand il est blanc, on l’emploie à former la couverte, ce vernis vitreux qui rend les objets en porcelaine imperméables aux liquides.
Les autres roches primitives, telles que les pegmatites, les porphyres, les syénites, bien que différentes du granit, présentent, au point de vue spécial où nous nous plaçons, des propriétés analogues. Quand ces roches sont intactes, qu’elles se sont conservées au travers des âges, elles sont dures, compactes ; l’eau glisse sur leur surface sans les pénétrer. Si elles avaient persisté à cet état sans subir aucune métamorphose, la vie n’aurait pu apparaître à la surface du globe.
Il n’en a pas été ainsi ; ces roches sont, au contraire, altérables ; elles se fendillent, se brisent, tombent en poudre, elles se décomposent même, et la terre que nous cultivons est formée par leurs débris.
Au premier abord, on a quelque peine à concevoir comment des roches aussi dures que le granit, que nous voyons persister intact dans les monuments égyptiens depuis des milliers d’années, aient pu donner nos terres meubles, formées de particules impalpables… Essayons cependant de nous figurer comment cette métamorphose s’est produite, et dès le début, rappelons-nous que, dans les phénomènes géologiques, il faut toujours faire entrer en considération le temps !
Quand une matière, fondue par l’action du feu, est brusquement refroidie, elle reste après sa solidification extrêmement friable. Toutes les personnes qui ont visité des verreries ont été sollicitées par les petits apprentis, les gamins, de leur acheter des larmes bataviques. Elles ont l’apparence de petites poires, terminées par une queue grêle et recourbée ; on les obtient en coulant du verre fondu dans de l’eau froide ; si on place les larmes dans un linge épais, de façon à éviter les éclats et qu’on brise la pointe recourbée avec une pince, on entend un craquement et en ouvrant le linge, on en tire une fine poudre de verre. Il a suffi d’un ébranlement dans la masse, pour amener non seulement sa rupture, mais sa pulvérisation complète.
Dans les cours de chimie, on montre l’instabilité des matières fondues, brusquement refroidies, on coulant en couche mince du borax sur une plaque métallique ; quelques instants après sa solidification, la masse se brise en projetant des éclats ; la surface vitreuse, qui tapisse le creuset dans lequel a eu lieu la fusion, fait entendre pendant plusieurs minutes un craquement continu, et quand on l’examine, on la trouve entièrement fendillée.
Dans la fabrication des glaces, on évite la rupture des grandes plaques de verre, laminées lorsqu’à la sortie du four la masse est encore pâteuse, en ne les laissant arriver à la température ordinaire qu’avec une extrême lenteur, en les recuisant. Si leur refroidissement est brusque, elles se fendent et sont perdues.
Ces phénomènes de rupture ne se produisent pas seulement dans les laboratoires ou les usines, on les observe également dans les laves qui s’écoulent des volcans. Les nombreux touristes, qui font chaque année l’ascension classique du Vésuve voient les coulées qui couvrent les flancs du volcan fissurées, fendillées, brisées en fragments : les laves anciennes montrent également ces fissures, et les baigneurs de Royat, en Auvergne, les ont constamment sous les yeux.
Les roches primitives, les laves parvenues fondues à la surface de la terre, puis exposées à un brusque refroidissement, ont donc une tendance naturelle à la rupture ; si cependant aucune autre force n’était entrée en jeu, les pierres n’auraient sans doute pas subi les altérations profondes qui les ont amenées à l’état de terres végétales ; d’autres causes, en effet, ont contribué à leur désagrégation.
A mesure qu’au cours des âges notre planète s’est refroidie, une croûte solide a séparé du noyau central, encore incandescent, l’atmosphère dont le globe est entouré. Cette atmosphère était formée de toutes les matières volatiles à ces températures élevées et notamment d’une énorme quantité de vapeur d’eau. Quand la température a baissé, cette vapeur s’est condensée à l’état liquide, et roulant ses vagues sur la surface dure, anguleuse des roches, elle a commencé à les disloquer, à les corroder, à les entraîner dans ses mouvements incessants. L’abaissement de la température a non seulement transformé la vapeur en eau liquide, mais encore en glace. Or, au moment où elle se solidifie, où elle gèle, l’eau augmente de volume, et la force, développée par ce changement d’état, est suffisante pour exfolier les roches les plus dures : d’où l’expression employée pour caractériser les froids rigoureux : « il gèle à pierre fendre ».
Lorsqu’une roche commence à se fissurer, elle est condamnée à être brisée, réduite en fragments, pulvérisée même ; l’eau, en effet, pénètre dans ces fissures, s’y gèle et agit comme un coin pour écarter les parois de la crevasse ; celle-ci s’élargit, devient plus profonde, et la désagrégation s’accélère… les fragments de la roche restent parfois en place, mais au moindre effort, ils se détachent et tombent.
Quand la glace se forme dans les petites cavités des pierres, elle exerce déjà une dislocation puissante ; elle agit cependant encore avec une bien plus grande énergie, lorsque, réunie en grande masse, elle descend des hautes montagnes. Dans le mouvement lent mais continu qui les entraîne des sommets vers les vallées, les glaciers usent, polissent la surface des rochers sur lesquels ils s’écoulent. Les fragments de pierre qui tombent sur la glace s’y enfoncent peu à peu par suite de la fusion que provoque l’élévation de leur température au soleil et, quand ils ont pénétré jusqu’au lit pierreux sur lequel glisse le glacier, ils agissent comme un outil solidement encastré ; ils strient, rabotent la roche. Dans leur mouvement continu, les glaciers atteignent les parties basses où l’eau reprend l’état liquide, ils abandonnent alors des fragments de roche, des graviers, du sable, et ces moraines sont comme les témoins de l’usure qu’a subie la montagne. Les fragments de roches, s’éboulant des hauteurs et tombant dans les parties basses, sont souvent charriés pendant de longs parcours par les eaux des torrents ; on trouve dans la Crau des débris rocheux, provenant des Alpes, que la Durance a entraînés à 240 kilomètres ; pendant ces transports, les cailloux se frottent les uns contre les autres, s’usent, perdent leurs aspérités, s’arrondissent et prennent l’aspect caractéristique des cailloux roulés… le sable est le résidu de cette usure. Sa formation se poursuit sous nos yeux ; à marée haute, sur toutes les plages à galets de la Manche, au bruit sourd de la vague, régulier comme une respiration, succède le cliquetis des cailloux roulant les uns sur les autres ; ils se polissent par le frottement, et les plages, couvertes du sable provenant de leur usure, s’allongent au-dessous des grèves à galets.
La rupture spontanée des roches brusquement refroidies, leur fendillement par suite des changements de température qu’elles subissent, leur exfoliation par la gelée, leur usure pendant qu’elles sont charriées par les eaux, amènent leur pulvérisation, déterminent la production de l’élément principal de nos terres cultivées, le sable.
Le deuxième élément dominant, l’argile, ne provient plus d’une simple désagrégation mécanique des roches primitives, mais bien d’une altération plus profonde, d’une décomposition chimique.
Les feldspaths, qui font partie intégrante des granits, sont des silicates d’alumine et d’une autre base, comme la potasse, la soude, la chaux, etc. Or, ces derniers silicates sont très attaquables par l’acide carbonique que renferme encore notre atmosphère, mais en bien moindre proportion qu’aux époques géologiques.
Pour montrer dans un cours combien cette attaque est rapide, on emploie une dissolution étendue de silicate de potasse, de ce produit que les anciens chimistes désignaient sous le nom expressif de « liqueur de cailloux », parce qu’ils l’obtenaient en faisant fondre du gravier dans du carbonate de potasse ou de soude liquéfié par l’action du feu. L’acide silicique, à la température rouge, déplace l’acide carbonique de ses combinaisons ; à froid, c’est la réaction inverse qui se produit.
On verse dans une éprouvette haute et étroite une dissolution étendue de silicate de potasse, puis on y dirige un courant d’acide carbonique. Quand il a traversé pendant quelque temps le liquide, un trouble y apparaît ; il augmente peu à peu, transformant la dissolution en une masse gélatineuse, au travers de laquelle les bulles de gaz ont peine à se frayer un passage ; cette masse est formée de silice ou acide silicique en gelée. Cette matière affecte donc des états très différents : anhydre, cristallisée, c’est le quartz ; agglutinée en masses compactes, c’est le silex ; réduite en poudre, c’est le sable ; hydratée, enfin, c’est une substance légère à apparence gélatineuse, qui se durcit parfois, présente de jolies irisations et devient pierre recherchée, sous le nom d’opale.
La décomposition du silicate de potasse, dissous par l’acide carbonique, est terminée en quelques instants ; bien plus lente et plus difficile est celle de ce même silicate quand, uni au silicate d’alumine, il constitue le feldspath. On conçoit cependant que cette même réaction détermine la dissolution de la potasse, l’entraînement de la silice, laissant comme résidu du silicate d’alumine ou argile. Ses aspects varient ; la décomposition des feldspaths ne renfermant pas d’oxyde de fer donne cette argile blanche admirablement plastique, employée sous le nom de kaolin, à la fabrication des porcelaines : l’altération des feldspaths ferrugineux produit la terre glaise des potiers, ou l’argile de nos champs : grise, quand l’oxyde de fer qu’elle renferme n’est pas suroxydé, elle devient rouge par la cuisson, et c’est alors la brique, ou reste simplement ocreuse quand, exposée à l’air humide dans nos sillons, lentement elle se sature d’oxygène.
Les roches primitives, les basaltes ou les trachytes des volcans, renferment tous du silicate d’alumine et, par suite, donnent par leur altération de l’argile ; on conçoit dès lors que, très répandue, elle soit partie intégrante de la couche meuble que nous cultivons.
Le troisième élément qui la constitue provient de réactions semblables ; il est dû à l’altération des silicates renfermant, outre l’alumine, une forte proportion de chaux, tels que le pyroxène, l’amphibole, le péridot. Soumises à l’influence des eaux chargées d’acide carbonique, ces substances se sont décomposées abandonnant, d’une part, de l’argile ; de l’autre, du calcaire.
Les notions précédentes suffisent à faire concevoir comment, sous l’influence des agents atmosphériques, les roches se sont altérées, corrodées, décomposées, de façon à laisser, comme résidu de leur décomposition, un mélange de sable, d’argile et de calcaire assez meuble pour être entamé par nos instruments, retenir l’humidité et porter des récoltes. Mais si dans quelques-unes de nos provinces : Bretagne, Limousin, Vosges, Auvergne, la culture s’établit sur la mince couche de terre végétale produite par l’altération des roches primitives, dans un grand nombre d’autres contrées, la terre, plus épaisse, provient de la désagrégation des roches sédimentaires, infiniment plus tendres, plus faciles à entamer que les roches anciennes.
Les géologues nous apprennent que pendant des milliers et des milliers d’années les eaux ont corrodé, disloqué, entraîné, dissous les roches primitives, puis lentement aux époques de calme, ont abandonné dans les profondeurs des océans les matériaux soustraits aux parties émergées. Des sables, des argiles, des calcaires se sont déposés au fond des mers, y ont formé des couches de centaines de mètres de hauteur ; puis, quand par suite des dislocations de la croûte terrestre, ces mers se sont retirées, les épais sédiments qu’elles avaient formés ont émergé. A leur tour, ils ont été attaqués, creusés par les eaux qui constamment ont roulé sur leur surface.
Échauffée par les radiations solaires, l’eau de l’Océan se transforme en vapeur ; la voilà mobile : participant à tous les mouvements de l’atmosphère, elle arrive au-dessus des continents ; invisible d’abord, au moindre refroidissement elle devient brouillard, puis nuage et, si la température baisse encore, se condense en pluie. L’eau atteint le sol et, entraînée par la pesanteur, retourne vers la mer, dont elle provient. Cette circulation incessante de l’eau de l’Océan à la terre, puis de la terre à l’Océan, a profondément modifié le relief des terrains. En descendant les pentes, l’eau leur arrache des matériaux, quelle abandonne ensuite lorsque, à son arrivée dans les parties basses, elle ralentit son mouvement. Il suffit de voir, après un orage, les quantités de limons qui viennent des hauteurs, pour comprendre que, soumises pendant des siècles à ces remaniements constants, les roches sédimentaires qui couvrent la plus grande partie de notre planète aient formé, à l’aide de tous les matériaux susceptibles d’être charriés par les eaux, un mélange de sable, d’argile et de calcaire, en proportions infiniment variables.