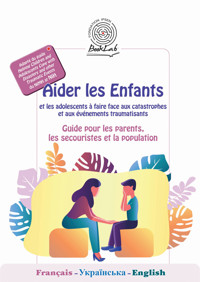3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ker
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Découvrez un nouveau numéro en version numérique de la revue littéraire belge Marginales
Qui l'aurait imaginé ? La Wallonie fait recette. Recette de réflexion, et d'imagination. Elle est manifestement emportée dans une dynamique de l'intelligence et de la créativité. Au niveau modeste de cette revue, cela s'est traduit par un trop-plein que nous n'avions pas encore connu. Il nous a fallu repasser les plats, jouer les prolongations. La livraison précédente n'a pas suffi à contenir tous les textes que le thème "Wallonie revue, Wallonie rêvée" avait suscités. Et lorsque l'idée a été lancée que l'on pouvait repartir pour un tour, les contributions ont recommencé à déferler.
Qui l'aurait imaginé ? Si la question se pose, c'est qu'aux yeux de beaucoup, la Wallonie était une affaire classée. Aux pertes plutôt qu'aux profits. La dépression économique qui l'avait fait chuter au rang de région nécessiteuse dans les années soixante semblait devoir déterminer son avenir durant longtemps encore. C'était mal analyser la singularité de son destin. La Wallonie pouvait disposer d'une autre issue que le redressement industriel pur et simple. On pouvait le lire dans un texte fondateur dont on avait plutôt tendance à sourire, le fameux "Tchant dès Walons" de Hiller et Bovy, qui date de 1902. Il contient ces vers, auxquels on n'a peut-être pas attaché suffisamment d'importance : "À prumi rang on l'mète po l'industreye / Et d'vins lès arts, èle rigatile ot'tant", ce qui se traduit en français par : "Au premier rang brille son industrie/ Et dans les arts on l'apprécie autant."
Des poèmes et nouvelles inspirés par la thématique de la Wallonie avec des écrivains comme Jean-Pol Baras, Michel Lambert ou encore Patrick Roegiers.
À PROPOS DE LA REVUE
Marginales est une revue belge fondée en 1945 par Albert Ayguesparse, un grand de la littérature belge, poète du réalisme social, romancier (citons notamment
Simon-la-Bonté paru en 1965 chez Calmann-Lévy), écrivain engagé entre les deux guerres (proche notamment de Charles Plisnier), fondateur du Front de littérature de gauche (1934-1935). Comment douter, avec un tel fondateur, que
Marginales se soit dès l’origine affirmé comme la voix de la littérature belge dans le concert social, la parole d’un esprit collectif qui est le fondement de toute revue littéraire, et particulièrement celle-ci, ce qui l’a conduite à s’ouvrir à des courants très divers et à donner aux auteurs belges la tribune qui leur manquait.
Marginales, c’est d’abord 229 numéros jusqu’à son arrêt en 1991. C’est ensuite sept ans d’interruption et puis la renaissance en 1998 avec le n°230, sorti en pleine affaire Dutroux, dont l’évasion manquée avait bouleversé la Belgique et fourni son premier thème à la revue nouvelle formule.
Marginales reprit ainsi son chemin par une publication régulière de 4 numéros par an.
LES AUTEURS
Jacques De Decker, Jean-Pierre Verheggen, Xavier Hanotte, France Bastia, Éric Brogniet, Jean Jauniaux, Jacques Sojcher, Patrick Roegiers, Adolphe Nysenholc, Jean-Pol Baras, Jean-Luc Outers, Liliane Schraûwen, Luc Honorez, Jean-Louis Lippert, André Delcourt, Michel Lambert, Serge Meurant et Lucie Spède.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
ÉditorialPar Jacques De Decker
Qui l’aurait imaginé ? La Wallonie fait recette. Recette de réflexion, et d’imagination. Elle est manifestement emportée dans une dynamique de l’intelligence et de la créativité. Au niveau modeste de cette revue, cela s’est traduit par un trop-plein que nous n’avions pas encore connu. Il nous a fallu repasser les plats, jouer les prolongations. La livraison précédente n’a pas suffi à contenir tous les textes que le thème « Wallonie revue, Wallonie rêvée » avait suscités. Et lorsque l’idée a été lancée que l’on pouvait repartir pour un tour, les contributions ont recommencé à déferler.
Qui l’aurait imaginé ? Si la question se pose, c’est qu’aux yeux de beaucoup, la Wallonie était une affaire classée. Aux pertes plutôt qu’aux profits. La dépression économique qui l’avait fait chuter au rang de région nécessiteuse dans les années soixante semblait devoir déterminer son avenir durant longtemps encore. C’était mal analyser la singularité de son destin. La Wallonie pouvait disposer d’une autre issue que le redressement industriel pur et simple. On pouvait le lire dans un texte fondateur dont on avait plutôt tendance à sourire, le fameux « Tchant dès Walons » de Hiller et Bovy, qui date de 1902. Il contient ces vers, auxquels on n’a peut-être pas attaché suffisamment d’importance : « À prumi rang on l’mète po l’industreye / Et d’vins lès arts, èle rigatile ot’tant », ce qui se traduit en français par : « Au premier rang brille son industrie/ Et dans les arts on l’apprécie autant. »
Ce texte a reparu récemment dans Le Monde diplomatique, qui consacrait un dossier à la Wallonie. Il rassemblait pour l’essentiel des articles dus à des Belges : Philippe Suinen, Serge Govaert, André Goosse. On aurait aimé, évidemment, un regard de l’extérieur. Il viendra sans doute, et peut-être plus vite que certains ne le pensent. La Wallonie a de quoi intriguer, en effet. Ne fût-ce que par son comportement politique. Voici une région qui n’a guère été privilégiée par le sort, à la différence de l’autre composante de la Belgique, la Flandre. On pourrait craindre, devant les scandales qui, de surcroît, l’ont malmenée au cours des années 90, que les démons de l’extrême droite la hantent. Or, qu’a-t-on pu constater lors du dernier scrutin communal ? Alors qu’en Flandre, le mouvement réactionnaire se confirmait, en Wallonie les menaces de ce type se résorbaient presque complètement.
On s’est contenté de constater le phénomène. Mais l’a-t-on vraiment analysé ? Un point de vue s’est fait entendre, de la part d’un observateur attentif de la Wallonie, qui se penche sur elle de longue date : le journaliste flamand Guide Fonteyn, attaché à la rédaction du quotidien De Standaard, auteur d’un ouvrage intitulé « Les Wallons » qui fait autorité depuis longtemps. Il est envoyé permanent à Namur, d’où il expédie ses articles à sa rédaction. Et il tient, dans son organe de presse, une chronique joliment appelée « Zuiderterras », dont on pourrait traduire le titre par « Terrasse plein Sud », où récemment il commentait le dossier du Monde diplomatique dont question ci-dessus. Il a vu dans la composition de cet ensemble d’articles une manœuvre francophone, appuyée par la France, pour nier l’autonomie culturelle de la Wallonie. Fonteyn partage avec beaucoup d’intellectuels flamands l’idée que la culture, en Belgique, devrait être régionalisée, et non pas gérée par la Communauté française, ce rassemblement fondé, justement, sur l’appartenance à une même culture, principe qu’ils rejettent au nom du droit du sol. Ce débat-là est loin d’être clos, car sa portée philosophique est évidente.
Le plus intéressant, dans l’éditorial de Fonteyn, est qu’il affirme avec détermination, contre la prise de position des contributeurs du Monde diplomatique telle qu’il l’interprète, qu’une culture wallonne existe. Il écrit, non sans quelque provocation : « Mes amis wallons ne me pardonneront pas la comparaison, mais de même qu’un Marc Dutroux ne pouvait naître qu’en parasite sur les ruines d’une industrie morte, un Jean Louvet ou un Franco Dragone envoient des signaux d’un monde dont ils font partie : La Louvière, ici et maintenant. » En d’autres termes, Fonteyn croit à la prégnance du milieu en matière de culture, il s’inscrit dans la lignée des positivistes, il adopte la méthode d’un Hippolyte Taine.
Et si c’était l’inverse ? Et si la Wallonie, dont on a déjà dit qu’elle était une vue de l’esprit, puisqu’elle avait été portée sur les fonts baptismaux par des poètes, devait plutôt son salut à son énergie intellectuelle ? Lors du débat organisé dans le cadre de « L’écrin de l’écrit » à Éghezée autour de notre précédent numéro, Bernadette Wynants a dit qu’elle y avait vu une sorte d’« invention de la Wallonie ». C’était nous faire beaucoup d’honneur, bien sûr. Mais il y a à puiser dans son raisonnement.
Si la Wallonie est sur la bonne voie, c’est qu’elle n’a pas renoncé à exercer son esprit critique, et qu’elle ne se complaît pas dans le narcissisme. On imagine difficilement qu’une de ses chaînes de télévision produise un programme aussi complaisant et régressif que « Big Brother », le reality show qui a réussi, si l’on peut dire, à mobiliser une audience flamande énorme devant le spectacle de la vie soi-disant quotidienne, en fait complètement truquée, de quelques exhibitionnistes que des caméras de télévision ont traqués sans discontinuer durant plusieurs mois. Ce succès ne peut s’expliquer que par une absence de résistance mentale, qui pourrait bien être aussi le substrat des scores que le Vlaams Blok réalise par ailleurs.
On le verra : pas plus que dans le précédent Marginales, on ne trouvera dans celui-ci trace de triomphalisme ou d’autosatisfaction. Beaucoup de tendresse, en revanche, et d’affection. Pour un petit coin d’Europe et de terre qui en a vu des vertes et des pas mûres, mais dont les pommiers sont en train de refleurir.
Remembrances de l’enfant idiot
Jean-Pierre Verheggen
Ouiquenne
Ouiquenne ! Ouiquenne, comme l’écrivait Queneau,
le ouiquenne, aussi loin qu’il m’en souvienne,
c’était quand il faisait beau
et qu’on allait jouer le long des berges
de la puante Orneau, et les nonquennes,
c’était quand il pleuvait à seaux,
des pluies diluviennes qui nous faisaient dire amen
à nos baleines et autres projos de bateaux !
Les niquennes (c’était la grosse moyenne)
c’était quand il faisait mi-frisquet mi-pâlot
et qu’on restait au pajot
à lire des Mickey ou des Zorros,
enfermés dans les chambres du haut
que nous devions quitter au triple galop,
les jours de grands niquennes,
quand les parents passaient au lit l’aprèm’
à niquer jusqu’à ce que survienne quelque tempête
dans leurs rapports conjugaux,
ô ouragan sur le Ouicaine !
Papa était en haut.
Capitaine sans paquebot,
Maman était en bas ne pipant plus un mot !
Le dimanche était chocolat !
Lecture élémentaire
Ainsi donc après avoir fait la connaissance - balbutiante ! - de René qui ramait pour ramener Irma à la rive ou de Petit Pol qui prenait la pipe de papa posée sur le piano pour aller fumer en cachette (Petit Pol qui pâlissait, vomissait et était justement puni : pan-pan cucul pèpette), je découvrais enfin, vers la mi-février de ma première année d’études primaires, les héros de mon second livre de lecture élémentaire, à commencer par Firmin et son lapin.
Au diable les bébés bégayeurs et zozoteurs de mes débuts mal assurés, voici venir les grands de la lecture silencieuse, souple et déliée, parfaitement enchaînée, courante, voire véloce parfois, trop précipitée. Voici venir Firmin et son lapin. Ah ! cher Firmin ! Je n’avais pas assez d’yeux pour lire son histoire et dévorer le dessin qui l’illustrait sur la page juxtaposée.
Firmin y nourrissait un lapin de clapier qu’il gâtait - régionalisme oblige ! - de pleines pâtées de légumes frais en provenance directe du jardin. Généreux gamin, se disait-on, n’était-ce qu’il le faisait à dessein (le texte tout entier étudiait le son « in » qu’il soulignait en lettres rouges imprimées) à des fins bassement alimentaires et sordidement spéculatives.
Il caressait en effet l’animal pour mieux lui palper les miches. Il lui flattait le râble pour constater avec satisfaction l’état d’avancement de son élève à l’engrais. Quand il serait gros et gras, notait le texte, il irait à la casserole où il ferait un fin plat.
Ah ! salaud de Firmin ! Vil hypocrite. Crapule accomplie. Maudit sois-tu ! Puisses-tu mourir ! Traître infâme ! Judas ! Oui Judas (Judas Iscarotte, serais-je aujourd’hui tenté d’écrire).
Sans doute le contexte de cette époque d’immédiate après-guerre justifiait-il de telles pratiques d’économie pour soulager le panier de la ménagère mais enfin ! tout écologique que fût cette nourriture, je ne comprenais pas, je pleurais devant ce projet d’assassinat, dégoûté de surcroît de tout livre de lecture à l’avenir.
Fort heureusement, d’autres historiettes moins cruelles m’en rendirent l’amour et avec lui l’attrait indéfectible pour les lapins littéraires : carrolliens, bugsbunnyens courant plus vite qu’un Golf Rabbit autour du Moulin de Daudet ou dans le thym et la rosée de Jeannot La Fontaine. Ils garderont toujours ma préférence !
Quant à Firmin, j’en connus un - un vrai ! - qui habitait la rue des Champs où mes grands-parents avaient leur coutellerie. C’était - il faudrait que j’interroge ma mère à son propos ! - un ancien mineur retraité ou un ex-ouvrier des glaceries qui mastiquait, à longueur de journée, un tabac de bouche infect qui lui jaunissait les dents. Il crachait constamment, expulsant, haut et fort, ce jus de chique couleur jus de chaussettes, voire marc de ramponneau pour filtrer le café ! Il m’effrayait, alors que tout en lui dégageait la gentillesse !
Mais, me direz-vous, et la lecture dans tout cela ? Eh bien, on l’aura compris : il n’y a pas de plus grand livre que le premier qui vous ait fait longuement pleurer.
Jules Chinchard
Si j’avais à retrouver mon âme innocente d’enfançon d’là Sambre et Meuse, je la chercherais du côté d’mes petits compagnons, petits pêcheurs wallons, capables, comme moi, de prénommer tous les poissons par leur prénom : Léon, le gardon du Piéton ou Valentin, un sacré goujat de goujon qui sévissait, raconte-t-on, dans les eaux de l’Eau Noire à Couvin, ou Gaston, le carpillon des Étangs du Bras Mort de la Tanche d’Or à Mornimont.
Ô saisons ô chanteaux de pain ô vermisseaux ô asticots, quelle âme est sans défaut ?
Les jours de manque - ô asticots que nous étions ! Ou bien nous chantions : bredouille, montre-nous tes couilles ! Ou bien nous attribuions notre malchance à la concurrence : aux grenouilles de bénitier que nous détestions et aux bigots qui ne cessaient de tirer des bigorneaux d’leur nez, pendant l’office du curé !
Ou encore aux Romains !
Aux légions de Jules Chinchard, venues gauler, sans permission, dans les rivières de nos régions, et enlever nos Sabines, et chaparder nos sardines que le Général disputait à Boduognat, le roi namurois du pan-bagnat, qu’il accusait de garnir de faux anchois, ses pizzas !
Camille Marique
Nous disions baloujes pour hannetons et berbijots pour les poux du mouton. Nous disions corioule pour désigner le liseron, flamouche et fougnant ou cosse et scafiote, talouche et malton. Nous disions chalbraque, capotine et goliman. Moussement, veau de mars, panauche et frumejon. Nous disions colaux ou coulons quand nous voyions les pigeons de Camille Marique rentrer dans leur petite guérite. Nous repérions l’Atomique, le Mozaïque ou l’Artiste 100 %. Le Barcelone flamand et le jeune Adjudant. Le Tarzan blanc nez, l’Artaban 77 et PÉcaillé Frazette. Le Louis foncé et le Merckx gamin. Le Borain de velours, le petit bleu Vitesse, le Direct de retour et la Princesse Louisa. Ah ! la Princesse Louisa ou la Femelle Monsieur, quelle joie ! Mais voici encore mieux que ça : l’inégalable Coppi, le jeune Diable et le Kennedy accouplé ! Le Derby tigré, le pur Napoléon, l’Adonis grand fond et le Caïd d’Argenton. Voici le Vétéran du Roi Albert et le Géronimo du Notaire. Le Jules Sans Peur, le Fantomas des Vents contraires, le Frère du Foreur et l’Aristo-Châteauroux. Mais voici celui qui régnait par-dessus tout, le plus prisé : le Longue Queue mailleté qui faisait routoucou routoucou routoucou en tenant les femmes avec son bec crochu, par leur cul ou par le cou !
(Extraits de On n’est pas sérieux quand on a 117 ans, à paraître en février 2001 chez Gallimard/L’Arbalète)
Sur la place
XavierHanotte
Au premier coup de sifflet, ils avaient formé les faisceaux. Le deuxième n’avait pas encore déchiré l’air épais qu’ils se laissaient tous tomber sur les pavés brûlants, dans un fracas amorti de fers de pelles et de gourdes vides. Certains s’étaient endormis aussitôt, avant même d’avoir débouclé leur sac et leur ceinturon. Les autres observaient un silence de bêtes recrues, indifférentes au monde qui les entourait. Sur la place légèrement déclive, piquetée de reflets cuivrés, le bataillon étalait jusqu’au pied des maisons sa large tache kaki.
Charlie était fatigué. Pourtant, il ne se lassait pas du spectacle. C’était sa première campagne, et la nouveauté des impressions qui l’assaillaient depuis Boulogne lui soufflait d’engranger, pour plus tard, une provision de lumières, d’odeurs et de sons.