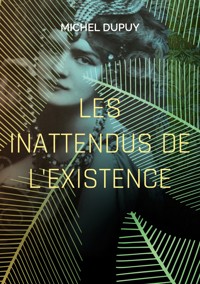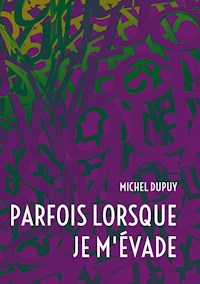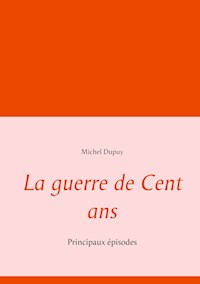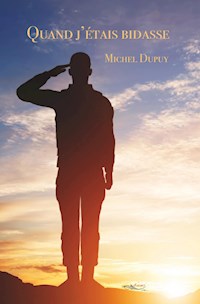Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un jeune homme accusé à tort du viol d'une adolescente est condamné à dix ans de prison. Au bout de deux ans d'incarcération il aura l'occasion de s'évader et il sera entraîné dans une série d'aventures. Réhabilité, il se vengera des responsables de ses malheurs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
… Ce qui est plus grave que le sang des hommes, plus inquiétant que leur présence sur la terre, la possibilité infinie de leur destin.
André Malraux
C’était encore le demi-jour de l’aube. Au levant, en un halo flamboyant qui émergeait lentement des flots et s’élargissait de plus en plus, une lueur rougeoyante annonçant une journée de grand soleil illuminait l’océan calme et paisible. Vivifiante, une brise légère soufflait doucement.
Chaque matin, après avoir quitté sa cabine, Roland venait à la première heure pour savourer durant quelques minutes ces instants magiques. Seul sur le pont, accoudé au bastingage à l’avant du bateau, il se laissait griser par l’ambiance sereine.
Au loin, soulevant dans son élan des gerbes d’écume argentées, un énorme poisson jaillit. Avant de retrouver son élément, image féerique de carte postale, presque irréelle, son corps en arc de cercle se détacha nettement sur l’onde moirée. Troublant à peine l’harmonie générale, semblant immobile sur l’immensité, le navire ronronnait doucement. Un banc de poissons volants, surpris par sa masse sombre, gicla hors des flots. Ils planèrent à fleur d’eau sur plusieurs dizaines de mètres, certains d’entre eux réussissant même à repartir encore plus loin après avoir ricoché.
Pressé de diffuser ses rayons, très vite l’astre solaire se manifesta, puis, continuant sa course, il s’éleva lentement dans le ciel limpide, totalement vide du moindre nuage. Aujourd’hui, il va encore faire très chaud, pensa Roland, avant de regagner la salle à manger du bord.
Le bâtiment sur lequel il avait embarqué, un cargo spécialisé dans le transport de marchandises, naviguait à présent sur l’océan Indien, dans cette région du globe où la canicule est particulièrement sévère. La veille, ils avaient fait escale à Djibouti, la ville la plus chaude de la planète, disait-on. Attablés devant un petit déjeuner copieux, les quatre autres personnes en compagnie desquelles il voyageait, étaient déjà là. Deux couples amis qui s’étaient accordés trois semaines de détente paisible. Des gens fort sympathiques qui avaient choisi ce moyen de locomotion pour faire du tourisme. Pour eux, une croisière beaucoup plus originale et surtout plus reposante que celles offertes par les agences de voyages spécialisées. Avec Roland, ils étaient les seuls passagers du cargo. En serrant la main à chacun, il leur souhaita une bonne journée.
- Alors monsieur Bricart ! La mer est belle aujourd’hui ? lui demanda l’un d’entre eux.
- Sensationnelle ! Mais tout à l’heure, sur le pont, gare aux coups de soleil ! La canicule va être sévère ! Je crois qu’il sera préférable de rester à l’ombre.
Alors que le matelot préposé au service des passagers, qui s’était présenté dés son arrivée, lui proposait tout un assortiment de plats et de boissons, il s’installa à sa place habituelle.
- Vous savez bien ! Je ne change pas. S’il vous plaît, un verre de jus d’orange, un bol de café au lait et deux croissants, précisa-t-il.
- Bien monsieur.
- Il est très bien ce garçon et très stylé, seulement si on l’écoutait, attention au kilos, commenta-t-il après le départ du jeune homme.
- Vous pouvez le dire ! déclara la dame à côté de laquelle il était assis, qui s’empiffrait de choux à la crème.
- Et votre roman ? Vous avancez ? questionna son mari.
- J’avance. J’avance doucement.
Pour tous à bord, il était Robert Bricart, un jeune homme technicien des travaux publics qui, désireux de devenir écrivain, s’était payé deux mois sans solde et ce voyage, sûrement plein d’enseignements, avait-il précisé, pour tranquillement écrire un roman, loin de toute agitation. Ayant donné ce prétexte plus ou moins crédible pour justifier sa présence parmi eux, il s’était finalement pris au jeu. Tous les après-midi, après la sieste obligatoire, il restait enfermé dans sa cabine et il s’essayait à la littérature. Il avait un sujet tout trouvé : les dernières années, riches en rebondissements, qu’il venait de vivre. Il n’avait pas eu trop de peine à intégrer sa nouvelle identité, maintenant s’entendre appeler Robert Bricart au lieu de Roland Brisset, son véritable nom, ne le surprenait plus du tout.
Tout avait commencé trois ans plus tôt, un certain après-midi d’automne.
Il venait de quitter Toulouse. Il avait dépassé les derniers immeubles de la banlieue. Il roulait vers Auch et la route nationale s’étalait toute droite devant lui. Il appuya un peu plus sur l’accélérateur et sa voiture prit de la vitesse. Il espérait trouver rapidement un endroit propice pour se garer et satisfaire un besoin qui devenait de plus en plus pressant. En ville, après la réunion à laquelle il avait été convié dans les bureaux d’Electricité de France, il n’avait vu aucune vespasienne sur son parcours. Il avait pensé à faire une halte pour entrer dans un débit de boissons quelconque, mais il n’avait vraiment pas soif, et puis le trafic très dense et le stationnement difficile l’avaient contraint à circuler.
Ce n’était pas encore la campagne, de chaque côté de la route, des maisons relativement proches les unes des autres avaient été construites. D’ailleurs, à deux ou trois cents mètres sur la droite, certainement le long d’une route parallèle, on apercevait des constructions plus importantes. Roland commençait à s’impatienter. Il ne pouvait toujours pas s’arrêter, les élargissements qui lui auraient permis de se ranger ayant tous été aménagés pour l’accès direct à des habitations. Enfin il arriva dans une zone plus champêtre. Bientôt, après avoir mis son clignotant, en bordure d’un vaste terrain laissé en friche et envahi par une végétation exubérante, il eut la possibilité de garer son véhicule. Là, sur le bas-côté aplani, qui avait mordu sur le domaine privé, d’autres automobiles, dont les occupants sans doute tourmentés par les mêmes impératifs, avaient déjà stationné. Après être descendu de sa voiture, rapidement, en quelques enjambées, il se rendit aux abords d’un fourré à une dizaine de mètres de la route, heureux de pouvoir soulager sa vessie. Il se sentait apaisé, lorsqu’il entendit des rires, d’enfants lui sembla-t-il. Ils étaient tout près, de l’autre côté du buisson au travers duquel il vit des corps bouger. Extrêmement confus de se donner ainsi en spectacle, il se tourna et, aussi vite qu’il le put, il remonta la fermeture-éclair de son pantalon. Avant de regagner sa voiture, il aperçut trois gamines qui, tout en gloussant, s’éloignaient en courant. Il les vit se diriger vers un grand bâtiment qui se trouvait de l’autre côté de la jachère, à environ cent cinquante ou deux cents mètres de là, et que, préoccupé par ses exigences physiologiques, il n’avait pas remarqué. Haut de plusieurs étages, c’était apparemment, autant qu’il pouvait en juger à cette distance, un immeuble d’habitation qui comprenait certainement de nombreux appartements.
Avant de reprendre la route, voulant oublier sa mésaventure pour le moins humiliante, il s’accorda quelques minutes de répit pour jeter un coup d’œil sur les notes qu’il avait prises lors de son entrevue. En roulant, il allait pouvoir y réfléchir. Il n’était que cinq heures de l’après-midi et, en principe, il devait avoir le temps de passer à son bureau pour faire le point sur les résultats de sa rencontre. Quand il redémarra, il ne prêta pas attention à l’homme qui, dans le taillis clairsemé, venant du bâtiment qu’il avait aperçu, courait dans sa direction.
Très souvent, durant leurs heures de loisirs, les deux filles de monsieur et madame Martinet, Agnès et Isabelle, retrouvaient leur petite voisine de palier, Claudine Bessous. Ensemble, elles avaient pris l’habitude d’aller jouer dans l’immense champ, depuis longtemps laissé en friche, se trouvant à l’arrière de la résidence où elles habitaient, au-delà de la cour de dégagement. Devenu une sorte de maquis inculte où proliféraient les broussailles et les arbustes, c’était un lieu de récréation idéal pour les enfants. Ce jour-là, un mercredi, les trois fillettes s’étaient éloignées un peu plus loin qu’à l’accoutumée pour cueillir des mûres. Un peu lasses d’avoir gambadé, elles venaient de s’étendre sur un lit de feuilles sèches et de mousse, et, par jeu, faisaient mine de dormir, quand elles entendirent une automobile s’arrêter sur le bord de la route toute proche. Une portière claqua. Les claquements secs de branches mortes qui se brisaient leur indiquèrent que quelqu’un venait vers l’endroit où elles se trouvaient. Muettes et un peu inquiètes, elles attendirent. C’est alors que, les jambes écartées, un homme se campa très exactement de l’autre côté du buisson au pied duquel elles s’étaient allongées, à deux mètres à peine. Si, cachés par la végétation, elles distinguaient mal son torse et son visage, en revanche elles voyaient très bien le bas de son corps et son pantalon. Elles le virent précipitamment se débraguetter et exhiber son sexe pour uriner. Vraisemblablement, il avait un sérieux besoin à satisfaire car il n’en finissait plus d’évacuer son trop-plein, ainsi elles purent tout à loisir contempler en silence ce qui leur sembla un énorme phallus. Une grosse bite comme disaient les garçons à l’école. Lorsqu’il la secoua, elles éclatèrent en choeur d’un gros éclat de rire et se levèrent pour voir à quoi ressemblait ce monsieur impudique. Avant qu’il ne tournât le dos, elles eurent le temps de découvrir qu’il était assez jeune, blond, très bronzé, et qu’il portait une courte barbe. Alors qu’il regagnait son automobile, une voiture semblable à celle du père des deux soeurs, les trois petites partirent en courant.
Madame Martinet était occupée à repasser du linge, pendant que son mari, qui avait pris une semaine de congés, bricolait dans la pièce à côté. Tout était calme dans l’immeuble, quand tout à coup, ils entendirent la porte d’entrée s’ouvrir bruyamment.
- Maman ! Maman !
- Eh bien ! Que t’arrive-t-il ?
C’était leur fille Isabelle, la benjamine, âgée seulement de neuf ans, haletante d’avoir couru et toute émotionnée. Elle tenait absolument à raconter à ses parents ce qu’elle venait de voir. Sa sœur Agnès, de quatre ans son aînée, éprouvant déjà lorsqu’il s’agissait de sexe, des sentiments confus et presque de la honte, était restée derrière, n’osant rien dire.
- Maman ! Un monsieur vient de nous faire voir son zizi !
- Quoi ? Qu’est-ce que tu racontes ? C’est vrai Agnès, ce que nous dit ta sœur ?
- Oui, c’est vrai ! Dans les buissons, là-bas, pas loin de la route. Nous ramassions des mûres. Il avait rangé sa voiture en face d’où nous étions et il est venu juste devant nous pour défaire son pantalon, répondit la grande.
Vivement intéressé, dés les premières paroles d’Isabelle monsieur Martinet avait abandonné son ouvrage. Après avoir entendu les deux gamines, il réagit violemment.
- Ah, le salaud !
Déjà il dévalait l’escalier et il se précipitait vers l’endroit indiqué par Agnès. Il espérait surprendre cet exhibitionniste vicieux, sans doute un pédophile. N’ayant vu personne dans le taillis, il se trouvait près de la route, quand il vit un break couleur ivoire démarrer. Il était trop éloigné pour lire le numéro minéralogique, mais, voyant parfaitement briller le sigle bien connu sur le hayon, il reconnut sans ambiguïté la marque Citroën. Revenu chez lui, il questionna ses filles.
- De quelle couleur était-elle la voiture du type ?
- Blanche, répondirent-elles en chœur.
- Enfin pas tout à fait, plutôt de la couleur du frigidaire, rectifia Agnès en désignant le meuble de la cuisine.
- Une grosse ou une petite voiture ?
- Assez importante, plutôt longue ! Comme la tienne ! Une familiale !
- C’est bien lui ! Si jamais vous le revoyez, vous me le dites. En attendant, ne revenez pas traîner par là-bas ! C’est bien compris !
- Oui papa !
- Tu te rends compte ! Cette espèce de salopard ! Montrer son attirail à des enfants ! Il a eu de la chance que je ne l’attrape pas ! déclara monsieur Martinet à son épouse.
- Peut-être faudrait-il avertir la police ? On ne sait jamais c’est peut-être un type dangereux ?
- En tout cas je vais en parler à nos voisins, que leurs gamins fassent attention.
En cette fin d’après midi d’un mercredi ensoleillé, jour de repos scolaire, la route était assez encombrée. Roland Brisset, contraint de rouler à l’allure modérée imposée par la circulation, se laissait aller à cogiter sur sa rencontre avec les gens d’EDF. Il avait presque oublié son arrêt d’urgence au cours duquel, sans le vouloir, il avait montré ses attributs à des enfants. Incident fort regrettable, et même, à vrai dire, plutôt dégradant, mais justement, à cause de la gêne qu’il ressentait en y repensant, il voulait le chasser de sa mémoire et ne lui accorder aucune importance. Par ailleurs, il était loin d’imaginer que son exhibition involontaire avait causé un trouble profond dans l’esprit des fillettes.
Conducteur de travaux dans une importante entreprise de travaux publics de Bordeaux, trois mois plus tôt, il avait été envoyé à Auch pour diriger la construction d’une ligne électrique à très haute tension. Destiné à renforcer l’alimentation en énergie de la ville et de la région, cet ouvrage, d’une trentaine de kilomètres de long, était raccordé sur le réseau national dans les environs de Condom. La maîtrise d’œuvre était bien entendu assurée par un des services spécialisés d’Electricité de France, dont les bureaux étaient basés à Toulouse. C’est pourquoi, Roland avait à se rendre fréquemment dans cette ville pour des réunions de travail.
Àgé seulement de vingt six ans, il était un tout jeune chef de chantier. Dans sa société, c’était lui principalement qui assurait la direction des ouvrages de moindre importance, ceux qui demandaient des déplacements de courte durée aux quatre coins de l’hexagone. En effet, ses collègues plus chevronnés, qui avaient tous charge de famille, rechignaient à jouer les itinérants. Alors la direction leur réservait les affectations proches du siège ou bien celles permettant de s’installer en famille, avec armes et bagages, pour de longs mois, voire des années. Lui, Roland, même s’il avait déjà trouvé l’âme sœur, était toujours célibataire. Follement amoureux de sa petite amie Josiane, infirmière à l’hôpital Pellegrin de Bordeaux, il se contentait, autant que ses activités professionnelles le lui permettaient, de revenir le plus souvent possible dans la capitale bordelaise pour la retrouver. Lors de ses trop courts séjours, durant les week-ends, il logeait dans la maison familiale qui d’ailleurs était toujours son domicile officiel. Une petite villa que ses parents avaient fait construire dans le quartier de La Bastide, de l’autre côté de la Garonne. Son père étant décédé deux ans plus tôt d’un infarctus du myocarde, sa mère y vivait seule. Depuis qu’il se trouvait à Auch, la durée du trajet jusqu’à Bordeaux étant relativement courte, tous les vendredis soirs il prenait la route, et, pour la brave femme qui n’avait eu qu’un seul enfant, c’était chaque fois une fête, même si elle devait partager avec cette fameuse Josiane qu’elle ne connaissait pas encore. Naturellement, il n’en était pas toujours ainsi, quand il avait à diriger des travaux à l’autre bout du pays, il rentrait beaucoup moins souvent au bercail, notamment lorsqu’il avait été envoyé dans le Jura il n’avait pu faire qu’un seul voyage de retour, et encore à l’occasion d’un week-end prolongé. De par ses fonctions, l’entreprise lui avait attribué un véhicule que, en qualité de cadre de chantier, accord tacite de la direction, il pouvait utiliser, non seulement pour ses déplacements professionnels mais également personnels. Dans les localités à proximité des chantiers, il logeait quelquefois à l’hôtel, mais le plus souvent, s’il n’avait pas à chercher trop longtemps, il prenait en location une chambre meublée ou un studio. Dans la capitale du Gers, il avait été gâté, en banlieue il avait tout de suite déniché un deux-pièces cuisine, largement suffisant pour lui tout seul, à deux pas du local qu’il avait loué pour entreposer le matériel de l’entreprise, et où il avait installé un bureau temporaire.
Les travaux qu’il dirigeait étaient loin d’être terminés, mais en principe, sauf évènements imprévus, les délais accordés par le maître d’œvre seraient respectés, et Roland ne se faisait pas de souci. Sous ses ordres, il avait une trentaine d’ouvriers, des lignards, ainsi qu’on les nommait. Des durs à cuire qui ne craignaient ni Dieu, ni Diable, mais qui, malgré son jeune âge, lui obéissaient au doigt et à l’œil. Il les considérait tous comme de bons copains. Étrangement, alors que la plupart le tutoyaient, il les vouvoyait. En effet, la majorité d’entre eux l’avaient connu jeune débutant et avaient contribué à lui apprendre le métier, lorsque, tout frais émoulu du collège professionnel, durant plusieurs mois il avait fait des stages dans les différentes équipes. En leur compagnie, nullement habitué au dur labeur des chantiers, il en avait bavé, surtout au début, autant dans les bois à couper les arbres à la hache ou au passe-partout, qu’au fond des tranchées à manier la pelle et la pioche, ou bien sur les pylônes de plusieurs dizaines de mètres de haut pour assembler les pièces métalliques, souvent sous les sarcasmes et les moqueries, et par tous les temps, qu’il pleuve ou qu’il vente. Et puis il s’était aguerri, et au bout de quelques temps tous l’avaient considéré comme un des leurs. Alors même encore, parfois, il ne dédaignait pas de donner un coup de main lorsque le besoin s’en faisait sentir. En compensation, cette vie au grand air et ces travaux éprouvants, lui avaient forgé un corps d’athlète et un caractère opiniâtre et volontaire. En outre, autant que ses obligations professionnelles lui en laissaient le temps, il se livrait en amateur, et pour ses loisirs, à plusieurs sports tels que la course à pieds, le bodybuilding, ainsi que le karaté. Évidemment, il s’appliquait à avoir une vie saine allant de pair avec ces pratiques, se refusant absolument à fumer ou à boire, même si, adolescent, en compagnie des copains, il avait parfois grillé une cigarette, ou en bordelais qui se respecte, il savait apprécier un verre de bon vin. De taille moyenne, mais large d’épaules et donnant une impression de puissance, il en imposait. De plus, il était assez beau garçon et il plaisait aux dames. Blond avec les yeux bleus, comme sa mère, il avait hérité de son père, d’origine antillaise, d’un teint mat, assez foncé, qui étonnait parfois et qui faisait dire à ceux qui ne le connaissaient pas, principalement à la mauvaise saison.
- Vous arrivez des pays chauds sans doute ?
Ou bien :
- On voit que vous venez des sports d’hiver, rien de tel que la neige pour brunir.
Parfois, selon son état d’esprit et en fonction de la personne à qui il s’adressait, il répondait, volon-tairement provocateur :
- Non monsieur, vous vous trompez ! J’ai du sang nègre, tout simplement !
Ce qui était vrai. Ses ancêtres paternels, ainsi que des milliers d’autres pauvres bougres, avaient jadis été importés d’Afrique pour, comme du bétail, être vendus aux Amériques à des colons esclavagistes. Son grand-père était né à Saint Pierre, alors capitale de la Martinique. Lors de la fameuse éruption de la Montagne Pelée qui, en 1902, avait entièrement détruit la ville principale de ce bout de terre française au large des Amériques et avait fait trente mille victimes, la famille Brisset, dont les membres avaient été affranchis quelques cinquante ans plus tôt, y vivaient encore. Par miracle, le jour de la catastrophe, celui qui devait devenir le papy de Roland, se trouvait chez une de ses tantes dans un village voisin et il avait ainsi échappé à une mort certaine. Plus tard, après un parcours mouvementé sur lequel il était toujours resté muet, il s’était retrouvé facteur à Bordeaux où il avait connu une girondine, blonde comme les blés, lui qui était noir comme du cirage. Leur alliance avait donné quatre beaux enfants métis dont le père de Roland qui, quarteron, espérait bien pouvoir un jour faire un voyage aux Antilles pour rechercher d’éventuels cousins, mais l’occasion ne s’était pas encore présentée.
C’était la fin du mois de septembre, un jeudi encore ensoleillé. Depuis que, au cours de leurs jeux, les filles Martinet, en compagnie de leur amie Claudine, avaient eu en spectacle les organes génitaux de ce personnage dégoûtant qui n’avait pas craint de s’exhiber devant elles, quinze jours s’étaient écoulés et, dans la famille, on n’avait pas reparlé de cette histoire. Ce jour-là, Agnès était seule à la maison. Son père se trouvait à l’usine et sa mère faisait quelques achats au supermarché tout proche. Quant à sa sœur, qui était encore à l’école communale, elle ne rentrerait que vers cinq heures moins le quart, peut être même plus tard si elle traînaillait avec les copines, au risque d’encourir des remontrances de ses parents. Elle, déjà en quatrième au collège, n’avait eu cours pour l’après midi que de deux à trois. N’ayant nullement envie de travailler à la narration qu’elle devait remettre le lundi suivant, elle se sentait un peu de vague à l’âme, ainsi qu’en éprouvent souvent les adolescentes de son âge. Elle décida d’aller faire un tour dans le terrain en friche devant l’immeuble. Peut-être trouverait-elle encore des mûres dans les buissons. Petite brunette aux formes arrondies parfaitement proportionnées, elle promettait déjà de devenir un beau brin de fille.
Ce jour là, Roland s’était à nouveau rendu à Toulouse. En effet, une fois par mois, indépendamment des séances de travail exceptionnelles pour informations ou mises au point diverses, afin de leur faire signer une demande d’acompte sur la facture définitive des travaux exécutés, il rencontrait à la direction d’EDF le maître d’œuvre du chantier et son supérieur hiérarchique. À cette occasion, action commerciale oblige recommandée par son patron, il invitait ces messieurs à faire un bon repas. Lui-même, tout comme ses clients, qui ne se faisaient pas prier, il appréciait ces agapes. Au cours de la réunion du matin, il avait réussi à obtenir l’accord pour le versement d’une somme substantielle, c’est pourquoi, très satisfait, il n’avait pas hésité à les convier à déjeuner à une bonne table, dans un des plus grands restaurants de la ville. En reprenant la route d’Auch, après un gueuleton un peu trop arrosé, il avait éprouvé le besoin de faire une petite sieste et il s’était arrêté à l’endroit même où, deux semaines plus tôt, pour un besoin urgent il avait rangé sa voiture. Maintenant, affalé sur son siège, il ne pensait qu’à dormir. Très vite il partit dans les bras de Morphée.
Des mûres dans les buissons, il n’en restait pas beaucoup, alors, malgré les recommandations de son père, sans même y prendre garde, Agnès s’était éloignée de la résidence. Elle se trouvait maintenant au milieu du bosquet où les broussailles épaisses et enchevêtrées formaient une sorte de dédale compliqué, à mi-distance de l’immeuble et de la route. Son panier à la main, elle avançait avec difficultés en évitant du mieux qu’elle le pouvait de se piquer aux épines des ronces, quand soudain elle eut conscience d’une présence derrière elle. Elle se sentit brutalement attrapée par le cou. Elle voulut crier, mais une grosse main s’était appliquée sur sa bouche. Elle tenta de s’échapper, mais on la tenait fermement par les épaules. Puis on la renversait, on la jetait au sol sur la mousse, heureusement assez épaisse. Sur sa tête, on appliquait une étoffe épaisse qui l’aveuglait, qui la bâillonnait. Elle essaya de se débattre, de griffer, seulement l’homme - c’était un homme, à présent elle en était sûre - s’était couché sur elle et, maintenant ses bras, paralysait tous ses mouvements. Semblant y prendre énormément de plaisir, il fourrageait avec sa bouche sur son cou et, son col de chemisette s’étant déboutonné, sur le haut de sa poitrine dénudée. Elle sentit sa barbe, fournie, mais qui piquait, et puis son haleine forte et saccadée. En se démenant de toutes ses forces et en agitant les jambes, elle avait fait relever sa jupe et son agresseur en profitait pour s’installer entre ses cuisses nues. Elle comprit qu’il déchirait sa culotte, puis un objet dur la pénétra, provoquant immédiatement en elle une douleur vive. Elle s’évanouit.
Quelques minutes plus tard, quand elle revint à elle, l’homme n’était plus là. Ses vêtements étaient défaits, les boutons de sa chemisette avaient été arrachés, et, sur ses cuisses découvertes, elle avait du sang et un liquide gluant. Sa culotte avait disparu. Elle éclata en sanglots. Elle se sentait sale, sale. Péniblement, elle se leva et, en faisant attention de ne rencontrer personne, elle regagna en toute hâte la maison familiale.
- Agnès ! Tu es là ?
Ayant laissé sa fille à la maison, Madame Martinet se demandait où elle était passée. Après avoir ouvert la porte d’entrée, avant de l’appeler, elle avait pris le temps de poser son manteau et de ranger ses achats dans la cuisine. Elle entreprit de visiter l’appartement. Elle entendit couler la douche. Tiens ! se dit-elle, elle fait sa toilette ? À cette heure-ci ? Elle s’est pourtant déjà douchée ce matin ! Elle entra dans la salle d’eau.
- Mais !... Que t’arrive-t-il ma pauvre petite ?
Recroquevillée tout habillée dans le coin de la cabine, sous le jet à son maximum, Agnès, secouée de spasmes convulsifs, sanglotait. Sa mère, affolée, ne sachant quoi penser, voulut lui prendre le bras.
- Ne me touche pas ! s’écria-t-elle violemment en se repliant sur elle-même.
Madame Martinet, complètement bouleversée, craignant le pire, et ne sachant comment s’y prendre pour savoir ce qui était arrivé à sa fille, se résolut à lui parler le plus doucement possible. Finalement, avec d’infinies précautions, elle réussit à la convaincre de sortir de la cabine de douche et de poser ses vêtements trempés. Mais dés qu’elle fut nue, la pauvre gamine voulut à toute force revenir se laver. Auparavant, entre deux hoquets, pendant que sa mère la déshabillait, malgré sa réticence, elle avait tout de même consenti à lui expliquer ce qui s’était passé.
- … c’est l’homme de l’autre jour… j’en suis sûre, avait-elle affirmé, omettant de préciser qu’elle n’avait pu le voir.
- Il y a longtemps que c’est arrivé.
- … non… une demi-heure peut-être…
Laissant la petite sous la douche, madame Martinet téléphonait immédiatement au commissariat, ainsi qu’au médecin de famille et à son mari. Aussitôt averti, ce dernier sautait dans sa voiture et à peine dix minutes plus tard, il était chez lui. Presque au même instant, une sirène annonçait la venue d’un fourgon de la police. Ils étaient quatre, un inspecteur et trois agents en tenue. Ayant tout de suite compris ce qui s’était passé, accompagnés de monsieur Martinet, ils partaient aussitôt reconnaître l’emplacement où Agnès avait été agressée. L’homme n’était certainement plus là, néanmoins peut-être avait-il laissé des indices.
En se rendant sur place, l’inspecteur repérait immédiatement un véhicule en stationnement sur le bord de la route. Une personne était au volant. Alors, pendant que ses collègues entreprenaient de battre les buissons, il se précipitait pour l’interpeller. Mais il n’en eut pas la possibilité, car, lorsqu’il n’en fut plus qu’à quelques mètres, l’automobile, dont il avait déjà entendu tourner le moteur, démarrait sous ses yeux. Le policier avait tout de même le temps d’apercevoir un homme jeune, barbu, plutôt blond et très bronzé, qui regardant la route, ne l’avait apparemment pas remarqué et qui, prenant tout son temps, ne paraissait pas particulièrement pressé de quitter les lieux. L’inspecteur avait alors largement le temps de noter le numéro minéralogique de la voiture.
Quand, après des recherches infructueuses, les quatre hommes revinrent à l’appartement des Martinet, le docteur Solange Frachet, venue en toute hâte dés la réception du coup de téléphone, venait de terminer l’examen de la petite Agnès toujours sous le choc. Terriblement inquiète, sa mère demanda à la praticienne :
- Pensez-vous qu’il soit nécessaire de l’hospitaliser ?
- Non, sur le plan purement physique, je ne le pense pas, néanmoins elle a subi un sérieux traumatisme psychique, alors je crois tout de même qu’il serait bon de la présenter à un psychologue. Par ailleurs, la police va certainement vouloir que soient effectués des prélèvements pour la recherche d’ADN. Il faudra également faire un test pour le sida.
Le sida ! Cette grave maladie ! Pourvu qu’elle ne soit pas contaminée ! pensa madame Martinet. Par ailleurs, une question lui brûlait les lèvres. Mais la doctoresse avait deviné.
- Pour le risque de fécondation, ne vous inquiétez pas, je vais lui donner une pilule.
Finalement, pour l’amener à l’hôpital dans un service spécialisé, une ambulance vint rapidement prendre en charge la pauvre gamine.
Avant de regagner le commissariat, les policiers avaient longuement questionné les parents de la petite, ainsi que sa jeune sœur et leur camarade Claudine, rentrées depuis peu de l’école. Les renseignements obtenus leur avaient rapidement permis de tirer des conclusions sans ambiguïtés. Cela ne faisait aucun doute, le coupable du viol ne pouvait être que le conducteur de la voiture dont l’inspecteur avait relevé le numéro. Vraisemblablement, le même personnage qui, quelques jours auparavant, avait osé montrer son sexe à trois gamines. En principe, s’il était le propriétaire du véhicule il allait être facile de l’appréhender.
Dés son retour au commissariat, Georges Pallas, l’inspecteur qui avait constaté le viol de la petite Martinet, avait fait un rapport détaillé à son supérieur. D’emblée, ce dernier l’avait chargé de l’affaire.
- Vous me trouvez rapidement ce salopard et vous le mettez au frigo !
Identifier le propriétaire du break Citroën, avait été extrêmement simple. Un simple coup de fil à la préfecture de la Gironde avait suffit pour découvrir qu’il s’agissait d’une compagnie importante de travaux publics de Bordeaux, la CPTB. L’inspecteur avait sur le champ repris le téléphone pour appeler cette entreprise. Ses bureaux étaient encore ouverts et il était immédiatement mis en relation avec le chef du service du matériel.
- Oui, ce véhicule nous appartient, avait répondu ce dernier, il est affecté à un de nos conducteurs de travaux, monsieur Brisset.
- Où peut-on trouver ce monsieur ?
- Je crois qu’il est sur un chantier à Auch, mais pouvez-vous me dire en quoi nous sommes intéressés ? S’agit-il d’un accident ?
- Non, c’est personnel, nous voudrions le voir, peut-on avoir son adresse exacte ?
- Attendez un instant, je me renseigne.
Deux ou trois minutes plus tard, le policier savait où trouver le conducteur du break Citroën et il connaissait son nom.
Il était vingt heures trente, Roland venait de terminer son repas. Généralement il dînait au plateau, devant la télévision. Ce soir-là, après son gueuleton de midi avec les gens d’EDF, il n’était pas affamé, et il s’était contenté de quelques amuses gueules et d’un morceau de fromage. Installé dans son fauteuil, il regardait la fin des informations quand il entendit frapper à la porte. Il alla ouvrir.
- Monsieur Roland Brisset ?
- Oui.
- Police !
Trois hommes se trouvaient devant lui, dont deux en tenue d’agent de la force publique. Celui qui l’avait interpellé présenta sa carte, puis lui demanda :
- Monsieur Brisset, vous êtes bien conducteur de travaux ?
- Oui, répondit-il.
- Vous conduisez un break Citroën immatriculé 4750 AC 33 appartenant à votre entreprise ?
- Oui, pourquoi ?
- Etiez-vous à Toulouse aujourd’hui, et avez-vous stationné à la sortie de la ville entre quinze heures trente et seize heures ?
- Oui, effectivement, mais sur une aire dégageant largement la chaussée.
- Vous avez l’habitude de vous arrêtez à cet endroit ?
- En effet, autant que je me souvienne, ce n’est pas la première fois.
- Monsieur Brisset, vous allez nous suivre.
- Vous suivre ? Pour quoi faire ?
- On vous expliquera tout ça au commissariat à Toulouse.
À Toulouse ? Qu’est-ce que vous voulez que j’aille faire à Toulouse ? Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Et puis Toulouse, c’est pas la porte à côté ! Demain je bosse moi ! Que me voulez vous ?
- Vous le saurez bientôt.
- Laissez-moi au moins le temps d’éteindre la télé, de prendre un manteau. Heureusement encore que je viens de finir de souper !
S’interrogeant sur ce que l’on pouvait bien lui vouloir, Roland tournait l’affaire en dérision, mais en réalité, il était inquiet. Il le fut encore plus, lorsque, avant qu’il ne quitte son domicile, on lui passa les menottes et on lui précisa.
- Monsieur Roland Brisset, vous êtes en état d’arrestation !
- En état d’arrestation ? Non, mais ! Ça va pas ? Qu’est-ce que j’ai fait ? C’est pas possible ! Vous vous trompez certainement !
- On verra ça !
Sans ménagement, l’inspecteur Pallas et ses collègues embarquaient Roland dans leur voiture et prenaient la direction de Toulouse. Au passage, respectant les règles, ils avisaient leurs collègues d’Auch de l’interpellation qu’ils venaient d’effectuer sur leur circonscription. Durant tout le voyage, ce fut le silence complet, autant de la part des policiers que de Roland totalement abasourdi par ce qui lui arrivait. Rendus au commissariat principal de la « Ville Rose », il était immédiatement transféré dans une cellule. On lui avait tout de même enlevé les bracelets aux poignets, mais également sa montre, sa ceinture et ses lacets de chaussures.
À présent, se morfondant dans l’espace réduit de la geôle où, en compagnie de deux prostituées et d’un mendiant complètement ivre il était enfermé, ayant recouvré ses esprits il se posait des questions avec anxiété. En prison ! Lui ! Mais pourquoi ? Que pouvait-on bien avoir à lui reprocher ? Terriblement inquiet, essayant de comprendre, il rechercha dans sa mémoire les situations ou les mésaventures auxquelles de près ou de loin il aurait été mêlé, mais il ne trouva rien. Finalement, à force de se torturer l’esprit, il en déduisit qu’il était là par erreur. Tout allait s’arranger. On allait le ramener chez lui, et cette histoire ne serait qu’un mauvais souvenir. Enfin, au bout d’un petit quart d’heure qui lui parut durer une éternité, on vint le chercher pour lui faire subir un premier interrogatoire. Épreuve qui allait être le début d’un horrible cauchemar.
Pour commencer, il dut débiter son nom, son âge, sa profession, où il habitait, enfin son curriculum vitae complet, puis, le policier qui posait les questions, celui qui l’avait arrêté, devint beaucoup plus direct, presque agressif.
- Vous vous arrêtez souvent pour stationner, à la sortie des villes ?
- Souvent, non, mais parfois.
- Vous choisissez généralement des endroits retirés, non loin tout de même des habitations ou des résidences, n’est-ce pas ?
- Pas vraiment non.
- Pourtant aujourd’hui, vous étiez juste en face de la résidence des Muguets, à la sortie de Toulouse ?
- Peut-être, si vous le dites.