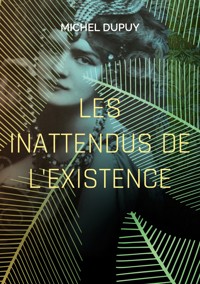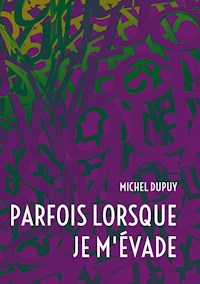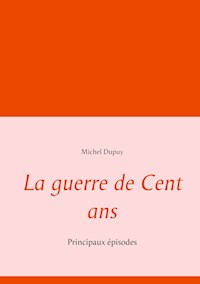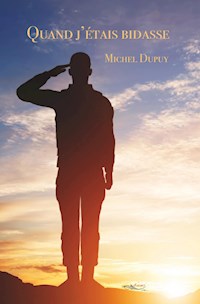Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Tout ce que j'ai vécu lors de mes séjours outre-mer, aux Antilles et en Guyane, et de mes voyages dans les îles de l'océan Indien, Madagascar, La Réunion, Mayotte, la Polynésie ; une expédition dans la jungle amazonienne, un cyclone, la plongée sous-marine, ma découverte de Madagascar, Cilaos à La Réunion, les animaux, mes rencontres.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Des années et des années ! Des décennies ! Presque le siècle ! Déjà ! C’est court une vie ! Je n’ai même pas vu le temps passer ! Mais, comme disait Jacques Brel : vieillir la belle affaire ! L’important c’est d’avoir toujours bon pied, bon œil ! Souvent je me retourne et je regarde derrière moi. Tellement de souvenirs sont emmagasinés dans ma mémoire ! Il en est de fugaces, les plus anciens, parfois que des flashes, et puis il en est d’autres, des clichés plus précis, inaltérables, qui imprègnent mon être tout entier, des imprévues, des rencontres, des aventures diverses qui sont peut-être moins banales et d’ailleurs beaucoup plus que des images. Des épisodes inoubliables de mon existence !
Réminiscences du passé ! Le plus ancien ! Mon enfance ! La maternelle ! La pâte à modeler ! Son odeur ! La chanson « Mon beau sapin » que la maîtresse nous avait apprise pour Noël ! Le matin, ma mère m’emmenait à l’école. A onze heures et demi, elle m’attendait à la sortie. A quatre heures et demi, c’était mon père qui venait me chercher. Il était boulanger, donc travaillant de nuit l’après-midi il était libre. J’étais heureux de le voir. Mais ça n’a pas duré, il y a eu la déclaration de guerre avec l’Allemagne. Il a dû partir pour le front et, quelques mois plus tard, il a été fait prisonnier et emmené de l’autre côté du Rhin, en Westphalie. Il nous écrivait souvent, et il y avait toujours un petit mot pour moi que ma mère me lisait. Elle était couturière, elle travaillait à façon pour une usine qui fabriquait des vêtements, des vestons surtout. À moitié terminés, on les lui livrait à domicile et, une fois finis, elle les rapportait à la fabrique. Et puis elle est tombée malade ! Les poumons ! A la maison, ce fut la misère. Pour souper le soir, je n’avais souvent qu’un quignon de pain avec une pomme. Pour Noël, je devais me contenter de quelques mandarines et d’un livre acheté d’occasion au bouquiniste du coin. L’hiver, pour se chauffer, il y avait un fourneau à charbon dans la pièce principale, la cuisine, qui servait aussi à faire cuire les repas. Le matin, on buvait de l’ersatz de café. Ma mère le préparait avec des grains de blé ou d’orge que nous allions glaner dans les champs en dehors de la ville et qu’elle faisait griller dans la poêle. Et puis j’ai quitté la maternelle pour aller à l’école communale. Le matin, avant de rentrer en classe, on hissait le drapeau tricolore à un mat qui était dans la cour et on chantait « La Marseillaise » et « Maréchal nous voila ». A dix heures, au cours de la récréation, on avait droit à un bol de soupe. Il fallait emporter un récipient, en métal, qui ne risque pas de se casser, le plastique n’existait pas encore. Préparée par une dame avec toutes sortes de légumes et d’énormes os, sans doute donnés par le boucher ou récupérés aux abattoirs, elle cuisait dans une grande toupine, sous le préau. J’aimais pas trop, mais il fallait quand même l’avaler. C’est alors que les Allemands ont envahi la zone libre, notre département. Il a fallu s’habituer à leur présence, à les voir défiler en chantant « haïli haïlo » ou à se baguenauder dans les rues du quartier et tentaient de lutiner les jeunes filles. Et puis les rafles des juifs par la Gestapo ! Le couvrefeu ! La nuit, ne laisser filtrer aucune lumière par les ouvertures, sous peine de rafales de mitraillettes dans les volets ! Les opérations menées par les résistants ! Radio Londres que ma mère écoutait le soir en cachette ! Pour les grandes vacances, quelquefois en compagnie de mes cousines, j’allais à la campagne, chez ma grand-mère. C’était une petite maison en pleine brousse, non loin de Fleurac, à mi-chemin de Rouffignac et de Plazac, en plein Périgord noir. Lieu-dit « Les Pleiniers » ! Il n’y avait ni l’eau courante, ni l’électricité, ni bien sûr le téléphone. On s’éclairait à la bougie. Comme les poules, on se couchait de bonne heure et on se levait dès les premiers rayons de soleil. On buvait l’eau des sources. Il y en avait plusieurs qui se trouvaient à quelques centaines de mètres de la maison. Le matin, nous allions chercher le précieux liquide dans des brocs. Le lait aussi, dans un petit bidon, à la ferme voisine. Pour nos ablutions, il y avait une citerne. Nos besoins, on les faisait dans la nature. Pour le quotidien, deux fois par semaine, on allait au village le plus proche, Fleurac, quatre kilomètres aller et retour. Il y avait une épicerie où on pouvait acheter n’importe quoi, même des vêtements, des outils et de superbes canifs avec le manche en corne. Quelquefois, pour rendre visite à des parents nous allions jusqu’à Rouffignac, à pieds. Ou bien, quand il faisait très chaud, à Plazac pour nous baigner dans le Vimont, le ruisseau qui court dans la vallée. Mais l’eau était très froide.
Et puis nous avons appris la fin de la guerre. Auparavant, il y avait eu la libération de Périgueux ! Un évènement ! Jamais je n’avais vu autant de monde dans les rues de mon quartier. Autant de gens qui chantaient, qui faisaient la fête. Bientôt, on a su que les envahisseurs avaient été boutés hors de France ! Mais on a vu aussi les règlements de compte plus ou moins justifiés, les femmes tondues ! Trois mois plus tôt, j’avais accompagné mon aïeule à Rouffignac, chez son frère et sa belle-sœur, l’oncle Victorien et la tante Sylvia. Après que nous ayons descendu de l’autobus, elle m’avait pris la main et elle l’avait serrée fort. Consterné, je n’avais pas reconnu le village ! Une cohorte d’allemands criminels était passée par là ! Des habitations, il ne restait que des pans de murs calcinés ! Tout avait brûlé !
Un peu plus tard, il y a eu le retour de mon père. Cinq ans qu’il était parti ! C’était le soir. Il s’est encadré dans la porte. En dépit des photos que nous avions de lui je ne l’ai pas vraiment reconnu. En bandoulière il avait deux musettes, à la main droite, il tenait une valise et à la main gauche l’étui d’un instrument. C’était un violon. Il voulait que je devienne musicien. Plus tard j’ai pris deux ou trois leçons, mais c’était trop cher, son salaire ne le permettait pas. Après son retour, lui et moi avons mis quelques jours pour nous familiariser, et puis très vite, j’ai voulu le suivre partout.
Durant les vacances, et puis les dimanches et les jeudis, je faisais les quatre cents coups avec les copains ! Les courses en patin à roulettes dans les principales rues du quartier ! Où bon nous semblait, mais évidemment dans celles qui étaient bitumées ! Les autres étaient simplement cailloutées. Les véhicules automobiles étaient encore rares et il n’y avait aucun danger ! Et puis, à la belle saison, les baignades à la rivière !
Mon adolescence ! J’ai quitté la communale pour le lycée. J’avais plein de camarades. Tout près de chez moi, est venu habiter Christian. Il avait mon âge. Nous sommes devenus inséparables, presque deux frères. Plus tard quand nous eûmes seize, dix-sept ans, le dimanche après-midi nous allions au cinéma. Avant de rentrer à la maison, après le film, si nous avions quelques sous, on se payait l’apéritif, du Cap Corse ou du Cinzano. Quelques années plus tard, nos routes se sont séparées. Il s’est engagé dans l’armée. Ça s’est terminé pour lui en Algérie, dans le djebel. Une balle en plein front.
Les filles ! La première que j’ai prise dans mes bras, j’avais quinze ans, elle en avait vingt, déjà une femme. Nous étions à la campagne chez des amis communs. Des fermiers ! On se retrouvait dans le foin. Elle m’avait appris à embrasser, à pleines bouches ! De longues fricassées de museaux. Mais je n’osais pas aller plus loin. Y pensais-je seulement ? Ça n’a pas duré bien longtemps. A peine un mois. Elle est partie vers d’autres cieux et je ne l’ai jamais revue. Avec Christian, nous avions aussi quelques amourettes. Des copines.
Par la suite, après des études plus ou moins bâclées dans un lycée technique, il a bien fallu que j’intègre le monde du travail. J’allais avoir dix huit ans, lorsque, c’était à la fin de l’été, un soir de septembre, mon paternel est revenu à la maison avec une adresse.
- Michel, je t’ai trouvé du boulot, m’a-t-il dit, une grosse entreprise qui cherche un jeune dessinateur, il faut que tu fasses une demande écrite.
Des travaux importants qui démarraient, à cinquante kilomètres de Périgueux ! De mon clocher ! Cinquante bornes ! Quasiment le bout du monde ! L’obligation de quitter le cocon familial ! De vivre avec des gens que je ne connaissais pas ! D’être tenu d’obéir à un chef ! Enfin l’obligation de m’adapter à une existence tout à fait nouvelle ! Sans oublier les besognes que j’allais avoir à exécuter. Allais-je en être capable ? Sans enthousiasme, j’ai rédigé une demande d’embauche et, quinze jours plus tard, je me suis retrouvé apprenti topographe à Chavagnac, un petit village en limite de la Corrèze. J’ai dû réviser mes connaissances en trigonométrie. Le théorème de Pythagore, celui de Thalès. Nous étudions le tracé d’une ligne électrique à très haute tension. Une 150000 volts ! Au début, si j’avais l’occasion de dessiner quelques croquis, le plus souvent, en pleine campagne, je coupais des broussailles ou des arbustes pour faciliter les visées, je tenais la mire et je plantais des jalons et des piquets de repérage. Et même, en compagnie de vrais bûcherons, il m’arrivait parfois, dans les massifs boisés, de participer à l’abattage d’arbres gênants. L’opportunité pour moi de me tremper dans le milieu viril des hommes de peine et, plus simplement, d’apprendre à me servir d’une hache et d’un passe-partout. Cependant, j’ai tout de même appris les rudiments du métier, et, au bout d’un an et demi, sans être un géomètre accompli, sur le terrain j’ai su me servir des appareils de visée, du goniomètre, du tachéomètre et, au bureau, étudier un plan, dessiner une planimétrie, un profil en long. Ensuite, la construction de la ligne a commencé. Le responsable du chantier, c’était le père Demarthon, un brave type. Il m’a fait faire des stages dans les différentes équipes. C’est ainsi que j’ai appris les rudiments du métier, le réglage et le bétonnage des embases de pylônes, le montage de ces derniers, le déroulage et la mise en place des câbles. On travaillait dur, mais heureux d’apprendre, j’y prenais du plaisir. Je prenais pension dans une auberge de campagne où j’étais comme un coq en pâte. Le samedi, je prenais le train pour revenir à la maison familiale. Ma mère m’avait préparé un de mes plats favoris. Le lundi matin, c’était tout de même toujours très difficile pour repartir.
Et puis, il y a eu le service militaire ! J’avais voulu devancer l’appel ! Une erreur ! Par contrat, je m’étais engagé à faire six mois de plus que prévus au temps légal. Dans le train des équipages ! Les tringlots ! Dans un camp situé non loin de Blanquefort, en Gironde ! Qu’ai-je appris ? Bien sûr des futilités, le lit au carré, le maniement d’arme, marcher au pas pour la parade, mais pas seulement, beaucoup plus utile, la conduite automobile et, de retour dans le civil, j’ai pu faire changer mon permis militaire ! Et puis, moi qui ne savait même pas comment faire cuire un œuf, j’ai été nommé sous-off d’ordinaire. Patron des cuisines ! Quatre cents bonshommes à nourrir ! L’occasion de savoir établir et équilibrer un menu, choisir les meilleurs produits alimentaires, les quantités à prévoir par tête de pipe, les temps de cuisson. Finalement, même si durant ces vingt- quatre mois mon seul objectif, presque ma raison d’être, avait été d’obtenir des permissions pour retrouver l’ombre de mon clocher, et surtout celle qui bientôt allait devenir ma femme, je ne fus pas à plaindre. Après ma libération, appellation officielle tout autant que judicieuse, j’ai été repris par l’entreprise qui m’employait auparavant. De toute façon, de par la loi, elle y était obligée si j’en faisais la demande. J’ai alors été envoyé dans le sud de la France, à Béziers, non loin de la Méditerranée, sur un chantier de construction d’une ligne 90000 volts. Je faisais partie de l’équipe, mais j’avais la qualité d’assistant administratif et technique du chef des travaux, Pierre Dal Zotto, un type remarquable, un italien, un peu gueulard, qui savait se faire obéir et qui, connaissant sur le bout des doigts les travaux sur le terrain, savait parfaitement les organiser, mais qui était uniquement un manuel et n’entendait rien aux paperasses. J’avais été très bien accueilli par les gars de son équipe, cosmopolite, une quinzaine de bonhommes, en majorité des italiens, la plupart du nord de la botte, des Abruzzes, notamment deux frères, Fiorello et Marcello Somacal, on les appelait les Somacaux, et puis Antonio, et Aldo le neveu de Pierre, mais il y avait également deux basques, un français, le Basquo, et un espagnol, le Basquito, et puis un catalan, et d’autres encore. Tout de suite, j’ai sympathisé avec les plus jeunes, guère plus âgés que moi, de quelques années seulement, avec Tony, un calabrais, avec Aldo, et puis Mamy, de son vrai nom Mohammed, un algérien. Je n’étais pas surchargé par les besognes qui m’incombaient en priorité, alors je participais aux travaux.
Le chef d’agence, dont les bureaux étaient à Béziers, venait parfois pour vérifier l’avancement et la bonne marche des travaux. Sans doute ai-je bénéficié de bons renseignements auprès de la direction puisque, au début de l’automne 1955, j’ai été nommé chef de chantier et on m’a confié la direction des travaux de construction d’une ligne 90000 volts, en Lozère. Quatre mois plus tard, j’ai pris pour épouse, Josette, que je fréquentais depuis trois ans. Pour notre lune de miel nous avons dû soigneusement nous calfeutrer car, le 6 février 1956, un froid sibérien s’est abattu sur la France. A Chanac, le petit village où nous habitions, à quelques vingt kilomètres de Mende, nous avons enregistré -32° centigrade, et, durant deux semaines, le thermomètre n’est jamais monté au-dessus de -25. Tout était gelé. Non loin de l’appartement que nous avions loué, il y avait tout de même une fontaine qui débitait encore de l’eau. Anecdote amusant, le boucher du village, allumait du feu dans sa chambre froide pour réchauffer sa viande pour pouvoir la débiter.
Par la suite, j’ai pris du galon, j’ai été nommé conducteur de travaux adjoint, et, sur plusieurs chantiers, dans l’Indre, en Ariège, je suis devenu le second de Demarthon, avec qui j’avais débuté. La dernière fois que je fus sous ses ordres, ce fut à Bordeaux. Une 220000 volts qui reliait Floirac à Ambés. Un mois après le début des travaux, il est tombé malade et j’ai dû le remplacer. Pour corser l’affaire, la direction d’EDF, maître d’œuvre, a voulu pouvoir mettre la ligne en service six mois plus tôt que prévu. Il a fallu embaucher du monde et je me suis retrouvé à la tête d’une centaine de bonshommes. Parmi les nouveaux, il y avait des personnages étonnants, de tous acabits, de toutes nationalités, portugais, espagnols, d’Afrique du Nord. Un gars que l’on voyait dans les foires, un bateleur qui interpellait la foule : « avec qui voulez-vous lutter ? ». Sans doute en avait-il assez de se bigorner avec le premier venu. Un autre qui m’a avoué sortir de prison mais qui s’est révélé travailleur et de bon commandement. Ce type qui s’était présenté pour un emploi de chauffeur de camion. En remplissant sa fiche d’embauche, j’avais été étonné par son nom et son lieu de naissance. Il s’appelait Popesco et, pourtant de nationalité roumaine, il était né à Puntarenas, dans le sud du Chili, au-delà de la Terre de Feu, où ses parents avaient émigré. Il était le frère d’Elvire Popesco, la célèbre comédienne que l’on avait pu voir au théâtre et qui avait tourné de nombreux films. Il était son chauffeur, mais après une dispute, il l’avait quittée. Et puis plusieurs algériens. Notamment deux qui faisaient équipe. Ils étaient bons ouvriers, ne rechignaient pas à la plus dure besogne et ils étaient toujours à l’heure. Ils avaient travaillé sans histoire durant deux mois, et puis un jour, puis deux, ils furent absents. J’étais étonné de ne plus les voir, quand le troisième jour, après avoir acheté mon quotidien, je vis leur photo en première page, appartenant au FLN, le Front de Libération Nationale de l’Algérie, l’un était un tueur attitré, l’autre un chef de wilaya. Ils avaient été arrêtés.
Après ce chantier que j’ai eu à diriger seul, je suis devenu conducteur de travaux en titre et j’ai eu l’entière responsabilité d’autres ouvrages. Dans tout l’hexagone. En Bretagne ! Dans les Pyrénées ! Dans le Massif Central ! Dans l’Est ! A Lille ! Mon épouse, à qui je faisais mener une vie de patachon, m’accompagnait dans tous mes déplacements. En fonction de l’importance des ouvrages, le service du matériel de l’entreprise me fournissait l’équipement nécessaire, outillage, véhicules, engins de levage, pelleteuses. Généralement, une trentaine de gars faisant partie du personnel de la maison m’accompagnaient. Des types sérieux, sur lesquels je pouvais compter. Sur place, je recrutais de la main d’œuvre supplémentaire et même parfois j’étais obligé d’embaucher des spécialistes. Dans le monde des lignards, on trouvait alors des sortes d’aventuriers, des têtes brûlées qui ne craignaient ni Dieu ni Diable, et qui allaient de chantier en chantier pour effectuer les besognes les plus difficiles et les plus dangereuses, et bien entendu les mieux payées. Dans la mesure où on respectait leurs compétences, ils n’étaient pas difficiles à commander. Sinon, ils allaient voir ailleurs. Mamy était un peu de ceux-là. Je l’ai retrouvé plusieurs fois. Il reprenait du service en fonction de ses besoins, non pas financiers, mais, appartenant plus ou moins au milieu des truands bordelais, pour se mettre au vert. Il avait une très belle femme qui généralement l’accompagnait dans ses déplacements mais que l’on pouvait voir, lorsque son homme était au repos, arpenter le trottoir dans la rue Sainte-Catherine. Une nuit, il y a eu une fusillade sur les quais de Bacalan. On a retrouvé une DS avec deux cadavres à l’intérieur. Plus tard, Mamy m’a confié qu’il conduisait le véhicule. Il avait eu la chance de s’en tirer.
Ma vie était donc alors entièrement consacrée aux travaux de construction des lignes à très haute tension. Dans ce domaine, dans tout le pays, avec les besoins en électricité de plus en plus importants, il y avait beaucoup à faire et les entreprises ne manquaient pas d’ouvrage. A peine un chantier était terminé qu’il fallait en attaquer un autre. Nous travaillions tous les jours de la semaine, même quelquefois le dimanche. On ne parlait pas de quarante heures hebdomadaires, c’était plutôt cinquante, voire soixante. A la belle saison, il n’était pas question de prendre des vacances, il fallait attendre l’hiver. Une dizaine de jours pour Noël et le premier de l’an ou bien, si le climat était trop rigoureux, on avait droit à l’arrêt de travail pour intempéries, mais parfois, dans certains cas, il fallait travailler tout de même, par grands froids ou sous la pluie.
Et puis, il y a eu les Antilles ! La Guyane !
Je me trouvais alors à Lille, dans le Nord. Je venais de diriger successivement plusieurs chantiers, à Haubourdin, à Maubeuge, à Dunkerque. J’attendais les ordres pour en ouvrir un autre. C’est alors que j’avais été convoqué à Paris au siège de l’entreprise. Monsieur Desport, le responsable des agences d’Outremer, adjoint de monsieur Ducreux, le directeur général des travaux, désirait me rencontrer. Je m’étais interrogé. Que pouvait-on me vouloir ? Au jour et à l’heure fixés, je m’étais présenté. Après avoir été annoncé par sa secrétaire, monsieur Desport m’avait reçu dans son bureau, m’avait serré la main et montré un des fauteuils réservés aux visiteurs, m’invitant à m’asseoir. Puis, sans préambule, il m’avait demandé :
- Nous avons un poste à vous proposer dans notre agence des Antilles, en Martinique. Êtes-vous intéressé ?
Interloqué, j’étais resté bouche bée.
- Vous paraissez étonné ?
- On le serait à moins. La Martinique ! Il faut partir quand ?
- Le plus tôt possible.
Huit jours plus tard, je prenais l’avion, seul. J’avais laissé ma famille en France. Entre temps, ma femme m’avait donné deux filles, Pascale née lorsque nous étions à Bordeaux et Christine qui avait vu le jour à Lille. Il était prévu qu’elles ne me rejoindraient que plus tard.
Parfois je revois mon départ pour les Antilles, mon arrivée en Martinique, mes premières impressions. C’était en février 1960, d’un hiver froid et pluvieux en métropole.
C’est à la nuit tombée, à Orly, que, en compagnie de presque deux cents voyageurs, j’avais embarqué dans un Bœing 707, un avion aux dimensions démesurées que, jusque-là, je n’avais vu que dans les magazines, au cinéma ou à la télévision. Déjà les moteurs ronronnaient. Lorsque tout le monde a été installé, que les portières ont été fermées, au micro, le commandant de bord s’est présenté et a souhaité un bon voyage à tous. Quelques secondes plus tard, une sorte de frémissement, des vibrations, se sont manifestés dans tout l’appareil. Après s’être ébranlé, il est allé prendre sa place en bout de piste. Durant quelques instants, il s’est s’immobilisé, puis, les turboréacteurs se sont emballés en un bruit assourdissant et il s’est mis à rouler, de plus en plus vite. J’ai guetté l’instant où il allait quitter le sol. Éprouvant à la fois une grande fierté et un petit serrement de cœur - c’était mon baptême de l’air -, j’ai deviné le décollage lorsque, collé au dossier de mon siège, mon corps s’est fait plus pesant. Penché en avant, s’accrochant aux sièges pour garder son équilibre et peinant comme s’il montait une côte abrupte, un steward se rendant à l’avant, m’a donné conscience de l’angle d’ascendance de l’avion. C’est seulement au bout de quelques minutes que, petit à petit, tel un pursang qui aurait pris le mors aux dents et qui, après avoir été maîtrisé se serait assagi, l’appareil a repris une position horizontale. Comme si j’avais été rassuré alors que je n’étais pas inquiet, j’ai été envahi par une sorte de bien-être. Ayant eu la chance d’obtenir un fauteuil près d’un hublot, j’ai essayé de reconnaître, scintillantes de mille feux, les villes en lumières que nous survolions, mais sans y parvenir. Puis, un peu plus tard, diffusée par les haut-parleurs, la voix au timbre voilé d’une des hôtesses s’est fait entendre :
-… nous venons d’atteindre l’altitude de dix mille mètres et notre vitesse est de neuf cents kilomètres à l’heure…
Comment ne pas ressentir une certaine émotion, presque une jouissance de se savoir si haut dans les cieux ? D’éprouver cette sensation de dominer le monde ?
Durant la plus grande partie du voyage, neuf heures de vol avec une seule escale, à Madrid, je n’ai fait que quelques sommes légers, entrecoupés au hublot par de longues et vaines quêtes sur le ciel étoilé. Deux ou trois heures seulement avant l’arrivée, accablé de fatigue, je suis tombé dans un profond sommeil, interrompu par le service du petit déjeuner au cours duquel, hébété, stupide, avant de me retrouver à nouveau dans les bras de Morphée, j’ai avalé machinalement le verre de jus d’orange, la tasse de café au lait et le croissant que le steward m’avait présentés sur un plateau.
- Monsieur ! … Monsieur ! …
J’avais sursauté ! Une main vigoureuse me secouait l’épaule.
- … Excusez-moi ! On va bientôt atterrir ! Nous avons déjà amorcé la descente.
Le steward ! Sans ménagement il venait de me tirer de ma léthargie ! Péniblement je reprenais mes esprits, m’ébrouais discrètement, et, malgré le peu d’espace qui m’était attribué, réussissais à étirer mes membres ankylosés. J’aurais voulu pouvoir me lever, marcher un peu, mais pour cela j’aurais dû déranger mes deux voisins, et puis il était trop tard, maintenant en face de moi, le voyant lumineux venait d’afficher : « Attachez vos ceintures ».
Maintenant, ayant recouvré toute ma lucidité, je tentais de voir, à l’extérieur, autre chose que le vide de l’espace, mais je ne découvrais, à quelques mètres en dessous de nous me sembla-t-il, qu’une mer de nuages immaculés. Impassibles, comme des vagues tourmentées qu’un coup de baguette magique aurait immobilisées, ils paraissaient figés pour l’éternité. Sans doute étaient-ils animés, mais je ne savais pas le voir. Une clarté subite m’éblouit ! S’exposant par le travers aux rayons ardents du soleil que nulle brume ne troublait, l’avion venait d’effectuer un large virage. Tout en vérifiant la fixation des ceintures des passagers, le personnel de bord, décidément plein de sollicitude, entreprit une distribution de bonbons.
- Pour déglutir plus facilement, à cause de la différence de pression atmosphérique, signala mon voisin.
Puis les micros diffusèrent la voix aux douces intonations de l’hôtesse préposée aux annonces :
- Nous allons bientôt atterrir sur la piste de l’aérodrome du Lamentin… avant de dégrafer vos ceintures de sécurité, nous vous demandons d’attendre l’arrêt complet de l’appareil… la température extérieure au sol est de trente degrés centigrade et le pourcentage d’humidité de quatre vingt pour cent…
Trente degrés ! La canicule ! Après Paris, froid et embrumé en cet hiver morose ! Plusieurs voyageurs manifestèrent leur contentement. Je constatai que les hôtesses de l’air et les stewards, avaient revêtu des tenues plus légères et que certains passagers, avertis, se défaisaient de leurs vêtements trop lourds.
L’hôtesse reprit :
- Le commandant de bord et tout son équipage vous souhaitent un bon séjour en Martinique.
Perdant de l’altitude, l’avion traversa la nappe de nuages. C’est alors que, le nez obstinément collé au hublot, je découvrais, non pas la Martinique, mais l’océan, une nappe d’un bleu indigo très sombre, sur laquelle, juste en dessous, un trait blanchâtre, qui allait s’élargissant avant de s’effacer, poursuivait un point noir, je reconnus un navire et son sillage.
La terre ! Je l’apercevais à présent ! Elle approchait. Très vite, nous la survolâmes. Grâce aux vagues qui l’assaillaient et qui dessinaient une bande sinueuse blanche immaculée, on pouvait imaginer le relief tourmenté du littoral. Au loin, mal définies, on distinguait des montagnes escarpées.
Après avoir sillonné l’hexagone de long en large, au cours de mes déplacements professionnels, c’était la première fois qu’il m’était donné l’opportunité de découvrir des horizons vraiment différents, de connaître une de ces terres lointaines qui m’avaient toujours fait rêver. À maintes reprises, j’avais eu l’occasion de rencontrer certains de mes collègues qui, revenant du bout du monde avaient, par leurs récits, entretenu dans mon imagination des désirs d’évasion. En outre, avec ma femme, nous venions de vivre quasiment une année entière dans les brumes du Nord, et, durant ces longs mois, chaque matin nous ne retrouvions que la grisaille, sans espoir de voir le moindre rayon de soleil au cours de la journée, tout en respirant les vapeurs nauséabondes, les poussières de charbon du bassin houiller encore en pleine activité. Pour des natifs du Sud-Ouest, habitués à la verdure, à un climat relativement généreux, comment ne pas souhaiter ardemment des cieux plus cléments ?
Après mon entrevue avec monsieur Desport, pour Josette et moi, qui n’étions pas vraiment savant en géographie, notre souci avait été de savoir où était exactement située l’île de La Martinique. Nous avions consulté un atlas et nous avions dû chercher longtemps avant de découvrir, là, tout près du continent américain, ce point minuscule dans l’archipel des Antilles. C’est alors que j’avais commencé à ressentir cette fièvre des grands voyages qui va crescendo au fur et à mesure que l’on approche du jour J. La visite médicale obligatoire, au cours de laquelle on m’avait reconnu apte à vivre dans un pays tropical, avait accru cette exaltation fébrile. Bien entendu je m’étais mis en quête du maximum d’informations, accordant une grande importance à la moindre documentation, au plus anodin des renseignements, voulant tout savoir, tout connaître sur le pays où je devais me rendre, son climat, ses habitants, sa faune, sa flore, son histoire.
Et puis le grand jour était arrivé. À l’aéroport, j’avais découvert dans un milieu cosmopolite, une ambiance frénétique un peu fausse, artificielle, mais à laquelle je n’avais pu échapper, réussissant néanmoins, en dépit de ma fébrilité, à afficher un visage tranquille et serein. Curieusement au moment de l’embarquement, après avoir occupé la place qui m’avait été préalablement assignée, j’avais su retrouver tout mon calme, comme un voyageur chevronné.
L’appareil perdait rapidement de l’altitude. Maintenant, je distinguais plus précisément les détails au sol, la végétation dense d’un vert foncé et chaud d’où, par endroits, émergeaient les formes cubiques de bâtiments plus ou moins bien alignés, sans doute des village, et, par-ci, par-là, quelques tâches jaunes ou rouges, certainement des arbres en fleurs. Et puis j’entraperçus la ville. Mais la terre se rapprochait de plus en plus vite. J’eus le temps de reconnaître des cocotiers, leurs troncs élancés tendant au ciel les faisceaux épais de leurs longues feuilles. Un choc léger ! Quelques vibrations ! Le Bœing venait de se poser. Il se déplaçait maintenant à vive allure sur le sol bétonné de l’aire d’atterrissage. Et puis, comme la veille au décollage, tel un cheval furieux qui aurait été mis en confiance et apaisé, il perdait progressivement de la vitesse pour finalement s’immobiliser. Au bout de quelques instants, les passagers furent invités à quitter leurs sièges et à se préparer pour l’évacuation de l’avion.