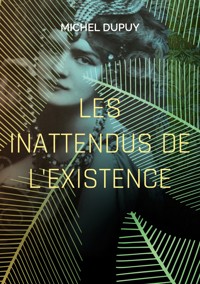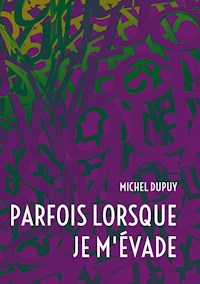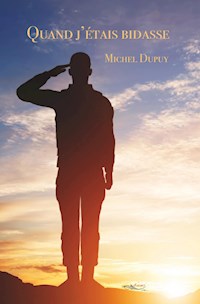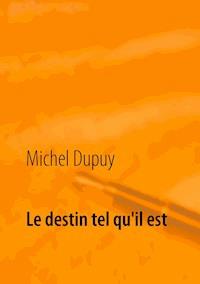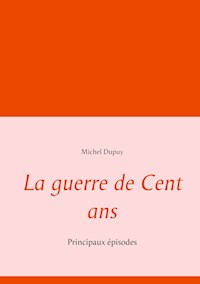
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Le plus célèbre conflit du Moyen âge qui opposa les rois d'Angleterre de la dynastie des Plantagenêt aux rois de France de la dynastie des Valois
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Introduction
Origines de la guerre de Cent ans
La guerre de Cent Ans : Dates – Evènements - Principaux personnages
Première phase - Premiers combats
Deuxième phase de la guerre de Cent Ans
Conditions et modes de vie durant la guerre de Cent Ans
Fin de la Guerre de Cent ans
Introduction
La Guerre de Cent ans ! Ce fut le plus célèbre conflit du Moyen âge ! Pour la possession du trône du royaume de France, il opposa les rois de France de la dynastie des Valois aux rois d’Angleterre de la dynastie des Plantagenêt. En réalité elle se déroula, on peut dire officiellement, durant 116 ans, soit de 1337 à 1453, et en fait, on peut considérer qu’elle débuta vraiment en 1323, lors d’incidents graves qui eurent lieu à Saint-Sardos, une petite commune du département actuel du Lot-et-Garonne, et qui déclenchèrent ce qui fut appelé la guerre de Saint-Sardos. Il faut savoir que ces démêlés n’auraient pas eu lieu si cette région du Sud-Ouest n’avait pas été sous domination anglaise. Rappelons que l’Aquitaine avait été apportée en dot par Aliénor d’Aquitaine, héritière du duc d’Aquitaine, à son deuxième époux, Henry Plantagenêt, devenu roi d’Angleterre en 1154 sous le nom d’Henry II. Plus tard, ce territoire était devenu officiellement anglais après le traité de Paris de 1259 ratifié par Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis, et Henry III d’Angleterre. Le duché d’Aquitaine s’étendait du Poitou à l’Auvergne et à la Bigorre, et englobait la Guyenne qui avait Bordeaux pour capitale et qui comprenait le Captal de Buch (région d’Arcachon, de la Teste de Buch et de Gujan-Mestras) et les Landes jusqu’à Bayonne.
C’est ainsi que possédant déjà la Normandie, le Maine, l’Anjou, l’Aunis, la Saintonge, le roi d’Angleterre, vassal du roi de France, était presque plus puissant que son suzerain.
Durant cette fameuse guerre cinq rois se succédèrent sur le trône de France : Philippe VI, Jean II dit le bon, Charles V, Charles VI et Charles VII. Aucun d’entre eux ne fut très brillant, peut-être le dernier qui mit fin au conflit, mais surtout grâce à Jeanne d’Arc, ce qui ne l’empêcha pas de ne plus considérer cette dernière après qu’elle l’eut fait sacré roi de France à Reims et de la laisser mourir sur le bûcher. Quant aux autres !… Philippe VI alla de défaites en défaites, Jean II fut fait prisonnier par les Anglais et mourut en captivité après avoir signé des traités désastreux pour la France sur le plan économique, Charles V eut quelques réussites, mais aidé pour cela par Bertrand du Guesclin, et Charles VI s’avéra bipolaire et totalement déséquilibré.
En fait, si on observe le déroulement de la guerre de Cent Ans, on constate qu’elle se divisa en deux phases distinctes marquées par deux personnalités emblématiques qui souvent retournèrent la situation, le connétable Bertrand du Guesclin et Jeanne d’Arc, mais durant lesquelles les Anglais manquèrent de peu de s’approprier définitivement le trône de France, en 1431, Henry VI de Plantagenêt avaient même était sacré roi en la cathédrale Notre Dame de Paris.
Le premier épisode que l’on peut dater de 1337 à 1390 environ, débutera par la prise en Aquitaine par les Français de trois ou quatre places fortes de peu d’importance, suivie d’un échec flagrant devant Bordeaux et l’abandon de leur offensive. Dans le nord du pays les Anglais attaqueront à leur tour et remporteront victoires sur victoires notamment à Crécy et à Calais. Humilié, Philippe VI, roi de France, devra laisser la place à son fils Jean, duc de Normandie. Celui-ci, après être monté sur le trône sous le nom de Jean II, dit le Bon, sera fait prisonnier par les Anglais à la bataille de Poitiers. Mort en captivité à Londres, Jean II sera remplacé en 1364 par son fils Charles V qui accordera sa confiance à Du Guesclin. Ayant reçu l’épée de connétable en 1370, le célèbre breton qui, depuis 1357, avait déjà fait parler de lui, réussira non seulement à chasser les Anglais de la presque totalité du territoire français, mais encore à débarrasser le pays des Grandes Compagnies, fléau de l’époque.
Au début de la deuxième partie du conflit, une guerre civile entre les Armagnacs, partisans du duc d’Orléans, et les Bourguignons, partisans du duc de Bourgogne, va favoriser les Anglais qui attaqueront à nouveau et qui, malgré la supériorité numérique de l’armée française (18000 hommes en face de 6000 anglais), seront victorieux à Azincourt, ce qui aboutira cinq ans plus tard au funeste traité de Troyes, bannissant le dauphin Charles, fils de Charles VI. Le trône de France semble être alors acquis par l’Angleterre. Mais, aidé par Jeanne d’Arc, le dauphin sera sacré roi de France sous le nom de Charles VII et, grâce à ses victoires, rendra caduc le fameux traité.
Bien entendu, on ne peut pas considérer que la guerre de Cent ans fut une guerre telle qu’on l’entend de nos jours, mais plutôt une série de batailles qui se succédèrent de manière intermittente. Interrompue par des traités qui n’étaient généralement pas observés, elle fut surtout une longue période au cours de laquelle plusieurs générations durent vivre dans une perpétuelle ambiance de troubles et d’affron-tements suivis d’exactions de toutes sortes, brigandages, viols des femmes, pillages des bourgades et incendies des châteaux. Du reste en 1364, Sa Sainteté le pape Urbain V écrivit au sujet du climat engendré par ce conflit :
« Des multitudes de scélérats de diverses nations, associés en armes par le désir avide de s’approprier le fruit du travail des peuples innocents et désarmés, prêts aux pires cruautés pour extorquer de l’argent, dévastent avec méthode les campagnes, brûlent les maisons, coupent les arbres et les pieds de vigne, contraignent les pauvres paysans à la fuite, assaillent, assiègent, dépouillent, et détruisent les châteaux et les cités emmurées, torturent, sans égard pour l’âge ou pour l’état ecclésiastique, violent les dames, les vierges et les religieuses, contraignent les gentes dames à les suivre dans leurs camps, pour y servir à leurs plaisirs et pour porter leurs armes et leurs bagages. »
C’est pourquoi, vivant dans un climat d’insécurité, perpétuelle, les gens devenaient à leur tour agressifs et malfaisants. On demandait alors à la justice d’être sans indulgence et souvent impitoyable, et les châtiments étaient barbares : pendaisons, écartèlements, empalements, mutilations. On cite l’exemple de faux monnayeurs qui furent bouillis vivants ! Dans les batailles, on utilisait la hache, la masse d’armes ou l’estramaçon, et les combattants survivaient rarement à leurs blessures.
Origines de la guerre de Cent ans
Ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, la guerre de Cent ans débuta vraiment en 1323, à Saint Sardos, village d’Aquitaine. De nos jours, Saint-Sardos est une petite commune de 330 habitants située dans le Lot-et-Garonne, non loin de Cahors, au cœur du pays de Serres, et faisant partie de la communauté de communes de Prayssac. Au douzième siècle, en 1153, sur l’emplacement de ce village, sur une avancée surplombant le Lot, au lieu-dit « L’église rouge », il avait été fondé un prieuré dépendant de l’abbaye de Sarlat, en Périgord. En 1289, conformément à un contrat de paréage (accord donnant des droits égaux à chacune des deux parties) conclu entre l’Abbé de Sarlat et Philippe IV le Bel, roi de France, il avait été construit une bastide. Par la suite, c’est en l’an 1318 que, suite à une demande de l’abbé de Sarlat, le parlement de Paris, avec l’agrément de Charles IV, dernier fils de Philippe le Bel et qui avait succédé à ses deux frères Louis X le Hutin et Philippe V, accorde à cette place forte des statuts permettant notamment une installation libre des immigrants, mais sur un territoire contrôlé par Edouard II, roi d’Angleterre. Par ailleurs, sous la réserve d’hommage, le prieur de Saint-Sardos avait été investi en 1298 de la seigneurie du lieu par le baron de Montpezat, hobereau de la région acquis aux Anglais. C’est en 1323 que, revendiquant le droit de présence de la France, Charles IV envoie un officier royal à Saint Sardos avec mission de faire respecter les conventions du statut et d’ériger un mât symbolique à ses armes. Cette décision provoque la fureur de la noblesse locale acquise aux Anglais, et surtout de Raymond Bernard de Montpezat. Le 16 octobre, ce seigneur prendra la tête d’énergumènes excités et de gens à sa solde qui vont brûler la bastide, pendre l’envoyé du roi de France, massacrer les habitants et s’emparer de leurs biens qu’ils transporteront au château de Montpezat. Bien entendu, Charles IV ne peut accepter cet affront, en outre c’est pour lui l’argument idéal afin de déclencher une offensive et d’asseoir son autorité sur une partie de l’Aquitaine. Tout d’abord, avant une action guerrière, il prononcera la confiscation du duché, ce qui provoquera les interventions de plusieurs ambassadeurs venus de Londres pour dédramatiser l’affaire. Démarches infructueuses, puisque quelques mois plus tard, en juillet 1324, sera mis en campagne une armée de 7000 hommes commandée par Charles de Valois, oncle du roi, qui va livrer une offensive que l’on appellera la guerre de Saint Sardos. En six semaines, la plupart des villes de l’Aquitaine sous domination anglaise vont se rendre et le duché d’Aquitaine, à l’exception de Bordeaux et des zones côtières jusqu’à Bayonne, va être occupé par les Français. Finalement une trêve va être conclue et, après de longues négociations, le 31 mai 1327, il sera signé un traité stipulant que, si Charles IV ne confisque pas la totalité du duché, il conserve cependant tout l’Agenais, en réalité une grande partie de ce qui a été gagné au cours de la guerre de Saint Sardos, en contrepartie pour garder l’ensemble de l’Aquitaine, le duc, en l’occurrence Edouard II, roi d’Angleterre, doit prêter hommage lige au roi de France. Renforçant l’hommage simple, l’hommage lige, signifie qu’un vassal est tenu à tous les devoirs envers son suzerain et doit le servir à ses dépens. Mais Edouard II, qui par ailleurs vient d’être destitué par ses pairs, meurt en 1327 et à son tour Charles IV en 1328. Afin d’entériner le fameux traité, il faudra donc attendre la nomination des deux nouveaux rois.
En Angleterre, la succession d’Edouard II ne pose pas de problème, c’est naturellement son fils, sous le nom d’Edouard III, qui va être sacré roi, cependant il est encore mineur, c’est sa mère qui assure la régence. En revanche, en France il n’en est pas de même. En effet, de son vivant Charles IV n’a pas eu d’héritier mâle, malgré tout, au moment de son décès, Jeanne d’Evreux, qu’il a épousée en troisième noce, se trouve enceinte, naturellement si elle met au monde un garçon, ce sera forcément lui le roi de France. À noter que Jeanne d’Evreux est la fille de Louis de France, comte d’Evreux, donc la cousine germaine du roi et leur union n’a pu avoir lieu qu’avec l’accord de Sa Sainteté le pape. Si elle accouche d’une fille, les pairs de France seront dans l’obligation de choisir le futur monarque parmi les quatre prétendants qui sont en lice, soit :
Philippe, comte de Valois
Né en 1293, il est le plus âgé des postulants. Il est le fils de Charles de Valois, frère cadet de Philippe le Bel, et de Marguerite de Valois, fille de Charles d’Anjou, roi de Naples. Il a été marié en juillet 1313 à Jeanne de Bourgogne, surnommée Jeanne la boiteuse, fille de Robert II, duc de Bourgogne et d’Agnès de France qui est la dernière fille du roi Saint Louis. Ayant assuré la régence du royaume après la mort, le 1er février 1328, de Charles IV, il a un sérieux avantage sur les autres prétendants.
Edouard III d’Angleterre.
Il est le fils d’Edouard II d’Angleterre et d’Isabelle de France, fille de Philippe IV le bel et de Jeanne de Champagne, reine de Navarre. Donc par sa mère, il appartient à la dynastie des Capétiens. Il parle couramment le français, mais, handicap sérieux, c’est un noble anglais.
Jeanne de Navarre.
Elle est la fille de Louis X le Hutin et de Marguerite de Bourgogne. A son discrédit, elle est soupçonnée de bâtardise ou d’illégitimité, sa mère ayant été compromise dans le célèbre scandale de la tour de Nesle, néanmoins elle a été malgré tout reconnue par l’époux de sa mère, le futur roi de France de l’époque.
Philippe d’Evreux
Il est le fils de Louis de France, comte d’Evreux, lui-même fils en seconde noce de Philippe III le Hardi, et de Marguerite d’Artois. Il est l’époux de Jeanne de Navarre citée ci-dessus.
Finalement, Jeanne d’Evreux ayant accouché d’une fille, c’est Philippe de Valois qui sera choisi par les pairs de France, la loi salique qui interdit la transmission de la couronne aux femmes et par les femmes ayant été également invoquée pour écarter Edouard III et Jeanne de Navarre, Philippe d’Evreux n’ayant pas été retenu. Le comte de Valois sera sacré roi de France à Reims, le 29 mai 1328.
Peu de temps après son avènement, afin d’asseoir son autorité, le nouveau roi va partir en guerre pour soumettre les Flamands qui se sont révoltés contre Louis de Nevers, comte de Flandre, son vassal. Le 23 août, il triomphera à Cassel, qui sera incendiée, et Louis de Nevers reprendra le contrôle du comté. Anecdote un tantinet narquoise : depuis son accès à la royauté, ses sujets l’appellent « Le fortuné », en Flandre, pour se moquer, on le surnommera « Le trouvé ». En effet, sur ses étendards il avait fait peindre un coq avec cette inscription : « Quand ce coq cy chantera, le Roy trouvé cy entrera ».
Cependant, les trois autres prétendants au trône de France vont contester la décision des pairs du royaume. Si Jeanne de Navarre et son époux Philippe d’Evreux, en obtenant officiellement la Navarre et en ayant été sacré roi et reine, sont momentanément apaisés, il n’en est pas de même pour Edouard III, roi d’Angleterre ou plus exactement pour sa mère, Isabelle de France, régente du royaume d’Angleterre. En effet, né le 13 novembre 1312, Edouard qui, le 1er Février 1327, a été sacré roi n’a que 14 ans. Son père, homosexuel, qui, durant son règne a laissé gouverner son royaume par ses favoris a été définitivement destitué trois semaines plus tôt par le parlement. Déjà sa mère, depuis 1326, en accord avec les nobles du pays, et assistée par son amant, Roger Mortimer, comte de March, assurait la régence, pouvoir qu’elle conservera d’ailleurs jusqu’en 1330. Femme particulièrement volontaire et déterminée que rien n’arrête (à noter que sur son ordre son mari, le 21 septembre 1327, sera assassiné après avoir été interné au château de Berkeley), Isabelle de France accepte mal que son fils ait été écarté de la succession de Charles IV et elle adoptera une position intransigeante vis-à-vis de l’hommage lige qui a été demandé lors du traité de mai 1327. Aux envoyés français de Philippe VI qui viendront à Londres pour rappeler cet accord, en faisant allusion au fait que le roi de France est le fils du comte d’Evreux, elle répondra : « mon fils est fils de roi et il ne fera pas hommage au fils d’un comte. » C’est ainsi du reste que, en sa qualité de duc d’Aquitaine et par conséquent pair de France, Edouard III, ne se rendra pas au sacre de Philippe VI, le 29 mai 1328 en la cathédrale de Reims. Cependant, les Anglais ne pouvant opposer de défense assurée pour leurs possessions en Guyenne, Isabelle conseillera à son fils de se soumettre et de rendre tout de même hommage au roi de France le 6 juin 1329 en la cathédrale d’Amiens, mais un simple hommage et, ainsi qu’elle le lui avait demandé, Edouard III refusera de joindre les mains devant Philippe VI. Il reconnaîtra le roi de France simplement comme son seigneur et non comme son suzerain suprême. C’est son porte-parole, l’évêque de Lincoln, qui présentera la liste des arguments juridiques contre l’hommage lige. Accommodant, Philippe VI donnera alors à Edouard III la date limite du 30 juillet 1330 pour accomplir son devoir de vassal. Ce à quoi, toujours sur les conseils de sa mère, le jeune roi donnera son accord, mais en réclamant la remise des territoires saisis pendant la guerre de Saint-Sardos. Philippe refusera catégoriquement et fixera une nouvelle date butoir : le 15 décembre 1330. Devant un nouveau refus, le roi de France chargera son frère Charles II d’Alençon, lieutenant général du royaume, de s’emparer de la ville de Saintes qui, investie sans problème, sera pillée. C’est alors que, contre toute attente, en février 1331, Edouard III va faire amende honorable et demandera que son hommage soit considéré comme hommage lige. Il a maintenant 19 ans, l’âge d’homme, et il désire assumer seul la royauté. Du reste, après avoir fait exiler sa mère au château de Rising, dans le Norfolk, il fera pendre son amant, Roger Mortimer. Les Français se retire alors de Saintes et propose une indemnisation pour le sac de la ville.
Dès lors, on s’achemine apparemment vers un apaisement des relations entre les deux pays. Mais en réalité, il existe toujours entre les deux rois un état de tension qui ne va pas tarder à s’envenimer. C’est encore l’Aquitaine qui est au cœur du conflit. Philippe VI voudrait étendre le domaine royal en se l’appropriant en totalité, et Edouard veut, non seulement maintenir ses positions, mais encore récupérer tout ce que les Anglais ont perdu au cours de la guerre de Saint-Sardos. Deux évènements serviront de prétextes pour, à nouveau, mettre le feu aux poudres. Le premier, curieusement situé Outre-manche, sera un conflit entre les Anglais et les Ecossais, ceux-ci refusant d’être les vassaux de leurs voisins. Le second localisé en Flandre, dans le nord de la France, aura pour origine l’intérêt porté par Edouard III sur cette province.
La guerre d’Ecosse.
Nous savons tous que l’île de Grande Bretagne est divisée en trois régions, trois états distincts, l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Ecosse. À l’époque, chacun d’eux revendiquait sa propre administration et son propre souverain. Si les Anglais avaient réussi à imposer leur suzeraineté sur les Gallois, il n’en était pas de même avec les Ecossais. Il faut remonter à 1292, année au cours de laquelle, après la mort sans héritier d’Alexandre III, roi d’Ecosse, Edouard 1ier, roi d’Angleterre, sous condition bien entendu d’être reconnu suzerain par le nouveau roi, avait réussi à donner le trône vacant à John de Balliol, noble issu d’une famille originaire de Normandie. Cependant, par la suite, ce dernier avait été renversé par le descendant d’une vieille lignée écossaise, Robert Bruce, appuyé par ses concitoyens. A sa mort, en 1329, son fils David, âgé seulement de 5 ans, lui avait succédé. C’est alors qu’Edouard Balliol, fils de John, va vouloir reconquérir le trône donné à son père par les Anglais. Aidé par le roi d’Angleterre, à la tête de 13000 hommes, il livre bataille aux partisans de David Bruce qui vont subir plusieurs défaites, ce qui oblige leur jeune roi à s’enfuir en France où Philippe VI l’accueille et l’installe avec sa cour à Château-Gaillard. En vertu de « l’Auld Alliance » (vieille alliance) qui lie l’Ecosse à la France, Philippe VI exigera du roi d’Angleterre que David retrouve sa souveraineté, mais évidemment sans résultat. Entre temps, honni par le peuple écossais, Balliol doit fuir. C’est alors qu’une médiation papale tente d’obtenir la paix : on propose que Balliol reste roi jusqu’à sa mort et qu’il soit alors remplacé par David. Celui-ci, sur les conseils de Philippe VI, refuse catégoriquement. On sait que plus tard, en 1341, il retrouvera son trône. Naturellement, ces interventions du roi de France seront mal perçues par les Anglais.
Ralliement de la Flandre à l’Angleterre.
À la suite de son mariage avec Philippa de Hainaut, fille de Guillaume le Bon, comte de Hainaut, Edouard III s’intéresse fort aux provinces du nord de la France. Voulant obliger les villes flamandes à se tourner vers l’Angleterre, il interdit en 1336 l’exportation des laines anglaises vers la Flandre, province dont l’économie est essentiellement orientée vers les draperies et le tissage, et il va soutenir l’industrie textile du Brabant. Par ailleurs les Flamands sont indignés par le ralliement au roi de France de Louis de Nevers, dit Louis de Dampierre et comte de Flandre. Pardessus le marché, celui-ci, non seulement exerce sur les citoyens de son comté une forte pression fiscale, mais encore il vit en permanence à la cour de Philippe VI. La Flandre entre alors en crise et se donne un chef, le tribun Jacob Van Artevelde, membre très populaire de la haute bourgeoisie de Gand, qui a fait fortune dans l’industrie drapière et qui devient le véritable maître du comté. Sous la direction de Van Artevelde, les Flamands vont se révolter contre la France et se rallier au roi d’Angleterre en le reconnaissant comme leur suzerain et le vrai roi de France. L’embargo sur les laines sera levé. Fort de l’appui de la Flandre, Edouard III renouvelle alors sa prétention au trône de France, c’est pourquoi le 24 mai 1337, Philippe VI décide de lui confisquer la Guyenne pour félonie. Ce à quoi, Edouard répond en envoyant, le 7 octobre 1337, l’évêque de Lincoln, Henry Burghersh, porteur d’un message adressé à « Philippe de Valois, qui se dit roi de France » dans lequel il est précisé la rupture de l’hommage et la déclaration de guerre.
Par la suite s’enchaîneront d’interminables péripéties qui émailleront le conflit : batailles sanglantes, traités et accords non observés, trahisons, félonies, envahissements et occupations de territoires.