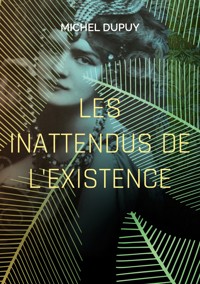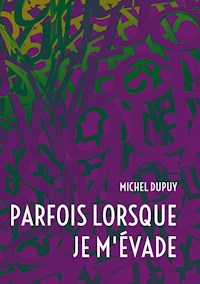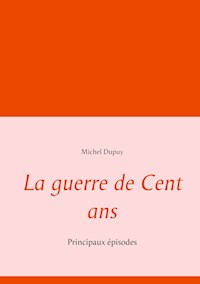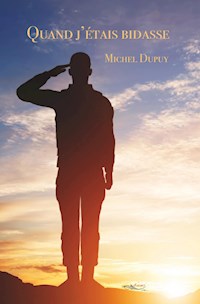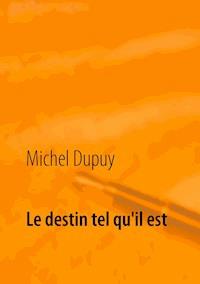Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Recueil des troubadours périgourdins et limousins. : Arnaut de Mareuil, Bertran de Born, Arnaut Daniel, Elias Cairels, Guiraut de Borneilh, Bernartz de Ventador, Ebles lo Chantador, Gui d'Ussel, Marie de Vantador, et d'autres encore.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 106
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
C’est des troubadours que viennent les premiers élans poétiques qui puisèrent dans les thèmes de l’amour courtois un sentiment d’émotion dont l’intensité et la profondeur ne cesseront de s’épanouir.
Encyclopédie Bordas
… trésors de cette Grèce humaine et chantante, de ce haut langage ancien roulant d’Italie à l’Espagne, du pays Maure au Poitou, une poésie dont secrètement je m’enivrais…
Aragon
Sommaire
Introduction
Arnaut Daniel
Arnaut de Mareuil
Aymeric de Sarlat
Bertran de Born
Elias Cairels
Elias de Fonsalada
Gausbert de Puycibot
Guiraut de Borneilh
Guilhem de La Tor
Guilhem de Salignac
Peire de Bragairac
Pierre de Bussinhac
Salh d’Escola
Arnault de Tintihac
Bernartz de Ventadour
Ebles lo Chantador
Gaulcem Faidit
Gui de Glotos
Joan d’Albusson
Les quatre troubadours d’Ussel
Ebles d’Ussel
Peire d’Ussel
Gui d’Ussel
Elias d’Ussel
Marie de Ventadour
Peire d’Alverhe
Peire de Vic
Uc de la Bacalaria
Postface
Introduction
Le troubadour ! Appellation issue de l’occitan trobador, celui qui trouve, qui compose, qui invente.
En créant une poésie lyrique bien spécifique, un genre littéraire inconnu jusqu’alors, les troubadours firent leur apparition vers l’an 1100 en Périgord et en Limousin, régions où le commun des mortels communiquait alors avec ses semblables en langue d’oc, l’occitan, dialecte considérée comme langue vulgaire et que l’on appelait « linga limosina », langue limousine. La langue noble était le latin employé par les intellectuels de l’époque, les clercs qui, seuls, savaient lire et écrire, le nom de clerc venant du latin cléricus qui signifie qui est instruit. A noter qu’il exista également des troubadouresses, on les appelait Troubaïritz.
Par opposition à oïl dans le nord de la France, oïl venant du gallo-roman o-il (celui-ci), dans le sud, le mot oc vient du latin hoc qui signifie cela. Ces deux mots sont devenus le oui utilisé dans toute la France La langue d’oïl était également nommée linga gallicana et les poètes qui l’utilisaient étaient appelés trouvères.
Au Moyen Age, durant longtemps la langue d’oc fut la langue vulgaire en Occitanie, mais, du fait sans doute qu’elle devint largement employée et notamment dans les cours par les seigneurs, elle fut alors une grande langue de civilisation utilisée bientôt, non seulement par les lettrés, mais également sur le plan juridique et administratifs et elle se dégagea complètement du latin. Ce n’est qu’en 1539, après l’ordonnance de Villers-Cotterêts, édictée par François 1ier, qu’elle sera remplacée par le français. Devenu langue officielle, le français venait de la langue d’oïl et du proto-français parlé en île de France et désigné par le terme francien qui s’était enrichi des langues du nord de la France.
De nos jours, depuis le début du XIXe siècle, avec le félibrige et Mistral, la langue occitane connaît un nouvel essor, toutefois le provençal qui lui est largement apparenté se rapproche un peu plus de l’italien. On peut dire que, si elle fut la langue d’une ethnie qui n’a jamais pu se constituer en nation, son histoire est la quête persévérante d’une prise de conscience que des difficultés diverses ont sans cesse remise en question.
Donc c’est à partir de 1100 que, généralement d’anciens clercs ou des personnages lettrés désirant s’exprimer par des poèmes, souvent mis en musique, décidèrent, en abandonnant le latin, de s’exprimer et de chanter en langue occitane, ceci sans doute pour être entendus de tous. Leurs chansons, des cançons, mots qui se prononcent cançous, composées en vers, utilisant la rime et découpées en strophes, étaient élaborées avec des règles rigoureuses et elles traduisaient fort bien l’expression de la pensée de leurs auteurs. Leur contenu étant appelé « razon » (raison), elles étaient écrites de trois façons : selon le « trobar lèu », style simple que l’on comprend aisément ; le « trobar clus » texte hermétique qui joue sur l’ambiguïté, mais dont la manière calculée dévoilait leur sens à partir de certains termes quelquefois difficilement appréciables ; et le « trobar ric », écriture riche dont la qualité réside dans la difficulté vaincue. On peut y ajouter le trobar planh qui est une complainte funèbre, le mot planh venant du latin planctus qui signifie plainte, gémissement. En fonction de leur finalité, ces poèmes étaient appelés différemment, soit : sirventès, (mot venu du latin sirvent, serviteur), qui était moral ou satirique et souvent inspiré par l’actualité politique ; salut qui chantait l’amour courtois ; ensenhamen (enseignement) qui s’adressait aux nobles, aux bourgeois et aux clercs afin de leur enseigner leurs devoirs et le savoir-vivre ; tenson ou partimen (jeu-parti), poème dialogué, généralement avec un ou plusieurs autres troubadours et où les interlocuteurs s’opposaient sur un sujet donné ; descortz, poème dont les vers étaient de forme discordante et souvent utilisé pour exprimer le désaccord ; cobla, poème d’une seule strophe. Ces chants furent généralement un bel exemple de réussite à la fois esthétique et idéologique et c’est ainsi qu’ils furent élevés au rang des belles-lettres.
En outre, venant en partie du chant grégorien, mais influencées par des rythmes arabes, leurs mélodies, bien entendu profanes, étaient nettement plus raffinées que les ritournelles des amuseurs et des saltimbanques qui se produisaient jusqu’alors.
On peut donc considérer que dans le sud de la France, au même titre que les trouvères dans le nord, les troubadours devinrent les intellectuels du Moyen Age, prenant place à côté des universitaires et des théologiens de l’époque. Par ailleurs, il semble que ce soit grâce au développement des villes dans lesquelles les troubadours ainsi que les trouvères se produisaient que cette vie culturelle put s’épanouir. Néanmoins, l’activité littéraire de ces poètes ne pouvait être envisagée sans l’aide d’un mécénat, c’est pour cela que chacun d’entre eux se mit au service d’un prince ou d’un puissant pour lequel il exécutait des commandes. En effet, la plupart des grands seigneurs n’étaient souvent ni frustes, ni incultes, se piquant d’élégance, de belles manières et de beau langage, ils aimaient à s’entourer de lettrés dont ils faisaient leurs écrivains attitrés et leurs hagiographes. Ainsi les troubadours furent appelés à jouer un grand rôle dans le divertissement des cours aristocratiques où le public féminin tenait la première place. D’une manière générale, ils chantaient surtout l’amour courtois, le fin’amor, qui aspirait à l’absolu et favorisait le progrès moral, véritable culte de la femme, qui, sans écarter l’adultère, évoquaient des sentiments fins, délicats, soit l’allégeance à la fille d’Eve, le chevalier possessif et violent prenant une attitude soumise devant elle. La mythologie de la dame hautaine et inaccessible vécue par les poètes, très souvent de condition modeste, se répandit alors partout où la vie de cour se développait. Mais ils chantaient aussi la soumission au vassal, et puis également la guerre tel Bertran de Born.
Fréquemment, avant de composer eux-mêmes, les troubadours débutaient dans les cours en qualité de jongleurs, non pas comme les personnages de cirque tel que nous l’entendons de nos jours, mais en qualité d’interprètes qui déclamaient ou chantaient des textes écrits par des poètes déjà connus. Le jongleur était aussi celui qui plaisantait, qui bavardait, s’adressant, souvent avec impertinence, aux « rics homs » (les seigneurs). Généralement, se souvenant de milliers de vers, sa mémoire était exceptionnelle et il rendait vivant ce qu’il récitait. Ceux qui restaient jongleurs étaient souvent attachés à un troubadour réputé et ils étaient un peu considérés de la même manière que les écuyers des chevaliers. Souvent anonymes, les biographies des troubadours écrites à leur époque et qui nous sont parvenues, sont appelées vida.
Quelles étaient les origines de l’art des troubadours ? Plusieurs hypothèses ont été envisagées, mais aucunes n’ont vraiment été satisfaisantes. Il semble que la plus crédible soit, suite aux croisades, l’influence de la culture islamique.
Le premier poète occitan fut sans doute Guillaume IX, duc d’Aquitaine et comte de Poitiers, qui vécut de 1071 à 1127. Grand seigneur débauché, sa vie privée ayant fait scandale, paradoxalement il fut cependant très courtois, très enjôleur et naturellement toujours prêt à faire l’amour. On le vit courir longtemps de par le monde en trompant les dames. Il a chanté la femme, mais avec une grande liberté de ton, frôlant même le libertinage. Dans ses poèmes, il parle même d’amour entre hommes. Par la suite, c’est surtout en Périgord et en Limousin que se distinguèrent les troubadours qui lui succédèrent, avec autant de verve, mais avec des mœurs moins dissolues. Tous ont laissé une œuvre plus ou moins importante qui a permis de ne pas les oublier.
Extrait de poème de Guillaume de Poitiers
La nostr’amor vai enaissi
Com la branca de l’albespi
Qu’esta sobre l’arbre tremblan
La nuoit, a un la ploja ez al gel
Tro l’endeman, que I sols s’espan
Per las fueillas verze I ramel
Traduction en français
Il en est de notre amour comme de la
Branche d’aubépine qui, la nuit, tremble
Sur l’arbuste, exposée à la pluie et au gel
Jusqu’à ce que, le lendemain, le soleil
Inonde ses feuilles vertes et ses rameaux.
Autre extrait
Farai chansoneta nueva
Ans que vent ni gel ni plueva :
Ma dona m’assaya e-m prueva,
Quossi de qual guiza l’am;
E ja per plag que m’en mueva
No-m solvera de son liam.
Qu’ans mi rent a lieys e-m liure,
Qu’en sa carta-m pot escriure
E no m’en tenguatz per yure,
S’ieu ma bona dompns am !
Quar senes lieys non puesc viure,
Tant si pres de s’amor gran fam.
Traduction
Ferai chansonnette nouvelle
Avant qu’il vente, pleuve ou gèle
Ma dame m’éprouve, tente
De savoir combien je l’aime ;
Mais elle a beau chercher querelle,
Je ne renoncerai pas à son lien
Je me rends à elle, je me livre
Elle peut m’inscrire en sa charte ;
Et ne me tenez pour ivre
Si j’aime ma bonne dame,
Car sans elle je ne puis vivre,
Tant de son amour j’ai grand faim.
Les troubadours périgourdins
Arnaut Daniel
Il est né au château de Ribérac vers 1150, de parents nobles mais pauvres. S’il n’avait que peu de goût pour les études, il avait malgré tout acquis une certaine culture, notamment en lettres et, de bonne heure, il sera passionné par la réalisation de poèmes. Il ne débutera cependant dans les cours qu’en qualité de jongleur, c'est-à-dire, on l’a vu précédemment, qu’il chantera les poèmes d’autres troubadours, mais rapidement il composera à son tour et, beaucoup plus tard, ses écrits feront l’admiration des poètes italiens de la fin du Moyen Age et de la Renaissance. Effectivement, aucun troubadour n’a reçu autant d’éloges et même de la part d’auteurs de notre époque. Dans son « Traité de l’éloquence vulgaire », Dante Alighieri le célèbrera à maintes reprises. Estimant que sa poésie surpassait tout ce qui avait paru avant lui dans le même genre, l’auteur de « La divine comédie » écrira qu’il fut « le meilleur forgeron du parler maternel » dont le style « fait honneur au pays qui l’a vu naître ». Dans le « Purgatoire » dans le « vingt-sixième canto » il en fera un vif éloge, rappelant ce simple vers :
Leu sui Arnaut qui plor e vau cantan
Soit :
Je suis Arnaut qui pleure et vais chantant
Quant à Pétrarque, s’il lui préférera Giraut de Borneilh (objet d’un prochain chapitre), non seulement il le nommera à la tête des troubadours les plus célèbres en l’appelant le « grand maître d’amour », mais encore il l’imitera dans ses poèmes. Plus près de nous, Ezra Pound, le poète américain qui exercera son art en Angleterre, le considérera comme le plus grand poète jamais vécu, le Moyen Age nous ayant légué d’après lui deux précieux héritages, l’église de San Zeno (dans le nord de l’Italie), et Arnaut Daniel, citant trois vers écrits par celui-ci qui lui paraîtront significatifs, argument un peu simpliste :
Leu sui Arnaut qu’amas l’aura
E chatz le lebre ab lob ou
E nadi contra suberna
Soit :
Je suis Arnaut qui rassemble le vent
Et poursuit le lièvre avec le bœuf
Et nage contre le torrent.
Même Aragon citera Arnaut Daniel dans un de ses textes intitulé « La leçon de Ribérac ou l’Europe française », article paru dans le numéro 14, en juin 1941, de « Fontaine », la revue mensuelle de Max-Pol Fouchet.
Toutefois Jean-Baptiste de la Curne (1697 – 1791), auteur de « L’histoire littéraire des troubadours », rédigée par l’abbé Millot, n’aura pas éprouvé les mêmes sentiments. On peut lire dans son ouvrage qu’Arnaut Daniel était de ceux qui avaient une « fausse réputation fondée sur quelques jugements particuliers dont l’autorité prévaut sans examen sérieux ».