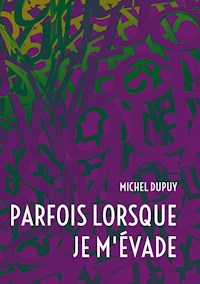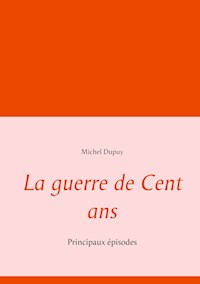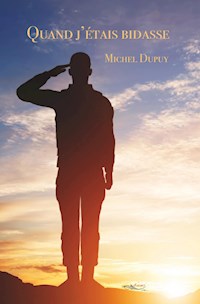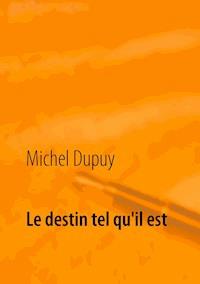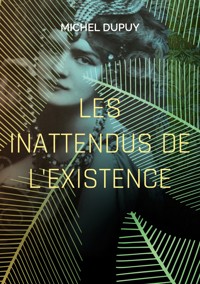
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un homme que rien ne destinait à un avenir particulier, va avoir une existence hors du commun. Pupille de la nation, il sera séminariste, curé de campagne défroqué, il finira planteur aux Antilles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La vie ! Quelle affaire ! Qui peut être banale, sans reliefs ! Mais qui nous réserve parfois tant d’inattendus ! Des bonnes et des mauvaises fortunes ! Des rencontres imprévues et surprenantes ! Des illusions perdues quelquefois retrouvées !
Je m’appelle Delacroix. Raymond Delacroix. Je suis né dans le quartier Saint-Georges, à Périgueux. En 1910 ! Le 2 mars ! En fin de matinée. D’un poids respectable de huit livres ! Un beau bébé, ai-je souvent entendu. Etais-je vraiment beau ? Tout dépend de ce que l’on entend par beau dans ce cas précis.
Huit livre ! Quatre kilos ! Que ma mère avait dus porter dans son ventre durant plusieurs mois. Elle n’avait, paraît-il, pas accouché facilement. Lorsqu’elle m’a mis au monde, mariée dix mois plus tôt, elle n’avait que vingt deux ans. Elle apprenait la couture chez une dame du quartier. Mon père, Léon, de trois ans son aîné, était cordonnier. Dans le quartier, il n’était pas le seul bouif, ainsi qu’on les appelait, mais je crois savoir qu’il était le meilleur d’entre eux car, disait-on, c’était lui qui avait le plus grand nombre de clients. Il exerçait son métier dans une petite maisonnette d’une vingtaine de mètres carrés à peine, dans laquelle un homme de taille respectable pouvait tout juste se tenir debout, et qui était située sur la route de Bergerac, juste en face de la rue du Pont Japhet. Bien avant qu’il ne l’occupât, ce minuscule bâtiment avait été construit il y avait très longtemps, personne ne savait ni pourquoi ni pour qui, mais à l’intérieur duquel, ayant tout à portée de main, il se sentait vraiment chez lui. Bien entendu, il ne pouvait guère recevoir plus d’un visiteur à la fois, toutefois, il y avait une petite fenêtre donnant sur la rue qui, à la belle saison, restait ouverte et qui lui permettait de converser avec les passants et les clients éventuels. En vérité, si j’ai bien connu le local en question qui a été occupé par la suite par un autre cordonnier, je me souviens mal de mon paternel. En 1914, lors de la première guerre mondiale, alors que je n’avais donc que quatre ans, il a été appelé sous les drapeaux et il n’est jamais revenu. Presque deux ans plus tard, fin 1915, il est mort dans les tranchées à Verdun. Ma mère a été avertie par les autorités militaires qu’il avait reçu un éclat d’obus en pleine tête et qu’il avait été enterré non loin du champ de bataille, au fort de Douaumont. On ne pouvait donc pas récupérer son corps et lui donner une sépulture digne de lui au cimetière du quartier. Cependant, on proposa à ma mère de lui payer le voyage pour aller sur sa tombe. J’ai eu le droit de l’accompagner. En passant par Limoges, nous avons pris le train pour Paris, puis après avoir changé de gare, nous avons continué jusqu’à Verdun où nous avons mangé et couché à l’hôtel. Le lendemain de notre arrivée, en compagnie d’autres personnes ayant perdu un des leurs, un autobus nous a emmené au fort de Douaumont. Sur la route, j’ai été surpris par l’environnement. Partout ce n’était qu’un champ de ruines ! Dans la campagne les arbres avaient disparu ! D’énormes trous se succédaient les uns aux autres ! Ce que l’on appelait le fort de Douaumont, c’était une bâtisse toute en longueur. J’appris que c’était un ossuaire ou avaient été déposé les corps des soldats dont on ne connaissait pas l’identité. Devant, dans la pente, des centaines de croix étaient alignées. C’était là qu’était enterré mon père. Il y avait un plan avec tous les noms. Il nous a fallu longtemps pour trouver le sien. Nous sommes allés nous recueillir. Ma mère a éclaté en sanglots et j’ai pleuré aussi. Nous ne sommes restés qu’un jour à Verdun avant de revenir à Périgueux. C’était la première fois que je prenais le train et, nonobstant le fait que le but de notre voyage était douloureux, j’ai été enthousiasmé par les paysages tellement nouveau pour moi, par ce que j’ai vu de la capitale, une ville dont on ne peut voir la fin, avec des avenues illimitées, des bâtiments magnifiques.
J’étais donc devenu orphelin et, m’a-t-on dit, pupille de la nation. Dans ma mémoire, de mon géniteur, je revois seulement un homme costaud et de haute taille qui me soulevait à bouts de bras et qui me faisait sauter sur ses genoux en chantant des comptines. Il n’était pas périgourdin, il était venu de Saint Martin de Cantaleix, dans le Cantal, pour faire son service militaire et c’est au cours d’un bal, durant la fête patronale, qu’il avait rencontré ma mère, Antoinette, une fille Merlet, dont toute la famille était bien connue dans le quartier. Après s’être revus à plusieurs reprises, ils étaient tombés amoureux l’un de l’autre et ils n’avaient pas tardé à s’unir pour le meilleur et pour le pire, devant monsieur le curé et monsieur le maire. Par la suite, mon paternel n’avait pas emmené son épouse dans son pays natal et il avait décidé de s’installer à Saint-Georges. De sa famille, à part de vagues cousins venus du Cantal pour son mariage et que nous n’avons jamais revus, nous n’avons connu personne et nous n’avons jamais rien su de ses origines. Après leur union, c’est un oncle de ma mère, frère de ma grand-mère qui leur a loué une petite maison non loin des limites de la ville. Il y avait un jardin potager où ils faisaient venir quelques légumes. A quelques deux cents mètres de là c’était la campagne. Moi, devenu grand, depuis la fenêtre de ma chambre, aux flancs du coteau je pouvais voir les vaches de la mère Lucie, celle qui tous les matins passait avec sa carriole dans les rues du quartier pour vendre le lait qu’elle venait de traire.
Durant plusieurs années, cinq ans en réalité, mes parents, sans rouler sur l’or, ont eu une vie relativement aisée, jusqu’à la déclaration de la guerre avec l’Allemagne. Une calamité pour toutes les familles ! Par la suite, mon père n’étant plus là pour assurer les besoins financiers du foyer, les temps furent difficiles pour ma mère. Ayant donc appris à coudre, elle travaillait chez une couturière du quartier pour un maigre salaire qui lui permettait tout juste de subvenir au quotidien pour elle et pour moi. Ce n’était pas tout à fait la misère, mais pas loin. J’ai le vague souvenir d’avoir eu à me contenter le soir d’une pomme et d’un morceau de pain. A Saint-Georges et sans doute dans toutes les régions de France, c’était le sort de nombreux foyers. Ce n’est que quatre ans plus tard, après la signature de l’armistice et la loi de mars 1919, que madame Merlet Antoinette, veuve Delacroix, a eu droit à une pension de veuve de guerre et, si ce ne fut pas alors l’opulence, ce fut pour elle une existence plus aisée.
Dans le quartier, en dépit de nombreux gars qui ne sont pas revenus du front, après la fin du premier conflit mondial la vie a repris comme par le passé.
A Saint-Georges où tout le monde se connaissait et où nous avions de nombreux parents et amis, il y avait suffisamment d’artisans, de petits entrepreneurs, de commerçants, pour donner à tous du travail et les autochtones vivaient un peu en autarcie. A l’époque, sauf quelques aventuriers qui montaient à Paris en espérant faire fortune, on ne s’éloignait pas de son clocher. De rares privilégiés avaient obtenu un emploi en ville dans l’administration ou dans un grand magasin. Se considérant comme d’une autre qualité, ces derniers, jouant les messieurs, revêtaient le costume et portaient la cravate. Et puis, comme la mère Lucie, il y avait les paysans, des cultivateurs aux portes de la ville ou même qui venaient de plus loin qui, deux ou trois fois par semaine, passaient dans les rues principales pour vendre leurs produits.
Le quartier Saint-Georges ! Un grand village ! Même si, géographiquement, il faisait partie de l’agglomération périgourdine, Périgueux, chef-lieu de la Dordogne, c’était de l’autre côté de la rivière, l’Isle. Avant de traverser le pont qui permettait d’y accéder, il y avait encore des champs et des près. Une ambiance rurale ! D’ailleurs, lorsque nous voulions aller faire des achats dans les grands magasins, comme « Les nouvelles galeries », de la ville, mettant nos vêtements du dimanche, on s’habillait.
A Saint-Georges, la majorité des gens, même ma mère, s’exprimait en patois périgourdin, la langue d’oc régionale. C’est pourquoi je n’ai vraiment appris à parler français correctement que lorsque je suis allé à l’école, le maître nous donnant des punitions lorsque nous employions notre langue maternelle.
A l’époque, en dépit de leur création au début du siècle, il n’y avait pas encore de maternelles dans les différents quartiers de la ville, alors j’avais dû attendre d’avoir six ans pour me retrouver avec des gamins de mon âge pour, sous la direction d’un instituteur, apprendre à lire et à écrire. A la communale ! Celle des garçons ! Les filles allaient dans un autre établissement. Elles avaient sans doute des heures différentes des nôtres, car nous ne les rencontrions jamais. L’école des garçons n’était pas très loin de notre maison, à quelques deux ou trois cent mètres. La première fois, pour mon inscription et pendant plusieurs jours, ma mère avait fait le trajet pour m’emmener et revenir me chercher. Par la suite, je suis allé en classe en compagnie des autres écoliers des alentours. Il y en avait un, un grand, qui était dans la classe du certificat d’étude à qui ma mère avait demandé de me prendre sous son aile. Les cours, c’était de huit heures et demi à onze et demi le matin et, l’après-midi, de une heure et demi à quatre heures et demie, tous les jours de la semaine, sauf le jeudi car l’école était fermée, ainsi bien entendu que le dimanche. Pour les écoliers, le jeudi c’était une journée de détente. Cependant, je devais profiter du matin pour faire mes devoirs, l’après-midi je pouvais sortir dans la rue pour faire le fou avec mes camarades du quartier ou alors, à la belle saison, ma mère m’emmenait à la rivière, au moulin de Cachepur, pour la baignade et apprendre à nager. Les jours de classe, le matin, à la fin des cours, je me dépêchais de rentrer pour le repas de midi, le soir, si le temps le permettait, je prenais mon temps et je jouais aux billes avec les copains tout près de chez moi. Si je m’attardais trop longtemps, j’avais droit aux remontrances de ma mère, car il ne me restait pas beaucoup de temps pour apprendre mes leçons que, par la suite, elle me faisait réciter.
J’étais malgré tout assez bon élève et j’avais plusieurs fois changé de classe et de maître. L’école était tout près de l’église où j‘avais été baptisé et où, plus tard, préadolescent, tous les jeudis, avec une grande partie des gamins du voisinage, je suis allé au catéchisme sous la conduite de l’abbé de la paroisse. C’était de onze heures à midi. Il nous enseignait qui était Jésus-Christ, la Sainte Vierge, les apôtres, le bon Dieu. C’était un peu comme ce que nous apprenions à la communale en histoire et je ne demandais qu’à y croire. Il fallait aussi apprendre par coeur les dix commandements. Il en était un, le cinquième, qui me donnait à penser : « Tu ne tueras point ». Je savais que mon père et bien d’autres hommes avaient été tués sur le champ de bataille. Sans doute ceux qui étaient à l’origine de ces tueries n’avaient jamais appris les dix commandements. Au bout de deux ans, j’avais fait ma première communion. J’avais un beau costume, un brassard et un cierge. C’était mon grand-père Merlet qui m’avait payé un superbe missel avec la couverture en cuir et un chapelet dont les grains étaient en ivoire. La veille, ainsi que les autres communiants, j’avais dû passer par le confessionnal, mais je n’avais pas su me trouver de péchés, je ne pouvais tout de même pas les inventer ! C’était mon confesseur qui m’en avait suggérés. J’avais avoué sans conviction. Pour punition, j’avais été obligé de répéter dix « Notre père ». Après la première communion, trois semaines plus tard, il y avait eu la confirmation au cours de laquelle chaque communiant avait dû baiser l’anneau de monseigneur l’évêque. J’avais un parrain, c’était un cousin, de trois ans mon aîné. Par la suite, j’ai continué à aller à la messe tous les dimanches. C’était une sortie agréable, presque un divertissement, même si tout était dit en latin et que je n’y comprenais rien. A certaines occasions je communiais, surtout pour Pâques. Huit jours plus tôt, pour la fête des Rameaux, ma mère m’en avait fait un de rameau, avec des branches de buis qu’elle avait décorées et qui, au cours de l’office, était béni.
C’était à la messe de neuf heures que je communiais. Beaucoup plus rarement j’allais à celle de onze heures. Et alors j‘avais le droit de me mettre dans le chœur, juste devant l’autel. L’après-midi, j’allais aux vêpres. J’aimais bien, surtout à cause des chants. Finalement, si l’abbé m’avait demandé d’être enfant de chœur, j’aurais été d’accord avec plaisir, mais les places étaient déjà prises.
A la communale, j’étais bon élève, je préparais le certificat d’études et j‘étais en bonne voie pour l’obtenir. Par la suite, comme la plupart de mes camarades, il était prévu que je fasse un apprentissage. Apprenti de quoi ? Je ne savais pas encore. Peut-être de la cordonnerie, comme mon père. Cependant, je n’eus pas l’occasion de présenter le certif, bien avant, lorsque je fus âgé de onze ans, monsieur l’abbé vint trouver ma mère pour lui faire une proposition.
- Voila madame, avait-il dit, votre fils est un bon sujet qui mériterait d’obtenir une bonne éducation, il est pupille de la nation et il a droit à une bourse relativement importante qui peut lui permettre de faire de études sérieuses, je vous propose de le faire inscrire au petit séminaire de Bergerac où il recevra une éducation lui permettant de bien démarrer dans la vie et, peut-être par la suite d’intégrer le grand séminaire.
Antoinette n’avait pas accepté tout de suite. Se séparer de son gamin, qu’il soit loin d’elle et qu’elle se retrouve seule lui faisait un peu peur. Et puis devant les arguments de l’abbé, elle avait donné son accord. Finalement, plutôt que de voir son fils devenir un simple ouvrier ainsi que les gens de sa famille et ceux de son entourage, le fait qu’il puisse avoir un très bel avenir était inespéré. Par ailleurs, étant très croyante, elle me voyait déjà devenir prêtre.
J’étais présent lors de cet entretien. Tout de suite j’avais compris que j’allais devoir aller vivre dans une autre ville, un autre environnement, loin de ma mère, de mes copains, de la vie dans le quartier. Et puis j’avais également réalisé que j’allais forcément être pensionnaire avec tout ce que cela pouvait comporter, et naturellement une organisation de mon existence bien différente de celle qui avait été la mienne jusqu’à présent. Terminés les petits soins auxquels j’avais droit, le confort douillet de mon lit, de la maison familiale ! Par ailleurs, au séminaire, en plus évidemment des mathématiques, de la géographie, de l’histoire, et des autres matières courantes, j’avais cru comprendre que c’était un enseignement basé en grande partie sur la religion, une sorte de catéchisme, mais qui pourtant permettait de présenter les mêmes examens qu’un lycée public. En vérité, je n’avais rien contre une étude plus sérieuse du christianisme, néanmoins, à ce sujet j’étais persuadé ne plus avoir grand-chose à apprendre. Si, le latin, et puis le grec. J’avais entendu l’abbé dire que ces langues étaient obligatoirement au programme de mon instruction future. Peut-être allais-je savoir ce que disait monsieur le curé au cours de la messe et des vêpres. Alors, tout ce qui m’attendait et que j’imaginais avec appréhension se bousculait dans ma tête. Que me réservait donc l’avenir ?