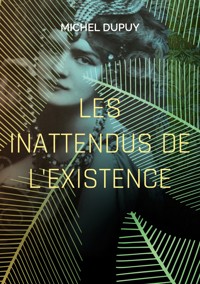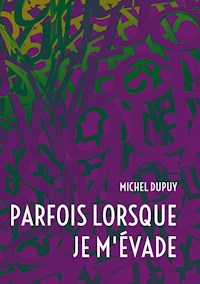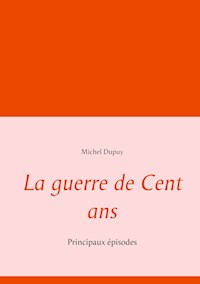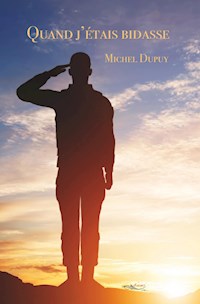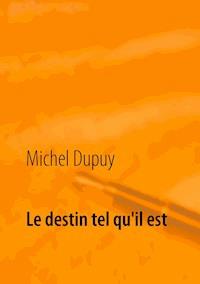Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Recueil sur les libertaires et la conquête de la liberté de par le monde et notamment en Périgord
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
Introduction
Comte de Saint-Simon
Charles Fourier
Auguste Blanqui
Armand Barbès
Pierre Joseph Proudhon
Mikhaïl Bakounine
Karl Marx
André Léo
Ernest Coeurderoy
Louise Michel
Jules Vallès
Aristide Rey
Benoît Malon
Pierre Kropotkine
Errico Malatesta
Benjamin Tucker
Jean Grave
Ravachol
Auguste Vaillant
Emma Goldmann
Emiliano Zapata
Marius Jacob
Joseph Ishill
Nestor Makno
Victor Serge
Mercedes Comaposada Guillen
La Commune de Paris
Grèves de 1920
Mai 1968
Estienne de La Boétie
Pierre Lachambeaudie
Eugène Le Roy
Jean Noé Chabot
Suzanne Lacore
La famille Reclus
Elie Reclus
Elisée Reclus
Paul Reclus
Paul Reclus, fils d’Elie
Elie Faure
Léo Ferré
Georges Brassens
Bernard Lavilliers
Joan Pau Verdier
Conclusion
Introduction
Libertaire ! Selon la définition du dictionnaire : qui n’admet pas de limite à la liberté individuelle en matière sociale et politique. Un état d’esprit qui, ainsi que le démontre la majorité des philosophes, se retrouve dans tout être humain et sans doute dans tout être vivant, et notamment chez les animaux dits sauvages, les autres étant les asservis qui n’ont pas pu, qui n’ont pas su ou qui n’ont pas eu assez de courage pour se rebeller. Rappelons nous la fable de La Fontaine, « Le loup et le chien ». Le loup qui n’avait que la peau et les os, et le chien gras, poli, aussi puissant que beau, mais à quel prix ! Celui d’un collier autour du cou et d’une chaîne à laquelle il était attaché ! La fin est éloquente :
Attaché ? dit le loup, vous ne courez donc pas
Où vous voulez ? Pas toujours mais qu’importe ?
Il importe si bien que de tous vos repas
Je ne veux en aucune sorte,
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor.
Cela dit, maître loup s’enfuit et court encor.
Naturellement, chacun sait que l’appellation de libertaire est synonyme d’anarchiste et, lorsque l’on parle d’anarchie, la majorité des gens pensent au désordre, à la confusion, à un manque total d’organisation. En réalité, être anarchiste c’est surtout essentiellement se révolter contre l’autorité et, par voie de conséquence contre l’oppression. C’est pourquoi au cours des siècles et dans tous les pays, se sont formés des clans, des groupes plus ou moins importants qui ont manifesté leur révolte. Les chrétiens furent sans doute parmi les premiers anarchistes connus. Auparavant, en 73 avant notre ère, il y avait eu l’insoumission des gladiateurs avec Spartacus, et puis l’insurrection des Gaulois et Vercingétorix vingt ans plus tard. Citons également, les Jacqueries en Ile-de-France en 1358, les Tuchins en Languedoc en 1378, les Tards-Avisés en Limousin et en Périgord en 1593, les Camisards de 1702 à 1715, d’autres encore. Et puis, il y eut la Révolution de 1789, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, proclamation qui fut longtemps bafouée et qui l’est encore. Par la suite, quelques décennies plus tard, s’est créée une idéologie libertaire et, dans le monde entier, on a vu se constituer de nombreux mouvements anarchistes composés naturellement de prolétaires et de partisans de la justice et de l’égalité, l’ensemble aboutissant à l’Association Internationale des Travailleurs (IUT) que l’on appelle à présent la 1ier Internationale et qui fut créée à Londres le 28 septembre 1864. De grands penseurs, encensés par les uns, les plébéiens et ceux qui sont pour l’équité, décriés par les autres, bien entendu ceux qui ont hérité de la puissance ou qui ont réussi à l’obtenir en faisant de la lèche et des courbettes et en n’ayant pas hésité à piétiner leurs semblables, ont été à la base de ces associations et de cette congrégation.
Chapitre I
Les libertaires du 18 ième au 20 ième siècle
Claude Henri de Rouvroy comte de Saint-Simon et le saint-simonisme
A ne surtout pas confondre avec Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, mémorialiste, né en 1675.
Philosophe et économiste, le comte Henri de Saint-Simon, arrière-cousin du duc, est né le 17 octobre 1760, dans une famille noble mais peu argentée, réduite à solliciter des pensions de la monarchie. Très jeune, il manifestera déjà son esprit contestataire en refusant de faire sa première communion. Il sera éduqué par un précepteur qui lui inculquera les manières de penser de d’Alembert et de Rousseau. En rupture avec sa famille, à 17 ans il s’engagera dans l’armée de libération des Etats-Unis aux côtés de La Fayette. Il sera nommé capitaine et, en avril 1782, à la bataille des Saintes, petit archipel des Antilles, il sera fait prisonnier par les Anglais et emprisonné à La Jamaïque durant un an. Revenu en Europe, il visitera l’Espagne, et là, ayant déjà le goût des grandes entreprises, il étudiera le projet d’un canal reliant Madrid à la Méditerranée. Idée qui bien entendu n’aboutira pas.
Et puis ce sera la Révolution de 1789, alors il abjurera son titre de noble, changera son nom contre celui de Claude Bonhomme et fera du commerce, mais qui lui laissera peu de profit. En dépit de son adhésion à plusieurs sociétés populaires, de novembre 1793 à juin 1794 il sera emprisonné. Pour quels motifs ? Sans doute avait-on découvert qu’il était aristocrate. Il sera libéré après la chute de Robespierre. C’est alors que, prenant conscience de ce qu’est la société qui l’entoure, il va changer d’état d’esprit, il va tourner le dos à ce qu’il était auparavant et il va vouloir apprendre. Il suivra des cours, à l’Ecole polytechnique, à l’école de médecine, et il va lire énormément. En outre, il va commencer à écrire. Dans son premier ouvrage, « Lettres d’un habitant de Genève à ses contemporains », il va critiquer la Révolution qui, si elle a détruit la féodalité, a permis à la bourgeoisie de triompher et a barré la route au quatrième état, celui des démunis et des ignorants. Il estime alors que le pouvoir des riches doit être fondé sur la capacité. Il souhaite que soit mis en place un pouvoir spirituel au-dessus du gouvernement des Etats, une sorte de religion de la science qui remplacerait le catholicisme, et qui serait basée sur la loi de la gravitation universelle d’Isaac Newton, phénomène par lequel les corps s’attirent.
Cependant, les grandes idées de Saint-Simon ne le font pas vivre. Démunis, il va en être réduit à travailler comme copiste au mont-de-piété et un de ses anciens domestiques lui viendra en aide, mais pour un temps seulement. A partir de ce moment-là il va vivre perpétuellement dans la gêne, ce qui ne l’empêchera pas de continuer à écrire et il publiera «De la réorganisation de la société européenne ».
En 1815, il se ralliera au régime des « cent jours » et acceptera un poste de bibliothécaire, mais la chute de Napoléon entraînera sa révocation. Dès lors, il se trouvera dans l’opposition aux Bourbons.
Cependant, il continue à écrire, dans la revue « L’industrie» il va publier les principes de sa philosophie. En novembre 1819, il fera paraître le texte «Parabole » qui lui vaudra à la fois des poursuites et la notoriété et dans lequel on peut lire : « inutiles à la nation sont tous ceux qui ne produisent pas, les princes de la Cour et l’Eglise, les officiers et les juges ; indispensables à la nation sont les travailleurs les plus modestes, des champs ou de l’atelier ». En juin 1820, il sera arrêté pour avoir manifesté contre la loi du double vote qu’il juge inadmissible. Promulguée le 29 juin 1820 durant la Restauration, ce décret permet aux citoyens les plus imposés donc les plus riches de voter deux fois.
Cependant, Saint-Simon ne parvient pas vraiment à faire passer ses idées, alors, découragé, le 9 mars 1823, il se tire une balle dans la tête, ne réussissant qu’à perdre un œil. En 1824, en collaboration avec Auguste Comte il fera paraître « Le Catéchisme des industriels ». Cependant ses concepts sont devenus différents. Il ne croit plus au régime parlementaire. Il a constaté que parmi les industriels, la part des prolétaires a grandi. Il faut en multiplier le nombre par l’éducation. A cette classe qui croît il veut donner une morale et une religion. C’est pourquoi, en 1825, il publie le « Nouveau Christianisme ». Sa pensée, basée sur l’industrialisme a évolué, il est devenu un vrai socialiste, malheureusement il mourra un mois plus tard.
Sur le plan social, la société proposée par Saint-Simon est fondée sur le principe de l’égalité parfaite et sur l’association entre les hommes et l’amélioration de leurs qualités physiques, morales et intellectuelles. Chacun d’eux doit pouvoir obtenir la considération de tous et les bénéfices associés, proportionnellement à ses capacités, et il faut établir une organisation qui assure du travail à tout le monde. La politique doit être motivée par le bon sens et l’amour du prochain et non par la charité. Les privilèges de la noblesse et de la royauté doivent être supprimée, la doctrine saint-simonienne s’opposant à tout avantage et droit de naissance. Il faut encourager l’industrie, l’agriculture, le commerce, augmenter la production, faire de grands travaux pour élever le niveau de vie des Français. On doit donner le pouvoir aux scientifiques et que les industriels, les cultivateurs et les négociants les plus capables et les plus désintéressés ne dirigent pas mais administrent la nation, la société devenant un grand atelier où chacun a un rôle.
Les contemporains de Saint-Simon n’avaient vu en lui qu’un original passionné, cependant en quelques années le nombre de ses disciples va devenir plus important et, par la suite, il influencera de nombreux philosophes. En 1825 et 1826 il sera publié un journal le « Producteur » diffusant ses idées. Puis à partir de 1830, ce sera « Le Globe », organe dans lequel on peut lire : « L’homme a jusqu’ici exploité l’homme. Maîtres, esclaves ; patriciens, plébéiens ; seigneurs, serfs ; oisifs, travailleurs, voila l’histoire progressive de l’humanité jusqu’à nos jours.» En 1829, deux saint-simoniens, Bazard et Enfantin, avaient créé une sorte d’église, les « Pères de la religion saint-simonienne », mais qui sera poursuivie et dissoute, leurs créateurs étant condamnés à un an de prison ferme, ceci en vertu du Code pénal qui interdit alors les réunions de plus de vingt personnes.
Sur le plan pratique, d’autres disciples de Saint-Simon vont se consacrer à l’action dans l’économie. Ferdinand de Lesseps percera le canal de Suez, un peu plus tard, il y aura celui de Panama qui certes aura quelques déboires, mais qui sera dans le même ordre d’idées. D’autres construiront des lignes de chemin de fer.
Finalement pour Saint-Simon et ses disciples, la société moderne est une société de producteurs fondée sur la véritable propriété, soit celle basée sur le travail qui engendre un bénéfice collectif et non privé défini par son utilité pour les autres, le vrai producteur étant toujours un altruiste.
Charles Fourier
Il est né le 7 avril 1772 à Besançon et mort à Paris le 10 octobre 1837. Son père était un commerçant aisé marchand de draps. Jusqu’à l’âge de 16 ans, il fera de bonnes études au collège religieux de Besançon. Après avoir fait son apprentissage commercial, il montera une affaire à Lyon, mais il sera ruiné par la Révolution, alors il deviendra commis dans une grosse maison de commerce. En 1826, il s’installera à Paris.
Philosophe, précurseur d’un socialisme coopératif, il a été à la base du «socialisme critico-utopique », doctrine influencée par l’humanisme et le christianisme social qui se caractérisait par la volonté de mettre en place des communautés idéales, soit une méthode de transformation de la société qui reposait sur la création par l’initiative du citoyen d’une société au sein même du système capitaliste, c’était la multiplication de ces communautés socialistes qui devait remplacer la société capitaliste.
En 1808, Fourier pose les bases d’une réflexion sur une société communautaire dans deux ouvrages dont « Le nouveau monde industriel et sociétaire ». Son projet est de créer des phalanstères, ensemble de bâtiments à usage communautaire mis en place par la libre association. Dans sa théorie, « la terre de la société harmonique sera divisée en trois millions de phalanstère, chacun regroupant 1500 personnes. Le phalanstère est une sorte d’exploitation agricole avec des bâtisses pour le logement et la distraction pouvant accueillir 400 familles sur un domaine de 2300 hectares ». Ces projets d’aménagements de structures furent l’objet de nombreuses tentatives en France et aux Etats-Unis, mais dont une seule n’a pas échoué, à Guise dans l’Aisne qui, mise en place en 1848, dura jusqu’en 1968.
Recherchant une harmonie universelle, Charles Fourier considérait que l’attirance naturelle des humains pour l’activité et la vertu était entravée et pervertie par le travail imposé par la société capitaliste et industrielle, mais également commerciale. En effet, un jour, alors qu’il était employé, il avait été obligé par son patron de faire jeter des sacs de riz à la mer afin de maintenir les prix. Une autre fois, il avait constaté que son beau-frère Brillat-Savarin, le célèbre gastronome, avait payé une pomme 14 sous, alors que lui, le matin même, en avait acheté une pour le centième de cette somme. Pour Fourier, une telle différence de prix était totalement injustifiée c’est pourquoi il condamnait toute société fondée sur l’échange tarifée et la concurrence. Cette remarque lui inspirera la théorie fameuse des quatre pommes sur le progrès de l’humanité :
- La pomme qu’offrit Eve à Adam.
- Celle que Pâris offrit à Aphrodite. Geste connu sous le nom du « Jugement de Pâris » qui déclencha la Guerre de Troie.
- Celle qu’Isaac Newton reçut sur la tête alors qu’il dormait.
- Et puis la sienne qui lui avait révélé la malfaisance des intermédiaires, la féodalité mercantile et l’ampleur de l’imposture commerciale.
Sa pensée, basée sur la croyance en un principe d’harmonie universelle articulée en quatre domaines, l’univers matériel, la vie organique, la vie animale et la société humaine, inspirera Proudhon, mais elle sera rejetée par Marx et Engels.
Auguste Blanqui
Il est né le 8 février 1805, à Puget-Théniers dans les Alpes-Maritimes. Révolutionnaire socialiste, il est considéré comme l’un des fondateurs de l’ultra-gauche française. D’origine italienne, sa famille avait été naturalisée lors de l’annexion du comté de Nice en 1792. Son père, conventionnel, avait été sous-préfet sous le 1ier Empire. Son frère Adolphe, son aîné de sept ans, fut un économiste libéral réputé.
A Paris, Auguste Blanqui étudiera tout d’abord le droit et la médecine, puis il se lancera dans la politique en se voulant le champion du républicanisme révolutionnaire sous les règnes de Charles X, de Louis-Philippe, puis de Napoléon III. Il sera hostile à la seconde Restauration.
C’est seulement âgé de 17 ans, qu’il militera contre le procès des 4 sergents de La Rochelle, condamnés à mort pour avoir adhéré à la société secrète de La Charbonnerie et fomenté des troubles dans leur régiment. Venant du Carbonarisme, mouvement politique italien qui s’était développé à Naples pour en chasser Murat et, en 1815, rétablir sur le trône Ferdinand IV, La Charbonnerie s’était constituée en France sur le même mode pour lutter contre le régime de la Restauration. Elle fut un temps présidée par La Fayette, puis elle fut absorbée par d’autres sociétés républicaines à la fin de la Restauration.
Par la suite, pour Blanqui se succéderont complots, coups de force manqués et emprisonnements. En 1829, il entre au journal d’opposition libérale « Le Globe », et, en 1830, il jouera un rôle important dans la révolution des 27, 28 et 29 juillet, « Les Trois Glorieuses », qui mettra fin au règne de Charles X, mais ouvrira la voie à la monarchie de juillet et ne pourra empêcher Louis-Philippe d’accéder au trône. Après quoi, Blanqui adhèrera à la « Société des amis du peuple » et il se liera avec d’autres opposants au régime Orléaniste. En janvier 1831, à la suite de manifestations, il sera emprisonné pendant trois semaines à La Grande Force (un hôtel dans Paris aménagé en prison). Fin 1831, du fait de ses activités, il sera à nouveau arrêté et condamné à un an de prison. A son procès il déclarera que « toute révolution est un progrès ». Le 6 mars 1836, il sera à nouveau arrêté et il sera incarcéré durant huit mois, puis il sera placé en liberté surveillée à Pontoise, mais en 1837, il reprendra ses activités révolutionnaires en qualité de participant à « La Société des Saisons », une association républicaine. Le 12 mai 1839, à Paris, en compagnie de Barbès, autre révolutionnaire, il sera à la tête de l’insurrection qui s’emparera du Palais de Justice et de l’Hôtel de ville. Ce sera un échec et on comptera 50 tués et 190 blessés. Il devra alors rester caché pendant 5 mois, mais le 14 octobre il sera arrêté et, quatre mois plus tard condamné à mort, toutefois, sa peine sera commuée en détention à perpétuité et il sera enfermé au Mont Saint Michel. Durant sa captivité, son épouse, Amélie-Suzanne Serre, décèdera. Malade, il sera transféré à Tours. C’est en 1847 que, suite à une pétition, il sera gracié par le roi, Louis-Philippe 1ier. Ce qui ne l’empêchera pas, par la suite, de s’associer aux manifestations parisiennes de la révolution des 22, 23 et 24 février 1848 qui mettront fin au règne du monarque pour instaurer la II république. En outre, il fondera la « Société Républicaine Centrale », un club républicain auquel adhèrera notamment Baudelaire. Ayant encore eu recours à la violence, il sera enfermé à Vincennes et il sera traduit devant la Haute Cour de Justice de Bourges le 7 mars 1849. Condamné à 10 ans de prison, il sera envoyé à Doullens dans la Somme, puis, en octobre 1850, il sera transféré à Belle-Ile-en-Mer, en décembre, à Corte en Corse, et par la suite, jusqu’au 16 août 1859, jour de sa libération, à Mascara, en Algérie.
En 1848, aura paru une publication d’un journaliste nommé Taschereau accusant Blanqui d’avoir dénoncé les noms de meneurs de sociétés secrètes. Il y aura une longue polémique qui aboutira à la conclusion que le document qu’il aurait signé est un faux, mais cette affaire causera grand mal à sa popularité.
Lors du Second Empire, Blanqui reprendra ses activités révolutionnaires et, le 14 juin 1861, il sera encore arrêté et à nouveau condamné à 4 ans de prison. Enfermé à Sainte-Pélagie, à Paris, il s’évadera en août 1865 et regagnera la Belgique d’où il continuera sa propagande contre le gouvernement jusqu’à ce que l’amnistie générale de 1869 lui permette de revenir en France. C’est alors qu’avec ses partisans, il contribuera à fonder la république de 1870 et il prendra même la tête d’un comité provisoire pour remplacer le gouvernement de défense nationale, mais seulement durant dix heures du fait de diverses querelles au sein de son organisation.
A Paris, durant le siège de l’armée allemande, la vie est extrêmement difficile et la disette oblige les parisiens à manger les chats, les chiens et même les rats. Mais le peuple refuse de se rendre aux Prussiens. Le gouvernement veut négocier avec Bismarck un armistice provisoire, à la suite de quoi une nouvelle assemblée nationale sera élue et décidera de la guerre ou de la paix, ce qui est réalisé, mais déclenchera la Commune de Paris, dont on verra plus loin les détails. Le 8 février 1871, dans un pamphlet, Blanqui accusera le gouvernement de dictature et de « haute trahison et d’attentat contre l’existence même de la nation ». Il va quitter Paris pour Bordeaux. Il sera arrêté le 17 mars 1871 à Bretenoux, dans le Lot, où il est allé se reposer chez un ami médecin. Malade, il sera conduit à l’hôpital de Figeac, alors non seulement alité, mais encore sous surveillance de la police, il ne pourra pas participer aux évènements qui vont se dérouler à Paris. Le 22 mai il sera transféré à Morlaix. Ramené à Paris, avec les autres communards il sera jugé et, bien qu’il ait été absent de la Capitale lors de la Commune, il sera condamné à la déportation et tout d’abord interné à Clairvaux. C’est le 21 février 1879 que Clemenceau, sympathisant et reconnaissant ses qualités, interviendra à l’Assemblée Nationale afin qu’il soit amnistié, disant de lui qu’il est un « ferme républicain ». Sa réputation est alors tellement grande que, malgré qu’il soit emprisonné, il sera élu député de Bordeaux, mais son élection sera invalidé. Le 10 juin 1879, il sera libéré et il se consacrera alors à l’amnistie de ses camarades communards. Il créera un journal intitulé « Ni Dieu ni maître » et il se déplacera dans toute la France pour diffuser ses idées. C’est le 1ier janvier 1881 qu’il sera terrassé par une congestion cérébrale. A son enterrement, il y aura cent mille personnes.
Surnommé « l’enfermé », Auguste Blanqui aura passé trente-cinq années de sa vie en prison, le but de ses activités révolutionnaires étant d’instaurer une république vraiment socialiste.
Armand Barbès
Il est né à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, le 18 septembre 1809, fils aîné d’une famille bourgeoise, son père étant chirurgien militaire.
Revenu en métropole avec ses parents qui se sont installés dans l’Aude, à Carcassonne, à vingt ans, déjà volontaire, il va prendre la tête d’un bataillon local pendant la révolution de 1830. En 1832, il se rend à Paris pour suivre des études de droit. Par la suite, son