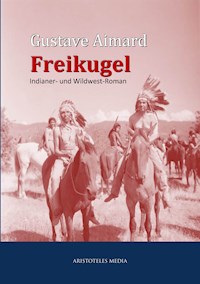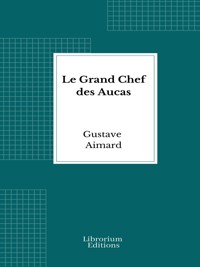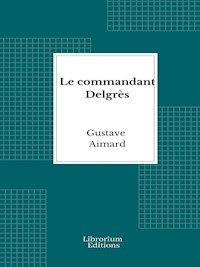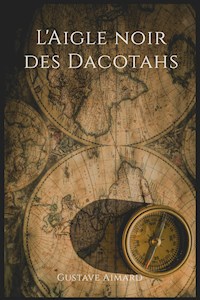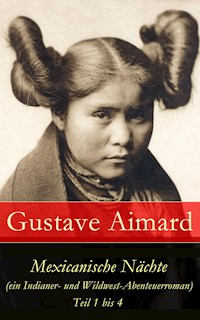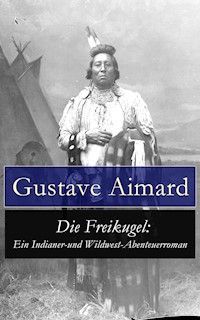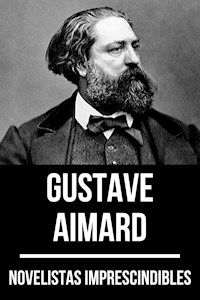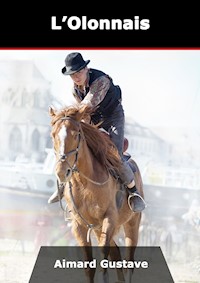14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,36 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,36 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bauer Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Les salteadores de la sierra de Tolède, ou pour mieux dire les gentilshommes de la montagne, ainsi qu'ils s'intitulaient pompeusement eux-mêmes, étaient des gens assez peu scrupuleux de leur nature ; et n'ayant de préjugés d'aucune sorte, pas même celui du respect de la vie humaine, ils avaient d'abord vu d'un assez mauvais œil l'établissement d'un étranger dans le voisinage de leurs impénétrables retraites ; la première pensée qui leur était venue, pensée essentiellement logique, du reste, au point de vue de leur intérêt particulier, était qu'ils avaient affaire à un espion. En conséquence, ils résolurent de surveiller l'étranger, déterminés à le tuer sans rémission à la moindre démarche suspecte qu'ils lui verraient faire.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Gustave Aimard
Le forestier
table des matières
Chapitre 1 Où le lecteur fait à peu prêt connaissance avec No Santiago Lopez et avec sa famille.
Chapitre 2 Quelques heures peu agréables dans la sierra de Tolède.
Chapitre 3 Comment le malheur entre dans une maison.
Chapitre 4 Où il est prouvé que ni l’or ni la grandeur ne rendent heureux.
Chapitre 5 Le serment d’Annibal.
Chapitre 1 Ce qui se passait entre quatre et cinq heures du matin, le 28 février 1664, sur une plage déserte aux environs de Chagrès.
Chapitre 2 Comment s’accomplit la première étape.
Chapitre 3 Quel homme c’était en réalité que le señor don Jesus Ordoñez de Silva y Castro, propriétaire de l’hacienda del Rayo.
Chapitre 4 Comment don Fernan devint amoureux de doña Flor et loua une maison à don Jesus.
Chapitre 5 Quelle singulière nuit don Fernan passa dans la hacienda del Rayo.
Chapitre 6 De quelle manière le capitaine Laurent, alias don Fernan, pénétra pour la première fois dans la casa Florida.
Chapitre 7 Où il est démontré que ce n’est pas toujours un tort d’écouter ce que disent certaines personnes.
Chapitre 8 Comment le comte de Castel Moreno s’installa dans sa nouvelle demeure.
Chapitre 9 dans lequel certains lecteurs retrouveront quelques-unes de leurs anciennes connaissances.
Chapitre 10 Où l’on voit appareiller la flotte flibustière.
Chapitre 11 Comment le capitaine de Sandoval invita don Fernando à déjeuner à bord de la corvette « la Perle ».
Chapitre 1 Où le lecteur fait à peu prêt connaissance avec No Santiago Lopez et avec sa famille.
Chapitre 1Où le lecteur fait à peu prêt connaissance avec No Santiago Lopez et avec sa famille.
A cinq ou six lieues, un peu plus ou un peu moins peut-être, de la ville de Tolède, l’antique capitale des rois goths, puis des rois maures, après le démembrement du califat de Cordoue, et qui, après avoir eu deux cent mille habitants, en compte à peine vingt-cinq mille aujourd’hui, tant la dépopulation marche vite dans cette malheureuse Espagne ; à cinq ou six lieues environ, dis-je, de cette ville célèbre, dans les montagnes, au fond d’une vallée verdoyante et presque ignorée, s’élevait à l’époque où commence cette histoire, c’est-à-dire vers 1628, une humble chaumière construite en rondins, couverte tant bien que mal en chaume, appuyée contre un rocher énorme qui la défendait du vent du nord, et entourée sur les trois autres faces par un enclos, bien entretenu et fermé d’une haie vive de bois épineux.
La vallée à l’une des extrémités de laquelle s’élevait cette chaumière était peu étendue ; elle avait une lieue de tour à peine, et était coupée en deux parties presque égales par une rivière qui, torrent au sommet des montagnes, tombait de cascade en cascade dans la vallée, et arrivée là fuyait silencieusement sous les glaïeuls, avec ce murmure presque insaisissable de l’eau sur les cailloux qui a le privilège de tant charmer les esprits rêveurs.
Rien de plus poétique, de plus calme et de plus reposé que l’aspect de ce petit coin de terre perdu dans ces montagnes où meurent sans écho tous les bruits du monde ; Thébaïde charmante, où la vie s’écoule pure et tranquille loin des soucis des villes et des haines mesquines des envieux.
Le 18 mai 1628, un peu avant midi, un homme jeune encore, grand, bien découplé, à la physionomie douce et énergique à la fois, revêtu du costume des habitants de la campagne des environs de Tolède, portant un fusil sous le bras gauche et un chevreuil sur le cou, descendit presque en courant les pentes abruptes de la montagne, par un véritable sentier de chèvres ou de forestier ; il se dirigea tout droit vers la chaumière, suivi ou plutôt précédé par deux superbes chiens, au museau allongé, aux oreilles pendantes, tachetés de feu sur leur robe brune ; en approchant de la cabane ils prirent leur course, bondirent par-dessus la haie dont la porte était close et s’élancèrent dans l’intérieur de la chaumière, où ils disparurent en poussant des aboiements joyeux, auxquels répondit un énorme molosse sur un ton plus grave.
Presque aussitôt, comme si ces aboiements eussent été pour elles un signal, trois femmes sortirent de la chaumière, suivies des chiens, et s’avancèrent en toute hâte au-devant du chasseur.
De ces trois femmes, la première avait, de quelques années, dépassé la trentaine ; ses traits conservaient les traces d’une beauté qui, quelque dix ans auparavant, avait dû être remarquable, sa taille était droite, flexible, et possédait cette morbidezza gracieuse qui caractérise les Andalouses et les femmes de la Nouvelle-Castille.
Ses compagnes étaient deux jeunes filles, âgées, la première de quinze ans, la seconde de quatorze à peine ; toutes deux étaient blondes de cette teinte nacrée particulière à la race gothique et avaient les yeux et les sourcils noirs, ce qui donnait un cachet étrange à leur physionomie rieuse et expressive ; leurs traits, peut-être un peu trop réguliers, étaient d’une perfection rare ; leur éblouissante et fière beauté avait cette sauvagerie hautaine qu’on ne rencontre que dans les grandes solitudes, qui séduit et charme à la fois et est un attrait de plus pour la passion.
La femme se nommait Maria Dolores ; les deux jeunes filles, Cristiana et Luz.
Cristiana était l’aînée.
L’homme au-devant de qui venaient ces trois personnes se nommait Santiago Lopez ; il était le mari de Maria Dolores et le père des deux anges blonds qui s’étaient jetés dans ses bras aussitôt qu’il s’était trouvé à leur portée.
Le chasseur débarrassé de ses armes et de son gibier, tous quatre entrèrent dans la chaumière et s’assirent autour d’une table sur laquelle un repas substantiel était préparé, et après une courte prière prononcée à haute voix par le père, ils commencèrent à déjeuner de bon appétit.
Profitons du moment où cette famille aux mœurs patriarcales prend paisiblement son repas pour raconter en quelques mots son histoire, ou du moins ce qu’on savait de cette histoire, ce qui n’était pas grand-chose.
Un jour, il y avait seize ou dix-sept ans de cela, un homme âgé d’une trentaine d’années au plus, venant du côté de Tolède, était arrivé dans la vallée alors complètement déserte.
L’étranger était suivi d’une vingtaine d’ouvriers et de plusieurs mules chargées de vivres, d’outils et de matériaux de toutes sortes, conduites par des arrieros qui portaient non pas le costume castillan ou andalou, mais celui des provinces basques.
Après avoir visité la vallée, et l’avoir pour ainsi dire étudiée sur toutes les faces, l’étranger avait semblé fixer son choix sur la partie la plus reculée ; il fait un signe aux ouvriers qui, après avoir aidé les arrieros à décharger les mules, s’étaient immédiatement mis à la besogne avec une grande ardeur.
Les uns construisaient une maison, ou plutôt une chaumière, les autres défrichaient une assez grande étendue de terre, pour faire un enclos d’abord, puis plusieurs champs assez vastes.
Le terrain n’appartenant à personne, on pouvait en prendre tant qu’on voulait.
Jamais, depuis des siècles, si grande animation n’avait régné dans cette vallée ; les arbres tombaient avec fracas, étaient sciés et préparés pour former les murailles ; les forgerons et les serruriers travaillaient sur des forges portatives ou des établis improvisés ; personne ne restait inactif.
L’étranger surveillait les travaux, expliquait ses plans et donnait des conseils.
Bref, les travaux furent menés avec une telle activité qu’en moins d’un mois la chaumière, haute d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage, parfaitement distribuée à l’intérieur, et complètement construite en bois, était achevée, ainsi qu’un grand hangar, une écurie pour trois chevaux, une étable et un cellier.
Le jardin ou huerta était enclos, dessiné, planté d’arbres fruitiers amenés de Tolède en plusieurs voyages, et garni de fleurs. Les champs défrichés étaient ensemencés ; deux vaches et une chèvre placées dans l’étable, deux chevaux à l’écurie, et plusieurs chiens de chasse et de garde attachés dans des niches, auprès d’une basse-cour remplie de poules et de canards.
Les meubles seuls manquaient, mais ils arrivèrent, aussitôt la maison construite, ainsi que de linge et de la vaisselle.
Ces meubles étaient simples, mais solides et capables de faire un long usage.
Lorsque tout fut terminé à sa satisfaction, l’étranger, qu’on appelait No Santiago Lopez, rassembla les ouvriers, les félicita sur la façon dont ils avaient accompli leur besogne, leur paya ce qu’il leur devait et les congédia en leur donnant une gratification considérable ; ce qui fit que ceux-ci se retirèrent non seulement satisfaits, mais encore en le comblant de bénédictions.
No Santiago dit alors quelques mots à l’arriero mayor, dans une langue que personne ne comprit, mais que celui-ci déclara plus tard être la langue basque ; les arrieros se retirèrent à leur tour et l’étranger demeura seul.
Alors il s’occupa à reconnaître son domaine, et à faire de longues courses dans les environs de sa demeure ; au bout de quinze jours il connaissait la montagne à dix lieues à la ronde, comme s’il l’avait habitée toute sa vie.
Ces quinze jours écoulés, un matin, au lieu de recommencer une de ses interminables promenades habituelles, No Santiago jeta son fusil sur son épaule, siffla ses chiens et se dirigea à grands pas vers l’entrée de la vallée.
À peine atteignait-il la gorge étroite qui débouchait sur le sentier conduisant dans la plaine en serpentant sur les flancs de la montagne, qu’il entendit le refrain d’une chanson basque chantée à pleine voix et scandée par le bruit argentin des grelots des mules.
Bientôt l’arriero qu’il avait congédié quinze jours auparavant, en lui confiant sans doute une mission de confiance, apparut au détour du sentier.
Il conduisait quatre mules chargées de bagages ; derrière ces mules quatre personnes marchaient au petit pas.
La première était une jeune femme de dix-huit à dix-neuf ans, d’une beauté remarquable, mais pâte, frêle et d’une physionomie triste et maladive.
Les trois autres, deux hommes jeunes, grands et vigoureux, et une femme de vingt-deux à vingt-trois ans, assez jolie et très fraîche, étaient des serviteurs ; l’un des deux hommes, nommé Pedro, était le mari de cette femme ; l’autre, Juanito, était le frère de Pedro, et par conséquent le beau-frère de Paquita la servante.
En apercevant les arrivants, No Santiago s’élança au-devant d’eux.
Les serviteurs s’arrêtèrent et le saluèrent avec ce respect joyeux que les domestiques nés dans la maison professent pour le maître qu’ils sont accoutumés à chérir.
No Santiago leur rendit leur salut en souriant, et prenant la jeune femme dans ses bras :
— Vous voilà donc enfin, Dolores ! s’écria-t-il ; oh ! que je suis heureux de vous voir, que le temps me pesait loin de vous !
— Et à moi, mon cher don Luis ! s’écria-t-elle en lui rendant ses caresses avec effusion.
— Pas ce nom, mon cher amour, pas ce nom ! s’écria-t-il en lui fermant la bouche d’un baiser : vous savez bien ce qui a été convenu.
— Pardonnez-moi, ami, reprit-elle avec un sourire qui illumina son beau et doux visage comme un rayon de soleil passant entre deux nuages, j’étais si heureuse de vous voir que j’avais tout oublié.
— N’en parlons plus, mignonne, et laissez-moi vous gronder.
— Me gronder, mon cher seigneur, et pourquoi donc ?
— Comment, faible comme vous l’êtes, au lieu d’être commodément assise sur votre mule vous obstinez-vous à marcher ?
— J’en ai fait l’observation a madame la comtesse, grommela l’arriero ; elle n’a pas voulu m’écouter.
— Eh bien, Arreguy ! s’écria vivement No Santiago, qu’est cela ? que dites-vous donc ?
— Bah ? reprit-il gaiement, nous sommes en famille ici, nous ne risquons rien, laissez-moi parler à ma guise, monseigneur ; ne craignez pas que je vous trahisse, votre secret est en sûreté avec moi.
Qu’il fut comte ou non, l’étranger lui tendit la main.
— Je le sais.
On arriva à la chaumière, doña Dolores sourit.
— Oh que nous serons heureux ici ! s’écria-t-elle avec joie.
— Oui, si nos persécuteurs ne nous découvrent pas, répondit tristement son mari.
— Comment cela pourrait-il se faire ? reprit-elle. N’êtes-vous pas mort, et bien mort, pour tous, et moi, n’ai-je pas fui en France, où j’ai pris le voile dans un couvent d’une province éloignée ?
— C’est vrai, dit-il ; ne songeons donc plus qu’à vivre pour nous ; puisque nous sommes désormais séparés de la société, soyons heureux par notre amour.
— Qui nous suffira, mon cher seigneur, c’est le paradis qu’une telle existence.
Le lendemain, No Santiago partit avec l’arriero pour Tolède.
Là ils se séparèrent, peut-être pour ne plus se revoir. Arreguy retournait en Biscaye.
Ce fut les larmes aux yeux que les doux hommes se serrèrent la main pour la dernière fois.
Bien que la vallée que No Santiago occupait n’appartint, en réalité, à personne, l’étranger, qui craignait surtout les tracasseries et les vexations que les autorités de la ville voisine auraient pu exercer contre lui, avait résolu de couper court à tout prétexte de la part du fisc de Tolède pour venir le troubler dans sa solitude.
Il s’était abouché avec un notaire de la ville, et l’avait chargé de proposer à l’ayuntamiento l’achat de la vallée.
Les membres du conseil de ville n’avaient d’abord pas compris un mot à cette affaire ; ils ignoraient jusqu’à l’existence de la vallée ; mais comme, en fin de compte, d’où qu’il vienne, l’argent est toujours bon à prendre, après plusieurs pourparlers assez longs, l’ayuntamiento, réuni en conseil, avait consenti à vendre au sieur No Santiago Lopez, cultivateur, ainsi désigné, la propriété pleine et entière de toute la vallée, pour lui et ses hoirs ou ayants droit en jouir, vendre ou céder à leur guise et sans autorisation préalable de personne, moyennant la somme de deux mille piastres fortes, en bon argent sonnant et trébuchant, marquées au coin du roi actuellement régnant.
À cette vente était annexé sur la demande expresse du forestier, le droit de chasse à perpétuité et en toute saison sur la montagne, dans un périmètre de quinze lieues tout autour de la dite vallée, et cela moyennant une seconde somme de mille piastres une fois payée.
Une seule réserve était faite en faveur de Sa Majesté le roi, si, pendant son séjour à Tolède, où il venait assez souvent, la fantaisie lui prenait de chasser dans la montagne ; ce qui élevait la vente à la somme ronde de trois mille piastres, soit quinze mille francs de notre monnaie, laquelle somme devait immédiatement être versée entre les mains du conseil de la ville par le notaire chargé de l’achat.
Ce que celui-ci fit séance tenante ; on lui remit alors l’acte de vente parfaitement en règle, et les consuls de la noble cité tolédane se frottèrent joyeusement les mains, car ils avaient fait une excellente affaire.
À cette époque comme aujourd’hui, les montagnes de Tolède jouissaient d’une si exécrable réputation, comme servant de refuge à tous les bandits de la province, qui tuaient et détroussaient les voyageurs, sans que jamais les alcades ni leurs alguazils osassent s’y opposer, que nul n’aurait osé élever des prétentions sur la vallée qu’il avait plu à No Santiago de choisir pour y établir sa demeure.
Quoi qu’il en fût, celui-ci récompensa généreusement le notaire, serra le papier avec soin, et regagna gaiement la montagne, où il arriva deux heures avant le coucher du soleil, tant il avait grand désir de revoir sa femme, dont il était séparé depuis le matin.
Alors commença pour les solitaires une existence réellement patriarcale.
Paquita était la sœur de lait de doña Maria Dolores ; Pedro et Juanite étaient, eux, les frères de lait de No Santiago, de sorte que ces cinq personnes formaient réellement une même famille, tant ils étaient unis.
Cependant, malgré les prières de No Santiago et même malgré ses ordres, jamais les trois serviteurs ne consentirent à s’asseoir à la table avec leur maître.
De guerre lasse, celui-ci finit par les laisser vivre à leur guise ; ce qui les rendit très joyeux.
No Santiago chassait, Maria Dolores surveillait le ménage, Paquita faisait les gros ouvrages et soignait la basse-cour, les hommes entretenaient le jardin et labouraient les champs.
Chaque dimanche, la petite colonie allait entendre la messe dans une pauvre bourgade située sur le versant de la montagne, du côté de Tolède.
Ils étaient heureux !
Au bout de quelques mois les deux femmes accouchèrent à quelques jours d’intervalle.
Paquita, la première, mit au monde un gros garçon.
Quinze jours plus tard. Maria Dolores donna le jour à une charmante petite fille.
Paquita voulut nourrir les deux enfants ; d’ailleurs, elle ne savait pas lequel elle aimait le mieux, le sien ou celui de sa maîtresse.
L’année suivante, nouvel accouchement dans les mêmes conditions. Les choses se passèrent comme la première fois ; ce fut encore Paquita qui fut la nourrice des deux enfants.
La femme de No Santiago, puisque tel est le nom dont, pour des motifs sans doute très graves, il a plu à notre personnage de s’affubler, doña Maria Dolores, dis-je, soit que l’air pur et vif de la montagne lui eût fait du bien, soit que le bonheur calme dont elle jouissait eût apaisé en elle certaines douleurs secrètes, avait senti peu à peu ses forces revenir avec la santé ; jamais elle ne s’était sentie mieux portante.
Et puis maintenant elle avait une distraction charmante, une occupation délicieuse pour une mère, le soin de ses enfants.
Ceux-ci se portaient à ravir ; du matin au soir leurs frais et cristallins éclats de rire résonnaient dans le jardin comme des chants d’oiseaux ; filles et garçons s’ébattaient sous l’œil vigilant de leurs parents, qui les regardaient en souriant doucement.
Le Père Sanchez, un pauvre jeune prêtre plein de foi, d’intelligence et de bonté, qui desservait l’église du village dont nous avons parlé plus haut, s’était chargé de l’éducation des enfants, auxquels trois fois par semaine il venait régulièrement donner ses leçons.
Ces jours-là étaient des jours de joie pour la petite colonie ; parfois le digne prêtre consentait à passer la nuit dans la chaumière.
La lendemain, lorsqu’il partait, tout le monde l’accompagnait jusqu’à l’extrémité de la gorge qui terminait la vallée, et on le suivait des yeux jusqu’à ce qu’il eut disparu dans les méandres du sentier de la montagne.
Les salteadores de la sierra de Tolède, ou pour mieux dire les gentilshommes de la montagne, ainsi qu’ils s’intitulaient pompeusement eux-mêmes, étaient des gens assez peu scrupuleux de leur nature ; et n’ayant de préjugés d’aucune sorte, pas même celui du respect de la vie humaine, ils avaient d’abord vu d’un assez mauvais œil l’établissement d’un étranger dans le voisinage de leurs impénétrables retraites ; la première pensée qui leur était venue, pensée essentiellement logique, du reste, au point de vue de leur intérêt particulier, était qu’ils avaient affaire à un espion.
En conséquence, ils résolurent de surveiller l’étranger, déterminés à le tuer sans rémission à la moindre démarche suspecte qu’ils lui verraient faire.
Cette surveillance dura une année tout entière.
Les dignes gentilshommes qui, du matin jusqu’au soir, ne perdaient pas une seconde de vue le forestier, arrivèrent enfin, après ce temps écoulé, à se convaincre que l’étranger ne songeait nullement à eux ; ils en conclurent que c’était un esprit malade, un misanthrope qui fuyait comme la peste les autres animaux de son espèce, et s’était réfugié au fond des bois, afin d’y vivre seul et loin des hommes que sans doute il détestait.
Alors la surveillance cessa.
Et non seulement elle cessa, mais encore les salteadores, se piquant d’amour-propre et ne voulant en aucune façon gêner un voisin si paisible et si peu embarrassant, firent un crochet de quelques milles, se retirèrent enfin à droite et à gauche, de manière à lui laisser la libre jouissance de son ermitage.
Le forestier s’était parfaitement aperçu des diverses manœuvres de ses voisins les gentilshommes de la montagne, mais il avait feint de ne pas les voir, de crainte de leur faire ombrage.
Plus tard, des relations, peu fréquentes mais assez facilement acceptées de part et d’autre, s’étaient nouées tout doucement entre les deux parties contractantes, selon les exigences de la situation, la nécessité ou le hasard.
C’est-à-dire qu’il était arrivé que maintes fois un bandit serré de trop près avait cherché un refuge dans la chaumière ; refuge qui jamais n’avait été refusé ; d’autres fois un salteador blessé avait été recueilli, pansé et guéri par la famille du forestier, qui, lui, n’avait, au contraire, jamais eu besoin d’avoir recours pour quoi que ce fut à ses voisins.
Il en était résulté de tout cela que le forestier était réellement le roi de la montagne, et qu’une protection occulte, mais attentive et dévouée, veillait incessamment sur lui et sur sa famille.
Malheur à celui qui, cédant à une mauvaise inspiration, aurait osé faire au forestier ou à quelqu’un des siens la plus légère injure, il l’eut immédiatement payée de sa vie.
Lorsque les filles de No Santiago furent assez grandes pour accompagner leur père, et que même, souvent, selon leur caprice, elles s’amusèrent à courir seules les montagnes comme des biches effarouchées, escortées de leurs frères de lait, aussi jeunes qu’elles, cette protection occulte redoubla, et jamais les jeunes filles n’eurent à se repentir de leur témérité.
Quand, le dimanche, la petite colonie de la vallée partait pour entendre la messe au hameau situé sur le versant de la montagne, la maisonnette demeurait seule, portes et fenêtres ouvertes, sous la garde des chiens ; plus formidablement protégée par sa faiblesse même que si elle eût eu une garnison.
Si par hasard un bandit passait par là, ayant faim ou soif, il entrait, mangeait un morceau, buvait un coup, et se retirait après avoir remis tout en place et caressé les chiens, qui l’accompagnaient en remuant la queue jusqu’à la porte de l’enclos.
Depuis près de seize ans les choses allaient ainsi dans cette vallée, coin de terre ignoré, mais où tant de bonheur se trouvait réuni, le jour où commence cette trop véridique histoire.
Voilà quel était, on du moins paraissait être l’homme que le lecteur sait maintenant être le propriétaire de la chaumière, et ce qui se disait sur son compte.
Lorsque le déjeuner fut terminé, No Santiago tordit une cigarette ; mais, au lien de monter dans sa chambre pour faire la sieste, ainsi qu’il en avait l’habitude après son repas de midi, il remit ses guêtres qu’il avait ôtées, prit son fusil et siffla son chien.
— Vous sortez, don Luis ? lui demanda sa femme.
Il n’avait jamais pu l’habituer à lui donner un autre nom.
— Oui, répondit-il, j’ai relevé les passées d’un sanglier ; je ne serais pas fâché d’aller voir un peu si je retrouverai l’endroit où il s’est remisé ; c’est un solitaire, chassé probablement par nos voisins de la montagne ; il s’est réfugié près d’ici.
— Vous feriez mieux de rester ; voyez, le ciel se couvre, il y aura certainement de l’orage ; vous savez combien les orages sont terribles dans la montagne.
— Oh ! il n’éclatera pas avant ce soir ; dans deux ou trois heures au plus tard je serai de retour.
— Tatita, demanda doña Cristiana, le Père Sanchez vous a-t-il dit que monseigneur le roi est à Tolède depuis quatre jours ?
— Oui, mignonne : mais que nous importe cela ?
— Pas beaucoup, en effet mais Juanito dit avoir entendu ce matin le cor dans la montagne.
— Il ne s’est pas trompé, mignonne, je l’ai entendu, moi aussi.
— Ah ! fit doña Dolores, peut-être est-ce la cour qui chasse. Dieu veuille que le hasard ne conduise pas de ce côté un chasseur égaré !
— Que nous ferait cela, mon cher amour ? Ne sommes-nous pas chez nous, ici ?
— Oui, mais…
— Bannissez ces craintes puériles, señora, nous sommes plus en sûreté ici que dans l’Alcazar de Séville ; du reste, je ne crois pas que la cour chasse aujourd’hui ; le cor que nous avons entendu est probablement celui de nos voisins ; ce sont, vous le savez, de déterminés chasseurs ; tout gibier leur est bon, ajouta-t-il en riant. Au revoir !
— Ne vous attardez pas, je vous en supplie, don Luis ! je ne sais pourquoi, mais je vous vois partir avec peine ; tout le temps que durera votre absence, je serai mortellement inquiète.
— Je vous promets, à moins de circonstances impossibles à prévoir, de rentrer avant le coucher du soleil, et cela d’autant plus que, ainsi que vous l’avez dit, le temps se met définitivement à l’orage.
Là-dessus, il embrassa sa femme et ses enfants, siffla son chien, sortit et s’éloigna à grands pas dans la direction de la montagne.
Mais les chasseurs sont de tous les hommes les plus oublieux ; dès qu’ils sont lancés sur la piste d’un gibier quelconque, ils ne se souviennent plus de rien.
Les heures se passèrent sans que le forestier, en quête sous la feuillée, songeât une seule fois à regagner sa demeure.
À plusieurs reprises, il avait entendu des fanfares sous le couvert, mais il n’y avait attaché qu’une médiocre attention ; il ne voyait que son solitaire, ou plutôt il ne le voyait pas, ce dont il était fort vexé.
Le soleil était couché depuis longtemps ; le soir était venu, avec le soir l’orage.
Plusieurs éclairs blafards avaient sillonné le ciel ; le tonnerre avait grondé à plusieurs reprises, et tout à coup la pluie s’était mise à tomber fine et drue avec une force extrême ; de plus, l’obscurité était devenue complète.
Le forestier se rappela alors qu’il avait promis à sa femme de rentrer de bonne heure ; il se mit immédiatement, quoiqu’un peu tardivement, en devoir de remplir sa promesse.
Bien qu’il fit très sombre, il connaissait trop bien la montagne pour craindre de s’égarer.
Il marchait donc aussi rapidement que le lui permettait le terrain accidenté qu’il foulait, lorsque soudain son chien commença à aboyer avec force ; et il crut entendre un cliquetis d’épées à une courte distance de l’endroit où il se trouvait.
Sans réfléchir davantage, il lança le chien sur cette piste et le suivit en courant.
Bientôt il déboucha dans une étroit clairière au centre de laquelle un cavalier démonté et se faisant un rempart de son cheval mort se défendait en désespéré contre six bandits qui l’attaquaient tous à la fois.
Autant que le forestier en pût juger à la lueur d’un éclair, ce cavalier, entièrement vêtu de velours noir, était un gentilhomme de haute mine, pâle, maigre, assez jeune encore et dont la physionomie un peu effacée avait cependant un indicible cachet de grandeur et de noblesse.
— Holà ! mes maîtres, s’écria le forestier en dégainant son couteau de chasse et en se plaçant d’un bond à la droite du cavalier. À quel jeu jouons-nous donc ici ?
— No Santiago ! s’écrièrent les assaillants, qui avaient reconnu sa voix.
Et ils tirent un pas en arrière.
Le cavalier profita de cette trêve pour reprendre haleine.
— Eh ! compère ! dit en riant un des bandits, ce n’est pas d’un bon chasseur, de venir ainsi au secours de la bête lorsqu’elle est aux abois et qu’il ne faut plus qu’un coup pour la mettre à bas ; laissez-nous terminer notre besogne, ce sera bientôt fait.
— Non, par le Dieu vivant ! s’écria résolument le forestier, à moins que vous ne m’abattiez, moi aussi.
— Allons, allons, No Santiago, laissez-nous faire ; que vous importe cet homme que vous ne connaissez pas ?
— C’est un de mes semblables en danger de mort, cela me suffit, je veux le sauver.
— Prenez garde, No Santiago, nous avons un proverbe terrible dans la montagne : l’étranger que l’on épargne est un ennemi implacable qu’on se fait.
— Il en sera ce que Dieu décidera, répondit généreusement le forestier, qui cependant avait senti un frisson de terreur glacer son cœur, mais je défendrai cet homme un péril de ma vie.
Il y eut un silence de deux ou trois secondes.
— Puisque vous l’exigez, No Santiago, reprit enfin un des bandits, nous nous retirons ; nous ne voûtons pas vous refuser la première demande que vous nous adressez ; mais, je vous le répète, prenez garde à cet homme. Adieu ! et sans rancune, No Santiago. Allons ! en route, vous autres ajouta-t-il en s’adressant à ses compagnons.
Les bandits disparurent dans les ténèbres, et le forestier demeura seul auprès de l’homme qu’il avait si miraculeusement sauvé.
Chapitre 2 Quelques heures peu agréables dans la sierra de Tolède.
Chapitre 2Quelques heures peu agréables dans la sierra de Tolède.
L’inconnu, accablé par la fatigue et peut-être un peu aussi par l’émotion qu’il avait éprouvée lors de la lutte inégale qu’il avait si bravement soutenue contre les bandits, s’était laissé choir sur le sol, où il gisait presque sans connaissance.
Le premier soin du forestier fut de lui venir en aide et d’essayer de lui faire reprendre ses forces épuisées.
De même que les autres chasseurs ses confrères, il avait toujours une gourde remplie d’aguardiente pendue à son côté.
Il la déboucha, et versa quelques gouttes de ce qu’elle contenait sur les lèvres de l’étranger.
Ce secours suffit pour le rappeler à lui.
Il se redressa et parvint avec l’aide du chasseur à se remettre debout.
— Êtes-vous blessé, señor ? lui demanda No Santiago avec intérêt.
— Non, je ne crois pas, répondit-il d’une voix faible encore, mais qui se raffermissait de plus en plus ; quelques égratignures peut-être, mais rien de grave.
— Dieu soit loué ! mais comment se fait-il que je vous rencontre en si fâcheuse position ?
— Le roi chassait aujourd’hui.
— Ah !
— Oui, j’appartiens à la cour ; emporté malgré moi à la poursuite de la bête, je me suis égaré.
— Et vous avez été attaqué par six bandits qui vous malmenaient fort.
— Lorsque heureusement pour moi Dieu vous a envoyé à mon secours.
— Oui, fit le forestier en souriant, je crois qu’il était temps qu’il vous arrivât de l’aide.
— Si grand temps même, señor, que, sans vous maintenant je serais mort ; je vous dois la vie, señor, je m’en souviendrai.
— Bah ! oubliez cela, c’est la moindre des choses ; j’ai fait pour vous ce que j’aurais fait pour tout autre.
— C’est possible, cela me prouve que vous êtes un homme de cœur, mais ne diminue en rien la dette que j’ai contractée envers vous. Je suis riche, puissant, bien en cour, je puis faire beaucoup pour mon sauveur.
— Oubliez-moi, caballero, je ne vous en demande pas davantage. Grâce à Dieu, je n’ai besoin de la protection de personne, le peu que je possède me suffit ; je suis heureux dans ma médiocrité, tout changement ne pourrait que m’être défavorable.
L’inconnu soupira.
— Vous souffrez, reprit vivement le forestier ; la fatigue, le besoin peut-être, vous accablent ; l’orage redouble, nous ne pouvons rester ici plus longtemps ; il nous faut trouver un abri ; croyez-vous pouvoir retrouver le rendez-vous de chasse ?
— Je l’ignore, je ne connais ni ces bois ni ces montagnes.
— Alors, à cette heure de nuit, il serait imprudent de vous y aventurer davantage. Vos forces sont-elles un peu revenues, pensez-vous être en état de marcher ?
— Oui, maintenant je suis fort, donnez-moi encore quelques gouttes de la liqueur contenue dans votre gourde, cela me remettra complètement.
Le forestier lui passa sa gourde, l’inconnu but et la lui rendit.
— Maintenant, dit-il, je suis prêt à vous suivre ; où allons-nous ?
— Chez moi.
— Loin d’ici ?
— À une lieue à peine, mais, je vous en avertis, par des chemins exécrables.
— Cela n’est rien, je suis accoutumé à courir les montagnes de nuit comme de jour.
— Tant mieux alors, partons.
— Oui, car j’ai hâte d’arriver quelque part, mes vêtements sont traversés, le froid me glace.
— Eh bien, en route !
L’inconnu se pencha sur son cheval, retira les pistolets contenus dans les fontes et les passa à sa ceinture.
— Pauvre Saïd, dit-il, un si noble animal tué par de misérables bandits !
— Ne vous plaignez pas, señor, sa mort vous a sauvé en vous permettant de vous faire un rempart de son corps.
— C’est juste.
Ils quittèrent alors la clairière ; malgré ce qu’avait dit l’étranger, il lui fallait une énergie surhumaine pour suivre les pas du forestier et ne pas rouler sur le sol.
No Santiago s’aperçut de l’état d’accablement dans lequel se trouvait son hôte : malgré ses protestations, il l’obligea à prendre son bras, et ils continuèrent à s’avancer, mais plus doucement.
— Arrea, mon bellot ! cria le forestier à son chien, en avant ! en avant ! va prévenir nos amis.
Le chien s’élança et disparut dans les taillis, comme s’il eût compris la mission de salut que son maître confiait à son intelligence.
Cependant Dieu a posé aux forces de l’homme une limite que dans aucun cas elles ne sauraient franchir ; malgré des efforts de volonté inouïe, il arriva un moment où l’étranger fut réduit à l’impossibilité complète, même avec l’aide du forestier, non seulement de faire un pas de plus, mais encore de se tenir plus longtemps debout.
Il s’affaissa sur lui-même, poussa un soupir de désespoir et roula aux pieds de No Santiago, non pas évanoui, mais, malgré son courage de lion, trahi par sa faiblesse.
Le forestier s’élança vers lui, le releva et l’assit sur le tronc renversé d’un arbre tombé de vieillesse.
L’orage redoublait d’intensité, les éclairs se succédaient avec une rapidité telle que le ciel, d’un bout de l’horizon à l’autre, ressemblait à une immense nappe de feu d’un jaune pâle et sinistre.
Le tonnerre grondait et roulait sans interruption avec des éclats terribles ; le vent mugissait avec une rage irrésistible, fouettant les branches, tordant et brisant les arbres comme des fétus de paille, les emportant dans sa course échevelée, et les faisant tourbillonner dans l’espace ; la pluie qui tombait avec un redoublement de force changeait le terrain en marécages où l’on enfonçait presque jusqu’à mi-jambe ; des torrents impétueux se précipitaient du haut de la montagne avec un bruit horrible, entraînant et renversant tout sur leur passage, détruisant les sentiers et ouvrant des fondrières d’une profondeur insondable.
C’était un spectacle d’une effroyable beauté que celui offert par cette manifestation grandiose de la colère divine.
Si le forestier eut été seul, quelques minutes à peine lui auraient suffi pour gagner sa demeure, mais il ne voulait pas abandonner son compagnon ; cependant il ne se faisait aucune illusion sur la situation terrible dans laquelle il se trouvait : demeurer où il était, c’était la mort, inévitable, horrible.
Il se pencha sur l’inconnu :
— Du courage, señor, lui dit-il doucement de cette voix qu’on emploie pour parler aux enfants ou aux malades.
— Ce n’est pas le courage qui me manque, monsieur, répondit l’inconnu, ce sont les forces ; les miennes sont totalement épuisées, je suis anéanti.
— Essayez de vous lever.
— Tout effort serait inutile, le froid me glace, je le sens qui gagne le cœur, je suis comme paralysé.
— Que faire ? murmura le forestier en se tordant les mains.
C’était une belle et forte nature que celle de cet homme, vaillante et énergique entre toutes ; une de ces natures d’élite qui luttent jusqu’au dernier souffle contre les obstacles même insurmontables et ne tombent que mortes.
— Tenez, señor, reprit l’étranger, dont la voix allait s’affaiblissant de plus en plus, ne résistez pas plus longtemps contre la fatalité qui s’acharne après moi ; vous avez fait tout ce qu’il était humainement possible de faire pour me sauver ; puisque vous n’avez pas réussi, c’est que je dois mourir.
— Ah ! si vous désespérez, s’écria-t-il d’une voix nerveuse, nous sommes perdus !
— Je ne désespère pas, mon ami, mon sauveur ; non, loin de là, je me résigne, voilà tout ; j’ai confiance dans la miséricorde divine. Mais, je le sens, ma dernière heure ne tardera pas à sonner ; Dieu me pardonnera, je l’espère, mes fautes, en faveur de mon sincère repentir et de la docilité avec laquelle j’accepte ses arrêts terribles.
— Fadaises que cela, señor ; Dieu, que son saint nom soit béni n’est pour rien dans tout ceci ; soyez homme, levez-vous ; avant dix minutes nous serons en sûreté ; ma chaumière est à deux portées de fusil à peine de l’endroit où nous sommes si malencontreusement arrêtés.
— Non, señor, je vous le répète, je suis incapable de faire le plus léger mouvement, ma prostration est extrême : abandonnez-moi, fuyez, sauvez-vous, puisque vous le pouvez encore.
— Ce que vous me dites serait une insulte gravé, señor, si vous n’étiez pas en si fâcheux état.
— Pardonnez-moi, señor, donnez-moi la main, je vous en conjure, partez, partez ! Qui sait si dans un instant il se sera pas trop tard ? Je vous le répète encore, tous vos efforts pour me sauver seraient inutiles, abandonnez-moi.
— Non, par le Dieu vivant ! je ne vous abandonnerai pas, señor ; nous vivrons ou nous périrons ensemble, je le jure par mon nom et par ma foi de… – mais, se reprenant aussitôt – de forestier ! Ce n’est point la première fois que je me trouve en semblable transe ; allons, allons, courage ! Vive Dieu ! nous allons voir qui restera victorieux de la matière inintelligente et brutale ou de l’homme, ce chef-d’œuvre intelligent fait à l’image de Dieu. Eh bien ! cuerpo de Cristo ! puisque vous ne pouvez pas marcher, je vous porterai ; nous nous sauverons ou nous périrons ensemble.
Et tout en prononçant ces paroles avec une feinte gaieté, le forestier, sans vouloir écouter davantage les dénégations et les protestations de l’inconnu, l’enleva comme il eût fait d’un enfant, entre ses bras puissants, le chargea sur ses épaules avec une force herculéenne, et, s’appuyant sur son fusil, se mit résolument en route, déterminé à périr plutôt que d’abandonner lâchement l’homme qu’il avait si généreusement sauvé.
Alors commença une lutte réellement gigantesque et qui dépasse toutes les limites du possible, de la volonté intelligente contre l’inertie féroce de la matière, aveugle et bouleversée par l’ouragan.
Chaque pas que faisait le forestier lui coûtait des efforts surhumains, surtout avec le poids dont ses épaules étaient surchargées ; il marchait comme un homme ivre, chancelant et trébuchant, s’enfonçant jusqu’aux genoux dans une boue liquide dans laquelle il redoutait à chaque seconde de rester englouti ; fouetté par les branches qui lui déchiraient le visage, aveuglé par la pluie, et à demi affolé par le vent qui lui coupait la respiration.
Cependant, il ne se rebutait pas, redoublait d’efforts, et suivait imperturbablement sa route, qu’il perdait et retrouvait vingt fois en dix secondes, au milieu de ce chaos horrible de tous les éléments en fureur ligués contre lui.
En une demi-heure, ce fut à peine s’il réussit à avancer d’une centaine de pas.
Alors il calcula froidement, avec cette netteté d’esprit de l’homme dont la résolution est inébranlable, que, en supposant qu’il ne fût pas brisé dans un précipice, englouti dans une fondrière ou complètement accablé par la fatigue qui déjà faisait perler une sueur froide à ses tempes, il lui fallait, si l’on ne venait pas à son secours, sept heures, de la façon dont il avançait, avant que d’atteindre la chaumière.
— À la grâce de Dieu ! murmura-t-il, il est au bout de tout ; il arrivera ce que dans sa divine sagesse il a décidé déjà sans doute ; mais, tant que mes forces me resteront, je ne m’abandonnerai pas et je continuerai la lutte, mais combien de minutes encore conserverai-je mes forces ?
Il étouffa un soupir et redoubla ses efforts déjà prodigieux. Quelques minutes s’écoulèrent.
L’inconnu pendait, masse inerte, sur l’épaule du forestier, sans donner signe de vie. Il était mort ou privé de sentiment.
— Tout à coup des aboiements furieux se firent entendre à peu de distance.
Le forestier s’arrêta ; il respira à deux ou trois reprises, et un sourire joyeux éclaira son mâle visage.
— Voilà mes braves chiens, dit-il, tout est sauvé !
Alors réunissant toutes ses forces :
— Oh là ! oh ! cria-t-il d’une voix stridente qui domina le fracas de la tempête : hallo ! oh ! mes bellots ! arrea ! arrea !
Les chiens redoublèrent leurs aboiements et bientôt ils apparurent suivis à quelques pas par deux hommes qui tenaient des torches.
— Dieu soit béni ! vous voilà enfin ! s’écrièrent ces deux hommes avec une joie presque religieuse, tant ils adoraient leur maître.
— Mais qu’est cela ? demanda Pedro.
— Un homme que j’ai sauvé et qui a grand besoin de secours, mon ami.
— La señora s’était bien doutée qu’il y avait quelque chose comme cela sous jeu, dit Juanito d’un ton bourru.
— La señora ! J’espère que par ce temps horrible elle n’est pas dehors ? s’écria-t-il vivement.
— Non, non, señor, rassurez-vous, elle est là-bas ; nous avons eu assez de peine à l’empêcher de venir !
— Digne et sainte créature ! murmura le forestier.
— Mais ce n’est pas tout cela, notre maître, il faut sortir d’ici, et le plus tôt sera le mieux.
— Oui, oui, hâtons-nous, ce pauvre malheureux est bien mal.
— Ce que c’est que de nous ! murmura Juanito, qui était un esprit fort ; bah ! après nous la fin du monde.
L’inconnu fut doucement posé à terre ; le forestier se pencha sur lui, et interrogea son pouls ; il était faible, mais distinct : l’inconnu était évanoui.
No Santiago se redressa.
— Nous le sauverons ! dit-il joyeusement.
— Amen ! répondirent les deux serviteurs.
— Allons, à la besogne vivement, faisons un brancard.
— Oh ! ce ne sera pas long.
— Surtout si nous nous y mettons tout de suite.
Les chiens léchaient doucement le visage de l’inconnu en poussant de petits cris plaintifs.
Ces caresses le firent revenir à lui ; il ouvrit les yeux.
— Mon Dieu ! murmura-t-il, j’ai cru mourir.
— Vous vous êtes trompé, heureusement, dit gaiement le forestier.
— Ah ! vous, mon sauveur, près de moi, encore.
— Toujours.
— Vous ne m’avez pas abandonné ?
— Vous abandonner ! allons donc, on voit bien que vous ne me connaissez pas, allez !
— Vous m’avez encore sauvé !
— Tout ce qu’il y a de plus sauvé. Ainsi, soyez tranquille.
— Comment m’acquitterai-je jamais avec vous ?
— Je vous l’ai dit déjà, en ne me donnant rien ; ce sera facile.
— Oh ! ne me parlez pas ainsi.
— Pourquoi donc cela ? Tenez, laissez-moi vous parler franc, afin de couper court à votre reconnaissance.
— Dites.
— Est-ce que vous vous figurez que je vous ai sauvé pour vous et que je me suis donné toute la peine que j’ai prise dans le but de vous être agréable ?
— Dans quel but, alors ?
— Allons donc ! vous êtes fou, señor. Je ne vous connais pas, moi ; je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir. Tout ce que j’ai fait, je l’ai fait pour moi seul, par égoïsme, purement et simplement ; pour me faire plaisir, enfin. J’adore rendre service ; c’est une manie comme une autre : chaque homme a la sienne, moi, j’ai celle-là, voilà tout.
— Quel homme étrange vous êtes !
— Je suis comme cela ; c’est à prendre ou à laisser.
— Ah ! comme vous avez dû souffrir pour en arriver à émettre sérieusement de telles théories, contre lesquelles votre cœur lui-même se révolte.
— Qui sait ? Peut-être oui, peut-être non ; mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit pour le présent ; comment vous trouvez-vous ?
— Mieux, beaucoup mieux ; je crois même que je serais en état de marcher.
— C’est une erreur ; votre faiblesse est trop grande encore pour que j’y consente ; voilà le brancard terminé, nous allons vous y étendre doucement, et puis après en route.
— Oh ! non, je vous assure…
— Je n’entends rien, laissez-vous faire.
Sur un signe du forestier, les deux serviteurs enlevèrent l’inconnu dans leurs bras et l’étendirent sur le brancard, puis ils prirent chaque bout du brancard qu’ils enlevèrent.