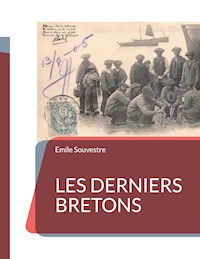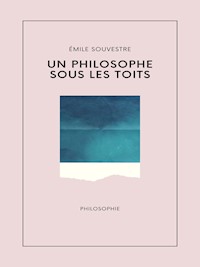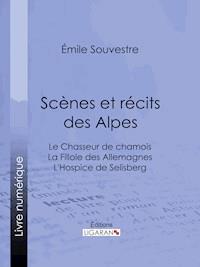Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Extrait : "Regardez l'enfant qu'une folle ronde emporte : ivre de plaisir, il tourne, il chante, il bondit !... et tout à coup, au milieu même de son transport, vous le voyez s'arrêter ; il abandonne les mains de ses compagnons de jeux, il s'éloigne ; il va au coin le plus reculé se reposer un instant de sa joie, et chercher un peu de silence et d'obscurité. Ce besoin de l'enfant, qui ne l'a éprouvé dans le mouvement du monde ?"
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LE FOYER BRETON.
W. Coquebert, Éditeur.
À
MONSIEUR MICHELET,
PROFESSEUR ET HISTORIEN.
On raconte qu’un magicien, après avoir étudié l’organisme humain dans tous ses détails, voulut créer un homme semblable à ceux qui étaient sortis de la main de Dieu. Il modela donc une statue merveilleuse par l’imitation des formes et de la couleur, et il cacha, dans son sein, un mécanisme puissant qui lui donna la vie ; mais, à sa grande surprise, les fils d’Adam demeurèrent sans sympathie pour ce nouveau frère. – Pourquoi les hommes s’éloignent-ils ainsi de mon œuvre ! s’écria le magicien ; ne l’ai-je point faite à leur image ? ne sait-elle point agir et parler comme eux ? – Pourquoi ? répéta un sage, qui avait entendu sa plainte, c’est que ton fils a un ressort à la place du cœur !
L’histoire, sans les traditions populaires, ressemble à la statue du magicien ; elle ne vit qu’en apparence ; elle a beau reproduire les motifs, les actes, les conséquences, l’homme reste froid parce qu’il ne sent point en elle ce qu’il y a en lui ; le ressort communique bien le mouvement, mais le cœur manque toujours.
Et le moyen qu’il en soit autrement ? Si l’histoire est la révélation complète de l’existence d’un peuple, comment l’écrire sans connaître ce qu’il y a de plus caractéristique dans cette existence ? Vous me montrez ce peuple dans sa vie officielle ; mais qui me dira sa vie du foyer ? Après avoir connu ses actes publics, qui sont toujours le fait d’un petit nombre, où pourrai-je apprendre ses habitudes journalières, ses inclinations, ses fantaisies, qui sont du domaine de tous ? Ne voyez-vous pas que ces indications sur la vie intime d’une nation se trouvent principalement dans les traditions populaires ? C’est là que le sentiment commun à tous prend la forme particulière qui trahit chaque race ; car il en est de nos âmes comme des corps sensibles qui, éclairés par une même lumière, la décomposent diversement et se teignent de couleurs variées.
Nous ne voulons point dire, on le comprend, que les traditions soient toute l’histoire ; mais nous croyons qu’elles en forment une partie essentielle. Pense-t-on, par exemple, que beaucoup de livres en apprennent autant sur l’Orient que les Mille et une Nuits ? Où trouverons-nous un tableau plus naïf et plus charmant de cette société qui n’a que deux pivots, le sensualisme et l’autorité ? Grâce à lui, ne la connaissez-vous pas, non seulement dans ses mœurs, mais dans ses rêves, ces confessions déguisées de nos plus secrets désirs ? Que vous lisiez l’histoire d’Aladin, de Mazen ou des Calenders, ne retrouvez-vous point partout la trace des aspirations pour lesquelles Mahomet inventa son paradis ? Et quelle fécondité d’inventions ! Que d’air et de parfums dans ces gracieuses fantaisies ! C’est un panorama de l’Orient, non en plein soleil, mais à la nuit étoilée, vers l’heure des aventures, alors que les Guèbres commencent leurs conjurations, que les portes des souterrains, où dorment les trésors cachés, s’entrouvrent mystérieusement, et que les péris s’abattent, comme des cygnes, sur les lacs enchantés.
Et, si vous voulez comprendre jusqu’à quel point les contes populaires reflètent le caractère des races, opposez à ces voluptueuses visions de l’Asie une des traditions du Nord ; celle des Petits enfants de Dyring, par exemple :
« Dyring s’en alla dans une île et épousa une jolie jeune fille. Il vécut avec elle sept ans et devint père de six enfants ; mais voilà que la mort passe par la contrée et le beau lis sans tache succombe.
Dyring s’en va dans une autre île et se choisit une nouvelle épouse. Après le mariage, il la ramène dans sa demeure. Malheureusement elle était dure et méchante. Elle entre, et elle voit les petits enfants affligés qui la regardent, qui pleurent, et elle les repousse rudement.
Elle ne leur donne ni bière, ni pain, et elle leur dit : – Vous aurez faim et soif. Elle leur ôte leurs coussins bleus, et elle leur dit : – Tous coucherez sur la paille. Elle leur ôte les cierges brillants, et elle leur dit : – Vous resterez dans l’obscurité !
Le soir, les petits enfants pleuraient ; leur mère les entendit sous sa couche de terre ; elle les entendit dans son froid linceul et résolut de retourner près d’eux. Elle s’avance devant notre seigneur, et lui dit : – Permets que j’aille voir mes petits enfants ; et elle continua à l’implorer jusqu’à ce qu’il lui eût permis de retourner sur terre : toutefois il lui imposa la condition de revenir avant le chant du coq.
Elle souleva ses jambes fatiguées et franchit les murs du cimetière. Comme elle passait dans le village, les chiens firent retentir l’air de leurs hurlements. Quand elle arriva dans sa demeure, elle trouva sa fille aînée debout sur le seuil : – Que fais-tu là, chère fille ? lui dit-elle, et où sont tes frères et sœurs ?
– Pourquoi m’appelles-tu chère fille ? répondit l’enfant ; tu n’es pas ma mère ! Ma mère était belle et jeune, ma mère avait des joues blanches et roses ; toi, tu es pâle comme une morte.
– Comment pourrais-je être belle et jeune ? Je viens de l’empire de la mort, et mon visage est pâle ; comment pourrais-je être blanche et rose ? j’ai été morte si longtemps.
Elle entre dans la chambre de ses enfants, et elle les trouve pleurant. Elle lave le premier, elle tresse les cheveux du second, elle console le troisième et le quatrième, elle prend le cinquième dans ses bras comme pour l’allaiter ; puis elle dit à sa fille aînée :
– Va-t’en prier Dyring de venir ici.
Et quand Dyring entra dans la chambre, elle s’écria avec colère :
– J’avais laissé ici de la bière et du pain, et mes enfants ont faim ; j’avais laissé des coussins bleus, et mes enfants couchent sur la paille ; j’avais laissé des cierges brillants, et mes enfants sont dans l’obscurité. S’il faut que je revienne ici, il vous arrivera malheur !
Maintenant, voilà que le coq rouge chante ; tous les morts doivent rentrer en terre ; maintenant, voilà que le coq noir chante, les portes du ciel s’ouvrent ; maintenant, voilà que le coq blanc chante, je ne peux rester plus longtemps.
Depuis ce jour, chaque fois que Dyring et sa femme entendaient aboyer les chiens, ils donnaient aux enfants de la bière et du pain, et chaque fois qu’ils entendaient les chiens hurler, ils avaient peur de voir reparaître la morte. »
Quelle distance entre cette sombre légende et les riantes féeries des Arabes ! Comme on sent qu’ici tout est changé, le ciel, les croyances, les hommes ! Tout à l’heure on ne nous montrait que palais étincelants d’or, que fées charmantes et prêtes à l’amour, que bassins d’eau vive embaumée par les roses, que festins délicieux ; et maintenant c’est une morte qui « soulève de la tombe ses jambes fatiguées ; » c’est une mère qui vient réclamer pour ses enfants orphelins « des coussins bleus, des cierges, de la bière et du pain ! » Qui ne sent, à ces contrastes, la différence des races et des contrées ? Des deux côtés se révèlent la fantaisie : mais l’une religieuse, sobre, austère ; l’autre riche, capricieuse et ardente ! Là-bas, c’est la volupté qui est la muse ; ici, c’est déjà le devoir.
Il serait facile, en multipliant ces rapprochements, de montrer, dans les traditions, jusqu’aux moindres reflets des individualités nationales. Ainsi, sans parler des contes populaires de l’Espagne, où l’élément arabe se mêle, avec tant de charme, à l’inspiration chevaleresque, nous pourrions comparer les traditions de l’Allemagne, toujours poétiques, mais parfois obscures ou puériles, à celles de l’Écosse si positives dans leur fantastique même. Près de la ballade follement gracieuse de l’Irlande, « cette terre des genêts fleuris et des pelouses vertes, » nous pourrions citer les traditions populaires de la France, si logiques, si fines, si railleuses, et le plus souvent si philosophiques sans le vouloir ! Car c’est là, surtout, le caractère du conte populaire, il est à son insu ce qu’il est. Né de tous, il ne connaît point de père. C’est un bruit pareil à celui qui s’élève des harpes éoliennes : le vent du siècle souffle à travers une génération, et il en sort des chants ; seulement, comme il y a pour cordes des hommes, les chants disent ce que les hommes sentent et ce qu’ils sont.
Quiconque doute de cette vérité n’a qu’à relire les traditions recueillies par Perrault. Il y retrouvera, à chaque page, cet esprit impatient, vivace, mobile, qui peut, tour à tour, ainsi que le génie dont parle Dinarzade, se renfermer dans l’urne étroite scellée au sceau de Salomon, ou monter jusqu’aux nuées. Voyez, en effet, comme partout perce la sympathie pour le faible et le goût de l’égalité, ces deux vertus françaises de tous les temps. Que ressort-il de Barbe-Bleue, de Peau d’âne, de la princesse Finette, de la Belle et la Bête, sinon la supériorité du droit sur la force et de la pensée sur la matière ? Et ce Chat botté, espèce de Mascarille, si fécond en imaginatives, qui sert par affection et sans gages un cadet dont il fait la fortune ; et ce Petit Poucet, si gai dans son malheur, si bon pour ses frères, si courageux contre le géant ; et cette Cendrillon, que méprisent, parce qu’elle est utile, des sœurs vaines de leur oisiveté ! Ne reconnaissez-vous point là autant de personnifications du peuple, méconnu comme Cendrillon, poursuivi par les ogres comme le Petit Poucet, dévoué au maître qu’il a choisi comme le Chat botté. En inventant ces fables, c’était lui-même qu’il peignait ; c’étaient ses propres sentiments qu’il essayait de traduire ; c’étaient surtout ses aspirations. Non qu’il le voulût ; les inventions de ce genre ne sont jamais le résultat d’un système, mais d’une nature ; l’imagination du peuple travaille en suivant son penchant, sans parti pris, et, selon ce que Dieu l’a faite, son œuvre est un follicule de soie ou un rayon de miel.
C’est dans ce sens que les traditions ont une signification symbolique importante pour l’histoire. Outre l’inspiration commune que l’on retrouve dans toutes, et qui est comme le cachet de la grande unité humaine, chacune voile, sous sa fable, une passion particulière et dominante qui indique, pour ainsi dire, le tempérament moral du peuple auquel elle appartient. Il y a plus : confiés à la mémoire des générations qui se remplacent l’une l’autre, les contes populaires en rappellent la succession ; ils retiennent quelque chose des opinions ou des coutumes de chaque siècle, et finissent par ressembler à ces coupes géologiques où les âges du globe se trouvent écrits par couches superposées.
On a nié l’importance des traditions en prétendant qu’elles ne renfermaient, en général, que des faussetés. Cela peut être vrai pour les faits, mais jamais pour les sentiments ; ceux-ci se révélant toujours, dans la tradition, tels qu’ils ont été réellement éprouvés par ceux qui les expriment : « Nous pouvons affirmer, dit Grimm, que dans les traditions et les chants du peuple, nous n’avons pas encore rencontré un seul mensonge ; le peuple les respecte trop pour ne pas les laisser tels qu’ils sont et tels qu’il les sait. Quant aux parties et aux détails qui, par l’effet du temps, peuvent s’en détacher et se perdre, ainsi que des branches isolées se dessèchent et tombent de la cime des grands arbres pleins d’ailleurs de sève et de force, la nature y a pourvu, et, là comme partout, elle prend soin de réparer ses pertes par d’éternels renouvellements… Il n’y a de possible, en fait d’invention, que ce que le poète a senti et éprouvé dans son âme. L’homme qui veut faire isolément de la poésie populaire, tirée de son propre fonds, échoue inévitablement ; car il ne peut rester dans la juste nature des choses : il n’atteint pas, ou il dépasse. »
On doit distinguer dans les traditions les chants et les récits.
Les chants, mieux préservés de l’altération par le rythme, ont toujours quelque chose de plus authentique ; ils traduisent d’ailleurs des sensations, tandis que les récits embrassent seulement des faits ; les uns ne donnent que la pensée d’un siècle, les autres nous en apprennent l’accent. Ce qu’un peuple chante est toujours ce qu’il a besoin d’épancher au loin, de répandre dans l’air pour que tous le respirent avec lui. Aussi, voyez comme la passion de chaque époque s’est clairement exprimée dans ses chants, depuis les Bacchanales et les Reverdies de notre renaissance païenne jusqu’aux noëls démolisseurs du dix-huitième siècle, jusqu’aux romances guerrières de l’Empire. Mais la chanson exige la brièveté ! Elle ne peut traduire qu’un seul sentiment ou qu’un seul souvenir ; encore faut-il qu’elle le concentre en un petit nombre de formules étincelantes. Le récit, plus ample, admet, au contraire, tous les détails, et peut prendre toutes les allures. Rien ne le borne, rien ne l’enchaîne, pas même le possible ! L’imagination populaire, resserrée dans les traditions rythmées, rappelle ces essences qui, sous un faible volume, concentrent mille parfums, tandis que, plus libre dans les traditions parlées, elle roule comme une eau vive qui emporte, parmi ses flots, tout ce qu’elle rencontre. On peut donc dire que les chants et les récits se commentent et se complètent l’un l’autre. Également instructifs, quoique par des moyens différents, ils forment les deux cordes « de cette vieille lyre dans laquelle dort l’âme du passé. »
Les chants populaires de la Bretagne ont déjà été publiés ; il ne restait qu’à recueillir ses récits, et c’est là ce que nous essayons aujourd’hui.
La difficulté de l’entreprise nous a longtemps retenu. Il ne s’agissait plus seulement de faire passer dans notre langue des poèmes formulés et que nous pouvions traduire d’après les chanteurs ; ici, il fallait sténographier un récit entrecoupé où le geste et l’inflexion avaient autant de valeur que la parole. Il fallait démêler la trame primitive sous les broderies de fantaisie ; car, livré aux caprices de la mémoire, le même conte se modifiait selon le conteur. Nous devons dire pourtant que ces variantes altéraient rarement le fond du récit, et que nous avons souvent éprouvé une singulière surprise en entendant la même tradition racontée dans les paroisses de la plaine et dans celles des montagnes avec les mêmes incidents, les mêmes réflexions et presque les mêmes termes.
Ces traditions sont fort variées de nature, de style et d’étendue ; cependant on pourrait en distinguer de trois sortes : celles qui ont pour origine un fait consacré par la chronique du pays ou par ses légendes religieuses ; celles où tout relève de l’invention, mais d’une invention évidemment nationale ; enfin celles qui semblent empruntées, pour le fond, à des traditions étrangères et que le génie breton s’est appropriées par les détails. Ces dernières sont surtout curieuses à cause des comparaisons auxquelles elles peuvent donner lieu.
Quant à la forme, les contes populaires de la Bretagne en affectent deux bien distinctes : l’une familière, flottante, cadencée et sans repos ; l’autre scandée par strophes et soutenue par une certaine emphase. Cette dernière forme n’est employée que pour les récits de peu d’étendue, et sans doute primitivement soumis à la mesure du vers ; la transmission verbale aura, à la longue, altéré le rythme du récit, et l’aura amené à cette prose cadencée.
Le plan suivi par nous dans le livre que nous publions s’écarte, en plusieurs points, de celui des recueils de contes populaires imprimés jusqu’à présent. Quoique la Bretagne ait inspiré, dans ces derniers temps, beaucoup de romances et de feuilletons, nous la croyons plus exploitée que connue ; et nous avons pensé que, pour être bien senties, ses traditions avaient besoin d’être entourées de ce qui les explique et de ce qui les colore. Qu’est-ce que l’improvisation du conteur napolitain sans le portique de marbre cuivré par le soleil, sans le lazzarone qui écoute, sans la brune Italienne qui sourit ? Rien de ce qui vit ne peut rester dans le vide ; il faut à tout récit son théâtre, son auditoire, son acteur. C’est là ce que je me suis efforcé de faire ; j’ai placé chaque tradition dans son milieu, je l’ai mise en scène, en la faisant redire et écouter par des Bretons. Les esquisses dont j’ai encadré les contes populaires que je publie sont donc de véritables commentaires, mais des commentaires dramatiques destinés à compléter la peinture de la Bretagne poétique que j’ai essayée ailleurs.
J’ai employé indifféremment les noms de contes et de traditions, en parlant des récits populaires que je publie, parce qu’ils participent également de ces deux formes. Grimm accuse la même confusion dans ceux qu’il a recueillis. « La nature, dit-il, n’établit nulle part de démarcations sensibles et tranchées. Dans la poésie, il n’y a que quelques divisions générales ; toutes les autres sont fausses et forcées. Encore ces grandes divisions elles-mêmes ont-elles leurs points de contact, et rentrent-elles les unes dans les autres. La distinction entre l’histoire, la tradition et le conte, est, sans doute, une des plus marquées et des plus rationnelles que l’on puisse admettre ; cependant, il y a des cas où l’on serait très embarrassé de décider à laquelle de ces trois classes appartient le récit qu’on a sous les yeux. Ainsi, par exemple, Frau holla tient à la fois du conte et de la tradition, et, souvent, une circonstance traditionnelle peut être également du ressort de l’histoire. »
Il n’existe jusqu’à présent aucun recueil des traditions parlées de notre vieux duché. Si l’exemple que je donne est imité, j’aurai du moins signalé le premier (comme je l’avais fait pour les traditions chantées) une source nouvelle d’études historiques et littéraires. Les contes que l’on va lire sont, en effet, bien loin d’être les seuls que l’on puisse recueillir dans les quatre évêchés bretons : nous aurions pu en donner un grand nombre d’autres, d’un intérêt égal ; mais l’étroitesse du cadre forçant à faire un choix, nous nous sommes bornés à publier les plus connus, ceux desquels s’exhalait cette senteur du pays qui ne peut tromper.
Un mot maintenant sur la méthode que nous avons cru devoir adopter pour notre travail.
Nous ne pouvions ici, comme pour les traditions rythmées, compiler un texte dans différentes versions écrites sous la dictée des chanteurs, puis traduire ce texte ; pour les récits que nous avions à reproduire, le fond et les principaux détails nous étaient seuls fournis, la forme, fréquemment modifiée, ne pouvait être reproduite que par approximation, il fallait enfin nous résigner à conter nous-mêmes d’après les conteurs. Or, cette nécessité avait mille périls, au premier rang desquels se trouvait l’infidélité involontaire de la transmission. Obligé de donner en français ces traditions bretonnes, nous pouvions, à notre insu, en altérer l’allure, y mêler des idées, des expressions, des images françaises. Il n’y avait qu’un moyen d’échapper à ce danger, c’était d’écrire d’abord nos récits en breton ! De cette manière, nous étions sûr de ne rien dire que ce qui avait été dit, ou du moins que ce qui pouvait être dit par les conteurs. La langue même nous défendait contre toute amplification étrangère ; nous nous trouvions place dans une atmosphère armoricaine ; forcé d’être Breton par la pensée et l’expression. Nous nous sommes, en conséquence, résigné à ce travail ingrat, et, avant de traduire en français les contes que nous donnons ici, nous les avons écrits dans la langue du pays qui les a produits et conservés. Nous ne sommes point sûr que nos récits aient littérairement rien gagné à ce travail, mais nous sommes certain d’être ainsi resté plus près de la véritable forme adoptée par les conteurs nationaux.
Nous devons dire pourtant qu’il nous est arrivé, parfois, de mêler au récit des explications dont ces derniers s’exemptent, mais indispensables pour les personnes auxquelles les coutumes ou les superstitions armoricaines sont peu familières. De plus, les titres, les noms des personnages et les lieux de scènes étant arbitraires, nous avons cru pouvoir les choisir à notre guise ; enfin, il nous est arrivé (notamment pour les Korils de Plaudren) de resserrer en une seule deux traditions appartenant au même sujet.
On trouvera peut-être nos récits bien arrangés pour des récits parlés ; mais nous ferons observer qu’à force d’avoir été répétées, ces traditions ont pris une allure consacrée et pour ainsi dire officielle. Les conteurs ne répètent pas seulement les mêmes faits dans le même ordre ; ils se servent, le plus souvent, des mêmes expressions, et leur narration n’a aucune des incertitudes ni des aventures de l’improvisation ; c’est plutôt une sorte de récitation diversement accentuée, mais toujours un peu monotone, que l’on prendrait, à quelques pas, pour une lecture.
Ces conteurs se partagent en deux classes distinctes : les Discrevellerrs, ou conteurs sérieux, qui commencent toujours par le signe de la croix, mettent une sorte de solennité dans leur débit, et ne mêlent que très rarement, au récit, leurs idées personnelles ; et les Marvailherrs, ou conteurs gais, qui, bien que répétant aussi un thème appris, y introduisent, assez souvent, leurs propres inspirations.
Nous avons intitulé notre livre le Foyer Breton, parce que c’est réellement sur l’âtre de nos paysans, devant leur feu de landes ou d’algues marines, que nous avons écouté les récits qui le composent. Ces souvenirs du pays, nous les renvoyons au pays, qui, nous le craignons, les aura bientôt oubliés tous ! Souvent déjà, quand des Bretons plus jeunes arrivent du vieux duché et que nous essayons de les interroger sur les croyances et les coutumes de notre enfance, nous les voyons s’étonner, ne pas comprendre et interroger à leur tour ! Ainsi les traditions meurent, même sur le sol de granit qui semblait devoir communiquer son immuabilité à tout ce qu’il produit, et le génie moderne a vaincu la ténacité proverbiale « des durs enfants de l’Armor. » Dans ce naufrage du passé, nous tâchons au moins de sauver la poésie, trop heureux si notre livre pouvait devenir jamais ce qu’il voudrait être, c’est-à-dire les Mille et une nuits de la Bretagne.
LE FOYER BRETON.
PREMIER FOYER.
Regardez l’enfant qu’une folle ronde emporte : ivre de plaisir, il tourne, il chante, il bondit !… et, tout à coup, au milieu même de son transport, vous le voyez s’arrêter ; il abandonne les mains de ses compagnons de jeux, il s’éloigne ; il va, au coin le plus reculé, se reposer un instant de sa joie, et chercher un peu de silence et d’obscurité.
Ce besoin de l’enfant, qui ne l’a éprouvé dans le mouvement du monde ? Qui n’a voulu parfois, comme lui, dégager sa main de la ronde humaine et s’en écarter, non par tristesse, mais par lassitude ; pour se reconnaître et donner à son âme le temps de reprendre haleine ?
C’est surtout dans la jeunesse que s’éveillent ces désirs subits de solitude. Au milieu du tourbillon bruyant de l’action, nous entendons s’élever parfois, en nous-mêmes, des voix secrètes ; et, saisis d’une subite langueur, nous laissons tomber la plume, le pinceau ou l’épée, pour aller écouter ces voix à l’écart. Heureux âge où l’on enlève sa fantaisie du milieu de la réalité comme une maîtresse dont le monde nous séparait, et où l’on va vivre quelques jours avec elle, au penchant des prairies et sous le ciel étoilé. Heureux surtout, si l’on pouvait s’oublier plus longtemps dans ces retraites enchantées, et si on n’en était pas bientôt arraché par cette lugubre visiteuse qui marche toujours armée de chaînes et de carcans : LA NÉCESSITÉ !
Je garde encore, au nombre de mes plus doux souvenirs, un de ces exils volontaires, à Kerneïs (la Ferme des Nids), dans le pays de Tréguier. Je n’y avais été conduit ni par ennui, ni par suite d’espérances déçues ; j’y venais l’esprit libre, le cœur content, et sans autre but que de donner de l’espace à la folle du logis.
Cependant, comme une pareille intention, loyalement avouée, n’eût été crue de personne, je m’abstins d’en parler, et je me décidai à un mensonge pour ne pas être accusé de mentir. Prétextant donc une subite passion de chasse, je partis muni de tout l’attirail meurtrier qui devait expliquer et justifier mon séjour à la Ferme des Nids.
Celle-ci était située dans l’arrondissement de Guingamp, à peu de distance de Bourbriac. Elle avait sans doute été habitée autrefois par un de ces gentilshommes-laboureurs qui conduisaient la charrue l’épée au côté, et siégeaient, en sabots, aux états de la province ; mais le temps et l’abandon avaient ruiné le vieux manoir, de sorte que ses débris s’étaient insensiblement transformés en bâtiments d’exploitation. Il ne restait de l’édifice primitif qu’un seul pavillon, dont le toit fléchissant et les murs étançonnés accusaient l’état critique ; il se composait de deux chambres tapissées de toiles d’araignée et meublées d’un lit, d’une table et d’un escabeau. C’était là que le nouveau propriétaire venait passer quelques jours chaque année pour recevoir ses fermages, chasser son gibier et surveiller ses plantations.
Je l’avais plusieurs fois accompagné dans ces campagnes (comme il appelait ses séjours à Kerneïs), de sorte que je connaissais le pays et la famille du fermier. Cette famille se composait du chef de maison, Antonn Gorou, travailleur infatigable quoique déjà sur l’âge ; de sa femme Glanda, plus vieille que lui de quelques années ; de leur fille Margaridd et d’un garçon appelé Cleménçz. Ce dernier habitait ordinairement Guingamp, où il étudiait pour la prêtrise ; mais, lors de mon arrivée, il se trouvait, par hasard, à Kerneïs. Il y avait, en outre, à la ferme, un jeune Kernewodd idiot chargé de garder les moutons sur les landes. Antonn Gorou, qui l’avait recueilli un soir d’hiver, sur la route, presque nu et à demi mort de faim, n’avait pu en obtenir aucun renseignement sur ses parents, et, lui-même, ne se connaissait d’autre nom que le sobriquet méprisant de Lawik.
Tous les habitants de la ferme me firent bon accueil, et je fus bientôt établi dans le pavillon en ruines, que l’on appelait la chambre du maître. La vieille Glauda se chargea de mon ménage, tandis que Margaridd, qui avait la surveillance de la laiterie et du poulailler, devait me nourrir.
Après m’être ainsi assuré, selon la formule antique, le feu et l’eau, je songeai à prendre possession de ma solitude.
Placé sur le penchant de la vallée, Kerneïs était environné d’un labyrinthe de bosquets, de taillis et de haies vives, auquel il devait sans doute son nom de Ferme des Nids. C’était comme un enchaînement de clairières qui morcelait la vallée en mille retraites encadrées de feuillages, ayant chacune son coin de ciel, que teignait une nuée ou qu’éclairait une étoile. Cette disposition créait pour ainsi dire autant de petites solitudes dans la grande solitude. À dix pas de la ferme, on ne voyait déjà plus rien que les arbres, et l’on n’entendait que les oiseaux, gazouillant sous les feuilles. C’était seulement lorsque l’on se dirigeait vers la montagne que l’horizon commençait à se découvrir et la vue à s’étendre. Mais quoique moins restreinte, la perspective restait alors aussi sauvage. Au-dessous des landes tachetées de genêts fleuris, se déroulaient d’agrestes campagnes entrecoupées de bois et de pâtures. De loin en loin seulement, quelques légères fumées qui s’élevaient du milieu des arbres, quelques mugissements de vaches égarées dans les herbages, quelques champs de blés d’un vert plus régulier et plus ondoyant, avertissaient l’œil de la présence des hommes.
Ce fut dans ce riant désert que je donnai la volée à mes fantaisies le quittais la ferme dès le matin avec un livre que j’étais quelquefois plusieurs jours sans ouvrir, et je me lançais, au hasard, dans les sentiers ombreux. J’eus bientôt pris ainsi connaissance de tout mon domaine, et je m’occupai alors de faire un choix.
L’attrait de la nouveauté épuisé, il se trouva que toutes ces retraites me devenaient indifférentes, sauf une seule, qui n’était pourtant ni la mieux exposée, ni la plus fleurie. D’où venait cette préférence ? Je ne pensai point à me le demander alors, et, maintenant, je me le demanderais en vain. Qui peut lire dans le mystère des affections humaines ? Quel souffle les allume, quel souffle les éteint ? Le cœur de l’homme ressemble aux lacs, pleins de courants sans qu’on y voie de pentes, et toujours agités sans qu’on y entende le vent !
Le lieu que j’avais choisi pour retraite habituelle à la Ferme des Nids était un de ces étroits vallons appelés kans dans le pays, espèce de ravins verdoyants que leur forme et leur nom feraient prendre pour les lits de quelques ruisseaux taris. Une fontaine, qui sourdait au niveau des herbes, l’arrosait dans toute sa longueur. Il était fermé d’une haie de prunellier entremêlée de clématites sauvages et de troènes. Près de la source, une touffe d’aubépines formait un toit parfumé. C’était là que j’allais m’asseoir et que je m’oubliais des heures entières dans mes rêveries. Je n’étais point encore alors ouvrier en livres ; je n’avais pas attelé mon imagination à la meule du journalisme ; elle m’appartenait toute entière ; j’en disposais comme de ces fleurs des champs que l’on tresse et que l’on effeuille pour le plaisir d’un instant. Je pouvais inventer mille romans dont j’étais à la fois le héros, le poète et le public. Mon ravin servait de théâtre !… c’était là que je faisais agir et parler mes personnages. Je marquais leur place sous les buissons fleuris, je les voyais marcher sur l’herbe fine, j’entendais leurs voix entrecoupées par les chants de la fauvette et du bouvreuil ! Que d’églogues charmantes ainsi commencées ! que de vagues poèmes interrompus et repris ! que de robes blanches, que de doux regards, que de blondes chevelures entrevues parmi ces herbes et ces feuillages ! L’Arioste parle d’un monde où les fous peuvent aller chercher leurs raisons égarées ; moi, j’avais trouvé là le monde où s’étaient envolés tous mes fantômes de jeunesse. Aussi, comme je prolongeais ces visions enchantées ! Parti le matin de la ferme, je n’y rentrais souvent qu’à la nuit, épuisé de fatigue, mais encore tout occupé de mes chimères et le cœur gonflé d’un attendrissement joyeux.
Là, je retrouvais d’autres sensations moins enivrantes qui me reposaient. Ma soirée se passait à la ferme, où j’écoutais les entretiens de la famille et les contes du foyer. Comme tous les jeunes gens arrachés à la charrue pour devenir prêtres, Cleménçz avait subi une transformation dont nous avons ailleurs expliqué les causes. À ses rudes manières de paysan avaient succédé des habitudes plus douces. Aidé par l’étude, son esprit était devenu souple et compréhensif, en même temps que le repos exaltait la tendresse de ses instincts. Ce développement moral et intellectuel avait encore agrandi l’intervalle qui le séparait de ses vieux parents, et eût rendu son isolement complet s’il n’eût trouvé sa sœur pour le comprendre.
La culture manquait pourtant à Margaridd ; mais elle était femme, elle était jeune, et n’avait que son frère à qui elle pût parler. Que celui-ci se fût trouvé semblable aux autres jeunes gens du pays, et Margaridd fût restée semblable aux autres jeunes filles ; mais il avait d’autres habitudes, et, avec la souplesse de son sexe et de son âge, elle voulut les avoir pour vivre comme lui et avec lui !
Le premier effet de ce désir fut d’engager la jeune fille à apprendre à lire. Cleménçz lui donna des leçons jusqu’au moment où il partit pour Guingamp : alors, elle continua avec un de ces maîtres ambulants qui vont de ferme en ferme apprendre la croix de Dieu et le catéchisme aux enfants, moyennant cinq sous par mois, une poignée de lin chaque année, et des sabots neufs à Noël. Mais, que ce fût la faute du professeur ou de l’écolière, les progrès de Margaridd avec le vieux Guiller avaient été peu sensibles, et le Kloärek l’avait trouvée, à son retour, presque au même point qu’à son départ ; aussi avait-il repris son enseignement, qui avait lieu le matin dans le courtil et le soir près de l’âtre.
J’assistais ordinairement à cette dernière leçon, toujours suivie de causeries, de chants et de récits. Margaridd me répétait les sônes du pays de Tréguier, et Cleménçz racontait des traditions, interrompues de loin en loin par une courte réflexion d’Antonn Gorou ou par un cri admiratif de l’idiot. Parfois le cercle s’agrandissait du maître d’école Guiller, vieillard railleur qui avait blanchi dans la suggestion et la misère, en gardant sa gaieté, ou de quelque chercheur de pain attardé qui gagnait Bohoa. Alors les récits devenaient plus nombreux et plus variés. Guiller, enhardi par le vin de feu emprunté à ma gourde de voyage, racontait librement les aventures de Moustache, et le mendiant passait en revue les traditions de toutes les paroisses comprises dans sa tournée. C’était tantôt l’histoire d’Azénor, renfermé dans la tour de Château-Laudren ; tantôt celle de la Pierre bornale que l’on voit encore à Coëtmieux ; mais surtout les souvenirs de la Lew-Dréz ou Lieu de grève, théâtre favori des merveilleuses aventures. Là avait existé autrefois une cité opulente, maintenant ensevelie sous les dunes. Tous les ans, à la Toussaint, s’ouvrait, dès le premier coup de minuit, une porte qui conduisait à une salle éclairée où se trouvaient les trésors de la ville morte ; mais au dernier tintement de l’horloge, les lumières s’éteignaient, la porte se refermait avec un grand bruit et tout restait clos et obscur jusqu’à l’année suivante. Des hommes trop hardis à connaître ce que Dieu veut leur cacher avaient plusieurs fois tenté de pénétrer jusqu’à la salle lumineuse, et aucun n’en était revenu.
À ces traditions fantastiques s’en mêlaient d’autres empruntées aux légendes, mais remaniées par le génie populaire. De ce nombre s’en trouva une appartenant à la Cornouaille, et dont le souvenir m’est resté d’autant plus vif qu’elle donna lieu à une des scènes les plus étranges dont j’aie été jamais témoin. Je veux parler de la tradition de Comorre que l’on verra plus loin.
Elle nous fut racontée par un mendiant qui arrivait de Gourin, après avoir parcouru toute la montagne. Lawik était accroupi sur la pierre du foyer, où il se balançait, en chantonnant tout bas, selon l’habitude des idiots. Il n’avait point d’abord écouté le conteur, mais insensiblement son attention parut s’éveiller. Il se tut, cessa de se balancer et leva la tête. Ses traits exprimèrent une sorte d’étonnement, puis une intelligence subite. Il se redressa en frappant les mains avec un cri de joie et répétant les noms des principaux personnages de la tradition : il avait évidemment retrouvé un récit familier à son oreille. Le mendiant s’était interrompu, et tous les auditeurs regardaient Lawik avec surprise : je voulus lui adresser quelques questions, mais il ne m’entendait pas ; tous les souvenirs d’enfance, évoqués par le conteur, venaient de s’éveiller à la fois dans cette âme obscure, et d’y répandre mille rapides lueurs. Il s’était levé tout droit, les yeux brillants, les narines gonflées, les cheveux flottants, et il continuait le récit du mendiant en phrases haletantes. Il parlait de Triphyna, de Saint-Veltas, du roi de Vannes, du chien géant, du faucon au collier d’or, puis, s’interrompant tout à coup, il mêlait au récit les images de son passé. Il courait autour du foyer en répétant la chanson de la vieille et en se roulant dans la poussière comme les petits mendiants qui parcourent nos routes ; il comptait tout haut le nombre de liards reçus, il les présentait à un maître invisible dont il fuyait les coups avec des cris plaintifs ; il murmurait le nom d’une femme qu’il appelait vieille tante ; puis, tout à coup, ce nom semblait lui rappeler quelque douleur oubliée, et il s’accroupissait sur l’âtre en sanglotant.
Tout cela apparaissait pourtant d’une manière moins nette et moins suivie que nous ne venons de le dire ; c’était un chaos de gestes, de paroles, d’exclamations au milieu desquelles jaillissaient seulement, de loin en loin, quelques révélations plus claires. On devinait le sens général de ce récit bizarre, mais sans en saisir les détails ; on eût cru entendre une improvisation dans une langue étrangère dont on comprenait seulement certains mots et certaines inflexions qui vous servaient à supposer le reste.
Cette espèce de crise lucide fut d’ailleurs de courte durée. Au bout de quelques minutes, la clarté subite qui avait illuminé la mémoire de Lawik s’éteignit ; sa voix devint confuse, ses mains retombèrent, l’expression de ses traits s’effaça, et, s’accroupissant sur l’âtre avec un murmure plaintif, il reprit son balancement et sa sourde chanson.
Cette scène étrange se renouvela plusieurs fois pendant mon séjour à la Ferme des nids. Éclairé par le hasard sur les moyens de faire revivre les souvenirs de l’idiot, je m’en servis pour savoir de lui ce qu’Antonn Gorou n’avait pu apprendre jusqu’alors. J’aurais beaucoup à dire sur ces interrogatoires bizarres, si je ne craignais de trop prolonger ces esquisses. J’arrive donc tout de suite à la fin de mon séjour au manoir.
Depuis le retour de Cleménçz à la ferme, le vieux maître d’école avait cessé ses leçons à Margaridd ; mais il les continuait à Lawik, qu’il préparait à la première communion, en lui apprenant ses prières. Un matin, comme j’ouvrais ma fenêtre, je l’aperçus dans la cour avec son élève. Il était assis sous la haie d’aubépines, tandis que Lawik, accroupi à ses pieds, l’écoutait en jouant avec de petits cailloux polis dans le ruisseau. Sur leurs têtes gazouillait le rouge-gorge, et à leurs pieds gloussaient les poules avec leurs couvées. De l’autre côté de la haie, mais dans le courtil, Cleménçz donnait également une leçon à Margaridd, agenouillée devant lui. Les sureaux en fleurs formaient autour d’eux une sorte de berceau sous lequel bourdonnaient trois ruches décorées de laine rouge par la jeune fille pour célébrer l’heureuse arrivée du Kloärek. Ces deux groupes, séparés par une barrière fleurie, formaient un contraste digne du pinceau d’un grand peintre. Les voix qui s’élevaient des deux côtés parvenaient distinctement jusqu’à moi ; Margaridd lisait un sône nouvellement imprimé, et l’idiot répétait une prière : il y avait alternativement des pauses de chaque côté du buisson, de sorte que les voix semblaient se succéder et se répondre. Ainsi, quand la voix traînante et inarticulée de l’idiot avait dit :
« Notre père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne nous arrive… »
La voix vive et timbrée de la sœur de Cleménçz continuait :
« Ne répétez à personne, petits oiseaux, que j’ai pris Herriedd pour ma douce belle ; ne dites pas qu’Herriedd est tout mon amour… » Puis Lawik reprenait :
« Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel ; donnez-nous notre pain quotidien… »
Et Margaridd ajoutait :
« Les cheveux d’Herriedd ont la couleur des feuilles mortes, ses yeux sont aussi bleus que l’air et son haleine a le parfum du miel… » Enfin l’enfant murmurait à demi assoupi :
« Pardonnez-nous nos offenses… ne nous laissez pas succomber à la tentation… »
À quoi la jeune fille répondait d’un accent entrecoupé :
« Pour les cheveux d’Herriedd, je donnerais toutes les forêts de la terre ; pour ses yeux, je donnerais les étoiles ; pour un de ses baisers, je donnerais le paradis. »
Et arrivées là, les deux voix reprenaient ensemble, mêlant, sans le savoir, dans ce chœur étrange, la prière de l’humble chrétien à l’hymne de l’amant avide.
Les leçons finirent pourtant ; le vieux maître d’école se leva pour entrer avec Lawik dans la ferme ; mais Margaridd resta sous la tonnelle de sureaux avec son frère. À l’enseignement avait succédé la causerie. Je crus comprendre qu’il s’agissait du prochain départ de Cleménçz. Le maître, dont la maladie l’avait engagé à quitter Guingamp, était rétabli et allait rouvrir sa classe ; le jeune Kloärek ne pouvait prolonger son séjour à Kerneïs sans nuire à ses études et sans retarder, par suite, son ordination. La jeune fille le comprenait et ne pouvait pourtant se résigner à ce départ.
– Quand vous serez retourné à Guingamp, disait-elle, que vais-je faire, moi, à la ferme ?
– Vous finirez d’apprendre à lire, Margaridd, répondait doucement le Kloärek.
Elle secoua la tête.