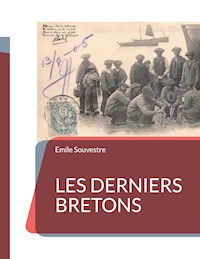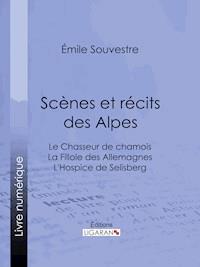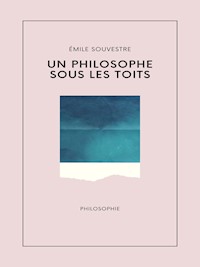
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
"Ce qu'on apprend en regardant par sa fenêtre" extrait, "Est-il bien sûr que le bonheur soit le prix des éclatantes réussites plutôt que d'une pauvreté sagement acceptée ! Ah ! si les hommes savaient quelle petite place il faut pour loger la joie, et combien peu son logement coûte à meubler."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Un philosophe sous les toits
Un philosophe sous les toitsAVANT-PROPOS.CHAPITRE PREMIER - LES ÉTRENNES DE LA MANSARDE.CHAPITRE II - LE CARNAVAL.CHAPITRE III - CE QU'ON APPREND EN REGARDANT PAR SA FENÊTRE.CHAPITRE IV - AIMONS-NOUS LES UNS LES AUTRES.CHAPITRE V - LA COMPENSATION.CHAPITRE VI - L'ONCLE MAURICE.CHAPITRE VII - CE QUE COUTE LA PUISSANCE ET CE QUE RAPPORTE LA CÉLÉBRITÉ.CHAPITRE VIII - MISANTHROPIE ET REPENTIR.CHAPITRE IX - LA FAMILLE DE MICHEL AROUT.CHAPITRE X - LA PATRIE.CHAPITRE XI - UTILITÉ MORALE DES INVENTAIRES.CHAPITRE XII - LA FIN D'UNE ANNÉE.Page de copyrightUn philosophe sous les toits
Émile Souvestre
...
À MME NANINE SOUVESTRE.
AVANT-PROPOS.
Nous connaissons un homme qui, au milieu de la fièvre de changement et d'ambition qui travaille notre société, a continué d'accepter, sans révolte, son humble rôle dans le monde, et a conservé, pour ainsi dire, le goût de la pauvreté. Sans autre fortune qu'une petite place, dont il vit sur ces étroites limites qui séparent l'aisance de la misère, notre philosophe regarde, du haut de sa mansarde, la société comme une mer dont il ne souhaite point les richesses et dont il ne craint pas les naufrages. Tenant trop peu de place pour exciter l'envie de personne, il dort tranquillement enveloppé dans son obscurité.
Non qu'il se soit retiré dans l'égoïsme comme la tortue dans sa cuirasse ! C'est l'homme de Térence, qui ne «se croit étranger à rien de ce qui est humain.» Tous les objets et tous les incidents du dehors se réfléchissent en lui ainsi que dans une chambre obscure où ils décalquent leur image. Il «regarde la société en lui-même» avec la patience curieuse des solitaires, et il écrit, pour chaque mois, le journal de ce qu'il a vu ou pensé. C'est le calendrier de ses sensations, ainsi qu'il a coutume de le dire.
Admis à le feuilleter, nous en avons détaché quelques pages, qui pourront faire connaître au lecteur les vulgaires aventures d'un penseur ignoré dans ces douze hôtelleries du temps qu'on appelle des mois.
CHAPITRE PREMIER - LES ÉTRENNES DE LA MANSARDE.
1er Janvier. —Cette date me vient à la pensée dès que je m'éveille. Encore une année qui s'est détachée de la chaîne des âges pour tomber dans l'abîme du passé ! La foule s'empresse de fêter sa jeune sœur. Mais tandis que tous les regards se portent en avant, les miens se retournent en arrière. On sourit à la nouvelle reine, et, malgré moi, je songe à celle que le temps vient d'envelopper dans son linceul.
Celle-ci, du moins, je sais ce qu'elle était et ce qu'elle m'a donné, tandis que l'autre se présente entourée de toutes les menaces de l'inconnu. Que cache-t-elle dans les nuées qui l'enveloppent ? Est-ce l'orage ou le soleil ?
Provisoirement il pleut, et je sens mon âme embrumée comme l'horizon. J'ai congé aujourd'hui ; mais que faire d'une journée de pluie ? Je parcours ma mansarde avec humeur, et je me décide à allumer mon feu.
Malheureusement, les allumettes prennent mal, la cheminée fume, le bois s'éteint ! Je jette là mon soufflet avec dépit, et je me laisse tomber dans mon vieux fauteuil.
En définitive, pourquoi me réjouirais-je de voir naître une nouvelle année ? Tous ceux qui courent déjà les rues, l'air endimanché et le sourire sur les lèvres, comprennent-ils ce qui les rend joyeux ? Savent-ils seulement ce que signifie cette fête et d'où vient l'usage des étrennes ?
Ici mon esprit s'arrête pour se constater à lui-même sa supériorité sur l'esprit du vulgaire.
J'ouvre une parenthèse dans ma mauvaise humeur, en faveur de ma vanité, et je réunis toutes les preuves de ma science.
(Les premiers Romains ne partageaient l'année qu'en dix mois ; ce fut Numa Pompilius qui y ajouta janvier et février. Le premier tira son nom de Janus, auquel il fut consacré. Comme il ouvrait le nouvel an, on entoura son commencement d'heureux présages, et de là vint la coutume des visites entre voisins, des souhaits de prospérité et des étrennes. Les présents usités chez les Romains étaient symboliques. On offrait des figues sèches, des dattes, des rayons de miel, comme emblème de «la douceur des auspices sous lesquels l'année devait commencer son cours,» et une petite pièce de monnaie, nommée stips, qui présageait la richesse.)
Ici je ferme la parenthèse pour reprendre ma disposition maussade. Le petit spitch que je viens de m'adresser m'a rendu content de moi et plus mécontent des autres. Je déjeunerais bien pour me distraire ; mais la portière a oublié mon lait du matin, et le pot de confiture est vide ! Un autre serait contrarié ; moi j'affecte la plus superbe indifférence. Il reste un croûton durci que je brise à force de poignets, et que je grignote nonchalamment comme un homme bien au-dessus des vanités du monde et des pains mollets.
Cependant, je ne sais pourquoi mes idées s'assombrissent en raison des difficultés de la mastication. J'ai lu autrefois l'histoire d'un Anglais qui s'était pendu parce qu'on lui avait servi du thé sans sucre. Il y a des heures dans la vie où la contrariété la plus futile prend les proportions d'une catastrophe. Notre humeur ressemble aux lunettes de spectacle qui, selon le bout, montrent les objets moindres ou agrandis.
Habituellement, la perspective qui s'ouvre devant ma fenêtre me ravit. C'est un chevauchement de toits dont les cimes s'entrelacent, se croisent, se superposent, et sur lesquels de hautes cheminées dressent leurs pitons. Hier encore je leur trouvais un aspect alpestre, et j'attendais la première neige pour y voir des glaciers ; aujourd'hui je n'aperçois que des tuiles et des tuyaux de poêle. Les pigeons, qui aidaient à mes illusions agrestes ne me semblent plus que de misérables volatiles qui ont pris les toits pour basse-cour ; la fumée qui s'élève en légers flocons, au lieu de me faire songer aux soupiraux du Vésuve, me rappelle les préparations culinaires et l'eau de vaisselle ; enfin le télégraphe que j'aperçois de loin sur la vieille tour de Montmartre, me fait l'effet d'une ignoble potence dont le bras se dresse au-dessus de la cité.
Ainsi blessés de tout ce qu'ils rencontrent, mes regards s'abaissent sur l'hôtel qui fait face à ma mansarde.
L'influence du premier de l'an s'y fait visiblement sentir. Les domestiques ont un air d'empressement qui se proportionne à l'importance des étrennes reçues ou à recevoir. Je vois le propriétaire traversant la cour avec la mine morose que donnent les générosités forcées, et les visiteurs se multiplier, suivis de commissionnaires qui portent des fleurs, des cartons ou des jouets. Tout à coup la grande porte cochère est ouverte ; une calèche neuve, traînée par des chevaux de race, s'arrête au pied du perron. Ce sont sans doute les étrennes offertes par le mari à la maîtresse de l'hôtel ; car elle vient elle-même examiner le nouvel équipage. Elle y monte bientôt avec une petite fille ruisselante de dentelles, de plumes, de velours, et chargée de cadeaux qu'elle va distribuer en étrennes.
La portière est refermée, les glaces se lèvent la voiture part.
Ainsi tout le monde fait aujourd'hui un échange de bons désirs et de présents ; moi seul je n'ai rien à donner ni à recevoir. Pauvre solitaire, je ne connais pas même un être préféré pour lequel je puisse former des vœux.
Que mes souhaits d'heureuse année aillent donc chercher tous les amis inconnus, perdus dans cette multitude qui bruit à mes pieds !
A vous d'abord, ermites des cités, pour qui la mort et la pauvreté ont fait une solitude au milieu de la foule ! travailleurs mélancoliques condamnés à manger, dans le silence et l'abandon, le pain gagné chaque jour, et que Dieu a sevrés des enivrantes angoisses de l'amour ou de l'amitié !
A vous, rêveurs émus qui traversez la vie, les yeux tournés vers quelque étoile polaire, marchant avec indifférence sur les riches moissons de la réalité !
A vous, braves pères qui prolongez la veille pour nourrir la famille ; pauvres veuves pleurant et travaillant auprès d'un berceau ; jeunes hommes acharnés à vous ouvrir dans la vie une route assez large pour y conduire par la main une femme choisie ; à vous tous vaillants soldats du travail et du sacrifice !
A vous enfin, quels que soient votre titre et votre nom, qui aimez ce qui est beau, qui avez pitié de ce qui souffre, et qui marchez dans le monde comme la vierge symbolique de Byzance, les deux bras ouverts au genre humain !
... Ici je suis subitement interrompu par des pépiements toujours plus nombreux et plus élevés. Je regarde autour de moi... ma fenêtre est entourée de moineaux qui picorent les miettes de pain que, dans ma méditation distraite, je viens d'égrener sur le toit.
A cette vue, un éclair de lumière traverse mon cœur attristé. Je me trompais, tout à l'heure, en me plaignant de n'avoir rien à donner ; grâce à moi, les moineaux du quartier auront leurs étrennes !
Midi. On frappe à ma porte ; une pauvre fille entre et me salue par mon nom. Je ne la reconnais point au premier abord ; mais elle me regarde, sourit... Ah ! c'est Paulette !... Mais depuis près d'une année que je ne l'avais vue, Paulette n'est plus la même : l'autre jour c'était une enfant, aujourd'hui c'est presque une jeune fille.
Paulette est maigre, pâle, misérablement vêtue ; mais c'est toujours le même œil bien ouvert et regardant droit devant lui, la même bouche souriant à chaque mot, comme pour solliciter votre amitié, la même voix un peu timide et pourtant caressante. Paulette n'est point jolie, elle passe même pour laide : moi je la trouve charmante.
Peut-être n'est-ce point à cause de ce qu'elle est, mais à cause de moi. Paulette m'apparaît à travers un de mes meilleurs souvenirs.
C'était le soir d'une fête publique. Les illuminations faisaient courir leurs cordons de feu le long de nos monuments ; mille banderoles flottaient aux vents de la nuit ; les feux d'artifice venaient d'allumer leurs gerbes de flammes au milieu du Champ-de-Mars.
Tout à coup, une de ces inexplicables terreurs qui frappent de folie les multitudes s'abat sur les rangs pressés ; on crie, on se précipite ; les plus faibles trébuchent, et la foule égarée les écrase sous ses pieds convulsifs. Échappé par miracle à la mêlée, j'allais m'éloigner, lorsque les cris d'un enfant près de périr me retiennent ; je rentre dans ce chaos humain, et après des efforts inouïs, j'en retire Paulette au péril de ma vie.
Il y a deux ans de cela ; depuis, je n'avais revu la petite qu'à de longs intervalles, et je l'avais presque oubliée ; mais Paulette a la mémoire des bons cœurs ; elle vient, au renouvellement de l'année, m'offrir ses souhaits de bonheur. Elle m'apporte, en outre, un plant de violettes en fleurs ; elle-même l'a mis en terre et cultivé ; c'est un bien qui lui appartient tout entier, car il a été conquis par ses soins, sa volonté et sa patience.
Le violier [Violier commun. On appelle aussi violier la giroflée.] a fleuri dans un vase grossier, et Paulette, qui est cartonnière, l'a enveloppé d'un cache-pot en papier verni, embelli d'arabesques. Les ornements pourraient être de meilleur goût, mais on y sent la bonne volonté attentive.
Ce présent inattendu, la rougeur modeste de la petite fille et son compliment balbutié dissipent, comme un rayon de soleil, l'espèce de brouillard qui m'enveloppait le cœur ; mes idées passent brusquement des teintes plombées du soir aux teintes les plus roses de l'aurore ; je fais asseoir Paulette et je l'interroge gaiement.
La petite répond d'abord par des monosyllabes ; mais bientôt les rôles sont renversés, et c'est moi qui entrecoupe de courtes interjections ses longues confidences. La pauvre enfant mène une vie difficile. Orpheline depuis longtemps, elle est restée, avec son frère et sa sœur, à la charge d'une vieille grand'mère qui les a élevés de misère, comme elle a coutume de le dire. Cependant Paulette l'aide maintenant dans la confection des cartonnages, sa petite sœur Perrine commence à coudre, et Henri est apprenti dans une imprimerie. Tout irait bien sans les pertes et sans les chômages, sans les habits qui s'usent, sans les appétits qui grandissent, sans l'hiver qui oblige à acheter son soleil ! Paulette se plaint de ce que la chandelle dure trop peu et de ce que le bois coûte trop cher. La cheminée de leur mansarde est si grande qu'une falourde y produit l'effet d'une allumette ; elle est si près du toit que le vent y renvoie la pluie et qu'on y gèle sur l'âtre en hiver : aussi y ont-ils renoncé. Tout se borne désormais à un réchaud de terre sur lequel cuit le repas. La grand'mère avait bien parlé d'un poêle marchandé chez le revendeur du rez-de-chaussée ; mais celui-ci en a voulu sept francs, et les temps sont trop difficiles pour une pareille dépense ; la famille s'est, en conséquence, résignée à avoir froid par économie !
A mesure que Paulette parle, je sens que je sors de plus en plus de mon abattement chagrin. Les premières révélations de la petite cartonnière ont fait naître en moi un désir qui est bientôt devenu un projet. Je l'interroge sur ses occupations de la journée, et elle m'apprend qu'en me quittant elle doit visiter, avec son frère, sa sœur et sa grand'mère, les différentes pratiques auxquelles ils doivent leur travail.
Mon plan est aussitôt arrêté : j'annonce à l'enfant que j'irai la voir dans la soirée, et je la congédie en la remerciant de nouveau.
Le violier a été posé sur la fenêtre ouverte, où un rayon de soleil lui souhaite la bienvenue ; les oiseaux gazouillent à l'entour, l'horizon s'est éclairci, et le jour, qui s'annonçait si triste, est devenu radieux. Je parcours ma chambre en chantant, je m'habille à la hâte, je sors.
Trois heures. Tout est convenu avec mon voisin le fumiste : il répare le vieux poêle que j'avais remplacé, et me répond de le rendre tout neuf. A cinq heures, nous devons partir pour le poser chez la grand'mère de Paulette.
Minuit. Tout s'est bien passé. A l'heure dite, j'étais chez la vieille cartonnière encore absente. Mon Piémontais a dressé le poêle tandis que j'arrangeais, dans la grande cheminée, une douzaine de bûches empruntées à ma provision d'hiver. J'en serai quitte pour m'échauffer en me promenant, ou pour me coucher plus tôt.
A chaque pas qui retentit dans l'escalier j'ai un battement de cœur ; je tremble que l'on ne m'interrompe dans mes préparatifs et que l'on ne gâte ainsi ma surprise. Mais non, voilà que tout est en place : le poêle allumé ronfle doucement, la petite lampe brille sur la table et la burette d'huile a pris place sur l'étagère. Le fumiste est reparti. Cette fois ma crainte qu'on n'arrive s'est transformée en impatience de ce qu'on n'arrive pas. Enfin, j'entends la voix des enfants ; les voici qui poussent la porte et qui se précipitent... Mais tous s'arrêtent avec des cris d'étonnement.
A la vue de la lampe, du poêle et du visiteur qui se tient comme un magicien au milieu de ces merveilles, ils reculent presque effrayés. Paulette est la première à comprendre ; l'arrivée de la grand'mère, qui a monté moins vite, achève l'explication. —Attendrissement, transports de joie, remercîments !
Mais les surprises ne sont point finies. La jeune sœur ouvre le four et découvre des marrons qui achèvent de griller ; la grand'mère vient de mettre la main sur les bouteilles de cidre qui garnissent le buffet, et je retire du panier que j'ai caché une langue fourrée, un coin de beurre et des pains frais.
Cette fois l'étonnement devient de l'admiration ; la petite famille n'a jamais assisté à un pareil festin ! On met le couvert, on s'asseoit, on mange ; c'est fête complète pour tous, et chacun y contribue pour sa part. Je n'avais apporté que le souper ; la cartonnière et ses enfants fournissent la joie.
Que d'éclats de rire sans motifs ! quelle confusion de demandes qui n'attendent point les réponses, de réponses qui ne correspondent à aucune demande ! La vieille femme elle-même partage la folle gaieté des petits ! J'ai toujours été frappé de la facilité avec laquelle le pauvre oubliait sa misère. Accoutumé à vivre du présent, il profite du plaisir dès qu'il se présente. Le riche, blasé par l'usage, se laisse gagner plus difficilement ; il lui faut le temps et toutes ses aises pour consentir à être heureux.
La soirée s'est passée comme un instant. La vieille femme m'a raconté sa vie, tantôt souriant, tantôt essuyant une larme. Perrine a chanté une ronde d'autrefois avec sa voix fraîche et enfantine. Henri, qui apporte des épreuves aux écrivains célèbres de l'époque, nous a dit ce qu'il en savait. Enfin, il a fallu se séparer, non sans de nouveaux remercîments de la part de l'heureuse famille.
Je suis revenu à petits pas, savourant à plein cœur les purs souvenirs de cette soirée. Elle a été pour moi une grande consolation et un grand enseignement. Maintenant les années peuvent se renouveler ; je sais que nul n'est assez malheureux pour n'avoir rien à recevoir, ni rien à donner.
Comme je rentrais, j'ai rencontré le nouvel équipage de mon opulente voisine. Celle-ci, qui revient aussi de soirée, a franchi le marche-pied avec une impatience fébrile, et je l'ai entendue murmurer : Enfin !
En quittant la famille de Paulette, moi, j'avais dit : Déjà !
CHAPITRE II - LE CARNAVAL.
20 février. Quelle rumeur au dehors ! Pourquoi ces cris d'appel et ces huées ?... Ah ! je me rappelle : nous sommes au dernier jour du carnaval ; ce sont les masques qui passent.
Le Christianisme n'a pu abolir les bacchanales des anciens temps, il en a changé le nom. Celui qu'il a donné à ces jours libres annonce la fin des banquets et le mois d'abstinence qui doit suivre. Carn-à-val signifie, mot à mot, chair à bas ! C'est un adieu de quarante jours aux «benoîtes poulardes et gras jambons» tant célébrés par le chantre de Pantagruel. L'homme se prépare à la privation par la satiété, et achève de se damner avant de commencer à faire pénitence.
Pourquoi, à toutes les époques et chez tous les peuples, retrouvons-nous quelqu'une de ces fêtes folles ? Faut-il croire que, pour les hommes, la raison est un effort dont les plus faibles ont besoin de se reposer par instants ? Condamnés au silence d'après leur règle, les trappistes recouvrent une fois par mois la parole, et, ce jour-là, tous parlent en même temps, depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Peut-être en est-il de même dans le monde. Obligés toute l'année à la décence, à l'ordre, au bon sens, nous nous dédommageons, pendant le carnaval, d'une longue contrainte. C'est une porte ouverte aux velléités incongrues jusqu'alors refoulées dans un coin de notre cerveau. Comme aux jours des saturnales, les esclaves deviennent pour un instant les maîtres, et tout est abandonné aux folles de la maison.
Les cris redoublent dans le carrefour ; les troupes de masques se multiplient, à pied, en voiture et à cheval. C'est à qui se donnera le plus de mouvement pour briller quelques heures, pour exciter la curiosité ou l'envie ; puis, demain, tous reprennent, tristes et fatigués, l'habit et les tourments d'hier.
Hélas ! pensé-je avec dépit, chacun de nous ressemble à ces masques ; trop souvent la vie entière n'est qu'un déplaisant carnaval.
Et cependant l'homme a besoin de fêtes qui détendent son esprit, reposent son corps, épanouissent son âme. Ne peut-il donc les rencontrer en dehors des joies grossières ? Les économistes cherchent depuis longtemps le meilleur emploi de l'activité du genre humain. Ah ! si je pouvais seulement découvrir le meilleur emploi de ses loisirs ! On ne manquera pas de lui trouver des labeurs ; qui lui trouvera des délassements ? Le travail fournit le pain de chaque jour ; mais c'est la gaîté qui lui donne de la saveur. O philosophes ! mettez-vous en quête du plaisir ! trouvez-nous des divertissements sans brutalité, des jouissances sans égoïsme ; inventez enfin un carnaval qui soit plaisant à tout le monde et qui ne fasse honte à personne.
Trois heures. Je viens de refermer ma fenêtre ; j'ai ranimé mon feu. Puisque c'est fête pour tout le monde, je veux que ce le soit aussi pour moi. J'allume la petite lampe sur laquelle, aux grands jours, je prépare une tasse de ce café que le fils de ma portière a rapporté du Levant, et je cherche, dans ma bibliothèque, un de mes auteurs favoris.
Voici d'abord l'amusant curé de Meudon ; mais ses personnages parlent trop souvent le langage des halles ; —Voltaire ; mais en raillant toujours les hommes, il les décourage. —Molière ; mais il vous empêche de rire à force de vous faire penser. —Lesage !... arrêtons-nous à lui. Profond plutôt que grave, il prêche la vertu en faisant rire des vices ; si l'amertume est parfois dans l'inspiration, elle s'enveloppe toujours de gaîté ; il voit les misères du monde sans le mépriser, et connaît ses lâchetés sans le haïr.
Appelons ici tous les héros de son œuvre : Gil Blas, Fabrice, Sangrado, l'archevêque de Grenade, le duc de Lerme, Aurore, Scipion ! Plaisantes ou gracieuses images, surgissez devant mes yeux, peuplez ma solitude, transportez-y, pour mon amusement, ce carnaval du monde dont vous êtes les masques brillants.
Par malheur, au moment même où je fais cette invocation, je me rappelle une lettre à écrire qui ne peut être retardée. Un de mes voisins de mansarde est venu me la demander hier. C'est un petit vieillard allègre, qui n'a d'autre passion que les tableaux et les gravures. Il rentre presque tous les jours avec quelque carton, ou quelque toile, de peu de valeur sans doute ; car je sais qu'il vit chétivement, et la lettre même que je dois rédiger pour lui prouve sa pauvreté. Son fils unique, marié en Angleterre, vient de mourir, et la veuve, restée sans ressources avec une vieille mère et un enfant, lui avait écrit pour demander asile. M. Antoine m'a prié d'abord de traduire la lettre, puis de répondre par un refus. J'avais promis cette réponse aujourd'hui ; remplissons, avant tout, notre promesse.
... La feuille de papier Bath est devant moi ; j'ai trempé ma plume dans l'encrier, et je me gratte le front pour provoquer l'éruption des idées quand je m'aperçois que mon dictionnaire me manque. Or, un Parisien qui veut parler anglais sans dictionnaire ressemble au nourrisson dont on a détaché les lisières ; le sol tremble sous lui, et il trébuche au premier pas. Je cours donc chez le relieur auquel a été confié mon Johnson ; il demeure précisément sur le carré.
La porte est entr'ouverte. J'entends de sourdes plaintes ; j'entre sans frapper, et j'aperçois l'ouvrier devant le lit de son compagnon de chambrée ; ce dernier a une fièvre violente et du délire. Pierre le regarde d'un air de mauvaise humeur embarrassée. J'apprends de lui que son pays n'a pu se lever le matin, et que, depuis, il s'est trouvé plus mal, d'heure en heure.
Je demande si on a fait venir un médecin.
—Ah bien, oui ! répond Pierre brusquement ; faudrait avoir pour ça de l'argent de poche, et le pays n'a que des dettes pour économies.
—Mais vous, dis-je un peu étonné, n'êtes-vous point son ami ?
—Minute ! interrompt le relieur ; ami comme le limonier est ami du porteur, à condition que chacun tirera la charrette pour son compte et mangera à part son picotin.
—Vous ne comptez point, pourtant, le laisser privé de soins ?
—Bah ! il peut garder tout le lit jusqu'à demain, vu que je suis de bal.
—Vous le laissez seul ?
—Faudrait-il donc manquer une descente de Courtille parce que le pays a la tête brouillée ? demande Pierre aigrement. J'ai rendez-vous avec les autres chez le père Desnoyers. Ceux qui ont mal au cœur n'ont qu'à prendre de la réglisse ; ma tisane, à moi, c'est le petit blanc.
En parlant ainsi, il dénoue un paquet dont il retire un costume de débardeur, et il procède à son travestissement.
Je m'efforce en vain de le rappeler à des sentiments de confraternité pour le malheureux qui gémit là, près de lui ; tout entier à l'espérance du plaisir qui l'attend, Pierre m'écoute avec impatience. Enfin, poussé à bout par cet égoïsme brutal, je passe des remontrances aux reproches ; je le déclare responsable des suites que peut avoir, pour le malade, un pareil abandon.
Cette fois, le relieur, qui va partir, s'arrête.
—Mais, tonnerre ! que voulez-vous que je fasse ? s'écrie-t-il, en frappant du pied : est-ce que je suis obligé de passer mon carnaval à faire chauffer des bains de pied, par hasard ?
—Vous êtes obligé de ne pas laisser mourir un camarade sans secours ! lui dis-je.
—Qu'il aille à l'hôpital alors !
—Seul, comment le pourrait-il ?
Pierre fait un geste de résolution.
—Eh bien, je vas le conduire, reprend-il ; aussi bien, j'aurai plus tôt fait de m'en débarrasser... Allons, debout, pays !
Il secoue son compagnon qui n'a point quitté ses vêtements. Je fais observer qu'il est trop faible pour marcher ; mais le relieur n'écoute pas : il le force à se lever, l'entraîne en le soutenant, et arrive à la loge du portier qui court chercher un fiacre.
J'y vois monter le malade presque évanoui avec le débardeur impatient, et tous deux partent, l'un pour mourir peut-être, l'autre pour dîner à la Courtille !
Six heures. Je suis allé frapper chez le voisin, qui m'a ouvert lui-même et auquel j'ai remis la lettre, enfin terminée et destinée à la veuve de son fils. M. Antoine m'a remercié avec effusion et m'a obligé à m'asseoir.
C'était la première fois que j'entrais dans la mansarde du vieil amateur. Une tapisserie tachée par l'humidité, et dont les lambeaux pendent çà et là, un poêle éteint, un lit de sangle, deux chaises dépaillées en composent tout l'ameublement. Au fond, on aperçoit un grand nombre de cartons entassés et de toiles sans cadres retournées contre le mur.