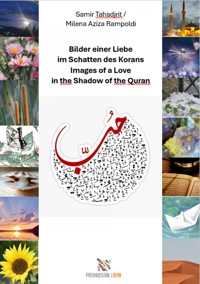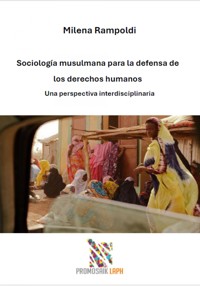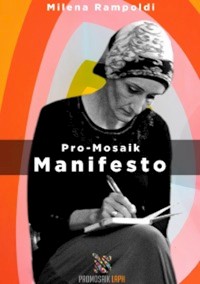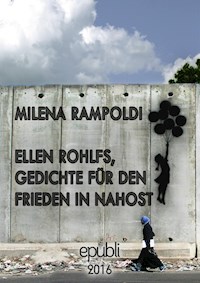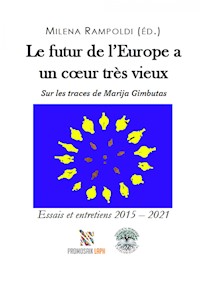
Le futur de l'Europe a un cœur très vieux Sur les traces de Marija Gimbutas E-Book
Milena Rampoldi
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Non, l'écriture n'est pas née en Mésopotamie. Non, la démocratie n'est pas née en 507 av. J-C à Athènes. Non, le patriarcat n'existait pas aux origines de l'humanité. Non, les hiérarchies sociales, les castes dominantes, les guerriers n'ont pas toujours existé. Non, les femmes n'ont pas été « de tout temps » soumises et exclues. Et oui, Platon était féministe. Ce sont quelques-unes des révélations auxquelles ce livre vous invite à réfléchir si vous avez entrepris un voyage vers l'utopie d'un autre monde. Découvrez cette « Vieille Europe » mise au jour par Marija Gambutas(1921-1994), la fondatrice de l'archéomythologie, dont les travaux pionniers ont établi qu'une civilisation a prospéré en Europe centrale et du Sud-est entre 6500 et 3500 avant J.-C., et en Crète jusqu'en 1450 avant J.-C., dans laquelle régnait un ordre social sans hiérarchie sociale, sans conflits armés et avec une égalité des sexes. Puis sont arrivés les nomades guerriers et pasteurs indo-européens depuis les steppes eurasiennes, qui ont imposé un ordre brutal dont nous ne nous sommes plus défaits. Des chercheurs et des artistes se sont engagés sur la piste tracée par Marija Gimbutas, pour alimenter leur recherche d'un autre monde possible, enfoui dans les restes de la civilisation danubienne. Nous leur donnons la parole, afin de permettre aux lecteurs francophones d'entrer dans un domaine plein de surprises, où bien des « vérités » qui semblaient définitivement acquises sont remises en cause. Lisez les interviews et articles de Harald Haarmann, LaBGC, Harald Seubert, Uwe Hinrichs, Joan Marler, Hans Bjarne Thomsen et Milena Rampoldi.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Image de couverture : nous avons remplacé les étoiles du drapeau de l’Union européenne par l’ensemble en terre cuite de 21 figurines et 13 sièges datant de l’époque 4900 à 4750 av. J-C, trouvé à Cucuteni, Poduri-Dealul Ghindaru, en Roumanie et conservées au musée départemental de Neamţ, à Piatra Neamţ.
À tous ceux qui croient au changement et cherchent leur utopie dans l’histoire
Repenser ensemble Entretien avec LaBGC et Harald Haarmann
Milena Rampoldi, 8 avril 2020
ProMosaik : Nous les avons déjà interviewés individuellement par le passé, aujourd’hui nous leur parlons ensemble : LaBGC et Harald Haarmann.
LaBGC, artiste et publiciste vivant en Espagne.
Harald Haarmann, un linguiste et philosophe de la culture allemand vivant en Finlande.
Von wegen dunkel! (Obscur, mon œil !) et Utopie einer idealen Gemeinschaft (Utopie d’une communauté idéale) sont deux articles passionnants que vous avez écrits ensemble - à lire sur le site ouèbe de la Frankfurter Rundschau. Maintenant, vous avez également écrit un livre ensemble. Il s’intitule Miteinander neu-denken (Repenser ensemble) et est paru à la fin de l’année dernière aux éditions LIT. Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ?
LaBGC : la certitude que la perte dramatique du bien commun et l’utilisation irresponsable de la nature exigent de toute urgence de réexaminer, voire de repenser les structures de notre vie en commun. Nous sommes tous deux profondément convaincus de cette nécessité, Harald Haarmann et moi-même.
Notre livre Repenser ensemble se fonde sur ce qui a été réussi dans un passé lointain pour ouvrir des perspectives pour aujourd’hui.
Dans ses infatigables recherches et publications, Harald répertorie les traces de cultures oubliées. Le résultat scientifique le plus étonnant obtenu de manière interdisciplinaire est que la première civilisation avancée de l’histoire de l’humanité - appelée vieille Europe ou civilisation du Danube -a réussi à vivre ensemble pendant 3 000 ans sans conflits destructeurs, a fait des découvertes révolutionnaires, a mis en place un immense réseau commercial et que tous les membres des communautés ont apparemment réellement profité de la prospérité croissante. Sacrée découverte ! Comment cela a-t-il pu fonctionner ?
Nous avons commencé à refléter les structures des sociétés de la vieille Europe dans le présent. Il est vite apparu que nous tenions là une clé qui devait être transmise. Et c’est ainsi que le livre a vu le jour.
Harald Haarmann : Il est vraiment fascinant que des communautés de régions aussi vastes - sur une carte actuelle, il s’agit de la Hongrie, de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Serbie, du Monténégro, du Kosovo, de l’Albanie, de la Macédoine du Nord, de la Grèce, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Moldavie et de l’Ukraine - aient pu vivre et travailler ensemble, pacifiquement et sur un pied d’égalité, en faisant du commerce et en assurant la subsistance de tous. Le Danube et ses affluents étaient les routes commerciales - d’où le nom de « civilisation danubienne » - mais les voies commerciales traversaient également la Méditerranée, la mer Noire et les terres adjacentes.
On peut prouver que les relations commerciales s’étendaient jusqu’à la péninsule pyrénéenne, jusqu’au nord de la France et au sud de l’Angleterre, jusqu’au nord de l’Allemagne et aux pays baltes, jusqu’aux steppes du sud de la Russie avec leurs pasteurs nomades et aux paysans sédentaires d’Anatolie, et jusqu’en Afrique du Nord. C’est un ordre de grandeur qui éclipse tout ce qui existait à l’époque dans le monde en termes de relations commerciales. Les contacts commerciaux avec l’Asie Mineure et l’Afrique du Nord formaient un véritable réseau intercontinental.
Un tel réseau commercial ne pouvait être mis en place et maintenu que sur la base de communautés de peuplement intactes, dotées d’une autogestion communale fonctionnant bien, et il s’agissait d’un milieu où chaque gain profitait au bien commun.
Ce sont précisément ces structures que nous exposons dans notre livre et nous demandons : qu’est-ce que cela nous dit aujourd’hui ?
ProMosaik : Comment avez-vous procédé ?
LaBGC : Eh bien, nous avons commencé par passer en revue les données disponibles et les conclusions qui en ont été tirées pour l’action dans les communautés de la vieille Europe. Le fait qu’Harald ait toujours les résultats de ses recherches à portée de main est fantastique ! Nous nous sommes ensuite penchés sur les structures qui régissaient la vie en commun. Dans les petites colonies, dans les villes ou au niveau suprarégional entre partenaires commerciaux. Et nous en avons déduit des notions telles que le bien commun, la démocratie, la propriété, la responsabilité, mais aussi la religion, l’amour, et ainsi de suite, à partir desquelles nous avons comparé la cohabitation des hommes de la vieille Europe à la nôtre. En outre, nous avons décidé de concentrer les textes sur les reflets dans le présent. Les connaissances sur la vieille Europe sont en effet suffisamment publiées. La plupart des ouvrages pertinents sont d’ailleurs répertoriés dans la bibliographie de Repenser ensemble.
ProMosaik : Oui, et les livres que vous avez écrits, Monsieur Haarmann, sur la vieille Europe et la civilisation danubienne constituent un fonds particulièrement riche. Sans oublier vos publications sur ce que les enseignements de Platon contiennent encore de la vieille Europe. N’est-il pas temps que ces connaissances soient intégrées dans les manuels scolaires ? Le fait que la démocratie ne soit pas seulement apparue avec les Grecs, mais qu’elle n’était déjà plus qu’un fragment chez les Grecs, jette un tout nouveau regard sur l’histoire mondiale.
Harald Haarmann : C’est exact. Bien que la vieille Europe fasse l’objet de recherches intensives depuis plus de trente ans, les résultats sont restés presque totalement absents des cursus de l’enseignement scolaire comme de la formation universitaire. Pourtant, la recherche archéologique et culturelle en Europe du Sud-Est a connu un essor dynamique après le tournant politique du début des années 1990. Mais les nouvelles connaissances sont restées jusqu’à aujourd’hui dans l’ombre du savoir établi.
L’histoire du monde, je vous l’accorde, doit en effet être revisitée. Les principaux éléments constitutifs sont là. On ne peut plus ignorer ce qui est connu comme certain sur les sociétés de la vieille Europe qui ont perduré pendant la période comprise entre 6 000 et 3 000 avant notre ère. ProMosaik : En lisant votre premier livre commun, Repenser ensemble, j’ai pensé à de nombreux endroits : Oui, c’est ça ! Ou oui, ça devrait être comme ça ! Et j’ai pris conscience de la quantité de choses fondamentales que l’on perd de vue dans le marathon quotidien des tâches au travail et en famille. Sans tomber dans la larmoyance sur des circonstances malheureuses et sans montrer du doigt, votre livre affronte agréablement les facteurs essentiels de la vie en commun, à petite et à grande échelle. Votre intention était-elle de montrer comment cela peut fonctionner ?
LaBGC (rires) : Nous ne fournissons pas de recettes pour bien vivre ensemble. Nous décrivons ce qui s’est avéré utile au cours de l’évolution de la coexistence entre les humains et qui a ensuite maintenu l’équilibre de la première civilisation avancée pendant plus de 3 000 ans.
Ce qui fascine en premier lieu, c’est la constatation que l’homme n’est pas forcément un loup pour l’homme. Et bien sûr, le pourquoi. Le loup, que nous portons tous en nous sans aucun doute, n’a aucune raison de partir à l’attaque si nous avons suffisamment à manger, un bon endroit pour dormir, des tâches et de la reconnaissance, si nous pouvons ressentir de l’amour et en donner, et si nous pouvons apprendre et nous impliquer en tant que créatures égales en valeur et en droits. Tous !En outre, il faut absolument de bons dirigeants et organisateurs. Ce sont des femmes et des hommes qui sont élus à ces postes parce qu’ils en ont les capacités et qu’ils ont montré que nous pouvons à juste titre leur faire confiance. Tant qu’ils n’abusent pas de leur position de responsabilité et de notre confiance, nous les réélirons. Le loup qui sommeille en nous se tourne avec satisfaction de l’autre côté et continue de ronfler.
Lorsque nous discutons aujourd’hui de la question de savoir si un revenu de base décent et des pensions suffisantes pour tous, un droit fondamental au logement, un droit au travail, à la formation, à la participation à la vie publique pourraient améliorer notre fragile cohabitation, c’est comme si quelqu’un soulevait le voile de notre mémoire culturelle.
ProMosaik : Il pourrait être si facile d’apprendre quelque chose des instruments de la vieille Europe pour les crises qui secouent notre société actuelle. Pourquoi est-ce que cela nous sera probablement difficile ?
Harald Haarmann : Parce que, contrairement à l’époque de la vieille Europe, nous ne sommes plus du tout orientés vers les maximes du bien commun. Certes, les valeurs fondamentales transmises jusqu’à aujourd’hui sont issues de l’ancien temps et ont subi de nombreuses transformations, mais la pensée et l’action originales orientées vers l’intérêt général ont été déformées et occultées par les bouleversements de l’histoire. Beaucoup de choses se sont même complètement perdues. Dans ce contexte, le chapitre « Fusion » de notre livre est révélateur. Il décrit ce qui a mis fin à l’équilibre de la vie dans la vieille Europe et qui a finalement conduit à des conflits violents et à des destructions.
Dans l’Antiquité déjà, les connaissances sur les sociétés en équilibre étaient presque entièrement ensevelies. Un seul philosophe avait encore en mémoire les idées directrices d’un monde de vie orienté vers le bien commun de l’époque pré-antique. Il s’agit de Platon. C’est aussi grâce à l’éducation de sa mère Perictione, également philosophe. Dans son modèle de société idéale, Platon a partagé l’essentiel de sa théorie politique.
La consolidation de la hiérarchie sociale, le renforcement des formes de pouvoir absolutiste, le durcissement de la bureaucratie étatique et la séparation des groupes sociaux sans possibilité directe d’influer sur le destin de la société ont déterminé l’évolution de l’État et de la société jusqu’à l’époque moderne. Dans le contexte des révolutions en Amérique (1776) et en France (1789), le renouveau des valeurs démocratiques s’est référé au modèle de la démocratie athénienne, qui ne représentait déjà plus depuis longtemps l’ensemble des valeurs fondamentales. Dans la société de la Grèce antique, il n’y avait plus d’égalité entre les femmes et les hommes, et il y avait la grande partie des sans-droits, les esclaves.
De plus, la pensée en termes de société avec une hiérarchie sociale a dominé l’histoire de l’Europe post-antique. Le modèle de la vieille Europe ayant été oublié et n’étant plus disponible pour une comparaison, une pensée unilatérale s’est consolidée, dans laquelle les valeurs fondamentales ont de plus en plus joué le rôle d’idéaux, mais qui se sont de plus en plus éloignés de la politique pratiquée au quotidien et se sont totalement estompés dans de nombreux contextes. Pour « restaurer » les valeurs fondamentales idéalisées, il faut penser différemment, et cela ne peut se faire qu’ensemble. C’est ce que nous avons expliqué dans notre livre.
ProMosaik : Bascha Mika, rédactrice en chef de la Frankfurter Rundschau, l’a résumé dans la préface à votre livre. Elle écrit : « Les auteur·es déclinent, de manière bien compréhensible agréable à lire, tous les termes qui peuvent avoir une importance dans ce contexte. De la responsabilité à l’égalité, de la possession à l’amour. Il en ressort clairement qu’il ne s’agit pas seulement pour eux d’une prise de conscience, mais d’une action. Agir ! Maintenant ! » Pouvons-nous envisager l’avenir avec plus de confiance grâce à nos nouvelles connaissances sur la vieille Europe ?
Harald Haarmann : Notre appel à repenser exige, comme première étape, une mise à jour du modèle de la vieille Europe. La connaissance de ces sociétés pré-antiques et des structures de leurs communautés doit être rendue largement disponible afin de combler le déficit causé par les canons de notre éducation occidentale-éclairée. L’ampleur de la refondation de nos connaissances et l’intensité de notre intérêt pour la vieille Europe détermineront dans quelle mesure les enseignements utiles pourront déployer leur effet dynamique pour la construction de notre avenir.
LaBGC : Ce serait bien que notre livre contribue à rassembler les visions, les idées et les modèles de nombreuses personnes. Si, de cette manière, il est compris comme un vent porteur sous les ailes de la pensée, alors je serai très satisfaite.
Le philosophe Harald Seubert sur le thème « Repenser ensemble »
Milena Rampoldi, 14 avril 2020
ProMosaik : Il y a quelques jours, nous avons interviewé LaBGC et Harald Haarmann à propos de leur premier livre publié ensemble, Miteinander neu-denken (Repenser ensemble). Aujourd’hui, nous publions notre entretien avec Harald Seubert sur ce livre.
Harald Seubert, né en 1967 à Nuremberg, est depuis septembre 2012 professeur et directeur du département de philosophie et de science des religions à la Haute école de théologie indépendante de l’État de Bâle, depuis 2009 chargé de cours à temps partiel en philosophie politique à la Haute école de politique de Munich. Depuis 2016, il est le président de la Martin-Heidegger-Gesellschaft (Société Martin-Heidegger).
Dans Miteinander neu-denken, on trouve à trois endroits marquants des citations d’un article que vous avez écrit, Monsieur Seubert, pour la Frankfurter Rundschau sous le titre « La panique comme signal de la raison pratique ». Dois-je en conclure qu’avec cet article, vous plaidez également pour une réflexion critique sur notre coexistence actuelle ?
Harald Seubert : Vous avez tout à fait raison. Je vois la vie en commun recouverte par différents épiphénomènes de nos sociétés hautement différenciées : les contraintes les plus diverses, une bureaucratisation excessive, une domination de l’économie de la valeur actionnariale sur la sphère politique depuis les années 2000 et un capitalisme monétaire déchaîné et presque religieux. D’ailleurs, cela se manifeste aussi dans des domaines qui devraient suivre d’autres logiques, comme l’éducation ou la santé. Le monde unique gagné par le numérique, qui permettrait de nombreuses libertés, n’engendre justement pas l’état de paix créatif et vivant que Kant attendait du cosmopolitisme de citoyens du monde à la fin du 18e siècle. En tout cas pas nécessairement et pas par la logique des algorithmes. Pour cela, il faut un véritable renversement de nos modes de pensée, de nos formes de vie et de nos représentations. Les idéologies usées du passé, qui ont vieilli et sont devenues parfois même vraiment malfaisantes, ne seront d’aucune aide. La bureaucratie et la technocratie menacent de pétrifier la vie et la pensée communes. Beaucoup de choses semblent désespérément figées dans ces vieux mécanismes, dans les images de soi et des autres. Je reste cependant convaincu, avec le philosophe présocratique grec Héraclite, que tout coule, est en mouvement, vivant. Un événement inattendu comme la crise actuelle du Covid, qui touche littéralement le monde entier, et dans laquelle notre civilisation et chacun, chacune, sont brusquement confrontés à la suspension de ce qui va de soi, pourrait vraiment être une crise : une césure qui fait époque.
ProMosaik : Le livre de LaBGC et Harald Haarmann Repenser ensemble reflète dans le présent ce que la science a découvert jusqu’à présent sur le monde vécu des sociétés de la vieille Europe. Cela se fait de manière condensée à l’aide de notions telles que le bien commun, la démocratie, l’égalité, la propriété, l’autorité et bien d’autres encore, comme l’amour et la religion, le bien commun semblant imprégner tous les domaines. Imaginez que vous entendiez parler pour la première fois de la réalité des sociétés de la vieille Europe. Qu’est-ce qui vous surprendrait, car vous l’auriez peut-être trouvé impensable jusque-là ?
Harald Seubert : J’ai découvert les recherches fascinantes de Harald Haarmann il y a un peu plus de deux ans, grâce à la recommandation d’un ami, mon médecin de famille depuis de nombreuses années. Ensuite, j’ai aussi rencontré LaBGC dans la vie réelle, par hasard ou par chance. Et maintenant, nous sommes tous les trois dans le même bateau. Il est surprenant et fascinant de voir quelles formes d’équilibre, de sens commun et d’art de vivre transcendant l’égoïsme et l’évolution sont tangibles dans les cultures danubiennes de la vieille Europe. Les recherches de Haarmann m’électrisent littéralement. Étant donné que, dans ma propre étude intensive, durant plus de vingt ans, de Platon et du platonisme, et plus généralement de la pensée grecque antique, qui est en grande partie étonnamment jeune, j’ai toujours compris cette pensée comme une grande somme et un héritage durable, et en aucun cas comme une utopie conçue dans le vide, les recherches de Haarmann m’ont ouvert de nouveaux horizons, y compris sur le plan philosophique. Ce n’est pas un hasard si lui et moi sommes très intéressés par la Sophia de Platon. Pour le platonicien, l’idéal n’est jamais un projet utopique, mais un rappel atopique, contrefactuel par rapport au courant dominant du moment, de ce qui a été, est et restera.
ProMosaik : Sous l’effet de l’appel au changement de nos sociétés qui vient de toutes parts - voir par exemple le premier jugement dans les scandales Cum-Ex - qu’est-ce qui, selon vous, est essentiel pour une nouvelle orientation face à l’abondance des possibles ?
Harald Seubert : Tout d’abord, je parle avec Karl Popper de falsification. Ce renouveau ne peut pas partir des visions linéaires du monde, de l’homme et de l’histoire du XXe siècle, auxquelles on ajouterait intellectuellement de nouvelles facettes. Il ne peut pas être simplement socialiste-marxiste, conservateur-traditionnel, ni libéral. Cela ne veut pas dire que toutes ces traditions ne contiennent pas, en plus des erreurs, des germes d’avenir et qu’elles ne peuvent donc pas être rappelées à certains moments. Mais pour cela, il faut, comme le dit Walter Benjamin, une « critique salvatrice ». Des maximes pour une autre vie commune peuvent en outre être tirées du trésor des grandes religions mondiales, certes. Mais ce qui est essentiel, c’est qu’un ‘nous’, un sensus communis naisse de la liberté, que de nouvelles voies non tracées voient le jour, c’est-à-dire une société mondiale composée de divers, un réseau dense de personnes âgées et de jeunes, d’hommes, de femmes, de divers, qui pensent et vivent ce nous non seulement par moments, mais de manière durable, sans pour autant abandonner la diversité chatoyante.
Cela suppose que l’individualité et la communauté, comme le dit Platon - la petite écriture de l’âme et la grande de la polis -, soient étroitement imbriquées l’une dans l’autre, dans un tissu humain. Cet humanum est une tâche et un champ ouvert. À condition de tolérer l’altérité de l’autre, même totale, dans son ambiguïté, et de se transformer soi-même de manière créative. Tout cela est dit dans le très beau motif de Los Altros : nous autres.
ProMosaik : Existe-t-il une approche interdisciplinaire qui permettrait de lancer un processus de réflexion ?
Harald Seubert : Pour moi, cette approche est effectivement une sorte de phénoménologie et d’herméneutique de la conversation. Phénoménologie, parce qu’il s’agit de percevoir l’autre tel qu’il se donne et se montre, aussi libre que possible de préjugés idéologiques ou même de ressentiments, et donc de le comprendre plus profondément. Edmund Husserl, le génial fondateur de la phénoménologie, qui, en tant que juif, fut proscrit et passé sous silence dans les dernières années de sa vie, appelait cela l’époché : mise entre parenthèses, voir les phénomènes tels qu’ils se donnent ànous à chaque fois, ainsi que la conversation, comme l’écoute de la voix provocante de l’Autre, qui me renvoie ma propre pensée modifiée.
L’interdisciplinarité, issue de différentes sciences, mais aussi des mondes largement différenciés de l’art, de la science, de la philosophie, de la politique, a besoin de ces deux maximes fondamentales. Elle est alors une attitude et une créativité, une combinaison de faire et de laisser être, d’activité et de passivité, comme nous en avons urgemment besoin.
ProMosaik : Avez-vous une idée de la manière dont un processus de nouvelle réflexion pourrait être mis en route - ou peut-être existe-t-il même une approche interdisciplinaire pour une nouvelle réflexion commune ?
Harald Seubert : Je vois comme cellule germinale une sorte d’académie de personnes et de forces qui ont déjà développé ce nouveau départ à partir de leur point de vue ou qui sont en train de le faire : L’académie n’est pas une méritocratie (maison de retraite), mais un contexte de vie et de recherche libre, mais passionné. L’art, la paidei (formation), les formes de vie doivent y avoir au moins autant de poids que les formes de pensée. Il s’agirait d’une académie de l’amitié bagarreuse, de la transparence, qui mettrait en place des ramifications, des rayonnements dans différentes régions du monde et qui relierait justement la bonne théorie clairvoyante à la pratique : comme Leibniz en rêvait d’ailleurs pour les académies européennes classiques au XVIIIe siècle : Theoria cum praxi - révolutionnaire à l’époque, car il incluait aussi les disciplines appliquées, l’architecture, la technique des véhicules. Je pense effectivement que la phénoménologie et l’herméneutique de la conversation peuvent offrir un bon plan pour cela. Mais rien de plus : ce qui peut alors naître devrait se façonner et se transformer soi-même, l’éducation et l’art jouant certainement un rôle très important à cet égard. Pour paraphraser Hölderlin : « (…) nous sommes undialogue (…) etnouspouvonsnousouïr les uns les autres ». D’ailleurs, je vois autour de moi, chez des artistes, des méditatifs, des penseurs et des écrivains merveilleux, des fils qui se tissent pour un tel nouveau départ, toutes générations confondues : ces fils veulent être reliés et connectés, mis en dynamique permanente.
ProMosaik : Voyez-vous des recoupements entre l’histoire, la philosophie et la politique ?
Harald Seubert : Très grands. Ces recoupements accompagnent mon propre parcours intellectuel et existentiel depuis plus de trois décennies. En tant que philosophe, je m’intéresse depuis mes études à l’histoire, qui était et est restée ma deuxième matière, à l’histoire des idées en premier lieu, mais aussi des hommes, des pouvoirs, de l’héritage complexe et de la mémoire collective et individuelle, et à la politique, qui est plus et autre chose qu’un métier (Max Weber) : elle fait partie de notre vie libre, de notre – pour le dire avec Aristote -. koinônia politikè [communauté politique, traduit en latin societas civilis, société civile, NdT]. Elle concerne nécessairement chacun et chacune. Ces trois disciplines fondamentales, qui décrivent en elles-mêmes la tension entre la théorie et la pratique, sont souvent liées entre elles. Même là où l’on ne peut pas parler d’intersection, mais où chacun des trois domaines se rapporte aux autres selon sa propre logique et profondeur. Leibniz parlait en effet des monades qui n’ont pas de fenêtres et qui communiquent pourtant entre elles. C’est la même chose entre les trois grands domaines que vous avez mentionnés.
En outre, il convient à mon avis d’ajouter à cette triade l’étude de la langue, de ses structures et de son utilisation concrète.
ProMosaik : J’aimerais encore aborder une préoccupation personnelle : J’ai l’impression que la majorité des jeunes d’aujourd’hui s’intéressent moins à la politique que les années précédentes. Quelle est votre perception ?
Harald Seubert : Oui, cela a longtemps été mon impression. Même mes étudiantes et étudiants me semblent en partie très peu politisés, surtout si on compare avec les générations précédentes, les années 68, ou même ma génération. Mais là où il s’agit de l’ensemble fragile, du climat comme condition sine qua non de la vie commune, la passion politique de cette jeune génération est soudain devenue évidente, surtout dans le mouvement Fridays for Future. Très impressionnant, intelligent, avec le plus grand impact. Cela doit et va s’élargir thématiquement, cela va prendre en charge d’autres problématiques, libérées des vieux slogans fatigués, et devenir une conversation entre plusieurs générations. Je suis convaincu que le nouveau politeuein [faire politique, Platon, NdT] entraînera également de nombreux jeunes, qui sont bien plus que de simples consommateurs.
ProMosaik : La traduction anglaise de Repenser ensemble sera publiée cette année sous le titre Re-thinking Togetherness. Vous avez rédigé un essai à ce sujet, qui sera la postface de l’édition anglaise. Le message de votre essai peut-il être résumé en quelques phrases ?
Harald Seubert : Ce qui m’intéresse dans cet essai, c’est de dégager la force nouvelle et inspirante de la démocratie à partir des sources européennes, tout en plaidant en sa faveur. Je pars du principe que nous vivons aujourd’hui dans une situation qui est à la fois une crise (décision, distinction) et un kairos (moment heureux et début de cette nouveauté). J’ai toutefois écrit ce texte peu avant la récente crise. Mais la crise, c’était déjà l’éclatement du sens commun, la constellation d’une politique ritualisée fatiguée d’une part, et les populistes au ressentiment destructeur d’autre part. La nouvelle politique devra avoir en vue la planète entière, précisément dans la conscience du « nous-mêmes en tant qu’autres », et non dans une normativité écrasante, mais dans une créativité commune, un nous qui n’abandonne pas le je et le tu, qui allie passion et rationalité. C’est une perspective pour laquelle je me réjouis de continuer à m’enthousiasmer.
ProMosaik : Je vous remercie pour vos réflexions à plusieurs niveaux en réponse à nos questions.
Nous autres : L’inspiration de l’ancienne et de la nouvelle Europe et le monde global
Par Harald Seubert
I
L’impression qui s’est dégagée des élections européennes de 2019 n’a cessé de se confirmer depuis : les partis politiques de différentes couleurs abordent l’avenir de manière incertaine et comme dans un état de demi-sommeil. Comme si cet avenir et la jeune génération qui s’exprime avec un nouvel agenda et un nouveau style de politique leur faisaient peur et leur étaient étrangers.
La politique européenne perd ses enfants. A première vue, c’est une question de médias et de vitesse de communication. Le fossé médiatique est dramatique lorsque les centrales électorales d’un grand parti populaire réagissent à la vidéo d’un youtubeur, d’abord en étant paralysées, puis se montrant vexées. Une analyse plus approfondie révèle que les partis ont perdu de manière continue leurs identités et milieux électoraux traditionnels.
II
La situation politique au début des années 20 du 21e siècle peut d’ores et déjà être définie comme profondément ambiguë : elle est au moins aussi ambivalente que ce qu’Ernst Bloch avait envisagé pour les années 20 dans son fulgurant diagnostic de l’époque, Héritage de ce temps (publié pour la première fois en 1935)1. Comme à l’époque, on voit se dessiner une « simultanéité des temps inégaux » : d’un côté, il y a la mondialisation, grande et oppressante. Une jeune génération les prend en charge avec charme, provocation et détermination. Ces questions concernent la société civile mondiale qui, indépendamment de sa localisation dans l’espace analogique et numérique, tourne autour des problèmes de l’écologie, de la participation à la vie dans un monde numériquement imbriqué, des inégalités et des conflits latents ou ouverts.2 La question de la guerre et de la paix, de la migration et de la violence structurelle reste également ouverte.
Avec leur « Internationale des nationalistes »3, les populistes et les extrémistes de droite s’emparent à l’inverse, dans toute l’Europe et avec des ramifications dans d’autres régions du monde, d’une maxime d’action authentiquement socialiste datant du début du XIXe siècle : s’internationaliser. Leurs recettes ne sont en aucun cas adaptées à l’époque. Le ressentiment et la revanche du national les déterminent. Ils retournent tactiquement et habilement l’internationalisme contre sa propre idée. L’insoutenabilité éthique et même logique élémentaire d’un tel mouvement est évidente : là où l’impératif national doit être internationalisé et élevé au rang d’une sorte d’impératif catégorique, la confrontation mutuelle et la paralysie en sont les conséquences.4 Les nationalistes rejettent méchamment l’enseignement fondamental de Kant selon lequel un patriotisme éclairé ne peut être justifié que dans une intention cosmopolite. Ce n’est pas une Europe pacifique des patries, telle que l’envisageait la génération des fondateurs de l’UE, mais les constellations d’avant 1914 qui se trouvent dans la ligne de fuite des rêveries de la droite.5
Les partis et les représentants de l’ordre démocratique constitué font preuve d’une négligence crasse en se contentant de réagir. Les nombreux commentaires sur les résultats des élections de l’année dernière donnent l’impression d’être des cavaliers qui viennent de traverser le lac de Constance et qui sont quelque peu heureux de s’en être encore sortis. La République, l’Europe ne sont pas encore devenues totalement ingouvernables. La division par les anciens /nouveaux nationalistes n’est pas encore aussi massive qu’on le craignait. On veut encore une fois faire le tri, réorganiser les champs. On est déterminé, mais on ne sait pas vraiment à quoi. On essaie d’adapter les anciens programmes aux nouveaux « défis ». Mais beaucoup de choses restent en demi-teinte, technocratiques, trop axées sur un ancien monde transformé. La vision fait défaut, tout comme l’attention portée à la nouvelle réalité mondialisée, à l’unité plurielle maintes fois brisée de la planète bleue.
III
Mais en même temps, on constate un changement de paradigme politique qui fait éclater les anciens modèles et habitudes de pensée, qui ne laisse plus l’action et la réflexion aux « experts » autoproclamés. La nouvelle politique retire également rapidement le crédit aux « révolutions d’en haut », comme le mouvement du président Macron, lorsqu’elles suivent trop les vieux schémas technocratiques et génèrent de nouvelles inégalités.