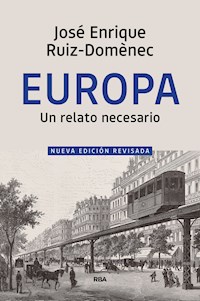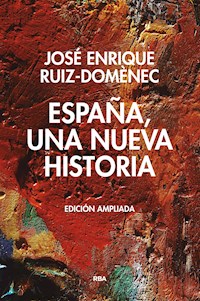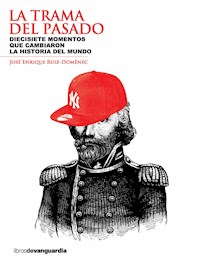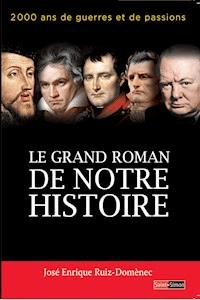
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Saint-Simon
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'Histoire de l'EuropeLa nuit de la Saint-Sylvestre de l’an 406, le Rhin gela. Des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants se lancèrent au-dessus du fleuve et la glace supporta le poids des chariots. Ce fait marqua le début des invasions barbares en Occident. L’Empire romain s’effondre, l’Europe est née.Le "Vieux Continent" au travers de ses conflits et de ses bataillesCE QU'EN PENSE LA CRITIQUE- "Parmi les grands livres récemment publiés, voici un texte séduisant et très ambitieux qui nous propose un voyage à travers plus de trois siècles… Il est écrit par un médiéviste qui sait écrire avec la plume d’un journaliste. Commençant comme Stefan Zweig, Ruiz Domènec condense l’héritage européen dans ses racines chrétiennes, une culture et un espace communs, un esprit scientifique, la séparation de l’Église et de l’État, l’évolution des formes de gouvernance… Plus on approfondit cette façon de faire de l’histoire, plus on saisit ce qui réunit une cathédrale gothique, un tableau de Rembrandt ou Picasso, un concert de Mozart et un train à grande vitesse. Magistral !" (Xavier Vidal Folch, El Pais)- "Pour croire en l’Europe, il faut lire l’Espagnol José Enrique Ruiz-Domènec. Dans une fresque épique, Le Grand Roman de notre histoire, il retrace ce que tous les écoliers d’Europe devraient apprendre : leur histoire commune, unique. Cela rend optimiste." (Alain Frachon, Le Monde)À PROPOS DE L'AUTEURJosé Enrique Ruiz-Domènec, né en 1948 à Grenade, diplômé en histoire médiévale, conférencier au Collège de France et à l’Ecole des Hautes Études, il dirige désormais l’Institut des Hautes Études médiévales de l’Université autonome de Barcelone. Il a réalisé des documentaires pour la télévision espagnole et collabore au journal La Vanguardia.EXTRAITUne histoire de plus.Et nous la connaissons à peine. Certes, nous nous sommes juré de profiter de nos erreurs pour ne pas les répéter ; de découvrir le passé pour construire l’avenir ; de s’y risquer en faisant preuve de bon sens, de façon digne et honnête, avec une conviction : la conception européenne du monde repose sur l’idée d’un ordre moral de la société ; elle est le fruit d’un apprentissage adapté, qu’on l’appelle « civilité » ou « courtoisie », et fondamental pour l’intégration des individus dans un objectif commun ; une attitude humaine, trop humaine pour la laisser entre les mains des tenants d’un dogme quelconque, capables de nous emmener « au bout de la nuit », selon les termes de Céline. L’éducation est plus indispensable que jamais, à présent que tout est nouveau. L’histoire de l’Europe est puissante et pèse de son propre poids. Je veux proposer ici mon récit des événements ; ensuite viendra le temps de juger, si tel est le souhait du lecteur. L’esprit d’investigation et la curiosité ont été les détonateurs de ce livre il y a une quarantaine d’années.De cette époque datent ses premières ébauches.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 651
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ce que la presse en dit
« Un livre passionnant, devenu best-seller de l’autre côté des Pyrénées. »
Les Echos
« Son récit est passionnant en ceci qu’il s’écarte des histoires nationales abordées en parallèle ; il se concentre sur les liens et les déchirements européens, l’horizon économique commun et l’impératif moral… »
Le Journal du Dimanche
Introduction
Elle soulève son pied nu pour que l’eau de mer ne le baigne pas et, avec une expression de peur et de désespoir, elle semble appeler ses amies qui, parmi les fleurs et la verdure, endolories, pleurent toutes Europe. « Europe ! » entend la plage, « Europe, reviens ! » ; et le taureau, tout en nageant, baise son pied.
Angelo Politiziano
À présent que tout est nouveau
Une histoire de plus.
Et nous la connaissons à peine. Certes, nous nous sommes juré de profiter de nos erreurs pour ne pas les répéter ; de découvrir le passé pour construire l’avenir ; de s’y risquer en faisant preuve de bon sens, de façon digne et honnête, avec une conviction : la conception européenne du monde repose sur l’idée d’un ordre moral de la société ; elle est le fruit d’un apprentissage adapté, qu’on l’appelle « civilité » ou « courtoisie », et fondamental pour l’intégration des individus dans un objectif commun ; une attitude humaine, trop humaine pour la laisser entre les mains des tenants d’un dogme quelconque, capables de nous emmener « au bout de la nuit », selon les termes de Céline. L’éducation est plus indispensable que jamais, à présent que tout est nouveau.
L’histoire de l’Europe est puissante et pèse de son propre poids. Je veux proposer ici mon récit des événements ; ensuite viendra le temps de juger, si tel est le souhait du lecteur. L’esprit d’investigation et la curiosité ont été les détonateurs de ce livre il y a une quarantaine d’années. De cette époque datent ses premières ébauches.
En mars 1968, alors que je faisais ma valise pour me rendre en Europe, peu de gens croyaient en elle. On décelait encore les traces du schisme entre l’Est communiste et l’Ouest capitaliste. On vous parlait de la Guerre froide au moindre commentaire ; en revanche, le traité de Rome ne provoquait que le sourire des eurosceptiques et la réprobation des tenants du socialisme réel. Je pensais alors que la décision avait été prise, mais ma formation était insuffisante pour défendre ce projet. Il flottait dans l’atmosphère un désir de changement pour mettre fin à la division décidée d’un commun accord dans les traités internationaux ; mais il n’existait aucun consensus sur la façon d’y parvenir. On avait choisi une voie à Varsovie et à Budapest, une autre à Rome et à Berlin. Aux deux extrêmes, à Paris et à Prague, on s’inquiétait des proclamations puériles proposant de mettre l’imagination au pouvoir. On ne trouvait aucun argument solide pour provoquer un renversement de la situation : de nombreuses protestations, beaucoup de théories et peu de possibilités. L’Europe resta vingt ans de plus divisée.
La conception de l’unité européenne est certainement un idéal élevé, dont la vigueur repose autant sur les espoirs d’un avenir prometteur que sur l’interprétation judicieuse du passé.
Dans un texte de l’humaniste Aeneas Silvius Piccolomini, écrit vers 1458, on peut lire : Nunc vero in Europa, id est, in patria, in domo propria, in sede nostra, percussi caesique sumus, qu’on pourrait traduire par : « Maintenant, c’est vraiment en Europe, c’est-à-dire dans notre patrie, dans notre maison, que nous avons été attaqués et anéantis. » En évoquant un événement déterminant de son époque (la chute de Constantinople, tombée entre les mains des Ottomans), Piccolomini avait trouvé ce qu’il cherchait : le cosmos européen. Il avait découvert le bon chemin. Il eut de nombreux successeurs : des humanistes dont les arguments furent jugés irréfutables.
Le cosmos européen représente un ordonnancement complexe de la réalité en vigueur depuis plus de mille cinq cents ans : il fut forgé au Moyen Âge. Historiquement, il marqua le devenir d’une mosaïque de peuples dotés de traditions, de langues et de points de vue différents, voire opposés, à l’origine de confessions, de souvenirs et de blessures. C’est la patrie des occasions perdues, des rêves qui transforment les moulins à vent en géants, des utopies sociales imprégnées d’un sens de la rectitude à la fois esthétique et moral, de la liberté, des risques et des opportunités, de la science.
En 1935, le philosophe allemand Edmund Husserl avait affirmé que ce cosmos devait être protégé pour ne pas être emporté (ce qui fut le cas) par des idées diaboliques débouchant sur un bain de sang. Il ne faut pas l’oublier : en effet, faire du neuf n’empêche pas de se rappeler ce qui est arrivé, et même de le dénoncer. « Plus jamais cette innocence », avait dit le poète anglais Philip Larkin en évoquant la confusion préalable à la Grande Guerre.
Maintenant que tout est nouveau, la situation est devenue cruciale. Les vieilles valeurs ont cessé de convaincre la société, sans avoir été encore remplacées. Nous ignorons de quoi sera fait l’avenir, mais nous pouvons l’améliorer si nous acceptons l’idée que le passé a beaucoup de choses à nous apprendre ; par exemple, la nature complexe de toute question : une crise économique, un revers politique, une guerre, un attentat terroriste, une catastrophe. C’est le meilleur vaccin contre le dogmatisme et la stupidité qui jalonnent d’ordinaire la voie menant au désastre. Et sans aucune grandeur. En effet, tout devient clair ; soudain, n’importe quel imbécile est à même d’adopter une décision catastrophique pour toute une série de raisons qui s’enchaînent : l’impossibilité de prévoir un problème, de le cerner une fois qu’il est apparu, l’incapacité de l’affronter dès lors qu’on l’a perçu, et l’échec de toutes les tentatives pour le résoudre.
Un doute se répand parmi les Européens, comme au début de l’ère moderne : l’Europe sera-t-elle un musée qui gère ses anciennes gloires ou au contraire un laboratoire capable de se tenir à l’avant-garde de la modernisation dans les domaines de la science, de la technologie et de la pensée ? Ou sera-t-elle ces deux choses à la fois ? L’avenir est conditionné par deux facteurs fondamentaux, qui sont apparus depuis peu et que personne n’avait prévus. L’un d’entre eux est l’avancée de la globalisation et du libre marché, qui exige de lutter contre les puissances émergentes, les Bric (Brésil, Russie, Inde, Chine), et contre l’emprise irrésistible des États-Unis. Le second facteur est la nature de l’Union européenne, tributaire d’une histoire décrivant ses valeurs communes et ses objectifs. Avancer ne sert à rien si on ignore ce qu’on laisse derrière soi. Le danger, c’est de glisser dans l’obscurité de l’oubli, de perdre la vision claire du passé et donc la sagesse.
L’histoire de l’Europe ne se limite pas à une succession d’événements, elle se caractérise par une série de problèmes : des problèmes fondamentaux et inéluctables, avait dit Geoffrey Barraclough lors de l’une de ses chroniques habituelles à la BBC. Tout enrichissement de la connaissance les complique au lieu de les simplifier ; il rend plus difficile l’appréhension d’une solution bien définie, radicale. C’est justement cette problématique qui a captivé les plus éminents personnages de chaque génération ; de plus, en abordant sans cesse les questions centrales, l’histoire s’est elle-même renouvelée, elle a découvert de nouvelles impulsions et perspectives. Il en a été ainsi à trois occasions : au VIe siècle, quand elle dut décider du sort de l’Empire romain ; au IXe siècle, lorsqu’elle affronta l’expansion turque en Anatolie, dans le Bas-Danube et à l’est de la Méditerranée, au milieu de profondes réformes des institutions ecclésiastiques ; et au XVIIIe siècle. Grâce aux Lumières, l’histoire offrit alors une issue aux problèmes hérités d’un long conflit religieux qui avait débouché sur la destructrice (et absurde) guerre de Trente Ans.
Il nous fallut comprendre, dans toute leur ampleur, ces grandes crises de l’esprit pour acquérir une vision exacte de l’histoire de l’Europe et pouvoir commencer à mesurer son héritage : cet enchevêtrement de contradictions non encore résolues. C’est désormais devenu indispensable, au début du XXIe siècle : nous sommes entrés dans un nouveau creuset qui vise à mettre fin à des siècles d’impasses, de mouvements ne menant nulle part, de solutions précipitées.
L’histoire de l’Europe ne doit pas être forcément eurocentrique ; en revanche, elle représente un acte de revendication de son héritage en vue de l’enrichir de l’imagination et des contraintes des valeurs de la modernité comme unique possibilité d’être une communauté spécifique au milieu du village global.
J’invite le lecteur à participer à un voyage qui repose sur ce rêve.
Pour commencer, le nom.
Nom
La signification exacte du nom de l’Europe reste inconnue, malgré son caractère familier, intime, cher, aimé, et parfois aussi haï. On cherche son étymologie, en vain. Il y a trois mille ans, les Assyriens de l’Antiquité avaient appelé Ereb les montagnes, les vallées et les plaines des confins occidentaux de la masse continentale euro-asiatique. Plusieurs siècles plus tard, Hésiode, un agriculteur et poète de Béotie, ajouta l’adjectif eurus, « long », au substantif ops, « regard ». On raconta alors l’histoire d’Europe, la fille du roi Agénor de Tyr, en Phénicie (le Liban actuel), son enlèvement par Zeus sous l’apparence d’un taureau et son transfert forcé en Crète. Ce mythe est associé à un rite solaire de fertilité et à l’importance du personnage du Minotaure dans les palais de Cnossos. La culture qui diffuse ces idées s’attribue à elle-même le pouvoir de dénommer les choses qu’elle voit ; c’est ce pouvoir que Dieu octroie à Adam dans l’Éden, d’après la Bible. La magie de mettre un nom sur un territoire, un individu, un animal ou une plante est une façon d’imiter la divinité.
Nommer l’Europe signifie participer au mythe, l’accepter comme métaphore fondatrice. Horace le fit dans son ode « À Galatée », en transformant le rapt en récit d’une séduction ; ou bien Angelo Poliziano, dans son poème dédié à Laurent le Magnifique. Le bout de terre qui attendait la fille d’Agénor avait beau être minuscule, le bonheur de se savoir l’élue du dieu servit à asseoir la naissance d’un monde qui s’appellerait Europe en son honneur. Ainsi, grâce au mythe de l’enlèvement d’Europe, ce continent se révèle être quelque chose de plus qu’une terre périphérique plus ou moins éloignée des grands empires d’Asie, une civilisation impliquée dès l’âge de Bronze, écrit l’archéologue Jean Guilaine, le foyer de la « grande mère phénicienne » d’où se propagent techniques et idéologies. Sans doute la Méditerranée et l’Europe sont-elles donc étroitement imbriquées de longue date, avant que ne s’affirme la colonisation grecque. C’est la vérité historique derrière le mythe.
Mais il fallut attendre encore quelques années, la disparition de l’Empire romain d’Occident, pour voir se profiler définitivement sa réalité historique. L’Europe, terre métissée, lieu de rencontres entre Romains, Germains, Slaves, Celtes et peuples de la steppe, surmonta les obstacles de ces temps convulsifs et créa un espace politique et culturel. Avec Bède le Vénérable, au VIIe siècle, elle était beaucoup plus qu’un nom : c’était la terre du père avec lequel le moine s’était senti spirituellement identifié. On se mit à lui chercher une couleur.
Couleur
Le bleu est la couleur de l’Europe. Il l’a toujours été ; sauf au cours des siècles où se prolongeait, à son encontre, le rejet de la culture romaine, qui le considérait comme propre aux barbares. « Tellement fantomatique qu’elle épouvante les adversaires », avait écrit Jules César dans la Guerre des Gaules, où il décrivait la manière dont l’attitude romaine déteignait sur ces barbares.
Rien d’étonnant à cela : le dieu Wotan apparaissait dans les récits comme un marcheur coiffé d’un chapeau souple et vêtu d’une cape de cette couleur. La reconstitution de l’histoire du bleu permet de comprendre son statut de couleur favorite de plus de la moitié de la population européenne (suivie, à distance, par le vert et le rouge) ; cette donnée revêt une profonde signification. La couleur est l’expression d’une vertu cachée, avait observé Marguerite Yourcenar dans Écrit dans un jardin : celle d’une soudaine densité de la vie.
Le bleu avait été la couleur choisie par l’empereur Henri II (duc de Bavière) pour la cape de son couronnement en 1002, conservée aujourd’hui dans le musée de Bramberg ; c’est la couleur de la voûte céleste, dont les constellations expriment la volonté de transformer l’univers en une garantie de l’ordre sur la Terre ; le bleu est présent sur les armoiries ornées de fleurs de lys des rois de France, dans les rosaces des cathédrales, dans les ornamenti qui plaisaient tant au poète Guido Cavalcanti. Mais dans les fresques de la chapelle des Scrovegni, à Padoue, le bleu devint une couleur abstraite, remplissant la même fonction que l’or dans les mosaïques, les miniatures ou les retables gothiques : il conduit le spectateur vers l’ordre profond, occulte, immatériel forgé par les histoires sacrées. Giotto fit ainsi du bleu le point de départ d’une exploration du rôle de l’art dans la culture européenne. Il fut obligé, dans ce but, de le refroidir.
La peinture moderne poursuivit ce mouvement. Picasso situa le bleu au cœur d’une recherche sur les efforts de la société européenne pour se libérer de ses anciens fléaux : la misère, la maladie et la guerre ; Kandinsky le relia à la réflexion sur la spiritualité dans l’art et à la signification de Der Blaue Reiter (Le cavalier bleu). Après 1948, la soif de paix se traduisit par le bleu, tandis que le rouge était alors la couleur de la révolution et le noir, celle de l’expressionisme abstrait (il suffit de regarder les œuvres de Rothko) ; il devint donc la couleur du consensus, de l’union d’éléments divers. Avec le bleu, Antonioni chercha le mystère d’Oberwald ; avec le bleu, Kieslowski pensa la musique qui devait accompagner l’Europe afin de panser ses blessures, à travers le témoignage d’une femme (excellente Juliette Binoche) qui a gardé dans sa mémoire les notes composées par son mari pour fêter la création de l’Union européenne.
Le bleu fut finalement adopté par les organismes internationaux : ONU, UNESCO, Conseil de l’Europe et, bien entendu et de façon significative, par l’Union européenne.
Des étoiles sur le drapeau
Les Européens ont un faible pour la musique. Sa présence les a accompagnés depuis Grégoire le Grand, le pape qui avait codifié le chant liturgique qui porte son nom, le chant grégorien. Aujourd’hui encore, les gens admirent les rituels de présentation d’un concert, le silence de la salle quand le chef d’orchestre lève sa baguette, l’attente suscitée par l’interprétation d’un morceau que l’on a déjà souvent écouté. Une métaphore de l’harmonie de l’univers, la conviction que les merveilles de la science, le progrès social et l’art deviendront une réalité en empruntant cette voie.
La musique est un art qui transcende les langues européennes. Nul ne songerait à s’interroger sur la langue maternelle de Couperin, de Bach ou de Falla ; il n’en va pas de même pour le roman, la poésie ou l’essai, où l’emploi de telle ou telle langue se révèle déterminant. La musique, langage universel, est le produit d’une société encline à un ordonnancement méthodique. Une donnée dont il faut tenir compte à l’époque de l’iPod et des téléchargements sur Internet.
Une curiosité : le morceau de musique choisi comme hymne officiel de l’Union européenne est tiré de l’Hymne à la joie de Schiller, que Beethoven avait incorporé à la Neuvième Symphonie : « Joie, superbe étincelle des dieux ! », dans une adaptation d’Herbert von Karajan. Dans la nouvelle version, l’espoir enthousiaste de l’idéalisme est remplacé par une paix perpétuelle soutenue par les étoiles dorées du drapeau. À écouter cet hymne, on est bientôt séduit par son message d’optimisme. Depuis son inauguration solennelle, le 29 mai 1985, les Européens se sont transformés en de véritables athlètes de la volonté, tant dans leur travail que dans leurs loisirs, malgré l’atroce guerre des Balkans. Ils restent persuadés depuis toujours que, face aux insolences du pouvoir, aux insultes de l’oppresseur et aux outrages de l’orgueilleux, seule la solidarité est efficace.
Utilisations de l’Histoire
Depuis 1989, l’Europe a mûri tandis qu’elle s’éloignait de l’après-guerre ; elle s’est sentie soulagée par la clôture d’un chapitre long et douloureux, ce qui est aussi important que la solidité de l’euro, la mise en œuvre de la transition démocratique, la standardisation des cursus pédagogiques, la rénovation de la vie familiale, le rôle du capitalisme, la foi dans l’État-providence, l’émigration ou la crise économique. La question devient donc : que peuvent faire les Européens face aux défis de l’avenir ? Avant tout et surtout, ils devraient apprendre à distinguer le passé des évocations présentes dans les films et les romans. Il leur faudrait ainsi, par définition, faire appel à l’historien, la personne la plus à même de conserver son authenticité au passé et d’empêcher qu’il ne se transforme en une carricature, une simplification ou une abstraction. Le véritable visage du passé ne réapparaîtra que si l’on encourage un métier gravement menacé par la bureaucratie.
L’utilisation de l’histoire afin de penser l’Europe a suscité de la méfiance chez les intellectuels ayant vécu durant des décennies derrière le Rideau de fer. Ils identifiaient l’étude de l’histoire au matérialisme dialectique d’inspiration marxiste, et cela ne représentait pas de leur part une exagération. Ceux qui manifestaient dans la zone orientale, devant le mur de Berlin effondré sous leurs yeux, considéraient, à l’instar de leurs compatriotes de l’autre côté, les Occidentaux formés dans les principes de la société ouverte, que le matérialisme dialectique s’était montré stérile dans son étude du passé et trompeur dans son ébauche de l’avenir. L’exigence d’un unique fil conducteur avait occulté les versions critiques, alternatives, imaginatives. Son carcan était incapable d’embrasser la complexe réalité de l’Europe, de son art, de sa littérature, de sa musique, de sa science, de sa technologie. Qui plus est, cette méthode avait légitimé un État autoritaire, inefficace et policier.
La question : « L’histoire est-elle morte ? », qui a fait tant de bruit il y a une vingtaine d’années, a été remplacée par une autre : « Que peut faire l’historien dans la construction de l’Europe ? » L’histoire narrative a trouvé la réponse : elle raconte le passé par le biais d’un récit doté de sa propre vie, qui n’est pas une fiction puisqu’il s’en tient aux faits réels et à leurs preuves.
Patrimoine
Le passé plane sur le présent : musées, parcs thématiques, monuments, sanctuaires, célébrations. Le tourisme culturel est la grande industrie de loisirs du XXIe siècle. L’objectif de cette récupération d’un hier perdu apparaît dans son message : on avance vers une nouvelle ère en visitant les lieux de mémoire sous la férule de guides enthousiastes, et l’on comprend que ces visites semblent beaucoup plus gratifiantes que la lecture de vieux manuels scolaires.
Comment évaluer le patrimoine de l’Europe ? Deux obstacles se dressent alors. D’abord, le désir de se sentir européen en conservant intacte l’émotion d’être allemand, français, italien, tchèque, hollandais, polonais ou espagnol. Toute émotion fondée sur un patrimoine culturel représente un enjeu personnel, qui renferme une certaine dose de subjectivité et, pourquoi ne pas le reconnaître, une part de chauvinisme. Ma cathédrale a plus de valeur que la tienne ! Le second obstacle, c’est de parvenir à préserver un caractère européen dans les expériences nationales. Voilà pourquoi on continue à s’interroger sur la nationalité de Charlemagne – était-il français ou allemand ? –, ou sur la façon de nommer Aix-la-Chapelle – doit-on plutôt dire Aachen ou Aquisgrán ? Que nous apprennent ces faits ? Une seule donnée, qui se répète souvent sous des formes variées : l’histoire a servi à témoigner de la fierté d’un peuple dans un environnement hostile. L’effet final fournit une idée relativement judicieuse du défi que doit relever notre siècle ; en effet, en Europe et en toutes circonstances, ce sont les piliers qui sont les plus importants, et non les péripéties qui ne prennent de la valeur qu’en raison des loyautés nationales de ceux qui les défendent.
Les piliers de l’Europe ont subi des changements constants ; je parlerai donc d’épigenèse, en faisant appel à un concept de la biologie. Il s’agit de la capacité d’adaptation d’un être à son environnement de façon efficace et créative. Chaque époque interprète le passé à sa manière. Aujourd’hui, les historiens proposent une description très dense fondée sur une analyse rénovée des sources. Ainsi, ils ont libéré l’histoire européenne d’une interprétation reposant sur la lutte du bien contre le mal, et ils l’envisagent à la lumière d’une franchise éduquée et d’une tolérance sceptique, le dernier haut fait d’une culture laïque instruite qui relativise la vérité humaine et préfère comprendre plutôt que juger. Plus on approfondit cette façon de faire de l’histoire, plus on saisit ce qui réunit une cathédrale gothique, un tableau de Rembrandt, un concert de Mozart et un train à grande vitesse. Ce regard éclaire des aspects considérés comme négligeables jusqu’à récemment.
La tour Eiffel, par exemple. Si ce n’était qu’une publicité pour l’Exposition universelle de 1889, personne ne viendrait la visiter, sauf quelques experts en industrialisation de la France ; mais perçue comme une icône européenne, malgré son caractère agressivement parisien, c’est-à-dire français, elle abandonne sa valeur spécifique pour éveiller un sentiment de fierté partagé par des millions de personnes. En suivant sa construction, j’ai trouvé le fil conducteur nécessaire pour comprendre l’Europe.
L’impératif moral
Quelles sont les raisons de la fierté européenne ? Francis Bacon, dans son ouvrage De dignitate et augmentis scientiarum (Du progrès et de la promotion des savoirs), avait écrit : « Nous, les Européens », en notant une série de réussites culturelles dans lesquelles lui-même se sentait impliqué. L’une d’entre elles était la soif de savoir ; une autre, le progrès matériel : à la fin du XVIe siècle, il existait des réseaux commerciaux internationaux qui menaient les navires ayant mouillé dans les ports anglais jusqu’aux endroits les plus reculés de la planète, des villes somptueuses qui accueillaient une République des lettres et un flux constant d’argent en espèces ou en effets de commerce qui assurait un niveau de vie sophistiqué, sans être ostentatoire. À l’évidence, les villes et la monnaie contribuèrent à bâtir la modernité. Une autre source de fierté, bien qu’elle ne s’exprimât pas avec autant d’emphase, était l’incontestable hégémonie militaire. Il restait la politique : ce fut là que résidèrent les problèmes.
Bacon n’eut que trop de raisons de déplorer et de condamner les rancœurs nationales, lesquelles se renforcèrent à mesure que se radicalisait le désaccord entre la Maison de Habsbourg et les rois de France ; mais il ne réussit pas à sauvegarder les piliers communs, ni même un ordre international gouverné par le droit des gens. Il échoua : la dignité fut bafouée à la signature du traité de Westphalie, une paix qui ne prit en compte qu’une seule partie. Cette injustice donna prise à une crise de la conscience européenne au cours du dernier tiers du XVIIe siècle, en dépit des efforts de la République des lettres et bien qu’elle comptât dans ses rangs des personnalités de la stature de Bayle, Leibniz, Locke, Newton ou Perrault. Une nouvelle tentative se déroula au siècle des Lumières, si décrié aujourd’hui par certains, sous prétexte qu’il déboucha sur une guerre en Europe et sur le polémique congrès de Vienne. Ensuite, au cours du XXe siècle, on prit conscience du danger de perdre sa dignité ; ou bien, comme l’écrivit le philosophe allemand Max Scheler dans un essai célèbre, d’accepter sans vergogne l’indignité de l’être.
Un exemple atroce : la Bildung1 développée par le nazisme stigmatisa les Européens juifs, en affirmant que l’attribut de la Sittlichkeit, de la dignité, représentait un privilège exclusif des Européens aryens. Les autres individus furent rangés dans la catégorie des Untermenschen, « sous-hommes ». Quand une société met en œuvre cette sorte d’image, il devient difficile, pour ne pas dire impossible, d’éviter la chute dans l’abîme. Ce genre d’idée donne forcément naissance à un monde monstrueux.
À ce sujet, il convient de poser la question suivante : faut-il, à l’avenir, entretenir une relation rationnelle avec la raison, comme cela s’est déjà produit à certaines périodes du passé européen, encore que pas toujours, bien entendu ? Et si tel est le cas, pourrait-on y arriver sans l’aide de l’histoire ?
L’avenir de l’Europe passe par une analyse du passé conformément à l’esprit que nous décelons dans la physique, les mathématiques ou la médecine, un esprit de fierté pour les succès qui ont été obtenus et qui ont fait du XXIe siècle l’époque la plus riche d’espoirs et celle ayant connu la plus grande amélioration du niveau de vie de tous les temps. Cette approche est le point de départ des batailles culturelles des années quatre-vingt-dix, qui réapparaissent aujourd’hui pour nous montrer quelle part de passé il y a dans l’avenir de l’Europe. En premier lieu, les médicaments, les hôpitaux, le traitement des épidémies les plus graves (polio, choléra, typhus, malaria), l’odontologie ou l’étude de la douleur. Les efforts pour éradiquer ces fléaux ont commencé par une attitude critique de la société ouverte face aux erreurs de ses gouvernants. Ensuite, le sens du service à la communauté reste l’une des valeurs les plus solides de l’esprit européen. Malgré leurs différences en termes de credo, d’idées politiques ou de goûts artistiques, les Européens sont convaincus de la nécessité d’un impératif moral, comme norme régissant le comportement social.
Arrêt sur l’héritage
Quel est l’héritage de l’Europe ? Cette question vaut la peine d’être posée au vu du caractère étrange et déconcertant que revêt le passé, dû en partie à la rapidité des changements survenus au cours de ces dernières années, et en partie à l’absence d’une forme narrative quand il s’agit de le présenter. Stefan Zweig l’avait découvert, quand il écrivait au sujet de das Europäisches Erbe, « l’héritage européen », dans son livre Le Monde d’hier, dont le sous-titre est une véritable profession de foi : Souvenirs d’un Européen.
L’héritage de l’Europe se caractérise par sept traits de longue durée.
1. Les racines chrétiennes. C’est l’un des sujets vedettes au Parlement de Strasbourg et sur les chaînes de télévision, surtout après le débat animé entre Joseph Ratzinger et Marcello Pera. De quoi s’agit-il ? La christianisation des noms fut la preuve de l’intégration des peuples barbares dans la société. Le changement de noms est un signifiant. Ainsi, les racines chrétiennes sont mises en avant par la reconnaissance du calendrier chrétien et ses implications symboliques. En outre, la continuité de la culture classique fut possible grâce aux scriptoria monastiques, où furent copiés des milliers de textes qui sinon auraient été perdus, et aussi grâce à la création d’écoles, de cathédrales, d’universités, d’études générales, à la stimulation des corporations, des hôpitaux, des auberges, des monts de piété et, finalement, au développement du gothique, le premier art européen.
Ce monde subit un sérieux revers avec la Réforme au XVIe siècle, lorsque la République des lettres, depuis Érasme, affirma que les modes de raisonnement, les goûts et les sentiments étaient affaire de culture littéraire et non de religion. Hume, Voltaire et Kant évoquèrent le principe de la raison pour corriger la variété des coutumes européennes. De même pour cette tour de Babel, des dizaines de langues placées sur un pied d’égalité. C’était ce que voulait dire Herder quand il exalta les différences nationales fondées sur la langue et la terre. L’histoire devint l’étude des outrages commis par certains peuples sur d’autres. Ce fut ainsi le début d’un débat doctrinal qui fut réglé sur les champs de bataille : depuis la guerre franco-prussienne de 1870-1871 jusqu’à la guerre des Balkans à la fin du XXe siècle, en passant par les guerres civiles en Espagne, en Grèce, en Finlande, sans oublier les conflagrations mondiales.
La mémoire sociale exige la diffusion des images héroïques de certains peuples luttant pour la défense de leur identité, lesquels heurtent néanmoins la sensibilité d’une Europe démocratique, laïque, partisane de la liberté religieuse, des droits de l’homme, de la liberté de pensée, de l’égalité entre les sexes. Il convient d’avoir présente à l’esprit, à cet égard, la coexistence de six credo religieux : catholique, orthodoxe, protestant, juif, sunnite et chiite. Une fois faite cette constatation, posons-nous de nouveau la question : l’Europe possède-t-elle des racines chrétiennes ? Sans doute sommes-nous bien loin d’avoir une réponse irréfutable à une interrogation qui doit être interprétée comme un principe de légitimité du style de vie européen. Pour certains, les racines chrétiennes ne sont qu’une invention justifiant l’exclusion des juifs et des musulmans de la societas fidelium ; pour d’autres, il s’agit d’une réalité historique fondée sur le credo de Nicée, l’obligation des sacrements, la transsubstantiation, le secret de la confession, la discipline du clergé.
2. La culture. Cela ne se réduit pas seulement à la littérature, à la musique, à l’art : il s’agit également d’une disposition de l’esprit ; par exemple, la capacité d’établir des analogies entre un morceau de Mozart et la philosophie de Voltaire ; entre un tableau de Léonard de Vinci et les essais de Montaigne ; la physique de Galilée et la sculpture de Bernini. Une culture sans une langue commune ; avec de nombreuses langues, au contraire.
Depuis le Moyen Âge, la langue est le principe d’identité des peuples, à tel point que certains intellectuels d’alors avaient fait du latin la langue commune européenne, sans penser à l’impossibilité de ne pas provoquer ainsi un schisme avec les nations dont les matrices linguistiques étaient grecques, dont beaucoup utilisaient l’alphabet cyrillique (du nom du missionnaire Cyrille). Il en résulta le développement des langues nationales et de leur littérature. La diversité maximum dans le plus petit espace ; aujourd’hui, dans un même État peuvent coexister trois ou quatre langues propres, ainsi que cela se produit en Espagne ; on y partage alors la même culture, mais avec des formes d’expression et des nuances si différentes qu’elles stimulent le désir de scission. Il en découle des polémiques concernant aussi bien de grands noms de la littérature que des petits. Kafka, par exemple, qui écrivait en allemand bien qu’il fût né à Prague et qu’il fût donc tchèque (depuis 1918), à quelle littérature appartient-il ? À l’allemande ou à la tchèque ? On peut en dire autant du poète barcelonais du XVIe siècle Juan Boscán, qui écrivait en castillan à l’instar de son ami Garcilaso : à quelle littérature appartient-il ? À la castillane ou à la catalane ?
Un auteur est-il du pays dans lequel il vit ou de la langue dans laquelle il écrit ? Cette question est pertinente à bien des égards. Un Européen est déterminé par la relation qu’il a nouée avec son pays natal, autant dire sa langue et les coutumes de ses aînés. Ce fait donne toute sa singularité à l’Europe, où coexistent de grandes nations forgées par l’histoire avec des petites parmi lesquelles beaucoup ont obtenu leur indépendance au cours des deux cents dernières années, et d’autres s’efforcent encore d’y parvenir en réclamant leur droit à l’autodétermination, droit qui fut invoqué à l’occasion de la conférence de Paris de 1919, à la suite de la Grande Guerre. Toutes les nations, grandes et petites, veulent participer à la culture commune européenne, mais chacune à sa façon, à partir de ses propres expériences et de sa langue.
Le rôle central joué par la culture en Europe est le fruit de l’expérience : le travail de la nature par les hommes. L’expansion commerciale et la révolution scientifique de l’ère moderne constituent ses fondements historiques. La modernité inventa un destin commun pour les Européens, qui les conduisit à envisager le passé antique et médiéval par le biais de l’explication humaniste, éclairée, romantique ou moderniste.
3. La géographie. Connaître l’Europe exige d’observer une carte du Vieux Continent. La cartographie a changé au fil de l’histoire. Des cartes médiévales en forme de T aux descriptions du XVIIIe siècle ou aux cartes modernes en trois dimensions, l’offre est riche, mais elle partage une même préoccupation : mettre le détail en valeur. Le cartographe n’est ni un historien ni un chroniqueur : c’est un notaire de la réalité. Devant une carte, on comprend mieux l’origine des lieux communs les plus répandus, celui qui oppose les barbares du Nord aux civilisés du Sud, ou le développement de l’Occident et le retard de l’Orient. De même, nous apprécions davantage les expressions culturelles du passé : les églises orthodoxes avec leurs coupoles classiques en forme d’oignon cédant la place aux églises baroques, les ermitages succédant aux minarets, de somptueux palais de style byzantin remplacés par d’austères bâtisses d’inspiration protestante. Se pose ensuite la question de la création de réseaux : les connexions qui permettent de transporter des marchandises, mais aussi des personnes et des idées. Le chemin de saint Jacques est une icône de la culture européenne.
L’étude des réseaux de communication poussa Jeno Szucs à distinguer trois espaces européens : l’Occident, c’est-à-dire le bloc franco-allemand, en étroite relation avec les villes hanséatiques de la Baltique et les îles Britanniques ; l’Orient, constitué de Byzance et de ses héritiers, Russie, Bulgarie et Serbie, le souvenir du tsarisme, l’âme slave, l’orthodoxie et l’alphabet cyrillique, sans oublier la Pologne, une espèce d’îlot de religion catholique et de culture latine ; l’Europe centrale enfin, polycentrique, où des villes telles que Prague, Vienne, Budapest et Zagreb créent des noyaux de culture ouverts sur la Bohême, l’Autriche, la Hongrie, la Slovénie, le centre du continent à bien des égards : terre d’élection, forums critiques, lieu de passage pour les idées et les êtres. Pour ma part, j’aimerais en ajouter un quatrième, de plus en plus visible parmi nous : l’espace euro-méditerranéen, avec ses longues frontières au sud et à l’est, derrière lesquelles habitent des peuples non européens, une histoire de multiples rencontres réussies ou avortées. Dans ces quatre espaces, l’Europe s’offre aux yeux du spectateur comme une donnée perpétuellement potentielle, inachevée : l’enjeu actuel est l’unification de ces espaces avec la conviction qu’une culture commune est possible, comme créatrice de cette réalité nouvelle, sans précédents historiques. La lutte pour la supériorité d’un espace sur un autre a été surmontée dans la pratique politique de ces dernières années. Les dichotomies issues de siècles de combats aussi vains qu’inutiles se dissolvent dans la sphère d’une conscience commune.
4. L’esprit scientifique. La clé réside ici dans la volonté de s’élever au-dessus de la contingence : labourer des champs, assécher des marécages, défricher des forêts, fixer des limites entre la superstition et la connaissance scientifique. Bref, l’invention de l’invention. Le fait est que, avant leur ouverture au monde, au XVe siècle, toutes les sociétés subirent un retard par rapport à l’Europe. L’explication de ce phénomène constitue une question historique de la plus haute importance, bien entendu polémique, puisqu’on tire autant d’enseignements de ses échecs que de ses succès. Victimes de vieux préjugés, certains commentateurs modernes n’ont pas daigné mesurer la portée de ces idées et ont préféré répandre le mythe d’une technologie européenne attendant la fin du XVIIIe siècle pour atteindre le niveau de celle de l’Asie. C’est faux. Cette situation se produisit au Moyen Âge, avec une détermination inconnue jusqu’alors.
À quoi est dû cet intérêt pour l’invention de l’invention ? Ce fut le résultat de nombreux éléments conjugués. Le respect pour le travail manuel, le concept de personne lié à la vie sociale, la valeur du temps linéaire, l’hégémonie du marché et l’esprit d’entreprise, la sereine froideur face aux admonestations de ceux qui brandissent les personnages d’Icare et de Prométhée pour limiter l’ambition humaine.
Le désir de changer le monde n’est pas de l’arrogance ni de l’insolence : c’est un principe de responsabilité, la norme éthique de la civilisation technologique, selon les termes du philosophe allemand Hans Jonas. L’Europe a transformé ce principe en une valeur intellectuelle et elle ne doit pas en éprouver de honte. Elle peut, certes, condamner ses excès, ses erreurs ; mais jamais ses réussites, ces découvertes qui ont forgé le style de vie actuel. L’historien soulignera la capacité des paysans médiévaux de transformer leurs instruments de travail, la subtilité des scholastiques quand ils adaptent la science hellénique qu’ils ont connue à travers les Arabes et les Byzantins, l’effort d’étudier la nature transformé en un idéal de vie par Galilée, Newton ou Darwin ; l’intelligence déployée pour chercher la matière invisible à l’œil nu, le monde cellulaire, microbien, viral, et dès lors modifier la pharmacologie jusqu’à réussir à analyser les cellules mères, notre objectif prioritaire pour l’avenir. Ces procédés ont changé le monde à un tel point que nous nous interrogeons aujourd’hui sur la nécessité d’imposer des limites à la connaissance, de peur que tel ou tel territoire ne soit peut-être moralement inacceptable.
La distinction entre savoir et savoir-faire créa, à partir du XIIe siècle, les conditions nécessaires au développement de l’esprit scientifique, qui permirent la métamorphose de l’artisan en ingénieur, du maître d’œuvre en architecte, de l’alchimiste en chimiste. Cette précision est indispensable aux philosophes, ingénieurs, physiciens, astronomes pour être les dépositaires des inventions, qui ne sont pas un attribut des dieux mais des hommes.
5. La séparation du séculier et du religieux. À la différence des sociétés théocratiques de leur environnement, y compris l’islamique, les Européens ont réalisé la distinction entre Dieu et César. À chacun ses prérogatives, bien qu’on n’ait pas éradiqué les conflits idéologiques au sujet de la suprématie du Sacerdocium ou de l’Imperium, bien au contraire ; mais ces derniers servirent à stimuler une façon de penser qui se révéla positive pour le développement de l’esprit. Les débats sur la suprématie de l’Église ou de l’État provoquèrent l’apparition d’une immense trame intellectuelle : les laïcs de formation humaniste du XIIe siècle, les scholastiques et les maîtres universitaires en plein Moyen Âge, les réformateurs du XVe, les protestants du XVIIe, les philosophes des Lumières, les membres d’une République des lettres organisés en clubs, loges, sociétés d’amis, athénées, les abolitionnistes du XIXe siècle et les leaders des mouvements des droits civiques du XXe siècle
Les Européens comprirent que le combat pour conserver une attitude critique, distante, entre les deux pouvoirs, ecclésiastique et civil, était le prix à payer s’ils souhaitaient parvenir à leur différenciation. Les élites culturelles se firent connaître et acquirent du renom, de la réputation, de la célébrité, même : leurs noms étaient cités avec respect dans une espèce de bazar mondial des idées, des arguments scientifiques et philosophiques. Leur vision de l’Europe était celle d’un avenir fondé sur la distinction entre le séculier et le religieux. Hegel fut le héraut de cette proposition, qui débouche à présent sur les valeurs qui nous paraissent obligatoires et qui sont donc qualifiées d’universelles : l’Europe actuelle est démocratique, laïque, partisane de la liberté religieuse, des droits de l’homme, de la liberté de pensée, de la liberté sexuelle, de la réduction des inégalités sociales, de l’émancipation des femmes, du respect des minorités, de l’éloge de la raison.
6. Les formes de gouvernement. L’Europe a conçu trois façons de gouverner pour articuler la société et développer l’économie.
D’abord, l’empire territorial avec Charlemagne et, surtout, avec la construction du Saint Empire romain et germanique à la suite de la victoire d’Otton Ier sur les Magyars à la bataille du Lechfeld ; un modèle politique qui deviendra la monarchie universelle des Habsbourg, puis un ambitieux projet destiné à articuler l’Europe centrale et donnant naissance à l’empire austro-hongrois. Dans son sillage, la République française se transforma dans l’empire napoléonien, les rois de Prusse formèrent l’empire allemand, et les tsars de Russie furent légitimés par la création d’un empire dont la Sibérie constituait la terre promise.
Ensuite, l’État-nation commença sous la forme d’une légitimation de puissantes dynasties médiévales – Capétiens, Plantagenêts, ducs de Bourgogne, rois de Navarre, de Savoie –, puis il se transforma en monarchies nationales à l’époque moderne, et en nations-États au cours des XVIIIe et XIXe siècles.
Enfin, la ville autonome, il comune dont parlent les Italiens. En s’inspirant du proverbe médiéval « Die Stadtluft macht frei », c’est-à-dire « l’air de la ville nous rend libres », la quête d’un espace politique garant de la liberté est devenue le pilier de la société ouverte et de l’État de droit.
La synthèse actuelle de ces trois formes de gouvernement exige une écologie des institutions, d’après Peter Drucker2 ; autrement dit, que les réussites sociales et politiques dépendent de l’influence et non de la force. Cela vaut la peine d’y songer, comme une hygiène nécessaire face au danger que représente toujours la résistance au changement et au moment d’adopter des décisions sur la sécurité physique et sur le lieu de travail.
7. Les mythes. L’Europe a créé ses propres mythes, sans oublier ceux qui provenaient de sources ancestrales : égyptiens, grecs, judaïques, perses ou romains. Les mythes proprement européens se réduisent à deux : le Graal et Faust ; ils représentent en quelque sorte des signes distinctifs.
Le mythe du Graal fut élaboré à travers toute une série de récits sur le roi Arthur et les chevaliers de la Table ronde. Il naquit en France et en Allemagne au cours du XIIe siècle, et constituait une sorte de projet pédagogique pour les jeunes gens des familles nobles, soucieux du rôle des femmes dans la vie sociale. Il se diffusa peu à peu dans toutes les littératures nationales et devint une icône politique au XVe siècle, lorsque Thomas Malory écrivit La Mort du roi Arthur, la synthèse la plus répandue puisqu’elle influença Tennyson, Rossetti et Burne-Jones.
L’éducation européenne a été liée à la récupération de ces mythes, expression d’une façon d’être qui, avec l’irruption du modernisme, entra en contact avec la tradition occulte et les mystères du Grand Architecte de l’univers. Ces mythes forgèrent une structure dont les quatre personnages rappellent les travaux de Jung, et qui sera conservée par la commedia dell’arte et les opéras de Wagner, où quatre voix (ténor, basse, soprano et contralto) débattent d’un sujet précis. Nous découvrons clairement ce schéma dans le développement du thème de l’amour dans Tristan et Yseult, de la superstition (sorcellerie) dans Lohengrin, ou de la présence du sacré dans la vie humaine dans Parsifal (Perceval).
La quête du Graal est la raison d’être du roman de chevalerie : des histoires impossibles ou incroyables, où est donné libre cours aux observations les plus inattendues, dans les situations les plus surprenantes. C’est un genre qui a donné naissance à deux antihéros, devenus des références universelles : don Quichotte, l’hidalgo de la Mancha, qui devint fou à force de lectures, d’où des aventures comiques qui constituent le meilleur de l’héritage européen ; et don Juan, qui réduisit les valeurs chevaleresques à une tactique effrénée de conquête sexuelle des femmes et qui, depuis Tirso de Molina jusqu’à Mozart en passant par Molière, instruisit, avec ses insatisfactions, un monde qui s’interrogeait sur le rôle du sexe dans la vie.
Le mythe de Faust, le docteur qui vend son âme au diable pour acquérir un pouvoir surnaturel et atteindre à la jeunesse éternelle, apparaît déjà dans certains récits anonymes du Moyen Âge, mais il n’obtiendra sa forme définitive qu’avec Marlowe, Lessing, Goethe et Mann. Lu ou vu sur scène (Faust inspira des opéras à Gounod et à Berlioz), le mythe a contribué à l’élaboration de la mentalité européenne.
Coda
Le lecteur trouvera dans ce livre une description des traits principaux de l’Europe au cours de son histoire. Pour parvenir à l’élaborer, j’ai dû chausser les bottes de sept lieux de ce conte qui m’avait tellement marqué dans mon enfance ; en effet, à chaque pas j’ai parcouru une période, une culture ou la vie d’un personnage. Grâce à ces bottes, j’ai traversé les siècles sans jamais céder aux difficultés ni à la peur de l’imprévu.
Pourquoi l’Europe ? s’était demandé la chancelière allemande Angela Merkel lors d’une séance du Bundestag, en mai 2006. La raison d’être de l’Union européenne, répondit-elle, devait être redéfinie conformément au triple enjeu du XXIe siècle exprimé par le commissaire aux Affaires économiques et monétaires Joaquín Almunia : le défi économique, l’exploitation du marché intérieur et la réorientation de ses activités vers les secteurs de croissance ; le défi intellectuel, de grands investissements en recherche et innovation, la matière grise du développement ; et le défi de gouvernement, un effort de pédagogie vis-à-vis des citoyens.
Cela voulait-il dire que, pour affronter l’avenir de l’Europe, il convînt de se livrer à une description fouillée de son passé ? C’est ce que moi, je déduis exactement de ces paroles. Je suis persuadé, sans l’ombre d’un doute, que l’étude de l’histoire devra être située au centre de l’éducation du XXIe siècle. L’enjeu est énorme ; en effet, d’après Henry Adams, « il faudrait que l’éducation réduise les obstacles, diminue les frictions, renforce l’énergie ; qu’elle apprenne à réagir à l’intelligence, non au hasard, mais en choisissant, face aux lignes de forces qui enserrent son monde ». Est-ce trop demander ? L’histoire de l’Europe que je propose ici est pensée du point de vue d’un cosmopolite non seulement parce que je vais comparer des cultures différentes tout au long des siècles, mais aussi parce que j’évaluerai positivement le style de vie où la démocratie fonctionne d’autant mieux que la propriété est mieux répartie entre les citoyens et que les échanges d’idées et d’opinions sont plus développés. Au bout du compte, ce livre est un essai, dans la lignée de Montaigne, une ébauche des effets du passé sur le présent et sur le futur. Je fais donc miennes les confessions du maître : « J’ay leu en Tite Live cent choses que tel n’y a pas leu. Plutarche y en a leu cent ; outre ce que j’y ay sçeu lire : et à l’adventure outre ce que l’autheur y avoit mis. »
Pourquoi l’Europe ? Ma réponse est directe : à cause de son histoire. En la suivant pas à pas, ainsi que je veux le faire ci-après, nous comprendrons mieux les intentions d’Hamlet quand il déclarait, dans un moment d’inquiétude : « Il y a plus de choses sur la Terre et dans le Ciel, Horatio, qu’il n’en est rêvé dans votre philosophie. »
1. Bildung (all.), formation, éducation. [N.D.E.]
2. Théoricien autrichien, né en 1909, spécialiste du monde de l’entreprise.
1. Fin de l’empire romain
(312-622)
Un homme juste et ferme ne redoute pas le visage menaçant du tyran, et il ne serait pas non plus altéré par l’effondrement de l’univers tout entier.
Horace, Odes
L’Europe est le résultat d’un métissage de races et de cultures qui se produisit entre le IVe et le VIIe siècle. Cet important processus commença par la division de la civilisation pan-méditerranéenne, connue sous le nom d’Empire romain, en deux parties : l’occidentale, qui disparut en 476, lorsque Odoacre renversa l’empereur Romulus Augustule, et l’orientale, qui emprunta sa propre voie avec l’arrivée d’Héraclius sur le trône de Byzance ; il fut suivi par la grande migration de peuples germaniques, slaves et ougro-finnois, les invasions barbares.
L’axe horizontal, qui réunissait les colonnes d’Hercule aux terres du Proche-Orient et à la mer d’Azov, fut remplacé par un nouvel axe qui commençait à hauteur d’Édimbourg et s’achevait à Palerme, orienté nord-ouest, sud-est, qui se révélerait déterminant dans l’histoire des siècles suivants. Comment l’observer ? Nous savons qu’on étudie les étoiles à l’aide du télescope, les insectes avec une loupe, une goutte d’eau grâce à un microscope, mais les faits historiques doivent être analysés à l’œil nu.
Une tâche laborieuse, artisanale, dans la mesure où, selon les termes de Thucydide, « le témoin présent dans chacun des événements ne décrit pas toujours de la même façon des faits identiques ; cela dépend de ses sympathies pour les uns ou pour les autres ou de sa mémoire ».
Changement de direction
La possibilité d’un changement de direction dans l’histoire de Rome fut considérée comme une incorrection politique par les élites dirigeantes. Certaines prophéties évoquaient la fin de sa civilisation. Celle des douze aigles, par exemple, dans laquelle chacun représentait un siècle d’histoire : Rome allait durer douze siècles à partir de sa fondation, ab urbe condita (à partir de la fondation de la ville) selon Tite-Live. Ces bavardages ne convainquaient pas, néanmoins, une société dont la fierté s’était exprimée dans les monuments et l’organisation de ses cités. Personne n’avait alors soupçonné que les monuments et les équipements publics se transformeraient en simples ruines au fil du temps.
Lorsque, en pleine Renaissance, on commença à découvrir les ruines romaines, les gens se posèrent la question suivante : pourquoi une telle chose s’est-elle produite ? Nous nous interrogeons, nous aussi, depuis des siècles, pour un piètre résultat malgré les efforts fournis par le graveur vénitien Giovanni Battisti Piranesi pour les cataloguer. Il s’agit d’un fait incontestable, du moins jusqu’à ce que le Grand Tour, au XVIIIe siècle, eût mis à la mode le voyage en Italie comme rituel d’apprentissage de l’Européen cultivé. Il suffit de visiter le Forum de Rome pour le vérifier : à une certaine époque, ce lieu fut le centre du monde civilisé, et il n’est plus aujourd’hui qu’un paysage de ruines, un site touristique. Si nous nous arrêtons un peu plus longtemps, nous verrons que c’est en réalité un espace d’expérience, où, pour reprendre les propos du poète romantique Novalis dans ses Fragments, on perçoit la concaténation secrète entre l’ancien et le futur, et on apprend à reconstituer l’histoire à partir de l’espérance et du souvenir.
Fin de Rome, naissance de l’Europe : une équation qu’il faut confirmer. Chaque époque a reconstruit ce moment en fonction de ses valeurs et préjugés, mais toujours avec la même morale : l’effondrement d’une civilisation marqua l’aurore d’une autre. Qu’a-t-on dit au cours des deux cent cinquante dernières années, c’est-à-dire depuis les Lumières jusqu’à aujourd’hui ? Je citerai deux témoignages.
En 1776, après un long voyage en Italie, Edward Gibbon publia le premier volume de son Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain. L’ouvrage suscita autant d’intérêt à Londres que les nouvelles de la révolte dans les colonies de l’Amérique du Nord et les campagnes de George Washington. Pour Gibbon, la décadence de Rome avait été la conséquence directe et inévitable de sa propre grandeur. Une affirmation qui exprime les certitudes d’un homme élevé dans les Lumières. Rien à objecter ? Vraiment ?
En 1971, la maison d’édition Thames & Hudson publia un livre, abondamment illustré selon ses habitudes. Son auteur était Peter Brown. Ce professeur d’histoire antique d’origine irlandaise, formé en Angleterre, y abordait la fin de Rome avec des témoignages disparates permettant de multiples lectures et non une seule, universelle et racialement pure. Il choisit un nouveau terme pour définir cette période : l’Antiquité tardive ; puis il dota les événements et leurs protagonistes d’un espace et d’un langage qui lui permirent d’esquisser la morale du christianisme primitif.
Voici donc ce que ces deux grands auteurs ont dit au sujet de la fin de Rome et de la naissance de l’Europe, en entrant dans les détails.
Si l’histoire a un sens
Si l’histoire de l’Europe a un sens, il lui a été octroyé par les transformations de l’Antiquité tardive : à partir du 28 octobre 312 (date de la bataille du pont Milvius), au sein même de la machinerie bureaucratique de l’Empire romain, les dirigeants romains effectuèrent ce pas en avant qui, en leur faisant atteindre leurs objectifs politiques, provoqua la fin d’un monde et la naissance d’un autre.
L’Europe fut le résultat d’une rencontre de civilisations, la romaine et la germanique. La première étape fut la disparition des cadres impériaux au fur et à mesure de l’intégration des Barbares. Une nouvelle classe sociale accéda aux responsabilités dans l’administration centrale romaine. La planification sénatoriale céda l’initiative aux assemblées de guerriers, le réseau d’amis et de clients de la noblesse palatine, aux compagnons d’armes des rois, et la propriété de la terre fut léguée en vertu des liens du sang.
L’Empire romain était politiquement décentralisé, mais unifié par des lois impératives : des lois relatives au travail agricole, aux impôts, à la propriété, à l’héritage, aux réseaux commerciaux, au contrôle de la technologie, à l’armée, à l’esclavage. Le monde barbare, en revanche, était constitué de communautés d’hommes où l’initiative collective garantissait la révolution métallurgique de certains forgerons alchimistes. Leurs instruments créèrent les conditions nécessaires au développement économique. En effet, si les peuples n’avaient pas eu à leur disposition les haches aiguisées des Francs, appelées francisques en leur honneur, ils n’auraient jamais coupé les arbres millénaires pour édifier des ponts, des maisons et des forts. Il faut connaître les changements de climat pour comprendre le progrès que représentait le fait d’élever le bétail sans avoir à chercher des pâturages lointains.
La fin du nomadisme est décisive dans la formation de l’Europe. Dans les prés, on éleva une race de chevaux qui ouvriraient la voie aux chevaux de guerre, montés par des cavaliers. Ceux-ci devinrent les chevaliers vêtus de cottes de mailles et coiffés de casques, soutiens d’une puissante noblesse. Il existe parmi nous une profonde sympathie pour les rites, les armures, les légendes et la littérature de ces chevaliers. Leurs noms appartiennent à l’imaginaire européen.
Le christianisme, religion de l’Empire
Jusqu’à ce que les Barbares admettent le pouvoir culturel de la religion, les sénateurs romains conservèrent le contrôle dans tous les domaines de la vie, sauf peut-être en matière militaire. Tout ce qui était en mesure de les inspirer ou de les anoblir fut corrompu par des mentors insensibles et à courte vue qui ne méritent pas le nom de « maîtres » qu’ils s’octroyaient souvent eux-mêmes. L’objectif était la légitimation d’une bureaucratie soutenant le colonat et la réforme agraire, quel que fût le coût matériel et humain de ces systèmes. Puisque l’État exerçait son hégémonie sur la société, il s’allia aux grands propriétaires terriens provinciaux ; mais cette hégémonie était, avant tout, un fait religieux. Plotin, un philosophe de l’école d’Alexandrie du IIIe siècle, pensait que Dieu était Un et le panthéon romain, une kyrielle de mensonges : le néoplatonisme devint le guide spirituel pour ces temps d’angoisse. Il fallut effectuer un pas supplémentaire ; quelqu’un de décidé, un leader simplement capable de répondre aux aspirations des gens, devint ainsi nécessaire. Constantin fut cet homme.
Constantin fit du christianisme la religion officielle de l’Empire : l’acte le plus audacieux jamais réalisé par un autocrate, car il défiait les croyances de la majorité de ses sujets et s’en tira avec les honneurs. Le défi de ces douze années (312-324), pendant lesquelles fut réécrite l’histoire de Rome, sera relevé par une société énergique et dans le même temps exsangue. Allions-nous assister au triomphe de la doctrine du Christ ou à la victoire du paganisme ? Une fois sorti de ce dilemme, Constantin diffusa la nouvelle que sa victoire du pont Milvius sur l’autre prétendant au trône, Maxence, était due au remplacement des emblèmes romains par le chrisme chrétien. Au XVIe siècle, le peintre Giulio Romano recréa cet épisode en faisant preuve d’un sens extraordinaire de l’histoire ; les manuels parlèrent ensuite de l’édit de Milan, bien que nous sachions que ce ne fut pas un édit et qu’il n’était pas de Milan : ce n’était qu’un texte qui permit aux chrétiens de sortir de la clandestinité.
D’après la légende, les chrétiens vécurent dans des catacombes. Une image romanesque (diffusée par le cardinal Wiseman dans son roman Fabiola) et popularisée par le cinéma hollywoodien ; une image émouvante et sympathique, mais fausse. La vie des premiers chrétiens fut par elle-même assez précaire et vulnérable pour que nous n’ayons pas besoin de rajouter cette dimension pathétique qui la dénature. À quoi bon s’enfermer dans un dédale de galeries humides et insalubres, dans les environs de Rome, s’il existait des cachettes beaucoup plus sûres ? L’« église des catacombes » est une métaphore, non une réalité historique.
La légalisation du christianisme fut le résultat d’une intrigue politique le jour de l’abdication de l’empereur Dioclétien (1er mai 305), quand il se réfugia dans un palais qu’il avait fait bâtir dans l’actuelle ville de Split, en Croatie. De là, il put suivre les luttes successives entre ses héritiers pour le contrôle de l’État. Ce fut comme une partie de dames : il ne devait en rester qu’un. L’ultime affrontement opposa Constantin à Licinius : l’un représentait l’avenir et l’autre, le passé ; ce fut Constantin qui l’emporta et devint empereur, à tort ou à raison.
Au cours de ces douze années de guerres, d’intrigues et de conflits doctrinaux, on passa d’une Rome à l’autre. De la vieille Rome de Caton, Marius, Cicéron et César, il ne restait presque plus rien ; elle avait en effet perdu ses dieux protecteurs ; quant à la nouvelle Rome, qui adorait un autre dieu, le Christ, le Messie, il était encore trop tôt pour deviner quel serait son destin. En tout cas, la ville éternelle entra dans une autre éternité, celle qui la lia pour toujours à l’héritage de saint Pierre, l’apôtre sur la pierre duquel le Christ édifia son Église. Rien de surprenant à cela, à un détail près : sans Constantin, le christianisme serait resté une secte formée d’hommes riches, sophistiqués et audacieux, au lieu de se transformer en une puissance mondiale avec son armée de fidèles. Une fois le christianisme légalisé, sa progression au sein de la société devint inéluctable, étant donné que le dieu chrétien constituait l’alibi d’un projet grandiose pour le salut de l’humanité ; ses commandements interférèrent dans la vie quotidienne en exigeant une morale stricte. Cet appel à un dieu unique, véritable, qui dès lors serait Dieu avec une majuscule, relia l’empereur Constantin à la nouvelle ère et, ainsi, à la naissance de l’Europe.
En route vers Andrinople
L’homme a besoin de réconfort ; a fortiori dans les périodes où il se sent atteint par l’apparition du vieil horror vacui, ou horreur du vide. Cela se produisit au début du IVe siècle. L’homme romain courant manifesta son besoin de réconfort face à l’irréparable perte de ses croyances et de ses coutumes ancestrales ; une perte provoquée par la présence des Barbares, qui marquaient le rythme de l’histoire. Comment lui offrir ce réconfort ?
Constantin (décédé en 337) eut recours au christianisme ; Julien l’Apostat, trente ans après, à la guerre patriotique contre l’Empire perse. Ces deux propositions visaient un même but : la protection d’une société de plus en plus troublée par la succession d’événements qu’il lui avait été donné de vivre. Les théologiens furent chargés d’avancer les arguments nécessaires. L’un de ces arguments fut l’idée de l’immortalité de l’âme ; d’autres se référaient à l’éducation du corps ; tous, en somme, adoptèrent une même forme de raisonnement : « Ce monde n’est en aucun cas aussi mauvais qu’il le paraît. » Jean Chrysostome et Éphrem le Syrien furent les champions de ces idées. On vit se diffuser la croyance qu’il existait assez de signes sur Terre et aux Cieux prouvant que la Providence divine veillait sur l’homme. Avec un tel argument, la religion chrétienne se transforma en une morale civique.
Les empereurs réunirent les hommes cultivés dans des conciles œcuméniques en vue de définir la voie ; en effet, face à la sensation de déclin, la tentation de se réfugier dans une retraite spirituelle apparut. Les anachorètes et les moines brossent une morale ascétique pour une époque sans empire. Même ainsi, la société romaine continuait à faire confiance aux élites, en estimant que les tyrans étaient contrôlés et qu’un gouvernement autoritaire apporterait la reprise économique et la paix. Cette chute dans l’insupportable légèreté de l’être empêcha la société romaine de comprendre la décision prise par l’empereur de la partie orientale de l’Empire. Dans les rues de Constantinople et d’autres cités, on commentait la venue de Valens avec ses légions en un lieu de la province de Thrace. Son objectif était obscur. On disait qu’il allait y arrêter une invasion des Wisigoths, qui étaient arrivés là chassés par les Huns, et sans doute par la variole qu’ils apportaient avec eux.