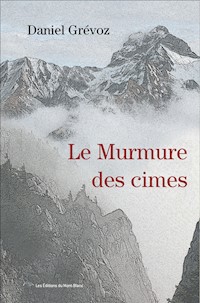
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Montblanc
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Anéanti par la guerre des tranchées, Germain se réfugie dans ses montagnes où il ne communique plus qu’avec les pages de son carnet intime.
On y partage les douloureuses séquelles des combats mais aussi la fascination de l’altitude.
On y rencontre le regard éploré de cette femme qui pénètre celui de Germain et bouscule son existence.
On y entend des éloquences qui ne sont pas que paroles.
On y suit des vies éperdues d’idéalisme qui cherchent leur raison d’être dans la montagne. Des vies qui s’épurent, s’élèvent, se détachent du quotidien pour aller à l’essentiel.
Jusqu’à quelle extrémité ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Guide de haute montagne depuis 1972,
Daniel Grévoz parcourt le Sahara – découvert à l'occasion d'escalades dans le Hoggar – à de nombreuses reprises. Passionné par l'aventure des premiers explorateurs européens du grand désert africain, il entreprend, à partir de 1985, des recherches sur ce thème dont il tirera cinq ouvrages historiques. Depuis 1996, ces premiers écrits s'enrichissent et se diversifient pour donner le jour à des livres dédiés à la montagne. Deux fois lauréat du Grand Prix du Livre de Montagne, il a aussi obtenu le Prix d'Excellence de l'association Arts et Lettres de France et le Prix du Groupe de Haute Montagne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Le murmure des cimes
« Le droit au rêve et, plus encore, le droit à l’éveil devraient faire partie de notre Constitution. »
Lionel Daudet, La Montagne intérieure.
« Pitié pour nous, forçats de guerre qui n’avions pas voulu cela, pour nous qui étions des hommes, et qui désespérons de jamais le redevenir. »
Maurice Genevoix, La Boue.
20 octobre 1918.
Il n’y aurait pas d’aube. Pas de fin de nuit, pas de jour…
Rien d’autre que le gris qui pissait d’un ciel de pluie sans relief, sans horizon, sans avenir.
« Baïonnettes au canon ! »
L’ordre infâme avait couru d’uniforme en uniforme.
Pour la deuxième fois en une semaine, il annonçait une épreuve au goût de sang. Une épreuve dont Germain savait déjà tout pour l’avoir si souvent vécue. Quand les artilleurs allongeraient leur tir, un ordre soulèverait le détachement. S’arracher à la tranchée, franchir le parapet de terre instable et glissante, courir à perdre le souffle dans la boue des entonnoirs d’obus, se déchirer aux barbelés, s’aplatir à chaque chuintement de projectile, trébucher sur des cadavres puants, ne pas se retourner sur la silhouette qui s’effondre et qui implore. Courir, courir coûte que coûte pour atteindre la tranchée adverse où il faudrait… éventrer… pour ne pas l’être.
Ce qui restait de la compagnie, saignée par les récentes offensives, allait encore devoir trouver la force d’affronter l’horreur… Conquérir les arpents de glaise et de sang que d’autres avaient pris à l’ennemi puis perdus, pris à nouveau et perdus encore. Renier tout ce qui pouvait être humain…
Oublier l’interminable marche nocturne pour aller relever une compagnie décimée. Une errance plutôt. Dans l’obscurité, sous la pluie, vers un but que personne ne semblait connaître. Lueurs et grondements d’explosions lointaines, forêt dévastée, ruines fantomatiques, pont effondré… Jusqu’à cet officier sorti du néant pour guider les arrivants vers l’enfer. À peine avait-on eu le temps de gagner les positions, remplacer des survivants hagards et terreux, retrouver l’odeur fétide de cadavres, courber l’échine au tonnerre d’incessantes déflagrations… À peine avait-on pu jeter un regard vers les lignes adverses pour les localiser, redresser un soutènement effondré, avaler une gorgée de piquette restée au fond d’une bouteille…
« Baïonnettes au canon ! »
Enclencher la féroce lame d’acier au canon du fusil… Un geste qui déshumanisait celui qui l’accomplissait ! Un geste que Germain ne pouvait plus faire autrement qu’à son corps défendant depuis ce jour où son arme avait transpercé un Allemand. Durant la démence d’un assaut, il s’était trouvé face à face avec cet homme. Jeune, les yeux bleus… un fusil à la main… Un fusil qui se tournait vers lui comme un doigt du destin. Le Français n’avait pas eu le temps de la réflexion. Emporté par l’élan du combat, chargeur vide, il avait fiché sa baïonnette dans la poitrine de son adversaire. De toutes ses forces… De toute sa peur…
Il avait senti la résistance des vêtements épais puis les tressaillements de la chair éventrée, le poids du corps qui s’alourdissait sur son arme. Il avait vu une coulée rouge sur l’acier.
Et ce regard…
Des yeux écarquillés par l’effroi qui n’avaient pas lâchés ceux de Germain jusqu’à ce que la blessure les fasse chavirer avant d’en effacer la vie. Des yeux bleus comme un ciel de printemps et qui mendiaient une miséricorde. L’image s’était incrustée au plus profond de son être. Pas seulement comme un souvenir horrible… Pire. Elle était devenue hantise, cauchemars, remords. Elle rongeait sa vie.
« Baïonnettes au canon ! »
Après avoir obéi à l’injonction, Germain appuya sa tête contre les rondins humides et froids qui soutenaient les flancs de la tranchée. Sous le casque d’acier, une sueur glacée perlait à son front. Une boule dans sa poitrine entravait sa respiration. En attendant l’ordre d’assaut, il avait besoin de puiser en lui, au plus profond de son être. Puiser la force nécessaire pour surmonter le violent écœurement que lui inspiraient les actes qu’il allait devoir accomplir. Les pires qu’on ait pu lui demander.
Quelque chose butait dans sa poitrine au rythme des battements de son cœur. Quelque chose qui répétait sans arrêt : non ! Non ! Il tenta de se reprendre. Mais comment ? Solliciter des ressources qu’il ne possédait plus ? Un sursaut de bravoure ? Il en avait tant consentis. Tenter de ne pas penser aux souffrances provoquées par un éclat d’obus venu déchirer sa chair quelques mois auparavant ? Il en sentait encore la brûlure. Oublier les yeux bleus ? Il n’avait pas de prise sur eux… Ils apparaissaient dans sa rétine selon leur bon vouloir sans qu’il puisse les en chasser. À la fois implorants et accusateurs.
Peur ?
Non. Il ne craignait même plus de mourir. Cette éventualité était devenue tellement banale, tellement probable que depuis quelques semaines, il l’attendait à chaque instant sans la redouter. Comme une délivrance. Non, il n’y avait plus de place pour la peur dans l’écœurement qu’il éprouvait. Mais il y avait pire que la peur ou la mort. Risquer de rencontrer une fois de plus les regards de ceux qui l’attendaient en face. Regards aussi jeunes, aussi avides et dignes de vie que le sien, insoutenables pour être emplis de haine, de terreur ou de folie et qu’il ne pouvait plus affronter… D’autres regards qui s’ajouteraient à celui qui hantait chacune de ses nuits.
« L’appel de l’altitude éveille en notre âme un espoir immense et instinctif comme si nous allaient être dévoilés d’infinies possibilités de bonheur. »
Pierre Dalloz, Haute montagne.
S’évader…
Le mot s’était mis à cogner dans son cerveau à chaque pulsation de son sang. S’évader ! Fuir cette grisaille froide, cette terre collante, ce fusil assassin… Mais c’était chose impossible. Physiquement tout au moins. Pour le reste… Il y eut comme une rupture dans son esprit épuisé. Un trou noir s’ouvrit sur une suite de souvenirs qui prit la place des yeux bleus. Toujours la même depuis le début de la guerre. La même à chaque fois qu’on lui imposait de renier les valeurs les plus fondamentales de sa personnalité. Mais de plus en plus insistante depuis quelques temps.
Elle commençait par des alpages qu’il gravissait en direction d’une éminence rocheuse loin au-dessus de sa tête. Une éminence défendue par de raides névés et des ressauts escarpés mais dont ses yeux ne quittaient pas le faîte. Là-haut dans le ciel, en pleine lumière…
La montagne avait vu venir à lui cet adolescent à la silhouette filiforme et dégingandée. Il s’était avancé vers elle avec des maladresses de novice, avec un équipement parfaitement inadapté. Sans aucune de ces attitudes ou de ces précautions qui caractérisent un alpiniste aguerri. Sans aucun complexe non plus. S’il n’ignorait pas qu’il pouvait rencontrer certains obstacles, courir certains risques, il n’avait aucune idée de la manière dont ils pourraient survenir et en quel lieu. Et ce n’était qu’une préoccupation secondaire, diffuse et mal évaluée.
L’essentiel était ailleurs.
Il s’échappait de la vie trop bien rangée à laquelle on voulait le contraindre. Il fuyait les interdictions, les mises en garde, les « fais attention », les « c’est dangereux là-haut »… Là-haut, ce monde minéral qui n’avait aucune utilité, lui disait-on, pour les bergers dont il était.
Rebelle, le jeune homme voulait juger seul des choses dont il devrait se méfier. Ces périls si redoutés des habitants de la vallée, il n’en connaissait d’autres manifestations qu’avalanches et éboulements. Phénomènes imprévisibles, violents parfois, mais qui ne lui semblaient pas de nature à restreindre ses initiatives. D’ailleurs, il craignait moins les forces de la montagne que les piques de ses semblables. Celles qui vous clouent au pilori en deux mots vitriolés et qu’on lui lançait parfois au village. Celles qui lui rappelaient sa modeste condition. « Hé ! Gardien de biques ! » Non, les sommets n’avaient pas de ces bassesses.
De même, la curiosité qui s’était emparée de tous ses sens faisait fi des nécessités matérielles. Peu importaient ses chaussures, à peine convenables pour courir après ses chèvres et qui se gorgeaient d’eau à chaque névé, peu importait sa veste de drap raide et trop lourde. Peu importait l’absence de lunettes qui auraient dû protéger ses yeux. Pas même un sac sur le dos… Ce n’étaient que négligeables accessoires. L’essentiel était ailleurs ! Là haut…
Il crevait d’envie de prendre de l’altitude.
Pas seulement celle que l’on compte en mètres. Celle aussi dont il pressentait l’existence et qui hisse une âme vers des élévations où elle peut s’épanouir. Monter sur l’une de ces cimes qu’il avait si souvent caressées du regard depuis la fenêtre de sa chambre et que d’autres gravissaient parfois. Suivre les lignes galbées que la neige avait ébauchées durant l’hiver le long des couloirs d’avalanches et dont le printemps avait épuré les courbes, découvrir ce que masquait un épaulement ourlé d’une corniche, se dresser sur un de ces pics de roc qui accrochaient si souvent son regard, chevaucher ces crêtes qu’il avait tous les jours pour horizon.
S’était forgée en lui la certitude qu’il grandirait à mesure qu’il s’élèverait dans ces espaces sans frontière. Grandir… Devenir un autre homme. S’approprier la puissance qui émanait des paysages qu’il contemplait, en devenir dépositaire, s’en nourrir. Oublier la médiocrité qu’il trouvait à la vie de tous les jours. Celle qu’il qualifierait plus tard de « négligeable » dans ses écrits. Dépasser les simples alpages où il conduisait les chèvres de son père chaque matin. Approcher le monde qu’on lui décrivait plein de perfidie, là-haut, vers les neiges que l’été ne parvenait pas toujours à effacer. Là-haut vers ces lumières radieuses qui attisaient sa convoitise. Ces récifs de roc où il avait si souvent imaginé tutoyer le ciel comme le font les chamois dont il apercevait parfois les altières et fugaces silhouettes.
S’approprier, enfin, l’essentiel de son destin sans en référer à qui que ce fût. Ouvrir à sa jeunesse une perspective d’envergure. Sentir le monde entier palpiter dans sa poitrine. Même si ce n’était que pour quelques heures. Les yeux des alpinistes, qu’il avait vu redescendre des cimes en disait long sur ce point. Regards lumineux et profonds, qu’on ne voyait nulle part ailleurs et qui conservaient un éclat mêlé de fierté et de satisfaction…
C’est bien ce qu’il ressentait depuis qu’il avait abordé les premiers névés. C’est bien ce qui le galvanisait, ce qui balayait toutes les craintes qu’il aurait pu nourrir. Il sortait des cloaques de la vallée. Il émergeait des jalousies, des cupidités, des médiocrités… Il s’échappait aussi des contingences qui le corsetaient, qui voulaient canaliser ses forces, brider ses ambitions. Il réalisait un serment ! Celui qu’il adressait chaque soir aux étoiles : « je grimperai vers vous ! »
Sans inquiétude pour la neige qui glissait sous ses pas et trempait ses chaussures, sans déroger du chemin idéal qu’il s’était tracé vers le sommet, sans se laisser intimider par le vide qui se creusait derrière lui, il montait.
Il montait vers le ciel.
Vers ce point qu’il imaginait comme une rencontre entre la terre et l’au-delà, la porte d’un autre monde. Lui qui avait rêvé parfois de devenir marin, écumer les grands espaces, affronter les tempêtes, tracer sa route, dompter le vent… Son océan était là, au-dessus de sa tête. Un océan vertical, avec ses calmes et ses fureurs, avec ses horizons sans limites, avec ses houles formidables, ses brisants et son écume… Un océan dans lequel il aurait voulu se fondre pour en capter la puissance. Non, la montagne ne lui inspirait pas de crainte mais au contraire une irrésistible attirance. Sa jeunesse en avait faim.
L’air frais du matin, agissait sur lui comme un bain de jouvence et la lumière encore rasante sculptait chaque relief. Un rapace l’avait approché de son vol silencieux, une trace de marmotte avait accroché son regard, des brumes légères flottaient en-dessous de lui… Rien de tout cela ne pouvait attenter à son existence. Rien ne pouvait entamer le bonheur qui l’inondait. Le sang qui battait à ses tempes jouait une partition qui prenait de l’ampleur à mesure qu’il montait.
Une musique puissante, enivrante, céleste peut-être, emplissait son âme. Elle le galvanisait, forcissait avec l’élan qui le portait vers le ciel, s’accordait au rythme de sa respiration. Une musique qu’il sentait prête à déborder de son être pour faire vibrer les hauteurs qui l’entouraient. Une musique qu’il sentait capable de faire trembler l’univers. Ce n’était pas seulement son horizon qui s’élargissait, c’était sa personnalité. Son âme, son esprit découvraient des dimensions dont il ne soupçonnait pas l’existence. L’adolescent prenait possession du monde. Il renaissait…
Les ultimes ressauts de la montagne lui opposèrent quelques gradins de rochers brisés. Il en fit l’escalade à la manière d’un chat, jouant parfois au funambule, sans vraiment se préoccuper d’une éventuelle méthode dont il ignorait l’existence. Ardent ! Sans imaginer qu’il aurait pu chuter. Son for intérieur avait dépassé ces contingences. Il n’y avait place que pour l’émerveillement, la curiosité, l’exaltation, la candeur. Un dernier rétablissement lui permit enfin de se dresser sur une crête effilée. Il ne pouvait monter plus haut… Du moins son corps ne pouvait monter plus haut. Mais son esprit continuait l’escalade d’espaces dont il avait tant rêvé, il se les appropriait…
Altitude : 2826 mètres lui avait indiqué une vieille carte qui ne mentionnait aucun nom pour cette élévation sans grade. Juste un épaulement d’une longue crête sans sommité bien définie.
Nous étions le 16 juin 1914.
À dix-neuf ans, Germain venait de faire la première et la plus belle ascension de son existence. Celle dont il se rappellerait toute sa vie. Celle à laquelle il comparerait toutes les autres sans que jamais aucune ne la surpasse en intensité, en profondeur, en enthousiasme. Celle aussi qui resterait sa propriété, que personne ne raconterait avec force redondance, verbiage ou fanfaronnade parce qu’elle était au-dessus des mots. La plus belle… Sans le savoir, sans le comprendre, il avait ressenti la légèreté que donnent les cimes au commun des mortels qui les fréquentent. Cette impression de n’être plus retenu à la Terre que par les quelques aspérités de roc sur lesquelles repose le bout des chaussures. Presque tout entier dans le ciel, comme l’oiseau juste avant l’envol. Que pèsent les règles imposées par la société quand la suprême indépendance est si proche ?
Combien de fois, au cours des cinquante-deux mois de guerre qu’il avait dû endurer n’avait-il pas songé à cet instant ? Combien de fois ne s’était-il pas évadé vers ces splendeurs qu’il n’avait vues que trop brièvement ? Évadé en esprit seulement…
« Ce ne furent pas seulement les blessures dans mon corps, ce fut aussi la marque au fer rouge sur mon âme, sur mon caractère. »
Jacques Dieterlen, Le Chemineau de la montagne.
20 octobre 1918
Le rêve s’interrompit brutalement. Germain aperçut la fusée rouge annonçant l’allongement du tir de l’artillerie. Sa lueur incendia les fumées de la bataille. Mais il n’entendit pas l’ordre d’assaut lancé par un officier au même instant. Il fut renversé par un flash aveuglant et une onde de chaleur fulgurante. Une myriade d’explosions traversa son corps. Toutes les explosions qu’il avait subies au cours de quatre ans de guerre. Toutes celles qui l’avaient bousculé, blessé, effrayé. Toutes… accumulées dans son inconscient et qui ravagèrent sa tête d’un seul coup comme si la dernière y avait déchaîné l’apocalypse.
Le fantassin recouvrit ses esprits deux jours plus tard.
Il était allongé sur un lit d’hôpital de fortune, la jambe gauche enveloppée d’un épais pansement, le visage brûlé du même côté. Souffrance, odeurs pharmaceutiques, plaintes et gémissements. Il faisait froid, le bâtiment n’avait plus de vitres, de sombres marbrures d’humidité s’élargissaient au plafond…
Une religieuse se tenait aux côtés du lit voisin, tournée vers un homme qui râlait doucement. Une religieuse que Germain tenta d’interpeller. « Ma jambe ? » Mais aucun son ne sortit de sa bouche. « Ma jambe » hurla-t-il dans sa tête, mais seulement dans sa tête. Personne ne l’entendait. Il agrippa la blouse de la religieuse qui lui répondit par un geste d’impuissance. Il y avait tellement d’autres urgences ! Lui n’était qu’un blessé léger, un miraculé ! Tout au moins si l’on s’en référait à son intégrité physique : une cuisse déchirée par un éclat, une joue noircie par une flamme, deux jours d’inconscience, quelques douleurs… Aucune menace immédiate ou ostensible pour son existence.
Le plus grave était ailleurs, invisible, ignoré encore.
Mais il s’imposa très vite. Après de vaines tentatives, le blessé dut se rendre à l’évidence : il ne pouvait plus parler. Le souffle de l’obus tombé sur le parapet de la tranchée l’avait projeté à cinq mètres de sa position. Et la violence du choc avait ébranlé les fondements de son être plus que sa carcasse. Elle avait libéré des flots de répugnance contenue qui avaient verrouillé ses cordes vocales. Diagnostic rendu par le médecin galonné dès ses premiers passages : il avait perdu la voix… et personne ne savait comment la lui rendre.
« Tu t’en tires bien, avait précisé trois jours plus tard un responsable sans compassion du service de santé des armées. Un éclat dans la jambe, quelques brûlures au visage… pas grave, et un problème vocal qui s’arrangera peut-être avec le temps. Il faut patienter, cela va revenir… La commotion, tu comprends… »
La commotion, mais aussi l’épuisement, la peur, le dégoût, le refus accumulés pendant des mois de guerre et qui avaient dépassé ce qu’il était humainement possible d’endurer… Germain ne se fit pas d’illusion sur une éventuelle guérison. Il comprit très vite que le « peut-être » du médecin n’était qu’un aveu d’ignorance, qu’il lui faudrait vivre, désormais, sans parler. Rien d’autre qu’un son sourd et rauque, hideux, ne sortait de sa bouche malgré ses efforts désespérés.
Infirme !
Le mot s’était rapidement imprimé dans son cerveau. Il avait déjà vu de ces soldats dont les violences de la guerre avaient détruit certaines de leurs facultés. Il avait croisé des yeux figés par l’effroi, des mains paralysées, des jambes raides, des troncs cassés en deux, des carcasses secouées d’irrésistibles tremblements ou prostrées… sans raisons apparentes, sans plaies ni fractures. Tous estropiés par la peur, la brutalité, les déflagrions, la promiscuité avec les cadavres, l’épuisement… Une révulsion ultime contre les violences. Blessures de l’esprit et non du corps. Blessures ? Non, ce mot n’était pas employé dans le langage militaire et administratif pour de tels dommages. N’avait-on pas plutôt affaire à des simulateurs, des couards ? Nombreux étaient ceux qui portaient un tel jugement sur ces soldats dont on mettait volontiers le courage en doute. Tous soupçonnés de mise en scène pour obtenir d’être éloignés des combats et souvent martyrisés par des médecins pas toujours capables de diagnostiquer ou de corriger ce genre de lésions inexplicables. Tous mutilés à jamais dans leur âme et leur honneur. Recroquevillés sur des traumatismes invisibles mais aussi douloureux que ceux qui saignent.
Il en fut ainsi pour Germain que l’on aurait réintégré dans une unité d’intendance si l’armistice n’était pas intervenu le 11 novembre 1918, quelques semaines après son hospitalisation.
Démobilisé, il avait été renvoyé dans les montagnes qui l’avaient vu naître…
Vingt-six ans, privé de parole.





























