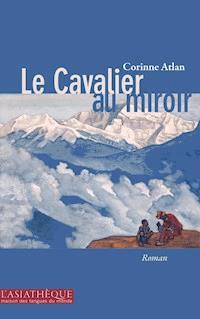Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Contre Allée
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
D’où vient ma passion pour cette langue qui fonctionne pour ainsi dire à l’envers de la nôtre, et pour la civilisation dont elle est le vecteur ? Pourquoi me consacrer à une tâche impossible, paradoxale, consistant à effacer les sons, l’écriture, et jusqu’à l’arrière-plan culturel d’un texte, pour le reconstruire, à partir de ces « ruines », avec une langue aux paradigmes si différents ?
Pour répondre à ces questions, j’ai entremêlé éléments fondateurs de ma vocation de traductrice et réflexions nées d’une longue pratique. Chemin faisant, j’ai tenté de décrypter les sensations liées à cette activité : frustration de ne pouvoir tout transmettre, joie de la création nichée dans la part du texte original qui irrémédiablement résiste, vertige addictif du décentrement, analogue à celui que procure le voyage…
Corinne Atlan
À PROPOS DE L'AUTEURE
Après des études de japonais à l’Inalco,
Corinne Atlan a passé une quinzaine d’années au Japon et au Népal, où elle enseigne le français langue étrangère avant de se consacrer, à son retour en France, à la traduction littéraire puis à l’écriture.
Elle a traduit plus de soixante oeuvres japonaises dans des domaines variés, notamment de nombreux titres de Haruki Murakami, Ryû Murakami, Yasushi Inoue, ou encore de Hitonari Tsuji et Fumiko Hayashi. Traductrice de poésie et de théâtre, elle est lauréate du prix Konishi de la traduction (pour Chroniques de l’oiseau à ressort, de Haruki Murakami, publié au Seuil en 2001), ainsi que de la Villa Kujoyama de Kyôto, en 2003, où elle écrit son premier roman :
Le Monastère de l’aube (Albin Michel, 2006), qui sera suivi par
Le Cavalier au miroir (L’Asiathèque, 2014), également situé dans la sphère géographique et culturelle qui lui est chère : Japon, Népal, Tibet.
Corinne Atlan a aussi publié plusieurs essais et récits, notamment Japon,
L’Empire de l’harmonie (Nevicata, 2016),
Un automne à Kyôto (Albin Michel, 2018), et
Petit éloge des brumes (Gallimard, collection folio, 2019).
Elle vit actuellement entre Paris et Kyôto.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Pont flottant des rêves
Corinne Atlan
© (éditions) La Contre Allée (2022)
Collection Contrebande
Le Pont flottant des rêves
Corinne Atlan
C’est celui qui est juste en dehors, sur la frontière ou sur le seuil, à la lisière, qui voit le mieux des deux côtés, mon cher Watson.
Barbara Cassin
Ouverture(s)
En Europe, la vérité réside en ce qui est dévoilé, c’est l’alètheia, tandis qu’au Japon ce qui est le plus important, c’est ce qui est caché.
Hisayasu Nakagawa1
Traduire est une activité étrange, issue de la volonté d’arracher une œuvre à son illisibilité pour la partager et, ce faisant, partager une dimension enfouie (ou enfuie ?) de nous-mêmes. Désir d’être compris des siens, dans cette langue secrète qui fonde la distance de notre regard. Il s’agit de déchiffrer pour nos « proches » un texte issu du « lointain » mais aussi de voir reconnu l’étranger qui est en nous.
Faire de la traduction son métier est plus étrange encore. Est-ce un métier, d’ailleurs ? Décider d’exercer à part entière une activité aussi précaire, aux revenus incertains, aux contrats à renouveler sans cesse, c’est s’affirmer comme saltimbanque, se placer du côté de ceux qui « vivent de leur plume » – plume d’oiseau migrateur pour ce qui me concerne.
Après avoir vécu à l’autre bout du monde, j’ai endossé un peu par hasard – mais je ne crois pas au hasard, sinon celui, « objectif », de Breton et des surréalistes – cet habit de traductrice qui m’a vite semblé taillé pour moi. Je ne me suis pas vraiment questionnée à ce moment-là sur les raisons du contentement que j’éprouvais à mettre l’énergie de mon esprit au service d’une parole autre, à superposer mes pas à ces empreintes-là. J’ignorais tout autant d’où m’était venu, assez tôt dans ma vie, le désir de m’approprier une langue pensant à l’envers de la mienne, au lieu de me laisser « materner » par celle acquise de naissance. Mais j’avais tout de suite aimé le chamboulement intérieur que cela impliquait, cette sensation du sol qui se dérobe sous les pas. En me lançant dans le voyage immobile de la traduction, j’ai retrouvé cette plongée dans l’inconnu, ce décentrement des certitudes que procure le déplacement géographique – et dont, très vite, on ne peut plus se passer.
Soudain, on n’est plus sûr de ce que l’on pense, de ce que l’on dit – de ce que l’on fait aussi peut-être, tant les codes diffèrent parfois. Il faut s’interroger sur le sens exact des mots, le bien-fondé de la syntaxe, questionner les règles de grammaire, de savoir-vivre, et tout ce que l’on tenait pour acquis. Alors, justement, on peut traduire. Ou écrire. Ou les deux : ce sont deux activités finalement si proches. Le réel lui-même, polysémique, polyphonique, est une langue à déchiffrer. « Le livre essentiel, le seul livre vrai, un grand écrivain n’a pas, dans le sens courant, à l’inventer [...] mais à le traduire. Le devoir et la tâche d’un écrivain sont ceux d’un traducteur »2, disait Proust, et cette phrase qui affirme la noblesse de la traduction m’accompagne depuis longtemps. Je regrette qu’il n’existe pas un terme unique englobant les deux faces de ces activités indissociables : écrire et traduire. Il conviendrait, bien sûr, d’ajouter : « lire ».
Les livres arrivent toujours à point nommé pour nous parler de ce qui occupe déjà nos pensées. Alors que j’entamais l’écriture de ce texte, j’ai trouvé un jour dans ma boîte à lettres un curieux petit roman traduit du japonais, aimablement envoyé par son éditrice : Chronique de Matsunoé. L’ouvrage commence par la décision du narrateur de traduire un livre (de l’anglais vers le japonais) : « Dès la première lecture, je compris qu’il me fallait traduire ce texte. C’était présomptueux compte tenu de mes compétences en langues. [...] En réalité, c’était moins la question de savoir si je saurais le traduire qui me décida que l’impression de découvrir un gars qui me ressemblait.3 »
Le narrateur s’attelle donc à la tâche puis envoie le fruit de son travail à l’auteur, qui lui répond que le texte n’a plus rien à voir avec l’original, en raison de ses « incompétences linguistiques », mais lui semble suffisamment intéressant pour être publié tel quel, comme une œuvre originale. Une fois paru le livre du traducteur autoproclamé, l’auteur se met en tête de traduire à son tour cette « œuvre » si différente de la sienne. « Et c’est ainsi, déclare le narrateur, que nous sommes devenus le traducteur l’un de l’autre ». Commence alors une étrange aventure intellectuelle, sur le thème de la traduction, mais aussi et peut-être surtout de l’écriture et de son rapport au réel.
Aux multiples mises en abyme du récit s’en ajoute une supplémentaire pour le lecteur français qui, lisant ce texte, se trouve face à une authentique traduction. On comprend que Sylvain Cardonnel, le traducteur, ait été « pris d’un certain vertige » lors de sa rencontre avec l’auteur, ainsi qu’il le raconte dans la préface. Mais quel bonheur cela a dû être de transposer en français un tel livre, jugé au premier abord « parfaitement illisible » par le traducteur, et qui se voulait « intraduisible », de l’aveu même de l’auteur ! Car voilà : la traduction procure de la joie. Une joie mêlée d’angoisse, sans doute – va-t-on y arriver, tenir les délais, trouver un éditeur ? – mais une joie avant tout. Les « difficultés » sur lesquelles on nous questionne si souvent sont finalement secondaires. Ou, en tout cas, d’un autre ordre que ce qu’imaginent les lecteurs.
À l’instar du narrateur de ce roman, et de nombre de traducteurs à leurs débuts, je n’avais probablement pas les « compétences linguistiques » nécessaires quand, à l’été 1989, de passage en France (je vivais depuis plusieurs années au Népal, où j’enseignais le français tout en étudiant une danse boud-dhiste), je me suis rendue dans les locaux d’une toute jeune maison d’édition pour soumettre un début de traduction à son directeur, Philippe Picquier. Je cherchais à l’époque un nouveau débouché professionnel, lié à mes études de japonais – une licence obtenue une douzaine d’années plus tôt, avant mon départ pour l’Asie.
Le texte que j’avais choisi posait des problèmes de droits, et Philippe Picquier me confia à la place, je ne sais pourquoi, la traduction de deux nouvelles d’Ôgai Mori4, contemporain de Sôseki Natsume, comptant comme ce dernier parmi les plus grands auteurs du Japon moderne et également traducteur de Goethe, Hans Christian Andersen, Oscar Wilde… Je n’avais encore rien publié, et l’éditeur manquait lui aussi des « compétences linguistiques » requises puisqu’il ne lisait pas le japonais. Il jugea pourtant que ma traduction méritait d’être publiée comme une « œuvre originale ». À ce jour, je lui suis reconnaissante de sa confiance et de son intuition. Car c’est ainsi – également avec mon intuition et ma sensibilité propre, autant sinon plus qu’avec l’aide des dictionnaires – que j’ai pu mener à bien cette première traduction5, et que le travail s’est dès lors enchaîné, auprès de divers éditeurs.
La traduction de la première nouvelle, surtout, L’Intendant Sanshô, reste un souvenir marquant. Ôgai Mori y raconte, dans un style à la fois réaliste et poétique qui m’enchanta dès la première lecture, l’errance de deux enfants contraints à l’exil et à l’esclavage. Trente ans plus tard, je suis frappée par l’actualité de ce récit datant de 1915, qui fait tristement écho à nombre de situations d’aujourd’hui. À l’époque, cette œuvre m’évoquait surtout le poignant film humaniste de Kenji Mizoguchi, datant de 1954, j’avais dû le voir à la cinémathèque de Chaillot quand j’étais étudiante.
Les prénoms des deux héros, Anju et Zushio, me remettent en mémoire les émotions et l’exaltation qui ont accompagné cette première traduction. Il se trouve qu’Anju est aussi un prénom féminin népalais, et que nombre de scènes se déroulent dans les montagnes : dans mon esprit la toile de fond du Japon féodal se superposait à certains coins reculés du Népal. Dans le type d’anciennes légendes bouddhistes japonaises dont Ôgai6 s’est inspiré, le périple des personnages à travers montagnes, rivières et vallées est d’ailleurs une allégorie du voyage dans un Himalaya mythique où vécut le Bouddha. On trouve aussi au Népal et en Inde, sous des formes plus ou moins proches, ce genre de légendes dont les héros, à l’issue d’un voyage semé d’épreuves, sont secourus par la puissance magique d’un objet de culte bouddhique. Alors même que je m’attachais à transcrire ces listes précises de toponymes caractéristiques de l’écriture d’Ôgai, les paysages que je voyais en imagination étaient certes japonais (certains noms m’évoquaient des lieux que j’avais déjà traversés et que j’aimais particulièrement : l’île de Sado, les montagnes autour de Kyôto, le Kiyomizu-dera…), mais également himalayens. La ferveur sacrée, la pauvreté, la dureté de la vie évoquées dans ces pages étaient directement perceptibles dans mon environnement népalais. Pourtant, il me semble aussi que ni ces coïncidences, ni la beauté précise et la puissance d’évocation du style d’Ôgai ne suffisent à expliquer pourquoi l’histoire de ce frère et de cette sœur, seuls en terre inconnue, ne pouvant compter que l’un sur l’autre, m’émouvait à ce point.
Cette première traduction m’a en tout cas ramenée vers la langue japonaise, qui n’a cessé de vivre en moi depuis. La tâche avait stimulé à la fois ma curiosité et mon orgueil, comme lorsque je lisais, enfant, des livres qui n’étaient, me disait-on, « pas de mon âge » : je voulais comprendre, je voulais me hisser à cette hauteur-là.
J’ai aussi pressenti, d’emblée, que le traducteur ne pouvait être ce personnage invisible à qui l’on demande de « s’effacer » totalement derrière le texte original. Il ne s’agit pas seulement d’une opération technique. Avoir le goût de la littérature et connaître le mieux possible les ressources des deux langues en jeu sont des conditions nécessaires mais loin d’être suffisantes. La traduction littéraire est une activité de création, davantage liée à la question de la représentation artistique du réel qu’à un savoir académique. Traduire ne fait pas seulement appel à l’intellect, mais à une intelligence des choses poétique, sensible. Comme tout processus d’écriture, cela engage l’ensemble de l’être : émotions, perceptions, imagination, souvenirs de lecture ou de vie, les deux d’ailleurs souvent mêlés. Sans compter le rôle que joue dans toute authentique rencontre, humaine comme littéraire, le réseau de racines souterraines qui court au fond de chacun de nous et nous relie à notre insu les uns aux autres.
Il faut aimer un texte littéraire, y reconnaître ou y pressentir quelque chose de soi, sinon, comment pourrait-on le lire véritablement – car le traducteur doit pouvoir lire une œuvre comme un devin lit l’avenir – et comment parviendrait-on à mettre ce texte à portée de compréhension de lecteurs appartenant à une tout autre culture ? D’où viendrait ce désir de trouver à tout prix, comme si notre vie en dépendait, les mots justes, afin de transmettre dans notre langue maternelle la parole étrangère que porte ce livre, si elle ne disait aussi une part essentielle de nous-mêmes ? Si l’on n’avait eu, en lisant ce livre pour la première fois dans sa langue originale, « l’impression de découvrir un gars qui [nous] ressemblait » ?
Origines
On naît au hasard, on est tout à coup dans un berceau, on ne sait pas d’où l’on vient, on ne sait pas où l’on est, on vous apprend ça par la suite. Eh bien moi j’ai toujours vécu comme ça. Chaque fois que je me suis trouvé quelque part à l’étranger, aux antipodes, n’importe où en train de bourlinguer, je me demandais : mon pauvre petit vieux, qu’est-ce que tu fous là ? D’où viens-tu ? Pourquoi es-tu dans ce pays-ci et pas dans un autre ? Exactement comme si je venais de naître.
Blaise Cendrars (Radio Lausanne, 1949)
Vocation
Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours eu le goût des mots étrangers : ces sons inconnus pour « dire presque la même chose 7» aiguisent ma curiosité pour le monde différent qu’ils suggèrent, là, tout près du mien. Des sons particuliers flottent en notes subtiles dans l’air que respirent depuis l’enfance les locuteurs d’une langue donnée – un peu à la manière de ce que les Japonais nomment kotodama, les « esprits des mots ». La musique de chaque langue donne une couleur particulière aux mondes, réels et intériorisés, de ceux qui la parlent.
Je ne m’en souviens pas, mais je suis sûre que le français n’a pas été la seule langue à résonner autour de moi, dans ma toute petite enfance, en Kabylie.
Je me souviens bien, en revanche, de la révélation que fut la découverte simultanée, en sixième, du latin et de l’anglais. Rosa rosa rosam. The wind in the willows… Joie immédiate face à cet élargissement du champ de la langue. Pourquoi en qualifiait-on certaines de « mortes » alors qu’elles irriguaient à tel point le français que nous parlions, que nous lisions ? C’est le rôle des morts de continuer à vivre en nous, je ne le savais pas encore. Si la littérature anglo-saxonne se trouvait en si bonne place dans la bibliothèque familiale, c’était grâce à ma mère, professeur d’anglais. Elle insistait toujours sur l’importance de lire « dans le texte », en s’aidant de dictionnaires. Je lui dois d’avoir pris conscience très tôt de la saveur incomparable d’un livre dans sa langue d’origine.