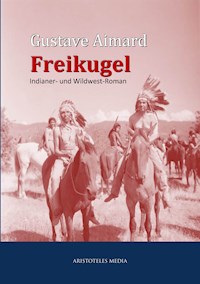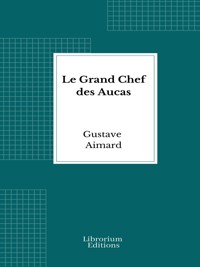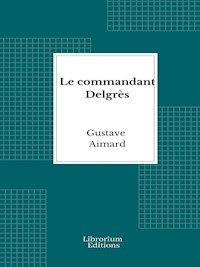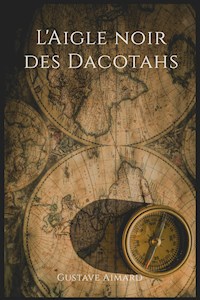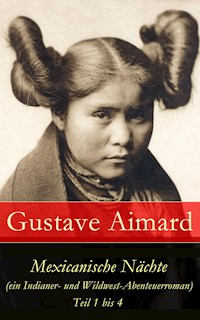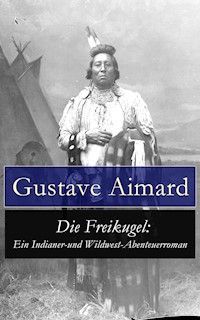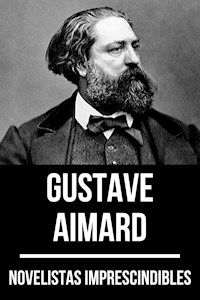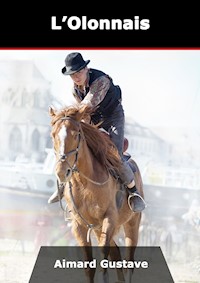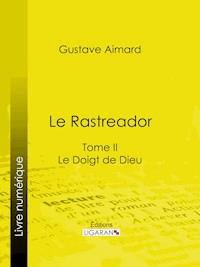
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Don Balthazar Turpide dégusta lentement un verre d'excellent cognac de France, véritable fine champagne d'une vieillesse respectable, et fit, avec l'ongle du petit doigt, tomber la cendre blanche de son cigare."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Don Baltazar Turpide dégusta lentement un verre d’excellent cognac de France, véritable line champagne d’une vieillesse respectable, et fit, avec l’ongle du petit doigt, tomber la cendre blanche de son cigare.
– Vous avez parlé d’un second échec que nous aurions subi ? dit don Manuel après un instant.
– Hum ! c’est vrai, fit négligemment don Baltazar, échec assez grave, même ; don Fabian de Torre-Azul est nommé ministre de la justice.
– L’ami de don Porfirio Sandoz ?
– Juste !
– Voto a Brios ! s’écria don Baldomero, il ne nous manquait plus que cela pour nous achever ! Et cette idée…
– Laquelle ?
– Ce prêt d’argent ! Sur ma foi, vous êtes fou !
– Moi ? pas le moins du monde.
– Oh ! quant à cela, c’est une plaisanterie, n’est-ce pas, mon ami ?
– Je ne plaisante jamais quand il s’agit d’affaires, reprit-il sérieusement ; j’ai trouvé l’occasion d’en faire une excellente, je l’ai saisie avec empressement ; ne suis-je pas banquier ?
– C’est vrai ; mais fournir ainsi de l’argent à notre plus mortel ennemi !…
Don Baltazar haussa les épaules et fit une grimace ironique.
– Vous n’entendez rien à ces sortes de spéculations ; celle-ci me rapportera deux cents et peut-être trois cents pour cent ; j’aurais été fou de la laisser échapper.
– Mais comment don Porfirio, lui si madré, s’est-il adressé à vous ?
– Oubliez-vous donc que tout le monde me croit votre ennemi, don Porfirio comme les autres ?
– Il a dû s’affermir dans cette croyance en vous trouvant si obligeant ?
– C’était précisément ce que je voulais ; j’ai complètement réussi : nous sommes intimes.
– Ah çà, mon ami, que venez-vous donc nous conter là ? Je vous trouve charmant, sur ma parole ! fit don Manuel en fronçant le sourcil.
– Vous êtes bien aimable, répondit don Baltazar en s’inclinant avec une de ses plus bouffonnes grimaces ; les dames me le disent encore quelquefois.
– Le diable soit de l’homme ! il n’y a pas, avec lui, moyen de se fâcher ! s’écria don Manuel en frappant du poing sur la table.
On se mit à rire.
– Mais, malheureux, reprit don Manuel, réfléchissez donc que, cette fois, nous jouons notre partie suprême ; que notre force réside principalement dans notre richesse, que ces gens-là sont gueux comme des rats d’église ; ils ne savaient de quel bois faire flèche pour trouver quelques milliers de piastres, et vous avez été assez niais pour leur en prêter deux cent mille !
– Je le crois bien ! je leur en aurais prêté le double, s’ils me l’avaient demandé.
– Mais c’est de la folie, cela ! de l’aberration mentale ! s’écria-t-il furieux.
– Calmez-vous, don Manuel, je vous prie, dit en intervenant don Baldomero ; je crois avoir compris la combinaison de don Baltazar et je partage entièrement son avis.
– Et moi de même, señor, fit don Cristoval Palombo.
– Comment, vous partagez l’avis de…
– Don Baltazar ? parfaitement.
– Laissez-le s’expliquer, ponctua froidement don Cornelio Quebrantador.
Don Manuel était contraint à de grands ménagements envers ses complices, il comprit qu’en cette circonstance il lui fallait céder ; il dissimula son mécontentement et feignit de se calmer.
– Alors, au nom du ciel, dit-il, qu’il s’explique ; je ne sais réellement plus où j’en suis, je me perds au milieu de toutes les folies que ce démon nous débite, comme à plaisir, depuis plus d’une heure.
– Je n’ai jamais parlé plus sérieusement qu’en ce moment, cher seigneur, répondit don Baltazar avec une grimace atroce qui avait évidemment la prétention peu justifiée d’être un charmant sourire ; si vous aviez consenti à me laisser m’expliquer sans m’interrompre, vous le reconnaîtriez depuis longtemps déjà.
– Alors parlez, mil diablos ! je ne soufflerai plus un mot.
– À la bonne heure ainsi ; du reste, je ne vous demande que cinq minutes : ce n’est pas mettre votre patience à une trop longue épreuve, je suppose.
– Allez, allez, supprimez les préliminaires.
– M’y voici, mais je vous en supplie, cher seigneur, une autre fois ne soyez pas aussi impatient. Vous connaissez mieux que personne notre situation, n’est-ce pas ? Donc, vous êtes convaincu comme moi que, malgré l’étendue de nos relations, le nombre considérable de nos complices, disons le mot, et la haute position que la plupart d’entre eux occupent soit dans les affaires publiques, soit dans l’armée, soit dans le commerce, cette situation, dans tout autre pays moins excentrique que le nôtre, ne pourrait pas se soutenir je ne dis point pendant un an, mais seulement pendant six mois, car elle ne repose que sur une pointe d’aiguille sur laquelle nous sommes en équilibre ; que cet équilibre se dérange par suite d’un hasard quelconque, tout s’écroule du même coup et nous sommes perdus.
– Cependant voilà vingt ans bientôt que les choses sont ainsi et notre puissance s’accroît tous les jours, dit don Manuel avec ironie.
– Parce que nous sommes au Mexique et que dans notre pays, où tout marche au rebours de la logique, l’invraisemblable seul est possible et l’absurde a des chances de durée ; de plus, nous n’avons, jusqu’à présent, jamais été attaqués sérieusement.
– Précisément à cause de ces immenses relations que nous avons su établir, et ces nombreux complices disséminés dans toutes les villes et jusque dans les moindres villages.
Don Baltazar haussa les épaules et s’agita sur son siège en faisant une série de grimaces plus épouvantables les unes que les autres.
– Allons, vous êtes un niais ! dit-il brutalement.
– Hein ! fit don Manuel en se redressant d’un air blessé à cette rude apostrophe.
– Vous êtes un niais et je le prouve, reprit l’autre sans autrement s’émouvoir ; comment, vous en êtes encore là ! vous vous imaginez bonnement que ces relations si chèrement établies, ces nombreux complices nous seront utiles à l’heure du danger ?
– Dame ! c’est pour cela que nous nous les sommes associés, il me semble ?
– Que vous vous les êtes associés, et non nous ; rétablissons les faits, s’il vous plaît, mon maître.
– Qu’importe cela ?
– Beaucoup plus que vous ne le pensez, cher seigneur ; c’est vous seul qui avez fait cela et non nous ; la plupart des chefs, et moi tout le premier, ont été opposés à cette mesure dangereuse, mais vous vous êtes obstiné, et la sottise a été faite : il est juste que seul vous en subissiez les conséquences devant le conseil ; je vous affirme que, s’il ne s’était agi que de vous, je ne me serais pas dérangé pour vous sortir de la fâcheuse position dans laquelle vous vous êtes mis ; mais, comme nous sommes malheureusement tous solidaires les uns des autres, et que votre perte entraînerait inévitablement notre perte à tous, je me suis dévoué, non à vous, mais à l’association ; voilà pourquoi j’ai agi comme je l’ai fait et pourquoi je suis venu vous rejoindre.
– Vous ne discutez pas, vous assommez ; les injures ne sont pas des raisons ; jusqu’à présent, vous n’avez rien expliqué ni rien prouvé.
– Patience ! j’y arrive ; d’abord, sachez ceci, c’est que tous ces complices, le moment venu, et il l’est, voudront retirer leur épingle du jeu et essaieront, par tous les moyens honnêtes ou non, de se disculper à nos dépens, afin de ne pas être entraînés dans notre chute ; pour cela, ils deviendront nos ennemis déclarés, nos dénonciateurs les plus acharnés.
– Oh ! oh ! vous allez trop loin señor.
– Vous croyez ? fit-il on ricanant ; eh bien, sachez que déjà ils ont commencé et que les dénonciations marchent grand train, à Mexico même.
– Serait-il possible ? s’écria-t-il d’un air effaré.
– Cela est rigoureusement exact.
– Nous sommes perdus, alors !
– Pas encore ; mais cela pourrait arriver bientôt si nous ne nous mettions pas en mesure au plus vite.
– Que faire ? valga me Dios ! que faire ?
– Ah ! vous comprenez enfin ! cela n’est pas malheureux ; vous y avez mis le temps.
– Vos récriminations ne signifient rien et nous font perdre un temps précieux ; si vous êtes venu ici, c’est que vous avez un moyen de nous sauver.
– Peut-être ! fit-il avec un ricanement sinistre.
– Eh bien, ce moyen, quel est-il ?
– Vous le saurez bientôt, mais laissez-moi d’abord vous exposer le plan de nos ennemis, plan fort ingénieux, très redoutable et dont vous ignorez le premier mot, ce qui fait que, sans vous en douter, vous avez jusqu’à présent joué le jeu de nos adversaires et rendu très problématique le succès de la partie si habilement engagée contre nous par nos ennemis.
– Je ne vous comprends pas, l’association est menacée ; je dois la défendre.
– Voilà l’erreur. Jusqu’à présent ce n’est pas l’association, mais vous seul que l’on attaque.
– Moi ? et à quel propos ?
– C’est incroyable, cher don Manuel, comme votre mémoire devient chaque jour plus mauvaise ; n’avez-vous donc pas quelque vieille peccadille, qu’en fouillant vos souvenirs il vous serait facile de retrouver, par exemple des enfants à vous confiés, une espèce de fidéicommis, un testament contenant certaines clauses ? que sais-je, moi ?
– Oh ! oh ! fit don Manuel en devenant livide, est-ce donc cette affaire qu’on prétend ressusciter contre moi ?
– Non pas ressusciter, cher seigneur, mais évoquer, ce qui n’est pas du tout la même chose.
– Bon ! je me défendrai, n’ayez peur.
– Je le crois, mais après ?
– Comment, après ?
– Dame, l’affaire une fois entamée, on emploie tous les moyens pour en assurer le succès. Ne craignez-vous pas que la fameuse association des Plateados, dont vous êtes le chef principal, ne l’oubliez pas, ne fournisse de sérieux arguments en faveur de vos adversaires ? il en a été dit quelques mots déjà ; nos ennemis, presque sans ressources, voyaient arriver avec terreur l’heure de la prescription ; ne possédant pas ou n’osant risquer les sommes considérables que nécessite tout procès au Mexique, sachant que nous comptions de nombreux amis et de chauds partisans dans les ministères et jusque dans l’entourage du président de la république lui-même, leur argent aurait été perdu sans bénéfice pour eux, car le jugement aurait été rendu en notre faveur ; vous comprenez cela, n’est-ce pas ? Telle était la situation, lorsque le pronunciamiento a tout changé, en renversant nos amis et les remplaçant par nos ennemis.
– Pronunciamiento auquel, sans doute, ils ont aidé.
– De toutes leurs forces ; c’était leur seule chance de succès.
– C’est vrai.
– Vous le reconnaissez, c’est très bien. Dès que le nouveau gouvernement fut installé, don Porfirio Sandoz, qui, il faut en convenir, est un ennemi aussi redoutable par sa haute intelligence que par son activité, a commencé par se faire nommer gouverneur de la Sonora, vous comprenez dans quel but ?
– Vive Dios ! celui d’obtenir par la force, s’il est possible, ce qu’il ne saurait avoir par le droit.
– Ne parlons pas de droit, nous qui nous sommes mis en dehors, cher señor, cela nous porterait malheur ; pourtant il y a du vrai dans votre observation, possession vaut titre dans un État aussi éloigné du centre.
– Surtout quand on est gouverneur de cet État, fit observer don Baldomero, et que, par conséquent, on dispose des troupes et des tribunaux.
– De plus en plus vrai, reprit don Baltazar en grimaçant ; mais pour obtenir ce magnifique résultat, c’est-à-dire pour se venger du seigneur don Manuel de Linares, et détruire la redoutable association des Plateados, il fallait de l’argent, beaucoup d’argent.
– Et don Porfirio n’en avait pas ! s’écria don Manuel en se frottant les mains.
– Personne ne sait positivement ce que don Porfirio a ou n’a pas ; c’est un Indien madré, silencieux et dont il est impossible de scruter les pensées secrètes ; ce qui est certain, c’est que, depuis quelques années, il passe pour complètement ruiné ; bref, don Porfirio se décida à engager ses propriétés de Mexico, les dernières qu’il possède, dit-on, avec son hacienda del Palmar, qui ne rapporte presque rien, pour la somme de soixante mille piastres. J’étais aux aguets, je lui fis donner l’idée de s’adresser à moi : il n’y manqua pas ; j’accueillis favorablement ses ouvertures, saisissant en apparence l’occasion de vous jouer un mauvais tour, car tout le monde me croit votre ennemi ; mais, au lieu de soixante mille piastres qu’il me demandait, je lui en offris deux cent mille, non plus comme prêt, mais comme paiement de ces propriétés, que je lui proposai d’acheter. Don Porfirio fit d’abord des difficultés ; j’insistai, enfin il céda aux conditions suivantes ; écoutez bien ceci : l’hacienda del Palmar et le palais de Mexico sont engagés entre mes mains tels qu’ils se comportent en ce moment ; mais si dans deux mois, à compter du jour de la signature de l’acte, don Porfirio ne m’a pas payé la somme totale de deux cent mille piastres versée par moi entre ses mains, plus la somme de trente-cinq mille piastres pour frais, intérêts et commission, soit en tout la somme énorme de deux cent trente-cinq mille piastres, ses propriétés demeurent à tout jamais miennes.
– Oh ! mais !…
– Je n’ai pas fini, il reste une dernière clause.
– Voyons ! voyons !
– À défaut d’argent, don Porfirio peut se libérer envers moi en me remettant le testament olographe que vous savez, en s’engageant à renoncer par écrit à toutes poursuites sur cette affaire et à ne plus attaquer dans l’avenir don Manuel de Linares de Guaytimotzin, directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit.
– Voilà une affaire bien conduite ! s’écria don Baldomero enthousiasmé.
– Parfaitement menée, appuya don Benito de Gazonal.
– Si c’est ce que je crois, c’est bien joué, fit don Cornelio Quebrantador.
– L’acte est signé ? demanda don Cristoval Palombo.
– Depuis cinq jours, fit don Baltazar en grimaçant plus que jamais et se frottant les mains à s’enlever l’épiderme.
Don Manuel regardait ses amis avec le plus profond étonnement.
– Ce que je vois de plus clair dans tout cela, dit-il enfin, c’est que notre ennemi ne possédait pas un réal et qu’aujourd’hui…
– Il est absolument au même point, interrompit en ricanant don Baltazar.
– Comment ? que voulez-vous dire ?
– Je veux dire que ce que j’avais prévu est arrivé ; d’abord il a fallu nettoyer la situation, c’est-à-dire se débarrasser des dettes criardes et se remettre en état de faire figure, monter ses équipages, etc. Soixante mille piastres ont été enlevées du coup, puis il a fallu visiter les membres du gouvernement et en obtenir sinon l’autorisation de manœuvrer à sa guise, du moins l’assurance de l’indulto complet ; cela a coûté cher, près de cent mille piastres ; de sorte qu’aujourd’hui le señor don Porfirio Sandoz, gouverneur de la Sonora, ne possède pas quarante mille piastres en caisse.
– Ah ! ah ! et plus de moyens d’en trouver d’autres ! s’écria don Manuel ; en effet, cher señor, c’est bien joué ; agréez toutes mes excuses ; vous êtes, sur ma foi, un habile homme.
– Merci, señor, mais ce n’est pas tout, dit don Baltazar.
– Qu’y a-t-il encore ?
– Vous m’avez donné carte blanche, n’est-ce pas, cher seigneur ?
– Certes.
– Eh bien, j’en ai usé.
– Voyons cela ?
– Le nouveau ministre des finances est venu me voir, se plaignant de l’état désastreux dans lequel se trouve le Trésor, du besoin extrême que le gouvernement avait d’argent comptant ; alors, je lui ai répondu que, depuis quelques mois, un vagabond, un mauvais drôle parcourait la Sonora, causant, par de sourdes menées, de graves préjudices aux habitants de ce pays, les effrayant par ses menaces, etc., etc. ; que cet individu, nommé don Torribio de Nieblas, n’était pas même Mexicain, s’était posé comme étant mon ennemi, qu’il avait fait piller deux de mes haciendas et que je désirais en être délivré au plus vite ; bref, je manœuvrai de telle sorte que je prêtai au ministre quatre-vingt mille piastres sans intérêt ; le ministre m’a serré la main et m’a promis que ma réclamation étant juste, il y ferait droit. Que pensez-vous de cela ?
– Je pense que c’est admirable et que vous avez très adroitement paré le coup que l’on voulait nous porter.
– Et cela d’autant plus que j’ai dans mon portefeuille une autorisation, signée du président de la république et du ministre de l’intérieur, de faire arrêter don Torribio de Nieblas et de repousser la force par la force au cas où nous serions attaqués.
– Vous avez cette autorisation ?
– La voilà, dit-il en la retirant de son portefeuille et la présentant à don Manuel.
Celui-ci la saisit et la parcourut rapidement des yeux.
– Eh ! mais, c’est tout simplement un blanc-seing que l’on vous donne là ! s’écria-t-il joyeusement.
– À peu près, répondit don Baltazar avec une feinte indifférence.
– Mais tout à fait, au contraire, voyez vous-même.
– Bon, mettons tout à fait si vous voulez, je n’y tiens pas. Ainsi, vous êtes satisfait ?
– Enchanté, c’est le mot ; je ne sais comment vous remercier ; tout cela a dû vous causer beaucoup d’ennuis.
– L’ennui n’est rien, la réussite est tout.
– Nous avons réussi complètement.
– Le croyez-vous ?
– Dame, il me semble que les faits sont là ; ce dernier papier a dû vous coûter assez cher ?
– Mais non, pas trop, une vingtaine de mille piastres tout au plus.
– C’est ma foi pour rien.
– C’est ce que j’ai pensé ; mais, ajouta-t-il avec la grimace d’un singe croquant un fruit vert, j’ai un autre papier là, quelque part dans mon portefeuille, qui m’a coûté cher.
– Bon, vous avez encore un papier, vous en êtes donc farci ? dit en riant don Manuel.
– Eh ! eh ! vous savez le proverbe : quand on prend du galon, on n’en saurait trop prendre ; et, ma foi, je me suis laissé aller à faire cette dernière dépense.
– Quelle dépense ?
– Celle du papier dont je vous ai parlé tout à l’heure.
– Très bien, et vous dites qu’il vous a coûté cher ?
– Horriblement cher, señor, horriblement, mais je ne le regrette pas.
– Combien donc l’avez-vous payé ?
– Hélas ! quatre-vingt-dix mille piastres comptant.
– Caraï ! c’est cher, en effet.
– Vous voyez, vous me blâmez.
– Moi ? nullement, s’écria-t-il avec vivacité, vous en auriez dépensé le quadruple que je trouverais encore que vous avez bien fait. Est-ce que je ne connais pas votre dévouement à l’association et votre amitié pour moi ! D’ailleurs, vous aviez carte blanche, et vous continuerez à l’avoir tant que cela vous plaira ; tenez-vous-le pour dit.
– Eh bien, señor, je ne veux pas plus longtemps jouer avec vous comme un chat avec une souris, fit-il en retirant un papier de son portefeuille et le lui présentant ; voici ce que je vous gardais pour la bonne bouche ; je crois que, lorsque vous aurez lu le contenu de ce rescrit, vous ne regretterez plus vos quatre-vingt-dix mille piastres.
Don Manuel déplia le papier d’une main fébrile et le parcourut des yeux.
– Voto a Brios ! s’écria-t-il avec explosion, ce n’est pas possible !
– Qu’est-ce qui n’est pas possible, cher señor ? demanda don Baltazar en grimaçant.
– Comment ? je suis nommé alcade-mayor d’Urès !
– Capitale de l’État de Sonora, si je ne me trompe.
– C’est vrai ; c’est un coup de maître ! mil Rayos !
– Vous comprenez, cher señor, que nous ne pouvions pas demeurer sous le coup de l’échec que nous faisait subir don Porfirio Sandoz : il est gouverneur de Sonora, vous êtes alcalde-mayor d’Urès ; il dispose des troupes, vous de la justice ; vous êtes ainsi à deux de jeu. Comment trouvez-vous la riposte ?
– C’est partie gagnée.
– Telle est aussi mon opinion ; seulement, si vous me le permettez, je vous donnerai un conseil.
– Parlez, parlez, señor ; venant de vous, il ne peut être qu’excellent.
– Le voici, vous en ferez ce qu’il vous plaira ; don Porfirio ignore tout ce que j’ai fait et par conséquent ce que j’ai obtenu pour vous ; maintenez-le le plus longtemps possible dans cette ignorance, prenez vos mesures sans perdre un instant, mais de façon à ne rien révéler. Don Porfirio ne sera pas installé avant huit ou dix jours, j’en suis certain ; cela vous permet d’agir vigoureusement, d’autant plus qu’il ne sera pas encore en état de vous attaquer tout de suite.
– C’est moi qui l’attaquerai.
– Gardez-vous-en bien, au contraire, ce serait tout compromettre ; attendez son attaque ; puis démasquez brusquement vos batteries et pressez-le vivement ; cela vous sera facile, puisque toutes vos précautions seront prises à l’avance.
– Il y a beaucoup de bon dans ce que vous dites là, señor.
– Ce sera notre ennemi qui se fourvoiera et se mettra ainsi dans son tort, puisqu’il proclamera, pour ainsi dire, la guerre civile en troublant l’ordre, que vous êtes chargé de maintenir.
– Ce plan de campagne est admirable ! s’écria vivement don Baldomero ; je m’y rallie entièrement.
– Seulement, gardons le silence et agissons avec la plus grande prudence, appuya don Baltazar ; là pour nous est tout le succès.
– Merci de votre conseil, señor ; je m’y conformerai de point en point, dit don Manuel en lui serrant affectueusement la main.
– L’affaire sera rude, dit don Baltazar ; le jaguar, quand il est acculé, se défend jusqu’à la mort.
– Eh bien, nous le traiterons comme les tigreros traitent les jaguars aux abois.
– N’ayant plus rien à perdre, nos ennemis n’ont plus rien à ménager, reprit don Baltazar ; nous devons nous attendre à tout de leur part.
– Oui, oui, cette dernière lutte sera terrible ; mais mieux vaut en finir une fois pour toutes.
– Que comptez-vous faire ? demanda don Baldomero.
– Je vous l’ai dit déjà, suivre le conseil de don Baltazar : ne pas perdre un instant, car c’est notre salut qui est en jeu ; mais, pour aller plus vite et être plus tôt en état de faire face aux évènements qui, d’un instant à l’autre, peuvent surgir, il faut nous partager la besogne.
– Moi, dit don Baltazar, je vous suis inutile ici, où vous n’avez nullement besoin de banquier, au lieu que peut-être je vous serai très utile à Mexico, quand ce ne serait que pour surveiller nos ennemis et vous mettre en garde contre les trahisons, les dénonciations et tout ce que l’on tentera sans doute contre vous.
– Parfaitement juste. Quand comptez-vous partir ?
– Au point du jour.
– Très bien ! Et vous, Baldomero ?
– Don Cornelio, don Cristoval et moi, nous avons notre ligne toute tracée : réveiller l’ardeur de nos amis, enrôler tous les pirates et les rôdeurs des prairies.
– Fort bien ; don Benito de Gazonal et moi nous nous rendrons à Urès, où il est important que nous soyons le plus tôt possible, nous vous laisserons partir en avant ; donc demain, au point du jour, ou plutôt dans quelques heures, car il est près de quatre heures du matin, chacun de nous se mettra en route de son côté.
– Eh ! s’écria don Baltazar en grimaçant d’une horrible façon, je ne suis pas coureur des bois, moi, cher seigneur.
– N’ayez aucune inquiétude à ce sujet, cher don Baltazar. Mon ami, je vous fournirai une escorte suffisante pour vous préserver de tout danger et qui ne vous laissera que lorsque vous n’aurez plus rien à redouter de qui que ce soit.
– À la bonne heure ; je ne me soucierais que très médiocrement, je l’avoue, de donner dans une embuscade.
– Vous arriverez sain et sauf, soyez tranquille ; connaît-on votre voyage là-bas, à Mexico ?
– On me sait absent, mais on me croit à la Vera-Crux pour affaires.
– Très bien ; il vaut mieux que l’on ignore que vous êtes venu de ce côté. Maintenant, ajouta-t-il en se levant, tâchez de dormir deux ou trois heures, je vous souhaite un bon sommeil.
– Un instant encore, dit don Baldomero, nous oublions la question principale.
– Bon, laquelle donc ?
– Vous n’avez pas déterminé où sera le rendez-vous général.
– C’est ma foi vrai, je perds la tête, je crois. Eh bien…
– Permettez, interrompit don Baldomero, je possède, à quatre ou cinq lieues de Tubac tout au plus, une hacienda que vous m’avez vendue, don Manuel.
– Monte-Negro ?
– C’est cela même ; sa position est excellente. Sauf meilleur avis, c’est là, je crois, que nous devons placer le rendez-vous général ; nous serons chez nous d’abord, et ensuite nous commanderons la Sonora et les routes qui y conduisent du côté des prairies.
– Oui, ce point est bien choisi, nous le connaissons tous ; de plus, ainsi que vous l’avez dit, Baldomero, la position est forte et pourrait, au besoin, être défendue.
– Alors, c’est entendu ? dit don Baldomero.
– Entendu ! répondirent d’une seule voix les assistants.
Sur ce, ils prirent congé les uns des autres et se retirèrent dans les appartements préparés pour les recevoir.
À peine la porte s’était-elle refermée sur les chefs Plateados qu’un léger craquement se fit entendre, et un pan de muraille se détacha, tourna lentement sur lui-même, et dans l’espace laissé vide un homme apparut.
Cet homme était don Torribio de Nieblas.
Il promena un regard inquisiteur autour de lui.
– Bien, murmura-t-il avec un sourire d’une expression étrange, moi aussi je serai à ce rendez-vous. À bientôt, mes maîtres ; vous n’étiez pas seuls à tenir conseil !
Il recula, disparut dans la fissure, et le pan de muraille reprit sa place sans qu’il fût possible à l’œil le plus exercé de découvrir la moindre trace de ce passage secret, si habilement dissimulé.
Après s’être séparé, ainsi que nous l’avons dit, des deux chasseurs Matadiez et Redblood, don Torribio de Nieblas s’assit au pied d’un énorme mélèze et, laissant tomber sa tête sur sa poitrine, il réfléchit longuement à la tâche ardue qu’il s’était donné et aux moyens dont il disposait pour en assurer le succès.
Depuis une heure déjà il était ainsi plongé dans ses réflexions lorsque le cri de l’aigle à tête noire, répété à deux intervalles assez rapprochés, lui fit subitement relever la tête.
Il se leva, jeta un regard autour de lui et imita, à s’y méprendre, le cri de l’épervier d’eau.
Presque au même instant le bruit d’une course rapide se fit entendre dans les halliers, les branches s’écartèrent brusquement et livrèrent passage à un homme qui bondit dans la clairière comme un daim effarouché et s’arrêta droit et ferme à deux pas du jeune homme.
Cet homme était Pepe Ortiz.
Don Torribio sourit.
– Te voilà donc enfin, frère, lui dit-il ; je t’attendais plus tôt ; sois le bienvenu.
– J’ai tardé, c’est vrai, répondit Pepe Ortiz, mais ne le regrette pas, frère, mon temps n’a pas été perdu.
– Je m’en doute ; il y a donc du nouveau ?
– Je le crois ; mais je dois t’avertir tout d’abord que je n’y suis pour rien : le hasard a tout fait.
– Explique-toi ; tu sais que nous n’avons pas un instant à perdre.
– Nous pouvons causer en marchant ; nous n’avons rien à redouter ici ; ce lieu est maudit, tu le sais ; les animaux eux-mêmes s’en écartent.
– Tu dis vrai, jamais je n’ai vu un paysage aussi désolé.
Tout en échangeant ces quelques paroles, les deux jeunes gens s’étaient enfoncés sous le couvert, dans une direction opposée à celle prise précédemment par Matadiez et son ami Redblood.
– Parle ; maintenant, je t’écoute, dit don Torribio.
– Non pas, à toi d’abord ; dis-moi ce que tu as vu ?
– Presque rien. Nous avons affaire à des gaillards très fins, trop fins même ; ils ont essayé pendant plusieurs heures de nous donner le change, mais ils n’ont réussi qu’à me faire comprendre qu’il était matériellement impossible de pénétrer, de ce côté, jusqu’à l’hacienda.
– Ainsi, ton avis ?
– Est que les sentes qui conduisent à l’hacienda, au lieu d’exister de ce côté, sont, au contraire, assez éloignées et probablement sur l’autre versant de la montagne.
– Seulement il faut arriver à cet autre versant.
– Nous y arriverons, sois tranquille.
– Je le sais bien ; tu as des empreintes ?
– Plus qu’il ne m’en faut ; et toi ?
– J’en ai quelques-unes aussi ; nous les comparerons.
– Maintenant, à ton tour.
– Soit. Après t’avoir quitté, je suis allé, comme tu me l’avais ordonné, au rendez-vous habituel. Lucas Mendez m’y attendait depuis longtemps déjà, il était impatient de te voir arriver, car c’était sur toi qu’il comptait.
– Tu lui as expliqué les raisons qui m’ont empêché d’aller le trouver ?
– Je n’y ai pas manqué. C’est étonnant, frère, fit-il en s’interrompant, c’est étonnant comme Lucas Mendez est changé depuis qu’il s’est séparé de nous.
– Bah ! tu es fou ; il me semble être toujours le même à moi.
– Tu ne l’auras pas examiné, sans cela tu t’en serais aperçu ; cela saute aux yeux.
– Qu’est-ce qui saute aux yeux ?
– Les changements qui se sont opérés en lui, donc ! Je t’assure que ce n’est plus le même homme ; il semble rajeuni de dix ans ; ses traits émaciés se sont raffermis, son visage a pris une expression de volonté et d’énergie que je ne lui avais jamais vue ; ses yeux brillent, lorsqu’il s’anime, de lueurs étranges ; sa taille s’est redressée ; sa voix elle-même est plus grave et plus ferme, enfin ce n’est plus du tout le même homme.
– Allons donc ! fit-il en haussant les épaules, tu divagues.
– Mais non, je te dis la vérité.
– Bien, je l’admets jusqu’à preuve contraire ; mais ces changements, si changements il y a, ne nous intéressent que très médiocrement ; vas au fait, je te prie.
– Bon, ne t’impatiente pas, j’y arrive : don Manuel est convaincu plus que jamais que don Porfirio est ruiné, il ignore encore le pronunciamiento de Mexico et la nomination de don Porfirio comme gouverneur de la Sonora et de l’Arizona ; il ne sait aucun de nos mouvements ; cependant, depuis quelques jours, il est inquiet, agité, il attend des nouvelles importantes d’un moment à l’autre ; il doit y avoir, aussitôt ces nouvelles reçues, une réunion des principaux chefs des Plateados à l’hacienda del Engaño.
– Oh ! oh ! voici des renseignements précieux.
– N’est-ce pas ?
– Est-ce tout ?
– Pas encore : depuis quelques jours, un certain don Benito de Gazonal reçoit l’hospitalité à l’hacienda ; il est fort bien avec don Manuel et passe pour faire la cour à doña Santa.
– Hein ! fit don Torribio en tressaillant.
– Je ne suis qu’un écho, frère.
– Va, va, continue, je puis tout entendre.
– Ce Gazonal est fortement protégé par don Manuel, qui voudrait le fiancer à doña Santa. La jeune fille le déteste ; elle reste enfermée dans son appartement et refuse de le voir.
– Chère Santa ! fit le jeune homme avec un soupir de soulagement. Ce Gazonal, quel homme est-ce ?
– Un jeune homme, vingt-sept à vingt-huit ans, beau garçon, fat, insolent, alcade de la ville d’Urès et l’un des principaux chefs des Plateados ; voilà son signalement exact.
– Il n’est pas à craindre pour nous ; continue.
– Je n’ai plus que quelques mots à ajouter, mais je ne les comprends pas.
– Dis-les toujours ?
– Les voici : don Torribio doit toujours regarder vers l’Est, se méfier des monuments druidiques et se souvenir que le côté gauche est le plus noble, parce qu’il est celui du cœur ; c’est une énigme.
– Oui, et assez obscure ; mais, je l’espère, la lumière se fera et nous la comprendrons.
– Quant à moi, j’y renonce.
– À ton aise. Lucas Mondez n’a rien dit de plus ?
– Rien, sinon que, si tu suis ses dernières indications, vous vous rencontrerez bientôt.
– Ceci est plus clair et m’aidera à comprendre ce qui précède.
– Tu espères deviner ?
– Peut-être ; j’entrevois une lueur.
– Grand bien nous fasse ! Quant à moi, je donne ma langue aux chiens des prairies.
– C’est par l’Est que nos recherches doivent commencer.
– Eh caraï ! Voilà qui est singulier !
– Quoi donc ?
– Ce que tu as dit.
– Pourquoi cela ?
– Parce que cela se rapporte à ma seconde aventure.
– Au fait, tu ne m’as rien dit de ce que tu as fait après avoir quitté Lucas Mendez ?
– J’allais te le dire, frère.
– Va ; j’attends.
– La nuit était avancée, j’avais un assez long chemin à faire avant de rencontrer le gué où je devais traverser la rivière ; j’étais à pied, j’avais beaucoup marché, je me sentais fatigué ; comme je ne devais te rejoindre que ce matin, que, par conséquent, rien ne me pressait, j’avisai un arbre magnifique et fort touffu, sur lequel je résolus d’établir mon domicile pour la nuit, ne me souciant pas d’allumer du feu et de faire connaître ainsi ma présence, si quelque rôdeur battait l’estrade aux environs ; tu sais que là-bas, dans les pampas, nous avons souvent dormi ainsi sur les arbres ; celui-ci était parfaitement à ma convenance, je grimpai dessus sans plus réfléchir, je me blottis dans le feuillage et commodément assis sur plusieurs branches reliées par des lianes et de la barbe d’espagnol, je fouillai dans ma gibecière et je soupai gaiement au clair de la lune ; seulement une chose me manquait, ma cigarette : une espèce de pressentiment semblait m’avertir de ne pas fumer. Bien m’en prit, comme tu vas le voir ; après avoir soupé, je m’attachai avec ma faja à une grosse branche, ne me souciant pas de tomber ; je m’accommodai du mieux que je pus pour dormir, je me souhaitai le bonsoir et je fermai les yeux.
– Ah ça ! quelle plaisante histoire me racontes-tu là, frère ?
– Attends donc, tu es toujours impatient !
– Bon ; continue !
– La nuit était magnifique, un silence majestueux planait sur le désert, la lune brillait à travers les branches, l’atmosphère était embaumée, je commençais à dormir ; déjà, je voyageais dans le doux pays des rêves, lorsque tout à coup je tressaillis et j’ouvris les yeux : j’avais entendu un bruit ressemblant à un tonnerre lointain, et qui se rapprochait rapidement de l’endroit où j’étais si singulièrement campé ; bientôt le bruit se fit plus distinct et je reconnus le galop pressé de plusieurs chevaux ; je me félicitai alors du poste que j’avais pris, tout en prêtant l’oreille et regardant entre les feuilles dans la direction du bruit. Mon attente ne fut pas longue, plusieurs cavaliers ne tardèrent pas à paraître ; ces cavaliers étaient au nombre de dix ou douze ; au lieu de continuer leur course endiablée, ils firent halte précisément à l’endroit au-dessous duquel j’avais eu l’idée de me blottir ; ils mirent pied à terre, entravèrent leurs chevaux, leur donnèrent à manger, puis ils allumèrent deux feux et soupèrent de bon appétit en causant entre eux, mais non pas assez haut pour que je comprisse clairement ce qu’ils disaient ; j’entendais seulement par ci par là quelques mots qui me donnaient, je l’avoue, fort à réfléchir.
– Quelle sorte d’hommes était-ce ? des Peaux-Rouges ou des chasseurs ?
– Ni Peaux-Rouges ni chasseurs, mais des Rancheros richement vêtus ; quatre d’entre eux surtout reluisaient comme des soleils, tant ils étaient chargés d’or et d’argent ; mais cela n’était rien, c’était leurs chevaux qu’il fallait voir.
– Bon ! qu’avaient-ils donc d’extraordinaire ?
– Rien, si ce n’est que le cuir de leurs harnais disparaissait complètement sous les orfèvreries dont ils étaient chargés.
– Mais alors ces individus dont tu parles sont des Plateados tout simplement ; ils appartiennent sans doute à la redoutable association que je me suis donné à tâche de détruire.
– Je l’ai soupçonné tout d’abord ; ces soupçons n’ont pas tardé à se changer en certitude lorsque, quelques instants plus tard, quatre ou cinq autres cavaliers, arrivant du même côté et d’une allure aussi rapide, ont rejoint les premiers ; j’ai compris, grâce à quelques mots qui sont parvenus jusqu’à moi, qu’il s’agissait d’une fausse piste et d’un change audacieux donné à des espions embusqués pour surveiller leurs mouvements.
– Plus de doute, ce sont mes hommes !
– Quels hommes ?
– Va toujours ! fit-il en se frottant joyeusement les mains ; que s’est-il passé après ? Tu n’es sans doute pas demeuré toute la nuit perché comme un corbeau sur ton arbre ?
– Non pas ; après une halte prolongée jusqu’au lever du soleil, les cavaliers se sont remis en selle et tous ils sont partis grand train.
– Hum ! qu’as-tu fait alors ?
– Ce que tu aurais fait toi-même, frère : je les ai suivis.
– À la bonne heure !
– Mais cela ne m’a pas avancé à grand-chose, frère.
– Comment cela ?
– Dame ! tu comprends, j’étais à pied, eux à cheval ; de plus, ils galopaient ; de sorte…
– De sorte que tu les as perdus ? s’écria-t-il vivement.
– À peu près.
– Maladroit !
– Ne m’en veux pas, j’ai fait l’impossible ; seulement, j’ai réussi à relever leur direction.
– C’est quelque chose.
– Il est évident qu’ils continuent leur fausse piste ; ils essaient d’embrouiller leurs traces de façon à les rendre impossibles à déchiffrer ; malgré cela j’ai cru reconnaître qu’ils tournaient toujours à peu près dans le même cercle, se rapprochant cependant de la montagne du Valadero, qu’ils semblent vouloir attaquer par l’Est.
– Ah ! ah ! fit don Torribio d’un air pensif, voilà un renseignement.
– Bon ?
– Je le crois ; bientôt nous saurons positivement à quoi nous en tenir. Où sont les chevaux ?
– À deux cents pas d’ici, cachés dans un fourré.
– Ils sont reposés ?
– Oui ; à peine s’ils ont fait deux lieues ce matin.
– Très bien ! en route ; mais non, va chercher les chevaux ; pendant que tu les conduiras ici, moi je préparerai le déjeuner : il n’est pas bon de commencer une expédition comme celle que nous entreprenons l’estomac vide. Qui sait si nous aurons le temps plus tard de manger ou même de nous arrêter ? Hommes et bêtes nous devons être en mesure d’accomplir vigoureusement notre tâche. Hâte-toi ; quand tu reviendras, tout sera prêt.
– Je ne te reconnais plus, frère, dit Pepe en riant ; sur ma parole, tu sembles rajeuni de dix ans ; tu me rappelles le temps où nous faisions ces belles chasses au puma, dans nos chères pampas ; te souviens-tu ? Ah ! c’était un heureux temps, celui-là !
– Le regrettes-tu donc, frère ?
– Non, puisque nous sommes toujours ensemble et que nous nous aimons comme nous nous aimions alors.
– Cher et bon Pepe ! fit don Torribio avec émotion.
Par un mouvement spontané les deux jeunes gens tombèrent dans les bras l’un de l’autre et demeurèrent un instant embrassés.
– Aimons-nous bien toujours, frère, dit don Torribio, à nous deux nous formons toute notre famille.
– Oui, cela est vrai, frère, répondit Pepe Ortiz avec émotion ; mais, tant que nous resterons unis ainsi, je défie le malheur de nous atteindre jamais ! D’ailleurs, ajouta-t-il avec un fin sourire, avant peu, si Dieu nous vient en aide, nous serons trois à nous aimer et j’aurai une sœur.
– Chère Santa ! murmura don Torribio devenant subitement triste, pauvre bien-aimée ! si malheureuse !
– Nous la sauverons, frère ! Reprends espoir, sois homme !
– Hélas ! quand je songe à ce qu’elle souffre, à mon impuissance de lui venir en aide, mon courage m’abandonne, je deviens faible comme un enfant.
– Allons ! allons ! chasse ces tristes pensées. L’avenir est à Dieu, il nous aidera ; nous a-t-il manqué jamais ?
– Tu as raison, je suis ingrat ; merci, frère, tu me rends à moi-même.
Ils échangèrent une nouvelle embrassade ; puis Pepe Ortiz s’éloigna presque en courant.
– Oui, je suis ingrat, murmura don Torribio en suivant son frère d’un regard attendri ; personne a-t-il jamais été plus heureux et mieux aimé que je l’ai toujours été, moi pauvre enfant abandonné presque depuis ma naissance ; courage donc et espoir, et, ainsi que me l’a dit mon frère, soyons homme et luttons bravement ; la cause que je défends est juste : je réussirai ou mes os blanchiront dans la savane.
Et passant d’un mouvement nerveux la main sur son front comme pour effacer toute trace de faiblesse, il se mit bravement en devoir de préparer le frugal repas du matin.
Une heure plus tard, les deux jeunes gens, après avoir, tout en déjeunant, arrêté entre eux le plan de la hasardeuse expédition qu’ils entreprenaient, montaient à cheval et prenaient à vol d’oiseau la piste des Rancheros ; nous disons à vol d’oiseau, parce que jusqu’à la clairière où du haut de son embuscade aérienne Pepe Ortiz avait surpris le secret de la halte des Plateados, les deux batteurs d’estrade n’avaient nullement besoin de suivre les traces de leurs ennemis et coupèrent en droite ligne, afin de gagner du temps.
Arrivés à la clairière, les jeunes gens firent une courte halte pour relever certaines empreintes, et Pepe Ortiz montra en riant à son frère l’arbre dont le feuillage touffu l’avait si bien abrité.
Après une reconnaissance sommaire qui leur prit out au plus dix minutes, ils repartirent ; mais cette fois, bien que leur course continuât avec la même rapidité, ils suivirent attentivement la piste très visible de ceux qu’ils poursuivaient, passant où ceux-ci avaient passé et examinant avec la plus sérieuse attention les moindres accidents de la piste.
Arrivé à un certain endroit de la forêt, à quelques pas seulement de la limite du couvert, don Torribio s’arrêta subitement, jeta un regard curieux autour de lui et mit pied à terre.
– Ils se sont arrêtés un instant ici, dit-il à son frère en lui donnant la bride de son cheval ; attends-moi sur le bord de ce ruisseau.
Il se pencha un instant sur l’eau, calme comme un miroir, puis, après avoir enlevé sa chaussure et relevé ses calzoneras au-dessus du genou, il entra résolument dans le courant, qu’il remonta rapidement ; presque aussitôt il disparut.
Le ruisseau coulait sur un lit de sable fin ; il était large d’une quinzaine de pieds environ et avait à peine dix-huit ou vingt pouces de profondeur ; il faisait les plus capricieux méandres, sous des taillis épais dont les branches feuillues, entrelacées les unes dans les autres, lui formaient une voûte de verdure du haut de laquelle tombaient en festons d’innombrables lianes dont les extrémités baignaient dans l’eau.
Pepe Ortiz, immobile à l’endroit où son frère l’avait laissé, attendait, le doigt sur la détente du fusil, le corps légèrement penché en avant, l’œil et l’oreille au guet, surveillant attentivement les buissons et fouillant du regard ce mur mobile de verdure qui l’enserrait de toutes parts.
Une demi-heure s’écoula ainsi, puis les lianes s’écartèrent et don Torribio reparut, marchant toujours dans le lit du ruisseau ; arrivé à l’endroit où son frère l’attendait, il reprit sa chaussure et remonta à cheval.
– Eh bien ? demanda Pope dès qu’ils eurent repris le galop.
– Eh bien, répondit don Torribio, je ne m’étais pas trompé : ils se sont arrêtés ici, l’un d’eux est entré dans le courant, l’a remonté, a été couper, à deux cents pas d’ici, une brassée de longues branches et les a rapportées ; puis ils sont repartis.
– Allons, allons, dit en riant Pepe, définitivement ces gens-là ne sont pas forts ; comment, ils ont à leurs trousses les deux plus habiles Rastreadores des pampas buenos-ayriennes, et ils agissent avec eux comme s’ils n’avaient affaire qu’à de vulgaires batteurs d’estrade yankees ou canadiens et ils croient nous échapper ! Sur ma foi, ils sont fous !
– Cependant, ils n’avaient pas mal combiné leur coup, je dois leur rendre cette justice ; le cavalier qu’ils ont envoyé couper les branches a très habilement manœuvré, il n’y a nulle part de traces de pas ; il a arrêté son cheval au milieu du courant avant de se mettre à l’eau, tout cela n’a point été mal fait, je te le jure ; tous autres que nous y auraient été pris.
– Bah ! tu leur adresses des compliments, leur compte est bon, alors, me voilà tranquille ! reprit Pepe en riant.
Tout en causant ainsi, les Rastreadores étaient sortis de la forêt et galopaient à travers la savane. Leur course continua ainsi sans nouvel incident jusqu’au coucher du soleil ; ils atteignirent vers sept heures du soir un bois assez touffu dans lequel ils entrèrent.
– Halte ! dit don Torribio, je sens l’ennemi devant nous, laissons-lui le temps de prendre l’avance.
– Hum ! tu es sûr que nous sommes aussi près de ceux que nous poursuivons ?
– Ils ne sont pas à trois portées de fusil de l’endroit où nous sommes, j’en ai la conviction.
– Alors, c’est autre chose, que faisons-nous ?
– Nous souperons, ainsi que nos chevaux, et nous dormirons deux heures chacun, l’un après l’autre, bien entendu.
– Alors, nous ne partirons d’ici qu’à dix heures ?
– Pas avant, laissons-leur une sécurité entière ; il importe qu’ils soient persuadés de nous avoir donné le change : s’ils nous sentaient sur leurs traces, qui sait où ils nous conduiraient ? Mieux vaut être patients et attendre.
– Soit, comme il te plaira.
Les chevaux furent dessellés, bouchonnés avec soin ; puis, lorsqu’ils se furent roulés tout à leur aise, Pepe leur donna leur provende, que les braves animaux se mirent à manger à pleine bouche.
Ce devoir accompli, les deux batteurs d’estrade s’assirent à terre, placèrent entre eux leurs provisions et soupèrent avec les restes froids de leur déjeuner. Ils n’avaient pas voulu allumer de feu de peur d’être dénoncés par la fumée ; ils poussèrent même les précautions jusqu’à se priver de leur cigare, complément obligé de tout repas de chasseur.
Leur appétit apaisé, Pepe Ortiz s’enveloppa dans son zarapè, se coucha au pied d’un arbre et s’endormit aussitôt, avec cette insouciance caractéristique de l’homme depuis longtemps accoutumé à la vie du désert.
Don Torribio, le fusil à la main, s’étendit auprès d’un buisson et, complètement perdu dans l’ombre, il veilla. Il demeura ainsi pendant deux heures sans faire un mouvement, mais attentif à ces mille bruits des savanes qui, sans causes apparentes, troublent le silence des nuits. Enfin il se releva, s’approcha de Pepe, lui posa la main sur l’épaule et se penchant à son oreille :
– Il est huit heures, lui dit-il d’une voix basse comme un souffle.
Pepe se redressa d’un bond.
– Quoi de nouveau ? demanda-t-il.
– Rien en apparence, répondit son frère ; veille attentivement.
– Sois tranquille.
Deux minutes plus tard, Pepe Ortiz avait pris la place de don Torribio et celui-ci dormait à poings fermés.
À dix heures, don Torribio s’éveilla ; il regarda autour de lui, il était seul.
– Bon ! murmura-t-il, Pepe est à la découverte ; il y a quelque chose.
Il se leva et, en attendant le retour de son frère, il sella les chevaux, afin que rien ne retardât le départ.
Cependant Pepe ne revenait pas. Une demi-heure s’était écoulée depuis le réveil de don Torribio, rien n’annonçait le retour de son frère ; le jeune homme commençait à être sérieusement inquiet de cette longue absence, qu’il ne savait à quoi attribuer ; déjà il se préparait à aller à sa recherche, lorsque tout à coup les branches d’un buisson voisin s’écartèrent silencieusement et Pepe Ortiz parut.
– D’où diable viens-tu ? lui demanda don Torribio, je t’attends depuis un temps infini ; j’allais me mettre à ta recherche.
– Tu avais raison, dit Pepe sans répondre à la question de son frère, il y avait quelque chose.
– Ah ! fit don Torribio oubliant son inquiétude, je ne m’étais donc pas trompé ?
– Voici la chose en deux mots ; tu en tireras les conséquences.
– Voyons cela.
– Je viens de poursuivre pendant près de trois quarts d’heure une dizaine de cavaliers qui, après avoir, selon toute probabilité, traversé la rivière, se dirigent à toute bride vers les savanes du Texas.
– Ah ! ah ! les as-tu reconnus ?
– Heureusement ! Sans cela, Dieu sait combien de temps encore je les aurais poursuivis. Cette troupe est composée de huit peones indiens yaquis, ils ont quinze chevaux avec eux ; de loin je croyais d’abord que tous les chevaux étaient montés ; mais grâce à la lune, qui éclaire comme en plein jour, je n’ai pas tardé à reconnaître mon erreur ; alors je les ai laissés continuer leur route sans davantage m’occuper d’eux et je me suis hâté de te rejoindre ; figure-toi que ces coquins d’indiens ont mis des espèces de mannequins sur les chevaux qu’ils conduisent en bride, de sorte qu’à cent pas l’illusion est complète. Mais je n’ai pas été assez niais pour me laisser prendre à cette ruse grossière : je me suis approché si près d’eux qu’ils sont passés presque à me toucher, alors tout m’a été révélé ; je leur ai souhaité bon voyage, à part moi, bien entendu, et me voilà. Que penses-tu de cela, frère ?
– Je pense ce que tu penses toi-même probablement ; les Plateados, après avoir traversé la rivière, ont trouvé un relais de chevaux préparé sans doute à l’avance, ils ont renvoyé leurs chevaux fatigués sous la garde des peones, avec ordre de s’enfoncer dans le désert et de faire une fausse piste.
– C’est cela même ; ainsi, tu ne m’en veux pas d’avoir momentanément abandonné mon poste ?
– Vive Dios ! je t’en remercie, au contraire ; si tu n’avais pas été aussi avisé, qui sait si ces drôles ne nous auraient pas fait perdre un temps précieux en nous entraînant à leur poursuite.
– C’était assez bien combiné.
– Très bien ! Malheureusement pour eux, nous ne nous y sommes pas laissés prendre.
– Et maintenant, que faisons-nous ?
– Pardieu ! nous reprendrons la piste véritable, et comme j’ai eu la précaution de seller nos chevaux, nous nous remettrons tout de suite sur les traces de ces bandits. Ma foi, je suis assez content d’eux : je ne les croyais pas aussi rusés.
Ils sautèrent aussitôt en selle et repartirent.
La nuit était claire, bien que la lune fût voilée par une légère brume ; un large ruban d’argent, sur lequel se reflétaient les rayons blafards de la lune et le scintillement des étoiles, coupait la savane en deux parties inégales : c’était le rio Salinas, dont les rives étaient bordées de cotonniers sauvages et de buissons de chirimoyas ; le fond de l’horizon était fermé par les masses sombres d’une forêt vierge, au-dessus desquelles s’élevaient jusque dans les nuages les aiguilles granitiques et curieusement découpées d’une montagne dont les pentes abruptes formaient les plus capricieux et les plus bizarres dessins ; la rive droite de la rivière s’escarpait insensiblement en forme de rampe, et les mouvements de terrain, s’accentuant de plus en plus, servaient de derniers contreforts à la montagne, sentinelle avancée de la sierra de Pajaros. À l’endroit où la rive droite de la rivière commençait à s’escarper, on apercevait les ruines assez bien conservées d’une habitation qui, quelques années auparavant, avait dû être un rancho assez important.