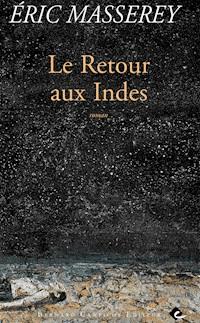
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bernard Campiche Editeur
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Les Anciens appelaient Indes toute terre lointaine et inconnue…
Sur l’île de Chios, en mer Égée, Vasco laisse sa fille à ses amours. Elle reste, il part :
J’irai vers toutes mes Indes, je mettrai mon pas dans ceux de ma jeunesse. Je retourne, Otilia, même si la terre que je cherche m’est désormais inconnue. J’irai à Castelo Branco, vers mon enfance. La route est ce lieu de mon âme où elle obtient le repos, je la ferai en paix…
Quelqu’un l’attend parfois ou n’est pas au rendez-vous. Il est accueilli ou rejeté, selon la fortune du jour. Puis la maladie l’envahit.
On le voit en contre-soir, solitaire et curieux, cultivé, mécréant, ingénieux quand il le faut, sans cesse renaissant – et qui marche un peu de guingois.
Éric Masserey nous entraine dans un fabuleux voyage, de ville en ville, d’aventures en aventures, jusqu’à la fin du périple d’une vie.
EXTRAIT
À la bibliothèque municipale de Castelo Branco, dans la Beira Baixa portugaise non loin de la frontière espagnole, je faisais des recherches sur Amatus Lusitanus, le grand médecin du XVIe siècle originaire de cette ville, alias João Rodrigues pour la naissance, Joannes Rodericus à Rome, puis Haviv à Salonique. Sur une vaste place récemment aménagée, je m’arrêtais chaque jour un instant devant sa statue qui regarde vers l’est.
Dans les rayonnages dédiés au siècle d’or, je trouvai de nombreux documents consacrés à Amatus en différentes langues, du latin au croate, le plus souvent en portugais. Un secteur « Divers » rassemblait quantité de papiers et de lettres non classées. Des heures durant, je passai en revue ces documents, et découvris une lettre, écrite en judéo-espagnol mêlé de grec, sans ponctuation, que je traduisis avec peine. Déchiffrée enfin, à la lumière d’une lanterne au cours d’une nuit trop chaude pour dormir, elle m’apparut dans son entier.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"Ravages de la peste et fanatisme religieux, pillages, chasses aux juifs, progrès de la médecine, savants et poètes: les faits et personnages historiques s’entrelacent à la fiction romanesque pour tisser un récit fluide et retenu, à la langue précise et imagée." -
Anne Pitteloud, Viceversa Littérature
"Un bel hommage venant d’une plume qui a su rendre avec fidélité une époque riche et passionnante…" -
Daniel Bujard, La Côte
A PROPOS DE L’AUTEUR
Éric Masserey est né en Valais. Après des études de médecine, il vit et travaille aujourd’hui dans le canton de Vaud.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ÉRIC MASSEREY
Le Retour aux Indes
roman
Mon cher père, écrivit Otilia ce 28 décembre 1572, j’ai eu un petit garçon Personne ne se nomme Vasco ici alors c’est devenu son deuxième nom Je suis seule à l’appeler ainsi tout doucement pour que personne d’autre n’entende Je le berce avec ce nom qui est aussi le vôtre Ou je lui raconte les Simples et les Drogues de l’Inde ainsi que vous le faisiez avec moi dans le livre que j’ai gardé près de nous Il sourit et gazouille au son de ma voix C’est un oiseau au futur migrateur Il vous ressemble j’en suis certaine Un jour je l’emmènerai à Castelo Branco Vous serez là je l’espère assis devant votre maison comme un prince revenu d’un grand voyage Comme un grand sage Vous l’accueillerez en l’appelant fièrement Vasco Vasco de Gama Et nous rirons tous.
Le message atteignit Castelo Branco à la fin de l’été 1573. Les deux noms soigneusement calligraphiés qui figuraient sur le feuillet plié et scellé, Otilia Charis de Mesta et Vasco Iseu de Castelo Branco, y étaient inconnus.
Éric Masserey est né en Valais. Après des études de médecine, il vit et travaille aujourd’hui dans le canton de Vaud.
Les Anciens appelaient Indes toute terre lointaine et inconnue… Sur l’île de Chios, en mer Égée, Vasco laisse sa fille à ses amours. Elle reste, il part :
« J’irai vers toutes mes Indes, je mettrai mon pas dans ceux de ma jeunesse. Je retourne, Otilia, même si la terre que je cherche m’est désormais inconnue. J’irai à Castelo Branco, vers mon enfance. La route est ce lieu de mon âme où elle obtient le repos, je la ferai en paix… »
Quelqu’un l’attend parfois ou n’est pas au rendez-vous. Il est accueilli ou rejeté, selon la fortune du jour. Puis la maladie l’envahit.
On le voit en contre-soir, solitaire et curieux, cultivé, mécréant, ingénieux quand il le faut, sans cesse renaissant – et qui marche un peu de guingois.
Illustration de couverture : Anselm Kiefer,Die berühmten Orden der Nacht, 1997©FMGB Guggenheim Bilbao Museoa, 2010Photo :Erika Barahona-Ede
Éric Masserey
Le Retouraux Indes
que fitVasco Iseu de Castelo Brancoentre 1568 et 1572, depuisChios en mer Égée jusqu’àSalamanque, par bateaux,caravanes muletières, et à pied
roman
CETOUVRAGE A BÉNÉFICIÉD’AIDES À LAPUBLICATION ACCORDÉES PAR
AINSI QUE D’UNSUBSIDE DE PUBLICATIONACCORDÉ PAR PRO HELVETIA, FONDATION SUISSE POUR LA CULTUREL’ÉDITEUR L’EN REMERCIE
« LE RETOUR AUX INDES » – DEUX CENT SOIXANTE-TREIZIÈME OUVRAGEPUBLIÉ PAR BERNARD CAMPICHE ÉDITEUR, A ÉTÉ RÉALISÉAVEC LA COLLABORATION DE CATHERINE NICOD, D’HUGUETTE PFANDER,DE MARIE-CLAUDE SCHOENDORFF ET DE JULIE WEIDMANNCOUVERTURE ET MISE EN PAGES : BERNARD CAMPICHEILLUSTRATION DE COUVERTURE : ANSELM KIEFER, « LES ORDRES DE LANUIT » (« DIE BERÜHMTEN ORDEN DER NACHT »), 1997,© FMGBGUGGENHEIM BILBAO MUSEOA, 2010.PHOTO : ERIKA BARAHONA-EDE. ALL RIGHTS RESERVED.TOTAL OR PARTIAL REPRODUCTION IS PROHIBITED.PHOTOGRAPHIE DE L’AUTEUR : PHILIPPE PACHE, LAUSANNEPHOTOGRAVURE : BERTRAND LAUBER, COLOR+, PRILLY,& CÉDRIC LAUBER, L-X-IR IMAGES, PRILLYIMPRESSION ET RELIURE : IMPRIMERIE LA SOURCE D’OR,À CLERMONT-FERRAND – (OUVRAGE IMPRIMÉ EN FRANCE)ISBN PAPIER 978-2-88241-274-4ISBN NUMÉRIQUE 978-2-88241-369-7TOUS DROITS RÉSERVÉS© 2010BERNARD CAMPICHE ÉDITEURGRAND-RUE 26 – CH-1350 ORBEWWW.CAMPICHE.CH
À Cléa
LES GRAPHIES DES NOMS DE LIEUX
CORRESPONDENT LE PLUS SOUVENT
AUX RÉFÉRENCES EN FIN DE VOLUME.
LE TEMPS ET LES PERSONNAGESRepères chronologiques
Les noms suivis d’un astérisque (*) font l’objet d’une notice biographique en fin de volume.
1492
Deux décrets des rois catholiques espagnols, en Castille et en Aragon, donnent aux juifs du royaume jusqu’au 31 juillet pour quitter le pays ou se convertir.
Entrée au Portugal des juifs venus d’Espagne qui refusent la conversion, par les chemins montagneux de la frontière gardée par le poste de Marvao, près de Castelo de Vide, d’où l’on voit tout le pays alentour et même Castelo Branco (château blanc). LA FAMILLE HAVIV (OU CHAVIV, AIMÉ EN HÉBREU, D’OÙ LE NOM LATINISÉ AMATUS) S’INSTALLE PROBABLEMENT À CE MOMENT-LÀ DANS CETTE CITÉ.
1497
Conversion générale forcée des juifs du Portugal, qui deviennent ainsi en masse des conversos, ou nouveaux chrétiens. Par dérision, ils sont aussi appelés marranes (qui signifie un interdit rituel, et « porc »).
Début du premier voyage vers l’Inde de Vasco de Gama *
1501
Élaboration de la Carte de Cantino, considérée comme le premier planisphère moderne.
1511
NAISSANCE DE JOÃO RODRIGUES (AMATUS LUSITANUS) À CASTELO BRANCO.
Érasme : Éloge de la folie.
1517
Naissance de Diogo Pires (Didacus Pyrrhus, Isaias Cohen *), cousin d’Amatus, poète.
1526
AMATUS S’INSCRIT À L’UNIVERSITÉ DE SALAMANQUE.
1529
AMATUS OBTIENT LE GRADE DE MÉDECIN PUIS DE DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE SALAMANQUE.
1532
AMATUS REVIENT AU PORTUGAL ET PRATIQUE LA MÉDECINE DANS QUELQUES VILLES, DONT LISBONNE, OÙ EXERÇAIT ET ENSEIGNAIT GARCIA DA ORTA *.
1536
L’Inquisition est instituée au Portugal. AMATUS QUITTE LE PORTUGAL POUR ANVERS, en même temps que Gracia Nasi *, dont il est le médecin, ainsi que de sa famille. IL PUBLIE SON PREMIER OUVRAGE, CONSACRÉ À LA BOTANIQUE : INDEX DIOSCORIDIS.
1543
AMATUS ET DIDACUS TRAVERSENT LA FRANCE ET S’INSTALLENT À FERRARE OÙ AMATUS AVAIT ÉTÉ NOMMÉ PROFESSEUR DE CHIRURGIE. IL A POUR ASSISTANT GIAMBATTISTA CANANO *.
Copernic publie De revolutionibus orbium caelestium sur son lit de mort. La terre n’est plus le centre de l’univers.
Vésale *, le grand anatomiste, publie De Humani corporis fabrica… Le corps n’est plus seulement objet de vénération, mais devient objet d’observation.
1547
AMATUS ET DIDACUS S’INSTALLENT À ANCÔNE. LE MÉDECIN SOIGNE LA NIÈCE DU PAPE.
1550
AMATUS SE REND À ROME POUR TRAITER LE PAPE JULES III ATTEINT DE GOUTTE INVALIDANTE.
1555
Décès du tolérant Jules III, élection de Giovanni Pietro Caraffa à sa succession sous le nom de Paul IV. Ce dernier publie aussitôt une bulle définissant le statut des juifs dans ses États (dont Ancône). Il leur interdit propriété, fêtes, domestiques, cohabitation avec les chrétiens.
1556
MASSACRES D’ANCÔNE. FUITE D’AMATUS À PESARO. IL SÉJOURNE ENSUITE À RAGUSE (aujourd’hui Dubrovnik).
1559
ARRIVÉE D’AMATUS À SALONIQUE. IL REPREND SON NOM DE FAMILLE HAVIV.
1563
Publication du livre de Garcia da Orta, Colloques des simples et des drogues de l’Inde, à Goa.
1566
Josef Nasi, neveu de Gracia Mendes-Nasi et favori du jeune sultan Selim, est fait duc de Naxos. Il est un parent (cousin par sa mère ?) d’Amatus, qui lui dédie un de ses ouvrages de médecine.
1568
21 JANVIER. DÉCÈS D’AMATUS À SALONIQUE, DE LA PESTE. Son tombeau ne sera pas retrouvé.
1570
Chypre, possession vénitienne, tombe aux mains des Turcs sans pratiquement combattre. Famagouste, assiégée, résiste encore.
1571
Famagouste est prise le 11 août. Son capitaine, Marcantonio Bragadino, est exécuté avec une cruauté qui révoltera les pays catholiques et favorisera l’émergence de la Sainte Ligue pour combattre les Turcs.
Dimanche 7 octobre, bataille navale de Lépante au nord du Péloponnèse, entre les flottes de la Sainte Ligue, commandées par don Juan d’Autriche, et la flotte ottomane, commandée par Ali Pacha, gendre du sultan Selim II. Victoire de la Ligue.
1572
Mars. Emprisonnement de Fray Luis de León * à Salamanque.
Massacres de la Saint-Barthélemy en France. Dès le 24 août à Paris, les protestants sont pourchassés et massacrés. La chasse continue pendant l’automne jusqu’en province.
Publication des Lusiades (Os Lusiadas) de Camões *.
… les Anciens appelaient Indes,toute terre lointaine et inconnue.GARCIA DA ORTAColloques des simples et des drogues de l’IndeGoa, 1563
PROLOGUE
À LA BIBLIOTHÈQUE municipale de Castelo Branco, dans la Beira Baixa portugaise non loin de la frontière espagnole, je faisais des recherches sur Amatus Lusitanus, le grand médecin du XVIe siècle originaire de cette ville, alias João Rodrigues pour la naissance, Joannes Rodericus à Rome, puis Haviv à Salonique. Sur une vaste place récemment aménagée, je m’arrêtais chaque jour un instant devant sa statue qui regarde vers l’est.
Dans les rayonnages dédiés au siècle d’or, je trouvai de nombreux documents consacrés à Amatus en différentes langues, du latin au croate, le plus souvent en portugais. Un secteur « Divers » rassemblait quantité de papiers et de lettres non classées. Des heures durant, je passai en revue ces documents, et découvris une lettre, écrite en judéo-espagnol mêlé de grec, sans ponctuation, que je traduisis avec peine. Déchiffrée enfin, à la lumière d’une lanterne au cours d’une nuit trop chaude pour dormir, elle m’apparut dans son entier.
Mon cher père j’ai eu un petit garçon Personne ne se nomme Vasco ici alors c’est devenu son deuxième nom Je suis seule à l’appeler ainsi tout doucement pour que personne d’autre n’entende Je le berce avec ce nom qui est aussi le vôtre Ou je lui raconte les Simples et les Drogues de l’Inde ainsi que vous le faisiez avec moi dans le livre que j’ai gardé près de nous Il sourit et gazouille au son de ma voix C’est un oiseau au futur migrateur Il vous ressemble j’en suis certaine Un jour je l’emmènerai à Castelo Branco Vous serez là je l’espère assis devant votre maison comme un prince revenu d’un grand voyage Comme un grand sage Vous l’accueillerez en l’appelant fièrement Vasco Vasco de Gama Et nous rirons tous
Deux noms soigneusement calligraphiés figuraient sur l’autre face de la page dont les pliures rompaient les mots, et qui menaçait de s’éparpiller en morceaux : Otilia Charis de Mesta, en petit, sur un bord ; Vasco Iseu de Castelo Branco en grand, au centre. On voyait que le feuillet avait été scellé pour le voyage, mais la cire avait disparu ; il n’en restait qu’une auréole jaunie. Une date encore était lisible : 28 décembre 1572, et un rajout : Transmettez je vous prie mes hommages à la famille Haviv.
Je travaillai encore quelque temps à mon projet sur Amatus, mais ne pouvais détacher mon esprit de la lettre découverte dans ces archives, plus de quatre cents ans après son départ de Mesta, sur Chios en mer Égée. Une longue quête commença dès lors, à travers l’Europe et la Méditerranée, pour retrouver la trace de ceux qui avaient porté ces noms, comprendre leurs liens et suivre leurs chemins.
SALONIQUE,automne 1567
FIÈVRES et rumeurs. Des marchands venus de l’est racontaient partout que la peste courait le pays. Ils parlaient à voix basse : « Les feux ne purifiaient rien, cachaient le soleil ou brillaient en vain dans la nuit. Bourgs et villages se vidaient de leurs habitants. Hommes, femmes et enfants à demi vêtus prenaient la route quand la maladie condamnait leur maison. Agonies et cadavres emplissaient les bas-côtés. Les supplications montaient de cette terre damnée en une tentation mortelle. Il fallait résister, ne pas toucher ces bras tendus, ne pas voir ces regards implorant le secours. La pitié torturait ceux qui passaient encore valides devant des malades épouvantés, abandonnés à leur désespoir. Que Dieu pardonne la dureté de nos cœurs ! Nos chants et nos prières couvraient les plaintes qui nous transperçaient ! Nous avancions masqués, psalmodiant, les yeux fixés au loin… »
Dans les environs de Salonique, des paysans attachèrent un bouc puant à la couche d’une villageoise secouée par la maladie. Ils savaient déjà, et se taisaient. Par la porte entrouverte de la chambre commune, les enfants terrorisés guignaient leur mère qui délirait. Au chevet de ses spasmes, un étudiant du docteur Haviv reconnut la maladie noire dans les bubons de son aine. Cataplasmes et vif argent ne la sauvèrent pas.
La nouvelle se répandit comme une flamme : le venin pestilentiel était de retour. On se précipita chez les épiciers et les potards de toutes espèces, puis on s’enferma. Malgré la tiédeur de l’arrière-saison, des feux furent rallumés dans les maisons. Des brassées de roses et de genévriers, jetées sur les braises dans les cheminées obstruées, enfumaient toutes les pièces pour éloigner le mal. Depuis la rue, on voyait parfois s’ouvrir brusquement une fenêtre d’où s’échappaient des volutes grises, et les têtes effarées d’habitants suffoqués. Chez les hommes, le vin clair coula plus abondamment. Les paillards se réfrénèrent, il fallait forniquer sans sueur sinon les pores, dilatés par l’effort, laisseraient entrer la mort. Les femmes se chargèrent des pierres précieuses qui devaient les protéger, et mouillèrent leurs vêtements de parfums lourds. Le corps des riches fut passé aux huiles odorantes, la poulaille de leur table à l’or fondu. La peau et le nez des pauvres se contentèrent de vinaigres, leurs estomacs de figues.
Avec les autorités de la ville, le docteur Haviv inventoria les mesures qui préviendraient peut-être la propagation de la maladie, conseilla sur l’isolement des vivants et le traitement des morts. Chez lui, comme partout, il faudrait renvoyer à des temps meilleurs les rassemblements, les rencontres, les soirées de musique et de poésie qu’il affectionnait. Il décida également d’envoyer vers Chios son secrétaire, Vasco. La résine de lentisque, le mastichio, manquait pour traiter les malades. Les apothicaires de confiance avouaient ne plus honorer les prescriptions médicales où il figurait, les moins scrupuleux coupaient leurs poudres de farines moins rares. Depuis que les Turcs avaient pris Chios aux Génois, moins de deux ans auparavant, le mastichio avait disparu des officines bien au-delà de Salonique. Rien ne le remplaçait. Seules les terres au sud de cette île lui donnaient ses vertus. La sève était recueillie sous forme de larmes au pied des troncs tailladés. Une fois durcie, elle se transformait en onguents ou en pilules, servait la beauté ou soignait les malades depuis des temps qu’Homère lui-même n’avait pas chantés. Les plantations des précieux petits arbres, et leurs cités de pierre, appartenaient désormais aux Osmanli d’Istanbul. Les Turcs avaient joint l’utile politique au nécessaire de la volupté : ils avaient récupéré un territoire en plein cœur de l’archipel et, au harem, les besoins en crèmes et en pâte à blanchir les dents, qui étaient grands, seraient satisfaits. Les livraisons de mastichio au reste du monde avaient tari. Elles reprendraient sans doute, une fois le commerce réorganisé avec les nouveaux propriétaires. Vasco devait quérir sur place la récolte de l’année, rien de ce qui aurait traîné dans les entrepôts ou les maisons, car « senio confectum, vires suas amittit, comme tu sais. » 1
— La ville est malsaine, ajouta Haviv, je crains cette année… Tu seras mieux là-bas. Dans notre maison, ta fille sera en sécurité.
— Je ne serai pas long, Rodrigue, avait répondu Vasco. Quelques semaines au plus. Prends bien soin d’Otilia !
Ils s’embrassèrent. Vasco appelait « Rodrigue » le docteur Haviv depuis leur jeunesse, et leur traversée de la France, francisant ainsi son nom de baptême chrétien, João Rodrigues. Il ne l’avait jamais appelé Haviv – son vieux nom de famille juive, ni Amatus, celui du médecin connu à travers l’Europe et mandé auprès des princes – ni d’aucun autre des noms qui avaient accompagné leurs exils tout au long de leur vie.
Sous la menace de l’épidémie, la maison Haviv répéta les règles d’hygiène imposées par le docteur en cet automne 1567 : mains lavées au savon plusieurs fois par jour et rincées au vin clairet coupé d’eau de rose, habits propres et lingerie aérée, de même que les lits ; eau bouillie, alimentation variée, citrons. Dans une resserre attenante à la maison se trouvaient des épices en suffisance et des herbes de cuisine qui se confondaient en partie avec les simples médicinaux. Dans le cabinet de travail étaient réservés diverses essences et quelques éclats de pierreries, perles et cornes, pour le cas où la maladie, malgré tout…
1 « Vieille, elle perd ses vertus. » Le docteur Haviv, qui était encore appelé Amatus Lusitanus, avait déjà fait ce commentaire quelques années auparavant, à Venise, pour expliquer l’échec d’un traitement utilisant une vieille corne de licorne.
UN PETIT BOUTRE quitta Salonique quelques jours plus tard. Il emmena Vasco jusqu’à Chios d’une traite car la lune était favorable et le temps bien établi. Au port, l’animation coutumière du temps des Génois avait disparu. Vasco prit des nouvelles auprès d’un négociant désœuvré. Le passage des trente mille Turcs de Piali Pacha, en route vers de plus grandes ambitions, le lundi de la Pâque 1566, avait fait des ravages jusque dans l’intérieur de l’île. Les vignes et les jardins avaient été dévastés, les églises ruinées, les hommes et les femmes déportés, les garçons enlevés et convertis, ou massacrés… La vieille enclave chrétienne dans l’empire du Sultan n’existait plus. Le message avait été reçu partout. En Méditerranée orientale, d’autres territoires attendaient désormais leur tour et renforçaient murailles et alliances. Malte aussi, une fois de plus, à l’orée des deux mondes ; Chypre surtout, perle menacée et convoitée. Les galères aux croissants étendaient leur domination, de batailles navales en sièges de places fortes. Dans Istanbul où s’oubliait Byzance, un vieux rêve d’empire n’avait pas encore fermé les yeux.
Vasco rencontra quelques survivants de la Maona, la maison de commerce des Giustiniani qui avaient monnayé, deux siècles durant, le mastichio dans toutes les officines d’Europe. Ces hommes riches et puissants hier, réduits à rien désormais, revenaient des bagnes de Crimée où leurs familles avaient disparu. Ils erraient dans la ville et les villages du Sud sans parvenir à reprendre les affaires. L’offre de Vasco intéressa des producteurs qui vendirent en secret une part de leur récolte, déjà triée et prête à être expédiée. Quand les émissaires du Sultan viendraient chercher leur dû, ce prélèvement serait invisible car le mastichio de l’an passé vieillissait encore sans destinataire. Pour une fois, les excédents n’avaient pas été brûlés. Les nouveaux marchands du Turc vendraient le tout pour du neuf à l’apothicaire du harem, et à ses parfumeurs peu regardants.
Amoureux de l’île malgré les traces vives des sévices subis, Vasco s’attarda, conseilla les uns sur les comptes, les autres sur les relations à créer, et promit de revenir aider à remettre le commerce sur pied.
Ses caisses de résine finalement rassemblées, il se força à reprendre la mer au début de l’année 1568.
LA CRAINTE le saisit depuis le large, déjà. En vue de Salonique, ce 22 janvier 1568, La Magdalena dérivait lentement entre deux risées. Des nappes de fumées, bleues au-dessus de la ville, annonçaient la peste répandue. Vasco serrait fortement sur son épaule la besace qui contenait quelques grandes larmes du meilleur mastichio. Avant même la première amarre tournée, il sauta sur le quai avec son adresse habituelle et particulière de boiteux, posant pied de guingois.
Les signes de l’épidémie le frappèrent aussitôt. Les rues étaient vides. Des marques rouges stigmatisaient les portes des maisons. Dans une charrette tressautaient deux ou trois corps, mal couverts d’un drap chassieux. Sur une place, un feu de branches d’olivier vert irritait le nez et les yeux. Il se précipita. Le silence l’accueillit dans la cour des Haviv. Tracé en travers de la porte, le signe. L’angoisse au ventre, il se dépêcha à l’étage de la maison voisine où vivait sa fille. « Quinze ans ces jours prochains, Seigneur Dieu ! » pensa-t-il. Il appela dès la cour franchie. « Otilia… Otilia ! Seigneur Dieu… Otilia ! OTILIA ! » Il hurla.
Quand elle lui répondit dans l’atmosphère endeuillée de la maison, le soulagement plia son corps soudain saisi de crampes. Elle descendit lentement l’escalier, refusa de l’embrasser. Elle avait, hésita-t-elle en gardant ses distances, donné hier à Rodrigue les derniers soins, et cousu le drap autour de son corps. Les servantes n’avaient pas voulu s’approcher de lui. Des hommes au visage caché étaient venus l’emporter ce matin, elle ne savait où.
— Un jour trop tard. Ou juste à temps ! dit Vasco.
Rodrigue… mort ?… La nouvelle ne prenait pas forme dans son esprit. Il rouvrit ses bras pour recevoir Otilia qui ne résista pas. Elle pleura contre lui de tristesse et de peur, raconta les semaines où il avait été absent.
Le pire était passé début janvier. Rodrigue ne cessait de courir la ville, assistait ceux qui étaient restés dans leurs résidences, trop vieux pour partir, trop pauvres pour savoir où fuir. Il allait jour et nuit, vêtu de sa cape de cuir malgré la moiteur, portant sa trousse d’une main, de l’autre les épices qu’il mettait sous son nez quand il passait le seuil d’une maison atteinte. Il sentit la fièvre arriver, prépara son traitement, demanda qu’on s’éloignât de lui, qu’on ne touchât à rien de ce qu’il avait eu entre ses mains… Quelques heures plus tard, il n’entendait déjà plus rien.
Otilia reprit après un silence.
— Je suis entrée dans sa chambre parce qu’il gémissait. Je l’avais entendu derrière la porte. Je l’ai regardé, d’abord. Il tremblait violemment de tout son corps. Son visage, ses bras étaient d’une étrange couleur jaunâtre avec des taches sombres. Je me suis approchée parce que j’ai cru qu’il m’appelait. Il appelait, oui. Il avait l’air de souffrir. J’ai essayé de lui faire boire son eau, mais il a tout vomi sur moi. J’ai voulu partir mais il s’est agrippé. Je crois que ce n’était pas de sa propre volonté. Son corps était secoué de ruades. Puis il est retombé. Pendant une heure ou deux, il a eu de grandes respirations, comme ça… Quand le silence est venu, et l’immobilité aussi, j’ai su qu’il avait perdu. Son visage était bouleversé. Pourtant, je le jure, il avait quelque chose de serein dans son expression. J’ai pensé que je devais lui faire honneur, l’ai tourné vers le mur, les bras étendus. J’ai brisé les deux miroirs, puis lavé son visage. Je ne voulais pas le déshabiller. Et j’ai cousu son grand drap tout autour de lui.
Vasco conduisit Otilia dans sa chambre et la coucha. Couvert d’un manteau, il se rendit dans la maison de Rogrigue. Personne ne se montra. Les servantes avaient dû trouver refuge dans une maison préservée ou en dehors de la ville. Il ne s’attendait pas non plus à rencontrer la famille de Rodrigue, car sa femme et ses grands enfants séjournaient à Istanbul depuis l’été, chez leurs parents Mendes-Nasi. Dans la cuisine désertée, il alluma un grand feu et se rendit dans la réserve aux simples, choisit avec soin des branches de romarin et des bouquets de lavande qu’il posa près du feu, chercha une éponge qu’il imbiba de vinaigre, trouva un citron dont il se frotta les mains, et monta au cabinet de travail de Rodrigue.
Un grand nombre de porcelaines et de fioles étaient alignées sur les rayonnages mais, à part l’huile d’aspic dont il tenta maladroitement d’instiller quelques gouttes dans ses oreilles, comme il l’avait vu faire à Lyon jadis, pendant une attaque de peste, il ne put découvrir ce qu’il cherchait. Les fragments de rubis et d’émeraudes à deux sols, trop petits pour servir autrement qu’en contrepoisons, avaient disparu de leur boîte, ainsi que les perles et la corne. Il ne s’attarda pas. Contre son visage, l’éponge vinaigrée dardait mille aiguilles dans sa tête. La main protégée par un linge de cuisine, il ouvrit la porte de la chambre contiguë et s’approcha du lit dévasté. Le silence de la pièce, l’atmosphère lourde et sa propre émotion lui donnèrent le vertige et une sensation d’étouffement. Il allait partir quand il vit un verre avec un reste de liquide rougeâtre sur la table de nuit. De l’eau d’arbouse, bien sûr ! Avec cela, il devait trouver… Voilà ! À côté du verre, il y avait une râpe et quelque chose qu’il reconnut immédiatement : un tronçon semblable à un morceau d’os. La corne de licorne ! Rodrigue la gardait habituellement dans son cabinet. Le voleur des perles et des pierres n’avait sans doute pas osé venir jusqu’au lit prendre le précieux antidote. Vasco l’enveloppa dans son linge, sans la toucher des doigts, laissa le verre et la râpe, et s’en fut par le même chemin jusqu’à la cuisine où il jeta le linge et le manteau dans le feu. Après avoir longuement tisonné le tout jusqu’aux cendres, il posa sur les braises la grande brassée d’herbes aromatiques qu’il avait préparée. Une âcre fumée puissamment odorante envahit la pièce. Les flammes fusèrent des plantes chargées d’huiles. Dans ces épaisses émanations, il passa ses mains puis le morceau de corne, tenu au bout de la pince à viandes. Enfin, il fit tomber quelques râpures de licorne dans l’eau bouillie d’un verre à la lèvre d’or.
Revenu vers Otilia, il lui fit boire cette potion sans attendre, et d’abord sans un mot.
— Comment savez-vous…, père ? Et qu’est-ce que cette corne ? demanda Otilia après avoir fini son verre.
— Une licorne, ma fille. Elle protège de tous les poisons.
— Je croyais que la licorne était une légende.
— Une légende ? Écoute. Bien avant ta naissance, j’ai vu deux pigeons picorer des grains de réalgar, le mortel arsenic, sur la place Saint-Marc à Venise. L’un d’eux survécut plusieurs heures, il avait picoré cette râpure en même temps que le poison. L’autre, qui n’en avait pas eu, mourut dans l’heure. Rodrigue lui-même, qui observait la scène, dit que cette corne devait avoir un certain effet puisqu’elle avait tenu en vie le pigeon quelque temps. Mais elle ne vient pas de la licorne des légendes, c’est l’épée d’un monstre marin qui vit dans le Nord, et qui s’échoue parfois sur les plages désolées de ces terribles pays. Il paraît qu’il suffit de boire l’eau où a baigné cette épée pour être protégé du mal. C’est, en fait, une espèce de dent qui vaut plus que de l’or. Le marchand de Saint-Marc en voulait deux mille ducats ! Je sais, cela n’a pas réussi à Rodrigue. Mais il s’est tellement exposé ! Je vais rester près de toi pendant sept jours. Tu boiras cette eau que je te préparerai et d’autres choses encore que je te donnerai. Dans sept jours, tu seras hors de danger.
Elle but son eau, ses infusions, et du vinaigre plusieurs fois par jour, pressée d’adoucir sa bouche avec un peu de ce mastic-en-larmes qu’il avait rapporté de Chios. Elle le suçotait longuement, aimait son goût discret de résine. Sept jours passèrent sans qu’il la perde des yeux beaucoup plus longtemps qu’un clignement de paupières. Otilia vécut. À la fin des sept jours, il pleura. Elle ne l’avait jamais vu ainsi.
La peste quitta Salonique. Ceux qui s’étaient éloignés de la ville revinrent, ainsi que les servantes, inquiètes et honteuses. Un commis ne se montra pas, atteint par la maladie, ou devenu médiocre marchand de pierreries. On vit encore, dans les rues, des visages et des mains jaunis au safran comme aux siècles passés. Charlatans… L’âcre odeur des fumigations et leurs brumes s’étirèrent encore quelques fois jusqu’à eux quand le vent de l’après-midi venait de certains quartiers, puis tout cela disparut.
EN ROUTE POUR CHIOS,printemps 1568
DANS l’inventaire des biens du docteur Haviv manquait une grande perle noire issue des mers du Sud, plus rare qu’un diamant d’eau pure. Quand Otilia était enfant, Rodrigue lui montrait son orient de mercure sur fond de nuit, et racontait l’histoire du marin qu’il avait sauvé à grand-peine d’un trop long voyage. Le moribond venu des mers lointaines avait apporté cette perle pour payer les soins qui l’avaient rétabli. Il avait aussi apporté un carnet taché de sels où étaient tracés, à la mine de plomb, des côtes ignorées, d’étranges peuples et des animaux inconnus. Celui que Vasco appelait Sinbad pour amuser Otilia, put se refaire une santé et une situation sur la vente de ses deux trésors. Otilia avait souvent rêvé devant la perle revêtue de ses mystères, ou fait des cauchemars dans lesquels l’aventureux marin revenait pour l’emporter vers des destinations innommées.
Les soupçons se dirigèrent vers Vasco. Tous savaient qu’il avait visité le cabinet du docteur quand son lit était encore chaud. Avait-il quelque chose à dire ? il refusa de se défendre. Le deuil de Rodrigue et la crainte mal apaisée de perdre Otilia criaient trop violemment dans son cœur pour qu’il luttât contre des murmures.
Personne ne chercha le reste de corne qu’il portait avec lui depuis ses jours d’angoisse et de prières maladroites.
Les rabbins, appelés pour décider des voies justes à prendre en la maison sinistrée, ne trouvèrent rien en sa faveur. Il ne fréquentait pas les synagogues, et quand il s’écriait « Seigneur Dieu ! », cela sonnait comme un juron. Sa vie de voyages et ses disparitions incessantes, son goût pour les œuvres frivoles dans les villes d’imprimeries où l’envoyait Rodrigue, ses habits sans apprêt, son goût pour le vin, la chanson et la beauté des femmes peu vêtues, ne l’avaient pas fait respecter. Avant d’être innocenté ou au moins entendu, il décida de quitter Salonique avec Otilia, et de paraître coupable.
La Magdalena, à nouveau, les accueillit à l’aube pour retraverser la mer par un vieux vent du nord, et ce serait sans retour. Vasco abandonnait peu de biens mais une belle bibliothèque, et laissait quelques chagrins qu’il savait consolables. Il emmenait son livre de chevet et une poignée de ducats. Otilia n’avait guère de bagage, elle non plus. Quelques habits, un bijou noirci de sa mère porté autour du cou, pas de pierres ni de perles. Et le carnet de Sinbad reçu un jour de Rodrigue en cadeau.
Durant les jours de cabotage qui les menèrent à leur but, ils commencèrent à guérir des moments difficiles passés à chercher une vie sans Rodrigue à Salonique. Ils ne se lassèrent pas de regarder la mer et les dauphins, dormaient la nuit sur le pont, couverts d’une vieille voile, en se donnant la main.





























