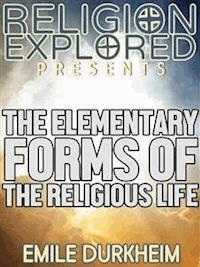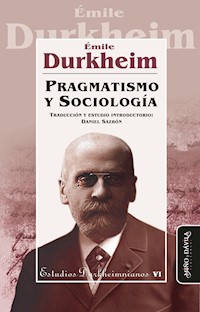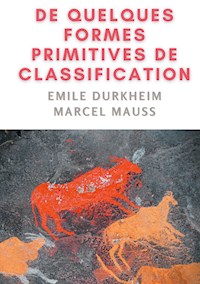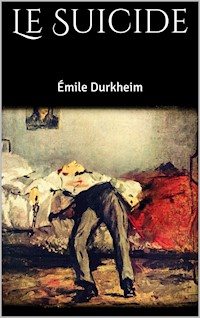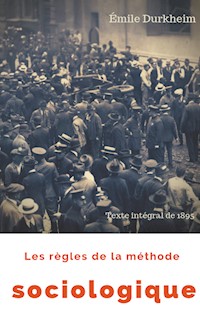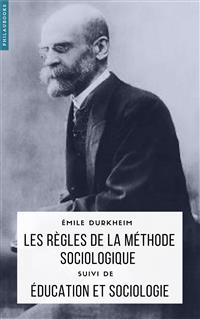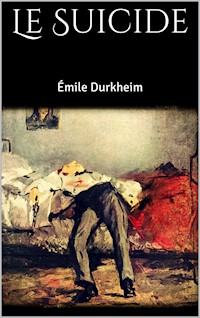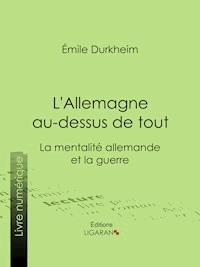1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Dans 'Le Suicide: Etude de Sociologie', Émile Durkheim aborde le phénomène du suicide sous un angle sociologique novateur, rejetant les explications individuelles au profit d'une analyse des facteurs sociaux. L'ouvrage est structuré autour de l'idée centrale que les taux de suicide varient selon les contextes sociaux et culturels, illustrant ainsi l'impact des normes collectives sur les individus. Durkheim utilise un style analytique et rigoureux, combinant des données statistiques avec une réflexion philosophique, pour mettre en lumière quatre types de suicide : égoïste, altruiste, anomique et fataliste. Ce travail est profondément ancré dans le contexte académique de la fin du XIXe siècle, période où la sociologie commence à s'affirmer comme une discipline scientifique à part entière. Émile Durkheim, considéré comme l'un des pères fondateurs de la sociologie, a été influencé par les bouleversements sociétaux de son époque, notamment la transition vers la modernité et ses conséquences sur la cohésion sociale. Sa formation en philosophie et son intérêt pour les questions de moralité et de communauté l'ont poussé à étudier comment les structures sociales influencent le comportement humain. 'Le Suicide' s'inscrit dans sa quête de comprendre les rapports entre l'individu et la société et représente un jalon dans l'établissement de la sociologie comme science empirique. Cet ouvrage est fortement recommandé pour toute personne désireuse de comprendre les interactions complexes entre l'individu et le collectif. Essentiel pour les sociologues et les amateurs de sciences humaines, 'Le Suicide' offre à ses lecteurs une perspective éclairante sur les impacts des contextes sociaux sur les comportements personnels. La profondeur de son analyse et sa méthodologie rigoureuse font de ce livre une référence incontournable dans l'étude des comportements suicidaires. Dans cette édition enrichie, nous avons soigneusement créé une valeur ajoutée pour votre expérience de lecture : - Une Introduction succincte situe l'attrait intemporel de l'œuvre et en expose les thèmes. - Le Synopsis présente l'intrigue centrale, en soulignant les développements clés sans révéler les rebondissements critiques. - Un Contexte historique détaillé vous plonge dans les événements et les influences de l'époque qui ont façonné l'écriture. - Une Biographie de l'auteur met en lumière les étapes marquantes de sa vie, éclairant les réflexions personnelles derrière le texte. - Une Analyse approfondie examine symboles, motifs et arcs des personnages afin de révéler les significations sous-jacentes. - Des questions de réflexion vous invitent à vous engager personnellement dans les messages de l'œuvre, en les reliant à la vie moderne. - Des Citations mémorables soigneusement sélectionnées soulignent des moments de pure virtuosité littéraire. - Des notes de bas de page interactives clarifient les références inhabituelles, les allusions historiques et les expressions archaïques pour une lecture plus aisée et mieux informée.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Le Suicide: Etude de Sociologie
Table des matières
Introduction
Quand un geste intime devient miroir d’une société entière, les coutures du lien social apparaissent. Tel est l’horizon que propose Le Suicide: Étude de sociologie d’Émile Durkheim, ouvrage qui transforme un acte apparemment personnel en objet d’analyse collective. Par une enquête patiente, l’auteur déplace le regard, de l’individu isolé vers les cadres qui le portent, l’orientent ou le déstabilisent. Dans ces pages, la question n’est pas de juger, mais de comprendre. Comprendre, surtout, comment des régularités se dessinent là où l’on n’attendait que des singularités, et comment une société se révèle à travers les variations de ses protections et de ses exigences.
Émile Durkheim, sociologue français, publie Le Suicide en 1897, à un moment où la discipline qu’il contribue à fonder s’institutionnalise en France. L’ouvrage s’inscrit dans la continuité d’un projet: établir la sociologie comme science autonome, dotée de méthodes propres et d’un objet distinct. Au tournant du siècle, entre consolidation républicaine et transformations rapides, Durkheim avance l’idée que certains faits ne s’expliquent qu’en référence à des contraintes et des solidarités collectives. L’étude du suicide, par son apparente intimité, devient un test décisif pour ce programme: si cet acte obéit à des régularités sociales, la démarche sociologique se trouve considérablement renforcée.
La prémisse centrale de l’ouvrage est claire: aborder le suicide comme un fait social, donc comme une réalité mesurable, comparative et située dans des contextes communs. Durkheim s’appuie sur des données disponibles, issues notamment des statistiques administratives, pour suivre des écarts persistants entre pays, régions, groupes religieux, situations familiales. Il ne nie pas les dimensions psychologiques, mais montre qu’elles ne suffisent pas à expliquer les variations observées. Dès lors, la question se déplace: quels agencements collectifs rendent ces taux plus élevés ou plus bas, et par quels mécanismes la trame sociale, plus ou moins serrée, influe-t-elle sur la propension au passage à l’acte?
L’un des apports majeurs réside dans la méthode: distinction nette des niveaux d’explication, définition rigoureuse des objets, comparaison systématique, prudence face aux confusions causales. L’argument progresse en éliminant les hypothèses insuffisantes et en reliant des variations stables à des formes de vie communes. À travers cette démarche, Durkheim met en relief le rôle de l’intégration et de la régulation sociales, axes qui permettent de situer les individus dans des ensembles plus vastes. Sans se perdre dans des psychologismes, il montre que l’étude des structures collectives éclaire des conduites que l’on croyait condamnées à l’énigme individuelle.
Si Le Suicide a le statut de classique, c’est d’abord parce qu’il convainc par la force de sa démonstration: une enquête ordonnée, un vocabulaire précis, une architecture argumentative qui se tient. Mais c’est aussi parce qu’il ouvre un sillon durable pour les sciences sociales: l’usage raisonné des statistiques, l’art de la comparaison, la discipline du concept. À cela s’ajoute une écriture nette, une sobriété qui sert le propos et en rend la lecture étonnamment actuelle. De génération en génération, son équilibre entre minutie empirique et ambition théorique en fait un modèle de rigueur et de portée.
Au cœur de l’ouvrage, des thèmes qui n’ont pas vieilli: la solidarité et ses failles, la norme et ses flottements, la tension entre autonomie et appartenance. Durkheim interroge ce qui, dans la modernité, engage ou desserre les liens communs, et comment ces mouvements influent sur les existences. L’idée qu’un désordre des règles peut désarçonner les individus, ou qu’un défaut d’ancrage collectif peut les exposer davantage, compose une trame de réflexion irréductiblement contemporaine. L’œuvre ne se contente pas de mesurer: elle propose une grammaire pour penser les attachements, leurs forces et leurs manques, à l’échelle d’une société.
L’impact du livre dépasse la seule sociologie. Par la clarté de sa langue et la fermeté de sa construction, Le Suicide a trouvé un écho dans des milieux intellectuels variés, où l’attention aux formes du récit d’enquête et aux grandes idées sur la modernité demeure vive. Ses thèmes — solitude, appartenance, crise des repères — ont circulé au-delà des disciplines, nourrissant des réflexions essayistiques et littéraires sur le destin individuel face aux cadres communs. Sans convoquer l’anecdote ni l’autorité, l’ouvrage a contribué à installer, dans la culture lettrée, l’idée qu’une écriture de la preuve peut aussi émouvoir par sa justesse.
Son influence est également méthodologique: il a consolidé la place de la comparaison contrôlée, stimulé la réflexion sur les indicateurs fiables et encouragé une lecture critique des sources. Les chercheurs y ont trouvé un étalon de précision et un appel à la vigilance: distinguer les corrélations des enchaînements causaux, surveiller les biais, expliciter les catégories. Dans la formation des sciences sociales, l’ouvrage demeure un passage obligé, tant pour apprendre une discipline de pensée que pour mesurer les promesses et les limites de l’approche quantitative. Cette pédagogie implicite a durablement marqué les façons d’écrire, d’argumenter et de débattre.
Le contexte de composition éclaire sa portée. À la fin du XIXe siècle, l’Europe connaît industrialisation, urbanisation et recompositions des appartenances religieuses et familiales. Les administrations développent des instruments statistiques plus réguliers, rendant visibles des phénomènes auparavant éclatés. Durkheim s’inscrit dans cette conjoncture intellectuelle et matérielle: il mobilise ces données, les ordonne et en éprouve la cohérence, afin d’en extraire des relations stables. Ce geste, au croisement de la théorie et de la documentation, fait de l’ouvrage un moment important de la culture des nombres, mais aussi une méditation sur ce que ces nombres peuvent réellement dire.
Lire Le Suicide, c’est suivre une progression soignée, du cadrage méthodologique à l’examen des séries, puis à l’interprétation qui s’en déduit avec prudence. Le livre ne cherche pas l’effet, il construit l’évidence. Le lecteur y apprend à se méfier des explications rapides, à distinguer les plans, à reconnaître qu’une régularité statistique n’est pas une causalité tant que les médiations n’ont pas été élucidées. Cette sobriété, loin d’amoindrir l’ouvrage, en fait la force: elle rend transmissible une attitude intellectuelle, faite de patience analytique et d’exigence dans la formulation des résultats.
Aujourd’hui, l’écho de ces questions est saisissant. À l’ère des données massives, des comparaisons internationales et des indicateurs omniprésents, la leçon de Durkheim — prudence méthodique et attention aux cadres collectifs — demeure essentielle. Les débats sur la cohésion sociale, la solitude, les normes changeantes et les protections communes trouvent dans ce livre un outillage pour penser sans simplifier. Il ne s’agit pas d’y chercher des réponses toutes faites, mais une manière de poser les problèmes: en reliant expériences individuelles et architectures de la vie commune, sans effacer la complexité de l’une ni la force effective des autres.
La pertinence contemporaine de l’ouvrage tient, enfin, à son humanisme de méthode: prendre au sérieux ce qui fait tenir une société, non pour moraliser, mais pour comprendre. Le Suicide nous rappelle qu’expliquer n’est pas excuser et que mesurer n’est pas déshumaniser; c’est chercher des prises pour agir avec lucidité. Voilà pourquoi ce livre demeure un classique: par la puissance de ses intuitions, l’épure de sa démonstration et la générosité de sa visée. Il attire encore parce qu’il nous parle du présent, en nous donnant les moyens d’en décrire les liens, les failles et les promesses.
Synopsis
Publié en 1897, Le Suicide: Étude de sociologie propose d’examiner le suicide comme un fait social mesurable et non comme une simple somme d’actes individuels. Durkheim installe d’emblée un cadre positiviste: recourir à des statistiques comparatives, dégager des régularités et rechercher des causes proprement sociales. L’ouvrage s’inscrit ainsi dans son projet plus large d’autonomiser la sociologie par rapport à la psychologie et à la philosophie morale. L’introduction expose la question directrice: peut-on expliquer les variations des taux de suicide par la structure des sociétés? L’auteur annonce une méthode rigoureuse visant à distinguer les conditions sociales générales des circonstances personnelles et contingentes.
La première partie précise les règles d’une explication sociologique. Durkheim discute les approches psychologiques, morales ou médicales qui attribuent le suicide à des dispositions individuelles, à la folie ou à la dégénérescence. Sans nier que des facteurs personnels interviennent, il soutient qu’ils ne rendent pas compte des différences stables observées entre collectivités. Il propose d’étudier des taux, non des cas isolés, et de traiter ces régularités comme des indices de courants sociaux. La causalité recherchée doit être sociale, accessible à la mesure, et contrôlée par des comparaisons systématiques qui isolent les variables pertinentes et excluent les coïncidences apparentes.
Durkheim rassemble des statistiques officielles provenant de plusieurs pays européens et de périodes prolongées, afin de vérifier la constance des écarts et la solidité des résultats. Il s’attache à la qualité des sources, aux définitions administratives et aux biais possibles, tout en montrant que, malgré ces limites, des profils nationaux et historiques se dessinent avec netteté. La stabilité relative des taux d’une année sur l’autre suggère des forces collectives durables. Il décrit des variations par sexe, âge, profession et milieu urbain ou rural, puis met en place une stratégie comparative destinée à faire émerger des relations explicatives entre organisation sociale et propension au suicide.
Avant de formuler sa typologie, l’auteur élimine les causes dites extra-sociales. Il examine la folie, l’hérédité, la race, le climat, les saisons et la température, et montre qu’aucun de ces facteurs ne coïncide régulièrement avec les différences de taux entre sociétés. Il souligne au contraire des corrélations sociales robustes, notamment l’effet protecteur de certaines formes de vie collective. Les appartenances religieuses offrent un cas instructif: des communautés plus fortement encadrées présentent des taux plus faibles. Durkheim insiste que ce n’est pas la croyance comme expérience intérieure qui agit, mais l’intensité de l’intégration sociale que ces groupes assurent à leurs membres.
Sur cette base, il définit le suicide égoïste, lié à un déficit d’intégration. Là où les liens sociaux sont faibles, l’individu se trouve moins soutenu par des groupes qui donnent sens, obligations et assistance. Les comparaisons entre confessions et, surtout, entre situations familiales étayent la thèse: le mariage et la parentalité, en tant que formes d’appartenance et de solidarité, tendent à diminuer la propension au suicide, alors que l’isolement l’accroît. Le mécanisme explicatif tient à la place de l’individu dans des collectifs capables d’encadrer les aspirations et de fournir des repères communs, plutôt qu’à des dispositions psychiques isolées.
Une autre forme, dite anomique, résulte d’un déficit de régulation. Durkheim observe que de brusques changements économiques, qu’ils soient de crise ou de prospérité, coïncident avec une hausse des taux. La cause n’est pas la pauvreté ou l’aisance en soi, mais la désorganisation des règles qui bornent les désirs et stabilisent les attentes. Quand les normes vacillent, les appuis moraux se relâchent et les appétits deviennent indéfinis, produisant un mal-être spécifique. L’analyse met en évidence le rôle des institutions économiques et juridiques dans la mise en ordre des aspirations, condition nécessaire à l’équilibre des individus au sein de la société.
À l’opposé, le suicide altruiste apparaît dans des contextes d’intégration excessive, où le moi individuel est subordonné à des devoirs collectifs contraignants. L’acte y prend sens par la soumission à un idéal ou à une communauté qui absorbe la personne. Durkheim évoque également une forme fataliste, plus rare, associée à une régulation oppressive qui écrase les possibles et enferme l’avenir. Ces cas, tout en étant moins répandus dans les sociétés modernes, complètent la typologie en montrant que les risques tiennent autant aux excès qu’aux défauts d’intégration et de régulation, deux dimensions complémentaires de l’ordre social.
L’argumentation s’achève en articulant les types de suicide aux deux axes théoriques d’intégration et de régulation, ce qui fournit une carte des états sociaux propices à chaque forme. Durkheim discute des explications concurrentes, notamment l’imitation, qu’il juge insuffisante pour rendre compte de régularités persistantes à grande échelle. La méthode comparative, l’usage des corrélations prudentes et l’idée de courants sociaux offrent une voie pour relier faits individuels et conditions collectives. L’ouvrage souligne que la statistique, correctement interprétée, peut dévoiler des causes sociales spécifiques, sans réduire les personnes à des nombres ni négliger la complexité des situations vécues.
Par-delà l’objet, le livre affirme la portée de la sociologie comme science des liens qui unissent et ordonnent les individus. En requalifiant le suicide en phénomène social, Durkheim propose un cadre durable pour penser la santé des collectifs: des niveaux appropriés d’intégration et de régulation sont nécessaires à l’équilibre moral. Ce diagnostic a nourri de nombreux débats ultérieurs sur le changement social, l’individualisme et le rôle des institutions. Sans prescrire une conclusion unique, l’ouvrage invite à regarder les souffrances privées à la lumière des formes de vie communes, et à évaluer les structures qui soutiennent ou fragilisent les existences.
Contexte historique
Publié en 1897, Le Suicide d’Émile Durkheim s’inscrit dans la France de la Troisième République, née après la défaite de 1870-1871 et structurée par des institutions parlementaires consolidées dans les années 1880-1890. L’ouvrage apparaît au cœur d’un univers académique en expansion, où les universités modernisent les savoirs et où la statistique d’État gagne en légitimité. Durkheim enseigne alors à l’Université de Bordeaux, où il dirige un enseignement de science sociale et de pédagogie. Le livre prend appui sur des séries chiffrées produites par les administrations nationales et provinciales, en France et en Europe, et propose une analyse sociologique des variations du suicide dans les sociétés modernes.
Ce contexte politique est marqué par la laïcisation de l’État et la réforme scolaire. Les lois Ferry (1881-1882) instaurent l’école primaire gratuite, obligatoire et laïque, renforçant la diffusion d’une morale civique républicaine. Les débats sur la place de l’Église, l’autorité de l’État et l’éducation nourrissent l’idée d’un ordre moral séculier. Durkheim s’y inscrit en cherchant à fonder une science autonome du social, distincte de la théologie et de la métaphysique. Son analyse du suicide interroge ainsi l’intégration et la régulation collectives, au moment où les institutions traditionnelles sont contestées et où l’école républicaine recompose les formes de socialisation.
Parallèlement, l’Europe occidentale connaît une industrialisation avancée et une urbanisation rapide depuis le milieu du XIXe siècle. Les réseaux ferroviaires, le télégraphe et la concentration manufacturière reconfigurent l’espace et le temps du travail. Les migrations internes déplacent des populations rurales vers les villes, modifiant les solidarités de proximité. Durkheim observe ces transformations non comme simples décors, mais comme des forces qui transforment la cohésion sociale. En articulant Division du travail social (1893) et Le Suicide, il relie l’individualisation croissante à des risques spécifiques de désintégration, et cherche à mesurer, par des taux, comment ces changements affectent les comportements autodestructeurs.
Les oscillations économiques de la fin du XIXe siècle constituent un autre arrière-plan décisif. La « longue dépression » (environ 1873-1896) entraîne déflation, faillites et chômage, suivie d’une reprise inégale. En France, le krach de l’Union Générale (1882) et le scandale de Panama (rendu public au début des années 1890) ébranlent la confiance dans la finance et le parlementarisme. Durkheim utilise des séries temporelles pour montrer que les bouleversements économiques — crises et prospérités brusques — peuvent accroître le suicide en dérégulant les attentes et les normes, ce qu’il nomme anomie. Le livre dialogue ainsi avec la conjoncture, sans s’y réduire.
La transition démographique, très précoce en France, fournit à Durkheim un terrain d’observation privilégié. La baisse de la natalité amorcée au XIXe siècle, les transformations du calendrier matrimonial et la redéfinition de la famille remodèlent la vie quotidienne. La réintroduction du divorce en 1884 (loi Naquet) témoigne de cette recomposition juridique et morale. Durkheim examine systématiquement les taux selon l’état civil, soulignant l’effet protecteur relatif du mariage et de la présence d’enfants. Ce cadre démographique et légal permet d’ancrer empiriquement ses arguments sur l’intégration familiale et d’éclairer des contrastes persistants entre célibataires, mariés et veufs.
Les mutations religieuses forment un autre fil. La France demeure majoritairement catholique, mais le XIXe siècle a vu le recul de la pratique dans certaines régions urbaines et la montée d’un anticléricalisme politique. Les minorités protestantes sont concentrées notamment en Alsace et dans les Cévennes, tandis que les populations juives restent numériquement faibles. Durkheim compare les taux de suicide par confession en Europe et observe, à partir de statistiques officielles, des niveaux plus élevés chez les protestants que chez les catholiques, et plus bas chez les juifs. Il interprète ces écarts par des degrés différents d’intégration religieuse et communautaire, plutôt que par des dogmes individuels.
Cette démarche suppose un État statistique robuste. Depuis la Révolution, l’état civil s’est rationalisé en France, et la Statistique générale de la France (créée en 1833) a développé des relevés réguliers. À la fin du XIXe siècle, la standardisation progresse, notamment grâce à la classification des causes de décès de Jacques Bertillon (vers 1893), bientôt adoptée internationalement. Durkheim exploite aussi des séries allemandes (Prusse, Bavière, Saxe) et scandinaves, réputées précises. La disponibilité de registres comparables rend possible son projet: traiter le suicide comme un « fait social » mesurable, soumis à des régularités collectives et non seulement à des caprices individuels.
L’ouvrage s’inscrit dans la tradition de la « statistique morale » qui, depuis André-Michel Guerry (1833) et Adolphe Quetelet (années 1830), met en évidence la stabilité de certains taux sociaux. L’italien Enrico Morselli publie Il suicidio (1879), dressant un vaste tableau statistique européen. Durkheim reprend ces acquis mais les réoriente: il ne se contente pas de décrire des constances, il propose des mécanismes sociologiques — intégration et régulation — pour expliquer les différences entre groupes et périodes. En ce sens, Le Suicide dialogue avec ses prédécesseurs tout en systématisant l’usage comparatif et critique des sources administratives.
Face à la montée de la psychiatrie au XIXe siècle, illustrée en France par Esquirol et l’essor des asiles, Durkheim se démarque d’une explication exclusivement médicale du suicide. Sans nier l’existence de troubles individuels, il conteste qu’ils suffisent à rendre compte des variations sociales observables. Il critique également les approches purement biologiques alors en vogue dans certains milieux européens. Sa proposition méthodologique — traiter les faits sociaux comme des choses — vise à isoler des causes proprement sociales, contrôlant autant que possible les biais de classification des décès et les erreurs d’enregistrement entre juridictions.
L’environnement intellectuel du livre est nourri de positivisme français et de science allemande. Après sa formation à l’École normale supérieure (entrée en 1879) et l’agrégation de philosophie (1882), Durkheim séjourne en Allemagne vers 1885-1886, où il se familiarise avec la psychologie expérimentale et l’érudition germanique. Ses Règles de la méthode sociologique (1895) formulent la stratégie scientifique qui structure Le Suicide: comparaison systématique, contrôle des facteurs concomitants, hiérarchie des preuves. L’ouvrage témoigne ainsi d’un moment où la sociologie cherche à s’autonomiser en s’adossant aux standards méthodologiques des sciences établies.
L’institutionnalisation de la sociologie passe aussi par des dispositifs collectifs. À Bordeaux, où il est nommé en 1887, Durkheim développe un enseignement régulier de science sociale et de pédagogie. À la fin des années 1890, il fédère un réseau de collaborateurs qui donnera naissance à L’Année sociologique (premier volume paru en 1898). Ce milieu fournit à Le Suicide un arrière-plan de lectures, de comptes rendus et de débats savants. La discipline y prend forme autour de principes communs: primat des faits, critique des explications ad hoc, et exigence de comparabilité, plutôt que construction de systèmes philosophiques a priori.
La culture de masse et la presse à grand tirage de la Belle Époque façonnent, elles aussi, le contexte. Les « faits divers » de suicides occupent les colonnes des journaux populaires, alimentant des inquiétudes sur l’imitation. Gabriel Tarde, avec ses Lois de l’imitation (1890), propose une diffusion mimétique des conduites. Durkheim discute cette perspective: s’il reconnaît des effets d’entraînement localisés, il soutient que les différences stables entre groupes et périodes renvoient d’abord à la structure de l’intégration et de la régulation sociales, et non à des vagues d’imitation médiatique.
Les cadres juridiques et policiers influent sur la production des données. En France, le suicide n’est plus criminalisé depuis le début du XIXe siècle, ce qui limite les pénalités juridiques et atténue certaines incitations à la dissimulation. Les enquêtes de décès impliquent autorités judiciaires et médecins légistes, avec des pratiques de qualification qui varient selon les pays. Durkheim discute ces écarts de codage et tente d’en mesurer les effets. La création de nomenclatures internationales à la fin du siècle améliore la comparabilité, mais n’abolit pas tous les biais, ce qui l’amène à croiser les sources et à privilégier des tendances robustes.
La question de la cohésion nationale est mise à l’épreuve par l’Affaire Dreyfus, ouverte en 1894 et devenue crise publique à partir de 1898. Elle révèle les fractures de la société française, l’antisémitisme politique et les tensions entre armée, justice et opinion. Durkheim, issu d’une famille juive de Lorraine, intervient dans le débat en 1898 par un article célèbre sur l’individualisme et les intellectuels. Bien que Le Suicide précède ces prises de position, il participe du même horizon: comprendre comment les sociétés modernes peuvent maintenir une solidarité morale sans recourir à la tradition religieuse ou à l’autorité charismatique.
Les comparaisons internationales, au cœur du livre, s’appuient sur l’État allemand unifié depuis 1871, doté d’administrations statistiques réputées. Les données prussiennes, bavaroises ou saxonnes, tout comme celles du Danemark et de la Suisse, permettent de situer la France. Durkheim examine aussi le cas militaire, où les taux de suicide dans les armées européennes semblent élevés, et y voit des effets particuliers de discipline et de conditions de vie. Ces contrastes nourrissent sa typologie et confortent l’idée que les configurations institutionnelles régulent différemment les individus.
Les transformations du monde du travail complètent ce décor. La légalisation des syndicats en 1884 favorise l’organisation ouvrière; les Bourses du travail se multiplient à la fin des années 1880. Les grèves et négociations collectives redéfinissent l’intermédiation entre individus et marché. Durkheim s’intéresse aux « corps intermédiaires » et aux groupes professionnels comme antidotes possibles à la désagrégation, thème déjà présent dans De la division du travail social. Sans prescrire de programme politique détaillé, Le Suicide suggère que des institutions d’encadrement non étatiques et non familiaux peuvent renforcer l’intégration morale.
La vie quotidienne fin-de-siècle se recompose: multiplication des horaires d’usine, séparation plus nette entre temps de travail et de loisir, mobilité résidentielle accrue. Les réseaux associatifs, les sociétés de secours mutuels et les cercles d’instruction populaire participent à de nouvelles sociabilités. La diffusion de la statistique et de l’enquête sociale — par les administrations, les philanthropes et les savants — fait émerger un regard quantifiant sur les mœurs. Le Suicide s’adosse à ces ressources, en convertissant des tableaux de chiffres en arguments causaux, et en posant que la santé morale d’une société se lit dans ses régularités collectives de conduite, y compris funestes.• Dernier point: la technologie de l’imprimé et la standardisation scientifique facilitent la circulation des idées. Les congrès internationaux de statistique et de médecine publique fixent des nomenclatures communes; les bibliothèques et revues spécialisées accélèrent la critique savante. Durkheim publie chez Félix Alcan, maison active dans les sciences humaines. Ce réseau éditorial et associatif donne à son livre une audience transnationale. Le Suicide devient rapidement un point de référence pour les discussions sur la causalité en sciences sociales, à la croisée de la démographie, de la criminologie et de la philosophie morale.• En définitive, Le Suicide fonctionne comme miroir et critique de son temps. Il reflète l’essor de l’État-statisticien, la laïcisation républicaine, l’industrialisation et les fractures politiques de la fin du XIXe siècle. Il critique, par la preuve, les explications purement individuelles, et propose que la modernité requiert des formes renouvelées d’intégration et de régulation. Sans trancher tous les débats, le livre fait du suicide un analyseur des solidarités: il mesure, compare et interprète les manières dont une société tient ensemble — ou se défait — à l’âge des masses et de la science.
Biographie de l’auteur
Émile Durkheim (1858–1917) est l’un des fondateurs de la sociologie moderne et un artisan majeur de son institutionnalisation en France sous la Troisième République. Son œuvre vise à faire de la vie sociale un objet scientifique, en définissant des méthodes et des concepts capables d’expliquer la cohésion des sociétés, leurs crises et leurs transformations. Il s’est attaché à comprendre comment la solidarité, la morale et la religion façonnent les conduites individuelles. Ses analyses articulent des comparaisons historiques et statistiques, et ont profondément marqué la sociologie, l’anthropologie et la théorie sociale au-delà du monde francophone, où ses thèses continuent d’être discutées et mobilisées.
Formé dans l’école publique républicaine, Durkheim intègre l’École normale supérieure en 1879 et obtient l’agrégation de philosophie en 1882. Il enseigne d’abord dans des lycées, puis séjourne en Allemagne au milieu des années 1880 pour observer de près l’organisation universitaire et s’initier aux sciences de l’esprit naissantes. Il y lit notamment la psychologie expérimentale et la philosophie morale, ce qui renforce son ambition de doter l’étude des phénomènes sociaux d’une méthode rigoureuse. Il dialogue avec le positivisme d’Auguste Comte, tout en s’en distançant, et prend au sérieux l’histoire intellectuelle (Montesquieu, notamment) comme source de modèles d’explication sociologique.
En 1887, Durkheim est appelé à l’Université de Bordeaux pour enseigner la « science sociale » et la pédagogie, étape décisive dans la reconnaissance académique de la discipline. Il y élabore un programme d’études et de recherche centré sur l’analyse des faits sociaux comme réalités sui generis. Sa thèse de doctorat, De la division du travail social (1893), accompagnée d’une thèse latine sur Montesquieu, propose la distinction entre solidarités mécanique et organique et introduit la notion d’anomie pour qualifier des situations de dérèglement normatif. L’ouvrage défend l’idée que la modernité transforme les formes d’intégration et de régulation qui rendent possible la vie collective.
Durkheim poursuit cette entreprise méthodologique avec Les Règles de la méthode sociologique (1895), qui énonce des principes pour traiter les faits sociaux comme des “choses”, observables, comparables et explicables par d’autres faits sociaux. Il met ces principes à l’épreuve dans Le Suicide (1897), enquête statistique comparée qui montre que les variations des taux de suicide relèvent du degré d’intégration et de régulation collectives. La typologie qu’il propose (égoïste, altruiste, anomique, fataliste) illustre l’ambition d’une sociologie capable de relier les trajectoires individuelles à des structures morales et institutionnelles, et d’identifier des pathologies sociales sur lesquelles l’action publique peut intervenir.
Pour structurer un travail collectif, il fonde en 1898 L’Année sociologique, revue et réseau de recherche qui recensent, discutent et coordonnent des études convergentes. Autour de lui se constitue une « école » dont les travaux sur le droit, la morale, la famille, l’économie et la religion prolongent son programme. À partir de 1902, Durkheim enseigne à Paris, à la Sorbonne, où l’enseignement de la pédagogie puis de la sociologie se consolide, notamment par des cours d’éducation morale. Dans le contexte de l’Affaire Dreyfus, il défend un individualisme civique et la laïcité, positions exposées dans L’Individualisme et les intellectuels (1898).
Les Formes élémentaires de la vie religieuse (1912) constituent l’aboutissement théorique d’une réflexion sur les liens entre religion, connaissance et société. S’appuyant sur des matériaux ethnographiques disponibles à l’époque, Durkheim y analyse les systèmes totémiques et la distinction du sacré et du profane pour montrer que les représentations collectives et les rites expriment et reproduisent la solidarité. Il entend ainsi éclairer la genèse sociale des catégories fondamentales de la pensée. Parallèlement, ses cours sur l’éducation et la morale, publiés après sa mort, témoignent d’un intérêt constant pour les conditions institutionnelles d’une intégration républicaine adaptée aux sociétés modernes.
La Première Guerre mondiale frappe durement son milieu et ses étudiants, et affecte ses dernières années. Durkheim meurt en 1917 à Paris. Son héritage est considérable: sa conceptualisation des faits sociaux, de la solidarité et de l’anomie irrigue la sociologie de la déviance, de l’éducation et de la religion; son influence se prolonge via ses élèves et lecteurs dans l’anthropologie et la théorie sociale du XXe siècle. Des traditions diverses, du fonctionnalisme à certaines approches structuralistes, se sont approprié ses intuitions. Ses textes restent une référence pour penser la cohésion, les crises normatives et le rôle des institutions dans les démocraties.
Le Suicide: Etude de Sociologie
PRÉFACE
Depuis quelque temps, la sociologie est à la mode. Le mot, peu connu et presque décrié il y a une dizaine d'années, est aujourd'hui d'un usage courant. Les vocations se multiplient et il y a dans le public comme un préjugé favorable à la nouvelle science. On en attend beaucoup. Il faut pourtant bien avouer que les résultats obtenus ne sont pas tout à fait en rapport avec le nombre des travaux publiés ni avec l'intérêt qu'on met à les suivre. Les progrès d'une science se reconnaissent à ce signe que les questions dont elle traite ne restent pas stationnaires. On dit qu'elle avance quand des lois sont découvertes qui, jusque-là, étaient ignorées, ou, tout au moins, quand des faits nouveaux, sans imposer encore une solution qui puisse être regardée comme définitive, viennent modifier la manière dont se posaient les problèmes. Or, il y a malheureusement une bonne raison pour que la sociologie ne nous donne pas ce spectacle; c'est que, le plus souvent, elle ne se pose pas de problèmes déterminés. Elle n'a pas encore dépassé l'ère des constructions et des synthèses philosophiques. Au lieu de se donner pour tâche de porter la lumière sur une portion restreinte du champ social, elle recherche de préférence les brillantes généralités où toutes les questions sont passées en revue, sans qu'aucune soit expressément traitée. Cette méthode permet bien de tromper un peu la curiosité du public en lui donnant, comme on dit, des clartés sur toutes sortes de sujets; elle ne saurait aboutir à rien d'objectif. Ce n'est pas avec des examens sommaires et à coup d'intuitions rapides qu'on peut arriver à découvrir les lois d'une réalité aussi complexe. Surtout, des généralisations, à la fois aussi vastes et aussi hâtives, ne sont susceptibles d'aucune sorte de preuve. Tout ce qu'on peut faire, c'est de citer, à l'occasion, quelques exemples favorables qui illustrent l'hypothèse proposée; mais une illustration ne constitue pas une démonstration. D'ailleurs, quand on touche à tant de choses diverses, on n'est compétent pour aucune et l'on ne peut guère employer que des renseignements de rencontre, sans qu'on ait même les moyens d'en faire la critique. Aussi les livres de pure sociologie ne sont-ils guère utilisables pour quiconque s'est fait une règle de n'aborder que des questions définies; car la plupart d'entre eux ne rentrent dans aucun cadre particulier de recherches et, de plus, ils sont trop pauvres en documents de quelque autorité.
Ceux qui croient à l'avenir de notre science doivent avoir à cœur de mettre fin à cet état de choses. S'il durait, la sociologie retomberait vite dans son ancien discrédit et, seuls, les ennemis de la raison pourraient s'en réjouir. Car ce serait pour l'esprit humain un déplorable échec si cette partie du réel, la seule qui lui ait jusqu'à présent résisté, la seule aussi qu'on lui dispute avec passion, venait à lui échapper, ne fût-ce que pour un temps. L'indécision des résultats obtenus n'a rien qui doive décourager. C'est une raison pour faire de nouveaux efforts, non pour abdiquer. Une science, née d'hier, a le droit d'errer et de tâtonner, pourvu qu'elle prenne conscience de ses erreurs et de ses tâtonnements de manière à en prévenir le retour. La sociologie ne doit donc renoncer à aucune de ses ambitions[1q]; mais, d'un autre côté, si elle veut répondre aux espérances qu'on a mises en elle, il faut qu'elle aspire à devenir autre chose qu'une forme originale de la littérature philosophique. Que le sociologue, au lieu de se complaire en méditations métaphysiques à propos des choses sociales, prenne pour objets de ses recherches des groupes de faits nettement circonscrits, qui puissent être, en quelque sorte, montrés du doigt, dont on puisse dire où ils commencent et où ils finissent, et qu'il s'y attache fermement! Qu'il interroge avec soin les disciplines auxiliaires, histoire, ethnographie, statistique, sans lesquelles la sociologie ne peut rien! S'il a quelque chose à craindre, c'est que, malgré tout, ses informations ne soient jamais en rapport avec la matière qu'il essaie d'embrasser; car, quelque soin qu'il mette à la délimiter, elle est si riche et si diverse qu'elle contient comme des réserves inépuisables d'imprévu. Mais il n'importe. S'il procède ainsi, alors même que ses inventaires de faits seront incomplets et ses formules trop étroites, il aura, néanmoins, fait un travail utile que l'avenir continuera. Car des conceptions qui ont quelque base objective ne tiennent pas étroitement à la personnalité de leur auteur. Elles ont quelque chose d'impersonnel qui fait que d'autres peuvent les reprendre et les poursuivre; elles sont susceptibles de transmission. Une certaine suite est ainsi rendue possible dans le travail scientifique et cette continuité est la condition du progrès.
C'est dans cet esprit qu'a été conçu l'ouvrage qu'on va lire. Si, parmi les différents sujets que nous avons eu l'occasion d'étudier au cours de notre enseignement, nous avons choisi le suicide pour la présente publication, c'est que, comme il en est peu de plus facilement déterminables, il nous a paru être d'un exemple particulièrement opportun; encore un travail préalable a-t-il été nécessaire pour en bien marquer les contours. Mais aussi, par compensation, quand on se concentre ainsi, on arrive à trouver de véritables lois qui prouvent mieux que n'importe quelle argumentation dialectique la possibilité de la sociologie. On verra celles que nous espérons avoir démontrées. Assurément, il a dû nous arriver plus d'une fois de nous tromper, de dépasser dans nos inductions les faits observés. Mais du moins, chaque proposition est accompagnée de ses preuves, que nous nous sommes efforcé de multiplier autant que possible. Surtout, nous nous sommes appliqués à bien séparer chaque fois tout ce qui est raisonnement et interprétation, des faits interprétés. Le lecteur est ainsi mis en mesure d'apprécier ce qu'il y a de fondé dans les explications qui lui sont soumises, sans que rien trouble son jugement.
Il s'en faut, d'ailleurs, qu'en restreignant ainsi la recherche, on s'interdise nécessairement les vues d'ensemble et les aperçus généraux. Tout au contraire, nous pensons être parvenu à établir un certain nombre de propositions, concernant le mariage, le veuvage, la famille, la société religieuse, etc., qui, si nous ne nous abusons, en apprennent plus que les théories ordinaires des moralistes sur la nature de ces conditions ou de ces institutions. Il se dégagera même de notre étude quelques indications sur les causes du malaise général dont souffrent actuellement les sociétés européennes et sur les remèdes qui peuvent l'atténuer. Car il ne faut pas croire qu'un état général ne puisse être expliqué qu'à l'aide de généralités. Il peut tenir à des causes définies, qui ne sauraient être atteintes si on ne prend soin de les étudier à travers les manifestations, non moins définies, qui les expriment. Or, le suicide, dans l'état où il est aujourd'hui, se trouve justement être une des formes par lesquelles se traduit l'affection collective dont nous souffrons; c'est pourquoi il nous aidera à la comprendre.
Enfin, on retrouvera dans le cours de cet ouvrage, mais sous une forme concrète et appliquée, les principaux problèmes de méthodologie que nous avons posés et examinés plus spécialement ailleurs[1]. Même, parmi ces questions, il en est une à laquelle ce qui suit apporte une contribution trop importante pour que nous ne la signalions pas tout de suite à l'attention du lecteur.
La méthode sociologique, telle que nous la pratiquons, repose tout entière sur ce principe fondamental que les faits sociaux doivent être étudiés comme des choses, c'est-à-dire comme des réalités extérieures à l'individu. Il n'est pas de précepte qui nous ait été plus contesté; il n'en est pas, cependant, de plus fondamental. Car enfin, pour que la sociologie soit possible, il faut avant tout qu'elle ait un objet et qui ne soit qu'à elle. Il faut qu'elle ait à connaître d'une réalité et qui ne ressortisse pas à d'autres sciences. Mais s'il n'y a rien de réel en dehors des consciences particulières, elle s'évanouit faute de matière qui lui soit propre. Le seul objet auquel puisse désormais s'appliquer l'observation, ce sont les états mentaux de l'individu puisqu'il n'existe rien d'autre; or c'est affaire à la psychologie d'en traiter. De ce point de vue, en effet, tout ce qu'il y a de substantiel dans le mariage, par exemple, ou dans la famille, ou dans la religion, ce sont les besoins individuels auxquels sont censées répondre ces institutions: c'est l'amour paternel, l'amour filial, le penchant sexuel, ce qu'on a appelé l'instinct religieux, etc. Quant aux institutions elles-mêmes, avec leurs formes historiques, si variées et si complexes, elles deviennent négligeables et de peu d'intérêt. Expression superficielle et contingente des propriétés générales de la nature individuelle, elles ne sont qu'un aspect de cette dernière et ne réclament pas une investigation spéciale. Sans doute, il peut être curieux, à l'occasion, de chercher comment ces sentiments éternels de l'humanité se sont traduits extérieurement aux différentes époques de l'histoire; mais comme toutes ces traductions sont imparfaites, on ne peut pas y attacher beaucoup d'importance. Même, à certains égards, il convient de les écarter pour pouvoir mieux atteindre ce texte original d'où leur vient tout leur sens et qu'elles dénaturent. C'est ainsi que, sous prétexte d'établir la science sur des assises plus solides en la fondant dans la constitution psychologique de l'individu, on la détourne du seul objet qui lui revienne. On ne s'aperçoit pas qu'il ne peut y avoir de sociologie s'il n'existe pas de sociétés, et qu'il n'existe pas de sociétés s'il n'y a que des individus. Cette conception, d'ailleurs, n'est pas la moindre des causes qui entretiennent en sociologie le goût des vagues généralités. Comment se préoccuperait-on d'exprimer les formes concrètes de la vie sociale quand on ne leur reconnaît qu'une existence d'emprunt?
Or il nous semble difficile que, de chaque page de ce livre, pour ainsi dire, ne se dégage pas, au contraire, l'impression que l'individu est dominé par une réalité morale qui le dépasse: c'est la réalité collective. Quand on verra que chaque peuple a un taux de suicides qui lui est personnel, que ce taux est plus constant que celui de la mortalité générale, que, s'il évolue, c'est suivant un coefficient d'accélération qui est propre à chaque société, que les variations par lesquelles il passe aux différents moments du jour, du mois, de l'année, ne font que reproduire le rythme de la vie sociale; quand on constatera que le mariage, le divorce, la famille, la société religieuse, l'armée etc., l'affectent d'après des lois définies dont quelques-unes peuvent même être exprimées sous forme numérique, on renoncera à voir dans ces états et dans ces institutions je ne sais quels arrangements idéologiques sans vertu et sans efficacité. Mais on sentira que ce sont des forces réelles, vivantes et agissantes, qui, par la manière dont elles déterminent l'individu, témoignent assez qu'elles ne dépendent pas de lui; du moins, s'il entre comme élément dans la combinaison d'où elles résultent, elles s'imposent à lui à mesure qu'elles se forment. Dans ces conditions, on comprendra mieux comment la sociologie peut et doit être objective, puisqu'elle a en face d'elle des réalités aussi définies et aussi résistantes que celles dont traitent le psychologue ou le biologiste[2].
* * * * *
Il nous reste à acquitter une dette de reconnaissance en adressant ici nos remerciements à nos deux anciens élèves, M. Ferrand, professeur à l'École primaire supérieure de Bordeaux, et M. Marcel Mauss[1], agrégé de philosophie, pour le dévouement avec lequel ils nous ont secondé et pour les services qu'ils nous ont rendus. C'est le premier qui a dressé toutes les cartes contenues dans ce livre; c'est grâce au second qu'il nous a été possible de réunir les éléments nécessaires à rétablissement des tableaux XXI et XXII dont on appréciera plus loin l'importance. Il a fallu pour cela dépouiller les dossiers de 26.000 suicidés environ en vue de relever séparément l'âge, le sexe, l'état civil, la présence ou l'absence d'enfants. C'est M. Mauss qui a fait seul ce travail considérable.
Ces tableaux ont été établis à l'aide de documents que possède le Ministère de la Justice, mais qui ne paraissent pas dans les comptes-rendus annuels. Ils ont été mis à notre disposition avec la plus grande complaisance par M. Tarde[2], chef du service de la statistique judiciaire. Nous lui en exprimons toute notre gratitude.
LE SUICIDE
INTRODUCTION
I.
Comme le mot de suicide revient sans cesse dans le cours de la conversation, on pourrait croire que le sens en est connu de tout le monde et qu'il est superflu de le définir. Mais, en réalité, les mots de la langue usuelle, comme les concepts qu'ils expriment, sont toujours ambigus et le savant qui les emploierait tels qu'il les reçoit de l'usage et sans leur faire subir d'autre élaboration s'exposerait aux plus graves confusions. Non seulement la compréhension en est si peu circonscrite qu'elle varie d'un cas à l'autre suivant les besoins du discours, mais encore, comme la classification dont ils sont le produit ne procède pas d'une analyse méthodique, mais ne fait que traduire les impressions confuses de la foule, il arrive sans cesse que des catégories de faits très disparates sont réunies indistinctement sous une même rubrique, ou que des réalités de même nature sont appelées de noms différents. Si donc on se laisse guider par l'acception reçue, on risque de distinguer ce qui doit être confondu ou de confondre ce qui doit être distingué, de méconnaître ainsi la véritable parenté des choses et, par suite, de se méprendre sur leur nature. On n'explique qu'en comparant. Une investigation scientifique ne peut donc arriver à sa fin que si elle porte sur des faits comparables et elle a d'autant plus de chances de réussir qu'elle est plus assurée d'avoir réuni tous ceux qui peuvent être utilement comparés. Mais ces affinités naturelles des êtres ne sauraient être atteintes avec quelque sûreté par un examen superficiel comme celui d'où est résultée la terminologie vulgaire; par conséquent, le savant ne peut prendre pour objets de ses recherches les groupes de faits tout constitués auxquels correspondent les mots de la langue courante. Mais il est obligé de constituer lui-même les groupes qu'il veut étudier, afin de leur donner l'homogénéité et la spécificité qui leur sont nécessaires pour pouvoir être traités scientifiquement. C'est ainsi que le botaniste, quand il parle de fleurs ou de fruits, le zoologiste, quand il parle de poissons ou d'insectes, prennent ces différents termes dans des sens qu'ils ont dû préalablement fixer.
Notre première tâche doit donc être de déterminer l'ordre de faits que nous nous proposons d'étudier sous le nom de suicides. Pour cela, nous allons chercher si, parmi les différentes sortes de morts, il en est qui ont en commun des caractères assez objectifs pour pouvoir être reconnus de tout observateur de bonne foi, assez spéciaux pour ne pas se rencontrer ailleurs, mais, en même temps, assez voisins de ceux que l'on met généralement sous le nom de suicides pour que nous puissions, sans faire violence à l'usage, conserver cette même expression. S'il s'en rencontre, nous réunirons sous cette dénomination tous les faits, sans exception, qui présenteront ces caractères distinctifs, et cela sans nous inquiéter si la classe ainsi formée ne comprend pas tous les cas qu'on appelle d'ordinaire ainsi ou, au contraire, en comprend qu'on est habitué à appeler autrement. Car ce qui importe, ce n'est pas d'exprimer avec un peu de précision la notion que la moyenne des intelligences s'est faite du suicide, mais c'est de constituer une catégorie d'objets qui, tout en pouvant être, sans inconvénient, étiquettée sous cette rubrique, soit fondée objectivement, c'est-à-dire corresponde à une nature déterminée de choses.
Or, parmi les diverses espèces de morts, il en est qui présentent ce trait particulier qu'elles sont le fait de la victime elle-même, qu'elles résultent d'un acte dont le patient est l'auteur; et, d'autre part, il est certain que ce même caractère se retrouve à la base même de l'idée qu'on se fait communément du suicide. Peu importe, d'ailleurs, la nature intrinsèque des actes qui produisent ce résultat. Quoique, en général, on se représente le suicide comme une action positive et violente qui implique un certain déploiement de force musculaire, il peut se faire qu'une attitude purement négative ou une simple abstention aient la même conséquence. On se tue tout aussi bien en refusant de se nourrir qu'en se détruisant par le fer ou le feu. Il n'est même pas nécessaire que l'acte émané du patient ait été l'antécédent immédiat de la mort pour qu'elle en puisse être regardée comme l'effet; le rapport de causalité peut être indirect, le phénomène ne change pas, pour cela, de nature. L'iconoclaste qui, pour conquérir les palmes du martyre, commet un crime de lèse-majesté qu'il sait être capital, et qui meurt de la main du bourreau, est tout aussi bien l'auteur de sa propre fin que s'il s'était porté lui-même le coup mortel; du moins, il n'y a pas lieu de classer dans des genres différents ces deux variétés de morts volontaires, puisqu'il n'y a de différences entre elles que dans les détails matériels de l'exécution. Nous arrivons donc à cette première formule: On appelle suicide toute mort qui résulte médiatement ou immédiatement d'un acte positif ou négatif, accompli par la victime elle-même.
Mais cette définition est incomplète; elle ne distingue pas entre deux sortes de morts très différentes. On ne saurait ranger dans la même classe et traiter de la même manière la mort de l'halluciné qui se précipite d'une fenêtre élevée parce qu'il la croit de plain-pied avec le sol, et celle de l'homme, sain d'esprit, qui se frappe en sachant ce qu'il fait. Même, en un sens, il y a bien peu de dénouements mortels qui ne soient la conséquence ou prochaine ou lointaine de quelque démarche du patient. Les causes de mort sont situées hors de nous beaucoup plus qu'en nous et elles ne nous atteignent que si nous nous aventurons dans leur sphère d'action.
Dirons-nous qu'il n'y a suicide que si l'acte d'où la mort résulte a été accompli par la victime en vue de ce résultat? Que celui-là seul se tue véritablement qui a voulu se tuer et que le suicide est un homicide intentionnel de soi-même? Mais d'abord, ce serait définir le suicide par un caractère qui, quels qu'en puissent être l'intérêt et l'importance, aurait, tout au moins, le tort de n'être pas facilement reconnaissable parce qu'il n'est pas facile à observer. Comment savoir quel mobile a déterminé l'agent et si, quand il a pris sa résolution, c'est la mort même qu'il voulait ou s'il avait quelque autre but? L'intention est chose trop intime pour pouvoir être atteinte du dehors autrement que par de grossières approximations. Elle se dérobe même à l'observation intérieure. Que de fois nous nous méprenons sur les raisons véritables qui nous font agir! Sans cesse, nous expliquons par des passions généreuses ou des considérations élevées des démarches que nous ont inspirées de petits sentiments ou une aveugle routine.
D'ailleurs, d'une manière générale, un acte ne peut être défini par la fin que poursuit l'agent, car un même système de mouvements, sans changer de nature, peut-être ajusté à trop de fins différentes. Et en effet, s'il n'y avait suicide que là où il y a intention de se tuer, il faudrait refuser cette dénomination à des faits qui, malgré des dissemblances apparentes, sont, au fond, identiques à ceux que tout le monde appelle ainsi, et qu'on ne peut appeler autrement à moins de laisser le terme sans emploi. Le soldat qui court au devant d'une mort certaine pour sauver son régiment ne veut pas mourir, et pourtant n'est-il pas l'auteur de sa propre mort au même titre que l'industriel ou le commerçant qui se tuent pour échapper aux hontes de la faillite? On en peut dire autant du martyr qui meurt pour sa foi, de la mère qui se sacrifie pour son enfant, etc. Que la mort soit simplement acceptée comme une condition regrettable, mais inévitable, du but où l'on tend, ou bien qu'elle soit expressément voulue et recherchée pour elle-même, le sujet, dans un cas comme dans l'autre, renonce à l'existence, et les différentes manières d'y renoncer ne peuvent être que des variétés d'une même classe. Il y a entre elles trop de ressemblances fondamentales pour qu'on ne les réunisse pas sous la même expression générique, sauf à distinguer ensuite des espèces dans le genre ainsi constitué. Sans doute, vulgairement, le suicide est, avant tout, l'acte de désespoir d'un homme qui ne tient plus à vivre. Mais, en réalité, parce qu'on est encore attaché à la vie au moment où on la quitte, on ne laisse pas d'en faire l'abandon; et, entre tous les actes par lesquels un être vivant abandonne ainsi celui de tous ses biens qui passe pour le plus précieux, il y a des traits communs qui sont évidemment essentiels. Au contraire, la diversité des mobiles qui peuvent avoir dicté ces résolutions ne saurait donner naissance qu'à des différences secondaires. Quand donc le dévouement va jusqu'au sacrifice certain de la vie, c'est scientifiquement un suicide; nous verrons plus tard de quelle sorte.
Ce qui est commun à toutes les formes possibles de ce renoncement suprême, c'est que l'acte qui le consacre est accompli en connaissance de cause; c'est que la victime, au moment d'agir, sait ce qui doit résulter de sa conduite, quelque raison d'ailleurs qui l'ait amenée à se conduire ainsi. Tous les faits de mort qui présentent cette particularité caractéristique se distinguent nettement de tous les autres où le patient ou bien n'est pas l'agent de son propre décès, ou bien n'en est que l'agent inconscient. Ils s'en distinguent par un caractère facile à reconnaître, car ce n'est pas un problème insoluble que de savoir si l'individu connaissait ou non par avance les suites naturelles de son action. Ils forment donc un groupe défini, homogène, discernable de tout autre et qui, par conséquent, doit être désigné par un mot spécial. Celui de suicide lui convient et il n'y a pas lieu d'en créer un autre; car la très grande généralité des faits qu'on appelle quotidiennement ainsi en fait partie. Nous disons donc définitivement: On appelle suicide tout cas de mort qui résulte directement ou indirectement d'un acte positif ou négatif, accompli par la victime elle-même et qu'elle savait devoir produire ce résultat. La tentative, c'est l'acte ainsi défini, mais arrêté avant que la mort en soit résultée.
Cette définition suffit à exclure de notre recherche tout ce qui concerne les suicides d'animaux. En effet, ce que nous savons de l'intelligence animale ne nous permet pas d'attribuer aux bêtes une représentation anticipée de leur mort, ni surtout des moyens capables de la produire. On en voit, il est vrai, qui refusent de pénétrer dans un local où d'autres ont été tuées; on dirait qu'elles pressentent leur sort. Mais, en réalité, l'odeur du sang suffit à déterminer ce mouvement instinctif de recul. Tous les cas un peu authentiques que l'on cite et où l'on veut voir des suicides proprement dits peuvent s'expliquer tout autrement. Si le scorpion irrité se perce lui-même de son dard (ce qui, d'ailleurs, n'est pas certain), c'est probablement en vertu d'une réaction automatique et irréfléchie. L'énergie motrice, soulevée par son état d'irritation, se décharge au hasard, comme elle peut; il se trouve que l'animal en est la victime, sans qu'on puisse dire qu'il se soit représenté par avance la conséquence de son mouvement. Inversement, s'il est des chiens qui refusent de se nourrir quand ils ont perdu leur maître, c'est que la tristesse, dans laquelle ils étaient plongés, a supprimé mécaniquement l'appétit; la mort en est résultée, mais sans qu'elle ait été prévue. Ni le jeûne dans ce cas, ni la blessure dans l'autre n'ont été employés comme des moyens dont l'effet était connu. Les caractères distinctifs du suicide, tels que nous l'avons défini, font donc défaut. C'est pourquoi, dans ce qui suivra, nous n'aurons à nous occuper que du suicide humain[3].
Mais cette définition n'a pas seulement l'avantage de prévenir les rapprochements trompeurs ou les exclusions arbitraires; elle nous donne dès maintenant une idée de la place que les suicides occupent dans l'ensemble de la vie morale. Elle nous montre, en effet, qu'ils ne constituent pas, comme on pourrait le croire, un groupe tout à fait à part, une classe isolée de phénomènes monstrueux, sans rapport avec les autres modes de la conduite, mais, au contraire, qu'ils s'y relient par une série continue d'intermédiaires. Ils ne sont que la forme exagérée de pratiques usuelles. En effet, il y a, disons-nous, suicide quand la victime, au moment où elle commet l'acte qui doit mettre fin à ses jours, sait de toute certitude ce qui doit normalement en résulter. Mais cette certitude peut être plus ou moins forte. Nuancez-la de quelques doutes, et vous aurez un fait nouveau, qui n'est plus le suicide, mais qui en est proche parent puisqu'il n'existe entre eux que des différences de degrés. Un homme qui s'expose sciemment pour autrui, mais sans qu'un dénouement mortel soit certain, n'est pas, sans doute, un suicidé, même s'il arrive qu'il succombe, non puis que l'imprudent qui joue de parti pris avec la mort tout en cherchant à l'éviter, ou que l'apathique qui, ne tenant vivement à rien, ne se donne pas la peine de soigner sa santé et la compromet par sa négligence. Et pourtant, ces différentes manières d'agir ne se distinguent pas radicalement des suicides proprement dits. Elles procèdent d'états d'esprit analogues, puisqu'elles entraînent également des risques mortels qui ne sont pas ignorés de l'agent, et que la perspective de ces risques ne l'arrête pas; toute la différence, c'est que les chances de mort sont moindres. Aussi n'est-ce pas sans quelque fondement qu'on dit couramment du savant qui s'est épuisé en veilles, qu'il s'est tué lui-même. Tous ces faits constituent donc des sortes de suicides embryonnaires, et, s'il n'est pas d'une bonne méthode de les confondre avec le suicide complet et développé, il ne faut pas davantage perdre de vue les rapports de parenté qu'ils soutiennent avec ce dernier. Car il apparaît sous un tout autre aspect, une fois qu'on a reconnu qu'il se rattache sans solution de continuité aux actes de courage et de dévouement, d'une part, et, de l'autre, aux actes d'imprudence et de simple négligence. On verra mieux dans la suite ce que ces rapprochements ont d'instructif.
II.
Mais le fait ainsi défini intéresse-t-il le sociologue? Puisque le suicide est un acte de l'individu qui n'affecte que l'individu, il semble qu'il doive exclusivement dépendre de facteurs individuels et qu'il ressortisse, par conséquent, à la seule psychologie. En fait, n'est-ce pas par le tempérament du suicidé, par son caractère, par ses antécédents, par les événements de son histoire privée que l'on explique d'ordinaire sa résolution?
Nous n'avons pas à rechercher pour l'instant dans quelle mesure et sous quelles conditions il est légitime d'étudier ainsi les suicides, mais ce qui est certain, c'est qu'ils peuvent être envisagés sous un tout autre aspect. En effet, si, au lieu de n'y voir que des événements particuliers, isolés les uns des autres et qui demandent à être examinés chacun à part, on considère l'ensemble des suicides commis dans une société donnée pendant une unité de temps donnée, on constate que le total ainsi obtenu n'est pas une simple somme d'unités indépendantes, un tout de collection, mais qu'il constitue par lui-même un fait nouveau et sui generis[4], qui a son unité et son individualité, sa nature propre par conséquent, et que, de plus, cette nature est éminemment sociale. En effet, pour une même société, tant que l'observation ne porte pas sur une période trop étendue, ce chiffre est à peu près invariable, comme le prouve le tableau I (V. ci-dessous). C'est que, d'une année à la suivante, les circonstances au milieu desquelles se développe la vie des peuples restent sensiblement les mêmes. Il se produit bien parfois des variations plus importantes; mais elles sont tout à fait l'exception. On peut voir, d'ailleurs, qu'elles sont toujours contemporaines de quelque crise qui affecte passagèrement l'état social[4].
/* TABLEAU I
Constance du suicide dans les principaux pays d'Europe (Chiffres absolus).
+————+————-+————-+————+———-+—————+—————-+ | | | | | | | | | ANNÉES.| FRANCE. | PRUSSE. | ANGLE- | SAXE. | BAVIÈRE. | DANEMARK. | | | | | TERRE | | | | +————+————-+————-+————+———-+—————+—————-+ | | | | | | | | | 1841 | 2.814 | 1.630 | | 290 | | 337 | | 1842 | 2.866 | 1.598 | | 318 | | 317 | | 1843 | 3.020 | 1.720 | | 420 | | 301 | | 1844 | 2.973 | 1.575 | | 335 | 244 | 285 | | 1845 | 3.082 | 1.700 | | 338 | 250 | 290 | | 1846 | 3.102 | 1.707 | | 373 | 220 | 376 | | 1847 | (3.647) | (1.852) | | 377 | 217 | 345 | | 1848 | (3.301) | (1.649) | | 398 | 215 | (305) | | 1849 | 3.583 | (1.527) | | (328) | (189) | 337 | | 1850 | 3.596 | 1.736 | | 390 | 250 | 340 | | 1851 | 3.598 | 1.809 | | 402 | 260 | 401 | | 1852 | 3.676 | 2.073 | | 530 | 226 | 426 | | 1853 | 3.415 | 1.942 | | 431 | 263 | 419 | | 1854 | 3.700 | 2.198 | | 547 | 318 | 363 | | 1855 | 3.810 | 2.351 | | 568 | 307 | 399 | | 1856 | 4.189 | 2.377 | | 550 | 318 | 426 | | 1857 | 3.967 | 2.038 | 1.349 | 485 | 286 | 427 | | 1858 | 3.903 | 2.126 | 1.275 | 491 | 329 | 457 | | 1859 | 3.899 | 2.146 | 1.248 | 507 | 387 | 451 | | 1860 | 4.050 | 2.105 | 1.365 | 548 | 339 | 468 | | 1861 | 4.454 | 2.185 | 1.347 | (643) | | | | 1862 | 4.770 | 2.112 | 1.317 | 557 | | | | 1863 | 4.613 | 2.374 | 1.315 | 643 | | | | 1864 | 4.521 | 2.203 | 1.340 | (545) | | 411 | | 1865 | 4.946 | 2.361 | 1.392 | 619 | | 451 | | 1866 | 5.119 | 2.485 | 1.329 | 704 | 410 | 443 | | 1867 | 5.011 | 3.625 | 1.316 | 752 | 471 | 469 | | 1868 | (5.547) | 3.658 | 1.508 | 800 | 453 | 498 | | 1869 | 5.114 | 3.544 | 1.588 | 710 | 425 | 462 | | 1870 | | 3.270 | 1.554 | | | 486 | | 1871 | | 3.135 | 1.495 | | | | | 1872 | | 3.467 | 1.514 | | | | | | | | | | | | +——————————————————————————————————+ */
C'est ainsi qu'en 1848 une baisse brusque a eu lieu dans tous les États européens.
Si l'on considère un plus long intervalle de temps, on constate des changements plus graves. Mais alors ils deviennent chroniques; ils témoignent donc simplement que les caractères constitutionnels de la société ont subi, au même moment, de profondes modifications. Il est intéressant de remarquer qu'ils ne se produisent pas avec l'extrême lenteur que leur ont attribuée un assez grand nombre d'observateurs; mais ils sont à la fois brusques et progressifs. Tout à coup, après une série d'années où les chiffres ont oscillé entre des limites très rapprochées, une hausse se manifeste qui, après des hésitations en sens contraires, s'affirme, s'accentue et enfin se fixe. C'est que toute rupture de l'équilibre social, si elle éclate soudainement, met toujours du temps à produire toutes ses conséquences. L'évolution du suicide est ainsi composée d'ondes de mouvement, distinctes et successives, qui ont lieu par poussées, se développent pendant un temps, puis s'arrêtent pour recommencer ensuite. On peut voir sur le tableau précédent qu'une de ces ondes s'est formée presque dans toute l'Europe au lendemain des événements de 1848[3], c'est-à-dire vers les années 1850-1853 selon les pays; une autre a commencé en Allemagne après la guerre de 1866, en France un peu plus tôt, vers 1860, à l'époque qui marque l'apogée du gouvernement impérial, en Angleterre vers 1868, c'est-à-dire après la révolution commerciale que déterminèrent alors les traités de commerce. Peut-être est-ce à la même cause qu'est due la nouvelle recrudescence que l'on constate chez nous vers 1865. Enfin, après la guerre de 1870 un nouveau mouvement en avant a commencé qui dure encore et qui est à peu près général en Europe[5].
Chaque société a donc, à chaque moment de son histoire, une aptitude définie pour le suicide. On mesure l'intensité relative de cette aptitude en prenant le rapport entre le chiffre global des morts volontaires et la population de tout âge et de tout sexe. Nous appellerons cette donnée numérique taux de la mortalité-suicide propre à la société considérée. On le calcule généralement par rapport à un million ou à cent mille habitants.
Non seulement ce taux est constant pendant de longues périodes de temps, mais l'invariabilité en est même plus grande que celle des principaux phénomènes démographiques. La mortalité générale, notamment, varie beaucoup plus souvent d'une année à l'autre et les variations par lesquelles elle passe sont beaucoup plus importantes. Pour s'en assurer, il suffit de comparer, pendant plusieurs périodes, la manière dont évoluent l'un et l'autre phénomène. C'est ce que nous avons fait au tableau II (V. ci-dessous). Pour faciliter le rapprochement, nous avons, tant pour les décès que pour les suicides, exprimé le taux de chaque année en fonction du taux moyen de la période, ramené à 100. Les écarts d'une année à l'autre ou par rapport au taux moyen sont ainsi rendus comparables dans les deux colonnes. Or, il résulte de cette comparaison qu'à chaque période l'ampleur des variations est beaucoup plus considérable du côté de la mortalité générale que du côté des suicides; elle est, en moyenne, deux fois plus grande. Seul, l'écart minimum entre deux années consécutives est sensiblement de même importance de part et d'autre pendant les deux dernières périodes. Seulement, ce minimum est une exception dans la colonne des décès, alors qu'au contraire les variations annuelles des suicides ne s'en écartent qu'exceptionnellement. On s'en aperçoit en comparant les écarts moyens[6].
Tableau II
Variations comparées du taux de la mortalité-suicide et du taux de la mortalité générale.
/* +——————————————————————————————————+ | A.—Chiffres absolus. | +——————————————————————————————————+ |PÉRIODE|SUICIDES|DÉCÈS|PÉRIODE|SUICIDES|DÉCÈS|PÉRIODE|SUICIDES|DÉCÈS| |1841-46|par |par |1849-55|par |par |1856-60|par |par | | |100.000 |1.000| |100.000 |1.000| |100.000 |1.000| | |hab. |hab. | |hab. |hab. | |hab. |hab. | +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | 1841 | 8,2 | 23,2| 1849 | 10,0 | 27,3| 1856 | 11,6 | 23,1| +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | 1842 | 8,3 | 24,0| 1850 | 10,1 | 21,4| 1857 | 10,9 | 23,7| +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | 1843 | 8,7 | 23,1| 1851 | 10,0 | 22,3| 1858 | 10,7 | 24,1| +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | 1844 | 8,5 | 22,1| 1852 | 10,5 | 22,5| 1859 | 11,1 | 26,8| +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | 1845 | 8,8 | 21,2| 1853 | 9,4 | 22,0| 1860 | 11,9 | 21,4| +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | 1846 | 8,7 | 23,2| 1854 | 10,2 | 27,4| | | | +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | | | | 1855 | 10,5 | 25,9| | | | +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | Moy. | 8,5 | 22,8| Moy. | 10,1 | 24,1| Moy. | 11,2 | 23,8| +——————————————————————————————————+ | B.—Taux de chaque année exprimé en fonction de la moyenne | | ramenée à 100. | +——————————————————————————————————+ | 1841 | 96 |101,7| 1849 | 98,9 |113,2| 1856 | 103,5 | 97 | +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | 1842 | 97 |105,2| 1850 | 100 | 88,7| 1857 | 97,3 | 99,3| +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | 1843 | 102 |101,3| 1851 | 98,9 | 92,5| 1858 | 95,5 |101,2| +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | 1844 | 100 | 96,9| 1852 | 103,8 | 93,3| 1859 | 99,1 |112,6| +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | 1845 | 103,5 | 92,9| 1853 | 93 | 91,2| 1860 | 106,0 | 89,9| +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | 1846 | 102,3 |101,7| 1854 | 100,9 |113,6| | | | +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | | | | 1855 | 103 |107,4| | | | +———-+————+——-+———-+————+——-+———-+————+——-+ | Moy. | 100 |100 | Moy. | 100 | 100| Moy. | 100 |100 | +——————————————————————————————————+ | C.—Grandeur de l'écart. | +——————————————————————————————————+ | | ENTRE DEUX ANNÉES |AU-DESSUS et au-dessous | | | consécutives. | de la moyenne. | +——————————————————————————————————+ | |Ecart |Ecart |Ecart | Maximum | Maximum | | |maximum|minimum|moyen | au-dessous.| au-dessus.| +——————————————————————————————————+ | PÉRIODE 1841-46. | +——————————————————————————————————+ |Mortalité générale| 8,8 | 2,5 | 4,9 | 7,1 | 4,0 | +—————————+———-+———-+————+——————+—————-+ |Taux des suicides | 5,0 | 1 | 2,5 | 4 | 2,8 | +—————————+———-+———-+————+——————+—————-+ | PÉRIODE 1849-55. | +—————————+———-+———-+————+——————+—————-+ |Mortalité générale| 24,5 | 0,8 | 10,6 | 13,6 | 11,3 | +—————————+———-+———-+————+——————+—————-+ |Taux des suicides | 10,8 | 1,1 | 4,48 | 3,8 | 7,0 | +—————————+———-+———-+————+——————+—————-+ | PÉRIODE 1856-60. | +—————————+———-+———-+————+——————+—————-+ |Mortalité générale| 22,7 | 1,9 | 9,57 | 12,6 | 10,1 | +—————————+———-+———-+————+——————+—————-+ |Taux des suicides | 6,9 | 1,8 | 4,82 | 6,0 | 4,5 | +——————————————————————————————————+ */