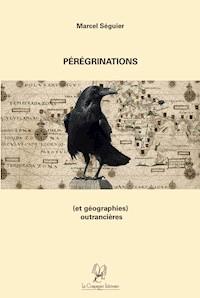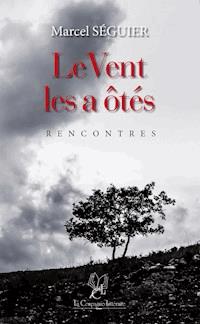
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Compagnie Littéraire
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Marcel Séguier nous livre ses plus belles rencontres sous le signe de l’amitié.
Le titre est emprunté au poème de Rutebeuf. Marcel Séguier est, pour le principal, romancier. Mais dans ces récits s’apparentant à des nouvelles, les héros sont bien réels, qui font pour la plupart partie de l’histoire littéraire. L’auteur y fait participer son lecteur à des moments significatifs par de petites anecdotes.
On y fait des rencontres, toutes inédites car personnelles. Ce mot de « rencontres », il a tenu à ce qu’il paraisse en sous-titre de cet ouvrage inspiré par la fidélité, la gratitude, une amitié émue qu’a ravivé le souvenir. On est mis dans une confidence dont les échos murmurent encore dans l’esprit et le cœur du témoin. Mais une surprise attend sur la fin le lecteur. Voici qu’à côté des êtres prennent place et prennent leur part d’âme des « choses inanimées », selon le vœu du poète. C’est, se substituant au prestigieux escalier de marbre blanc qu’il gravit, celui « de service » que l’enfant empruntait avec sa maman femme de ménage. Près d’accéder au salon d’apparat où il sera reçu par le président du Sénat de la République, le vieil enfant marque une pause. En cet instant il sait très fort qu’il est le fils des Jacques, et, par-delà les générations, celui de Pierril l’aïeul qui se louait de ferme en ferme à la saison. Il peut continuer son ascension, « le joueur de flûte n’a pas trahi » ainsi que le chante Brassens.
Un essai littéraire touchant d’humanité qui, tout en retraçant la vie d’un romancier, dresse les portraits de grands hommes de la culture.
EXTRAIT
Nous fûmes annoncés à notre tour. Le passé simple est ici à sa place, ne serait-ce qu’à cause de cet étrange temps retrouvé. L’imparfait du subjonctif ne serait pas déplacé non plus – peut-être dans la suite du récit. « Monsieur et Madame Marcel Séguier ».
Pour le coup ce que j’entendais n’était pas en situation et j’en conçus une gêne sincère. Certes, Marcel ! Il y en eut trois ce soir-là à l’hôtel George V : Pagnol, Achard, moi-même, et d’autres sans doute de moindre importance.
Au salon où nous fûmes introduits, Louise et moi – elle était ravissante et je crois qu’on la remarqua – le jeu des noms et des visages s’y rapportant continua. Cependant certaines personnes à proximité, nous étions verre en main, se nommèrent spontanément avec une gentillesse infinie. Les petits provinciaux que nous étions furent surpris et vite pris par une simplicité qui tranchait avec ce que nous avions imaginé.
A PROPOS DE L’AUTEUR
Dans les années 1970-1990,
Marcel Séguier a joui d’une très belle réputation. Salué par les plus grands de l’époque, notamment pour son titre
La Reddition, publié chez Fayard.
L’auteur joue avec les mots, les doubles sens et les phrases elles-mêmes, avec une dextérité que l’on ne trouve plus guère dans la littérature contemporaine.
Marcel Séguier, aime à se faire appeler Marcello par ses intimes. Franco-suisse, il aime à dire aussi, que son cœur est en deçà et au-delà des Alpes.
Ses références littéraires, musicales ou artistiques nous font traverser les époques ainsi que le néo-romantisme.
Les fantômes d’Anatole France, Valéry, Flaubert, Proust, Claude Simon ou Gracq, nous accompagnent à travers ses lignes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marcel Séguier
Le vent les a ôtés
ISBN 9782876835641
Catégorie : Nouvelles
www.compagnie-litteraire.com
Que sont mes amis devenus
que j’avais de si près tenus
et tant aimés [...]
Je crois le vent les a ôtés.
Rutebeuf
Les souvenirs ne sont pas exilés sans appel. Ils habitent une contrée lointaine que nous pouvons visiter. Cette idée nous rassure. Il arrive aussi que ce soit eux qui entreprennent le voyage. Leur séjour est un jardin aux secrets bientôt désarmés. Nous ne nous étonnons pas moins : la mémoire a chargé le temps d’altérer les traits d’un visage. L’effacement pourtant n’a pas eu lieu, ce n’était que tenace évanescence. Et quand d’eux se dérobait encore l’image, des mots vinrent la secourir, des noms pour que chacun de ces proscrits coure à nouveau en liberté son aventure.
Les mots sont les habits des souvenirs. Les mots désignent, comme dans cette vieille allégorie scolaire, merveilleuse telle la lampe d’Aladin. Elle mettait en scène un enfant et un très vieil homme qui s’appelait Démonstratif. Quel qu’il fût, composé de lettres, un nom, un mot, chacun d’eux à son tour s’éclairait le temps que pointait sur lui son index le vieil homme. Pour l’enfant qu’il tenait par la main il épelait, tous deux debout devant la tombe, les lettres que l’usure avait plus qu’à moitié gommées sur la pierre. Et sur la pierre l’oubli pris en faute regrettait l’offense de son ombre qu’il étendait sur elle. Rassemblant sa poussiéreuse matérialité, le « fantôme sans os » reprenait vie, épelé, appelé. Et l’oubli, à l’écart, laissait place au visage un long temps éteint.
Surpris, nous en reconnaissons certains, signe à signe réapparus. D’autres, qui tardent, seront ceux que notre avenir, aussi le leur, apprendra à connaître dans une naissance nouvelle. Ensemble nous irons à la découverte sur des routes soudaines. Et si le souvenir, inventif autant qu’infidèle, les a fait autres, ils ne seront pas pour autant ceux d’un autre car nous allons d’un même pas, celui du Temps.
Courant en cela tous les risques, je vais parler et de ce que d’eux j’ai vu et de ce que, de même, aujourd’hui je vois. Pour certains la rencontre fut brève. La durée, ici, n’est pas la mesure. La mesure s’égale, pour moi, à l’intensité d’un moment, une heure ou bien plusieurs années que le temps aboli condense. Je parle pour cette raison au présent. Le souvenir que je garde d’eux tous comme de chacun d’eux est de nature minérale comme on voit ce que le temps a roulé à la façon, exactement, du torrent qui a fait de la pierre imparfaite un galet à la forme aboutie, bien en main qui captive nos yeux. Ou ces coquillages qu’enfant nous portions à l’oreille pour y écouter le bruit de la mer. C’est ainsi qu’ils demeurent et qu’ils m’ont instruit, formé moi aussi; qu’avec l’âge je les retrouve. Avec leur œuvre qui, si je suis attentif, fait à son tour entendre ce grondement de houle qu’un instant d’écoute éternise.
M.S
Le Professeur Léonard
Je ne vois plus aujourd’hui son visage, mais son nom m’est resté, lié intimement au mot de professeur, et les paroles, à nouveau vivantes, que nous échangions. J’avais dix ans. Il fut le premier juge de mes premières poésies, après le cercle de famille dont on sait qu’il applaudit à grands cris. Bien que ce monsieur, qui me paraissait déjà sur l’âge, fût d’abord simple et agréable, dépourvu de toute condescendance, à plus forte raison de mépris pour le fils de la femme de ménage et pour ma naïve ignorance, c’est peu dire qu’il m’impressionnait beaucoup. Peut-être pour cette qualité d’homme dès l’abord – un professeur avec qui je parlais librement et qui avait désiré me lire! Mais aussi parce que son nom était lié, comme allié, à celui, prestigieux, de Larousse.
La vieille dame était, je crois, parente du lexicographe qui, lui, était en ce temps-là le juge absolu ès langue française. Et voilà que je comparaissais devant, je n’en doutais pas, son disciple; ce mot qui, hors le temple du dimanche, gardait en tout lieu, en toute occurrence sa force, et même une sorte de véhémence prophétique. Prophète, au moins augure, le « Professeur Léonard » le fut, puis-je le dire, dois-je le dire? Mais oui, je le lui dois, à mon endroit.
J’avais, encouragé, et désireux de savoir comment, plus que pourquoi, se font les livres, même un petit, même une « poésie » naïve, osé lui proposer de lire une telle, du moins le passage qui me valut la remarque critique du professeur Léonard, formulée avec autant de clarté que de rigueur, autant d’exigence pédagogique que d’amicale sollicitude. Hésitant devant cette image banale, écrirai-je qu’il semait dans une terre toute disposée ce que plus tard, passionné de mots à mon tour, je moissonnerais tout au long de mes livres? J’aime à le penser car il m’encouragea à continuer d’écrire des « poésies ». Cette première leçon, de part et d’autre fortuite, pour lui improvisée, pour moi impromptue car je n’étais là que parce que maman m’y avait fixé rendez-vous au terme de ses deux ou trois heures de ménage chez la vieille dame, parente ou alliée du professeur. Je m’en souviens comme si c’était hier. Je parle d’une de mes poésies en particulier, en disant plus haut « une telle ». Une parenthèse m’a fait surseoir de la citer, du moins, précisais-je, le passage qui arrêta le professeur dans sa lecture. Le voici donc sans plus d’ambages. Je ne me souviens plus du début. Mais parfaitement de la faute, une entorse aux règles de la syntaxe. Employa-t-il ce mot savant? De cela je ne me souviens pas non plus. Si oui, il me l’a assurément expliqué. Il me remontra en souriant que cette faute portait atteinte, cela plus gravement, au sens de ce vers malencontreux, et je traduisis qu’il rendait celui-ci assez ridicule. J’en fus très malheureux car j’y avais mis tout mon cœur, j’avais quelque dix ans je le rappelle. Le professeur relut pour moi. Il s’agissait de maman dans son exercice de ménage. Je la décrivais « balai en main, pelle de l’autre » et, sans transition : « par les fentes des volets mis en clef se glisse un rayon d’or ».
« Je comprends bien, dit le professeur, qu’il s’agit d’un rayon de soleil, mais si rien ne vient séparer les images du balai et de la pelle, il semble que la main qui les tient est celle du soleil, et cette méprise est très malencontreuse, grotesque. » Là non plus je ne suis pas sûr de ces mots. Sans aucun doute, tous restaient empreints du respect qu’on doit à l’enfance : une attitude bien au-delà de l’indulgence, à mille lieues de toutes les distances, qui veille à ne jamais blesser, à ne pas abîmer ce qui est tendrement adolescent et ne se confie qu’avec de secrètes réserves et que cet abandon peut reprendre. J’aime à penser que le professeur s’attarda pour cela moins longtemps sur la méprise dommageable au sens que sur l’aspect strictement grammatical de ma bévue, soulignant la nécessité d’un ordre congru des mots dans la phrase. Je savais déjà, notre maître, en classe, y insistait, qu’une virgule mal placée peut changer le sens, et qu’une négation mal venue... Etc. Je reçus la leçon volontiers, n’ayant qu’envers moi-même du ressentiment. Des émotions dont j’avais chargé ma poésie je dis un peu plus haut qu’il n’en fut guère question. Cette banalité, peut-être, que c’était d’un « bon fils ». Cela allait de soi pour moi, pour lui qui m’avait lu gentiment. Hormis le cercle familial au sein duquel il s’exprima ce jour-là, hors de celui de l’amitié, des relations professionnelles, mais le temps a passé, Monsieur Léonard, professeur de lettres à Caen, n’a pas laissé de souvenir. Et je ne sache pas qu’il ait écrit. J’ai tenu à le faire revivre l’espace d’une page et à sa place, la première en date; et au-delà, et hors d’atteinte les fatales préséances du Temps.
Marcel Pagnol
J’ai quarante ans. Trente-neuf. Lauréat l’année précédente de la fondation Del Duca, je suis invité à la remise de cette modeste distinction littéraire qui se tiendra dans les salons de l’hôtel George V à Paris. Nous y sommes allés, Louise, mon épouse et moi, avec d’autant plus de plaisir et d’intérêt que celui qui avait mérité cet honneur après moi était un jeune ami journaliste stagiaire au journal qui nous employait.
Mon bagage n’était pas gros, un livre seulement, un roman qui avait été généreusement reçu par les journaux, de France et de la francophonie. Cela fut suffisant pour être à nouveau très agréablement salué ce soir-là. C’est vous? C’est bien moi… Dois-je dire qu’avant même d’avoir présenté notre carton d’invitation au sombre personnage habillé et stylé comme un valet de comédie, Louise et moi étions très impressionnés. Le meilleur était à venir. Comme nous n’étions pas – c’est étrange quand j’y repense, quand je revois les messieurs dames qui nous précédaient à l’entrée du salon, appartenant à l’évidence à la gentry – des premiers à attendre, nous faisions la queue sagement et je pouvais entendre décliner les noms, parfois les titres, de chacune des personnes admises à leur tour au salon. Temps présent aux allures de temps retrouvé, fleurissaient barons et marquises. Pourquoi pas Charlus et la duchesse de Guermantes! Mon prénom de Marcel me valait-il ce privilège? Ces gens bien nés, sans compter les titres qui, pour n’être pas nobiliaires, ne laissaient pas être aussi impressionnants, ceux acquis dans le monde des affaires, des arts, des lettres pour lesquels j’essayais de faire coïncider des visages et des noms.
Nous fûmes annoncés à notre tour. Le passé simple est ici à sa place, ne serait-ce qu’à cause de cet étrange temps retrouvé. L’imparfait du subjonctif ne serait pas déplacé non plus – peut-être dans la suite du récit. « Monsieur et Madame Marcel Séguier ».
Pour le coup ce que j’entendais n’était pas en situation et j’en conçus une gêne sincère. Certes, Marcel! Il y en eut trois ce soir-là à l’hôtel George V : Pagnol, Achard, moi-même, et d’autres sans doute de moindre importance.
Au salon où nous fûmes introduits, Louise et moi – elle était ravissante et je crois qu’on la remarqua – le jeu des noms et des visages s’y rapportant continua. Cependant certaines personnes à proximité, nous étions verre en main, se nommèrent spontanément avec une gentillesse infinie. Les petits provinciaux que nous étions furent surpris et vite pris par une simplicité qui tranchait avec ce que nous avions imaginé. C’était bien là ne pas être au fait des us et coutumes de cette faune pour qui une apparence de naturel équivaut à un dépouillement des signes trop visibles de la suffisance chez les parvenus. Une dénudation, ai-je envie d’écrire. Comme on dirait d’un arbre déshabillé de son écorce, de son feuillage.
Le « simple appareil » pour les jeunes et belles dames de ce soir-là, l’été venu. Une tenue à la mode sur une plage réservée et sélecte.
De proche en proche je fus identifié. De même je mis des noms sur des visages comme on en avait mis un sur celui de l’inconnu. Ce fut celui de Jean Rostand, le biologiste, l’homme aux grenouilles mises à sécher sur une corde à linge. À rebours, on aurait pu parler d’affectation avec cette image déconcertante qu’il donnait de lui, son pardessus, déjà pas très frais, était décousu largement dans le bas et tout à l’avenant. Il apparaissait « négligé » comme on le dit d’Einstein dont les souliers n’avaient plus de lacets. Pas le temps de les nouer… Jean Rostand, lui, prit le temps de causer avec nous, avec moi dont il assura avoir lu les livres. Lui ai-je fait remarquer que je n’en avais publié qu’un seul, même si le second était en route? Il fut charmant. Mais l’adjectif ne convient guère.
Pas mondain, ni pédant, ni distant, ni condescendant, rien de tout ça. Je demeurai sans voix devant le grand homme, que j’avais lu, dont j’appréciais la pensée et l’esprit. Vint se mêler à la conversation une fort vieille dame qui se présenta à nous, Madame Une telle, sculptrice, élève de Bourdelle. Ce disant, elle ne nous quittait pas des yeux, Louise et moi. Marcel! Vous avez le front de Baudelaire! Votre femme est exquise! Vous formez un beau couple. Tenez! je veux vous sculpter tous les deux en bas-relief. Aussitôt je nous vis tous les deux immortalisés sur quelque fresque antique. Elle nous expliqua. Le projet était plus modeste quant à ses proportions. Mais enfin. Nous touchions à la gloire! Ce n’était ce soir-là que la première fois. Quant à l’immortalité une voix prophétique allait un peu plus tard m’en assurer. Êtes-vous d’accord?
Je bredouillai que oui après de chauds remerciements. Ce n’est rien! Prenons plutôt rendez-vous. Le rendez-vous fut-il pris? Je ne sais plus pour quand et où, mais je sais bien que de commun accord Louise et moi ne nous y serions pas rendus.
Un petit homme roulait de-ci, de-là, pressé, sur ses courtes jambes. C’était Marcel Achard. Outrageusement, il repérait et pistait le moindre journaliste et surtout photographe passant à sa portée. C’en était ridicule, déplaisant et pathétique presque. Je n’avais, je n’ai, aucune sympathie pour ce personnage. C’est plus épidermique que raisonné, peut-être même que raisonnable.
Le troisième Marcel à paraître fut Pagnol. Ni intérêt excessif pour son œuvre, plus méridionale que méditerranéenne, savant metteur en scène de ses livres et de soi-même, ce fut lui qui, très gentiment – n’ai-je pas trop déjà abusé de cet adverbe? – m’aborda. Je me souviens que ce fut au milieu, comme on dit au large, du salon. Il était fort différent de l’image que je m’en faisais à cette époque. Sans doute ses personnages y contribuaient-ils largement. Pour le coup, ni méridional ni méditerranéen, pas outrancièrement brun, ni verbeux, ni gesticulant, tout le contraire d’un personnage de sa fameuse partie de cartes. Bien, très bien mis, il respirait une manière d’aristocrate à la démarche d’une grande sobriété. Aucune affectation, ni le visible, ni son contraire qu’il faut décrypter. Il me tendit la main. Je la pris avec un sentiment de fierté que je me reprochai aussitôt, et pourquoi?
Très vite mes réticences cessèrent, qui n’étaient que la crainte de « me faire avoir », manger tout cru par le grand homme. Sans doute s’en aperçut-il. Il me prit par le bras. Aussitôt des photographes se postèrent à distance. J’étais vraiment dans mes petits souliers. Au vrai je ne me sentais plus marcher. Marcher à ses côtés!
« Nous nous prénommons Marcel tous les deux ». Il rit à demi mais franchement. Ce petit provincial, de l’âge de ses fils, l’amusait sans nul doute. « Je vous ai lu ». Ça c’était bien possible ma foi, ne faisait-il pas partie du jury, présidé par André Maurois, qui m’avait élu? Et j’ai beaucoup aimé votre livre. Vous y parlez, montrez bien la terre, en rendez parfaitement les parfums, et votre Rodrigo est un personnage comme je les aime. Vous me croyez? Je le crus car en effet le meilleur de son œuvre est là, à ce niveau de vie rustique que Giono a passablement abîmée par l’écriture apprêtée de celui qui, à l’instar de Colette dans ses mauvais livres – « La naissance du jour » par exemple – se regarde écrire. J’aime l’opéra, ses fastes, ses décors, jusqu’à ses excès, mais seulement à l’opéra. Or Giono n’est pas Verdi. Dans quel roman écrit-il – je cite de mémoire – « l’épée flamboyante du soleil se planta entre ses omoplates »? J’espère que, textuellement, c’est moins ridicule. Mais cette image est placée en toute fin de chapitre, juste avant le grand blanc qui le clôt. Quel coup de cymbale! On est bien à l’opéra à la fin du grand air. Pagnol, quoique parfois entre opéra seria (pas trop) et opérette, me convainc davantage. Il dit mieux, paroles et musique. Raison pour laquelle il a réussi au théâtre et quoiqu’on dise au cinéma, dans ses mises en scène des histoires de Giono, par exemple. Ses dialogues y font merveille. C’est assez proche de la jubilation qui nous saisit en écoutant les tirades de « Cyrano » et celles de « L’aiglon » quoique ici parfois pleurnichardes.
Mais il y a Flambeau ce flambard! Pour l’heure, le maître voulait bien dialoguer avec moi. Et, quelque trente années nous séparant, comme le professeur Léonard assurant que je pouvais écrire, il se fit lui aussi prophète à mon endroit. De cet augure, au visage soudainement d’antique, tombèrent des mots qu’articulait une bouche de marbre qui donnait à mon avenir une forme étonnante. L’encourageant professeur les aurait-il contredits? « Marcel! vous voulez bien que je vous dise Marcel? Un jour, je vous l’assure, vous me succéderez à l’Académie ». La voix de la Fatalité! Pour le meilleur et pour le pire. Mais ce « meilleur » ne s’oppose-t-il pas à ce « pire » en dressant contre la vieillesse et la mort l’immortalité?… Je ne me vis pas pour autant costumé de vert. J’étais d’ailleurs ailleurs. Sans couleurs comme sans contours, sans forme définie, pareil, si je dois à tout prix me décrire, à un ectoplasme au bras de Pagnol qui me paraissait élever ce corps éthéré à quelques centimètres du sol. Pagnol m’a transporté! Nous allions d’un bout à l’autre du salon sur toute sa longueur qui était sans fin quoique nous approchant, de ce pas, tantôt de l’une, tantôt de l’autre de ses frontières, y parvenant, en revenant comme le capitaine du « fériboite », Escartefigue, touchant et touchant de nouveau les rives portuaires entre lesquelles il se risquait. Moi, cette traversée sur le parquet, mer calmée du salon, mesurait, au prix d’autres périls, une étendue quasi océanique. Elle prit fin sur une poignée de main contresignant la flatteuse promesse en forme de prophétie, et sous le mitraillage qui reprit des reporters photographes. La suite fut mon retour sur terre après ces sphères aériennes.
Cette suite eut une suite. Sans elle, après avoir épuisé mes succès d’auditoires lorsque complaisamment je contais cette histoire, je ne me serais pas autant attardé sur cette dernière.
Rentré chez moi, je la casais, ainsi que je viens de le dire, un peu partout; un peu devant n’importe qui que ça épatait tout de même. Jusqu’au jour où elle vint, adroitement halée pensais-je, sur le fil, comme on dit du courant, de la conversation que nous soutenions seul à seul un bon ami poète et moi. Je lui avais décrit notre longue navigation de conserve, Pagnol et son assuré successeur quai Conti, sur le parquet du salon de l’hôtel George V. C’est alors que, comme on fiche une banderille dans le flanc du taureau, cet ami me crucifia debout. Il ne s’était pas étonné au récit de ma flatteuse aventure; et même, faisant aujourd’hui retour sur son attitude presque détachée, me semble avoir forcé son indifférence polie. Ah! ce sourire quand il me questionna sur un ton cruellement amical : « Il te l’a dit à toi aussi? »
Frédéric Joliot-Curie
J’ai vingt ans. Une grève dure paralyse la circulation du métro et des bus à Paris où se tient, au Parc des Expositions, un rassemblement pour la paix. C’est avant ou après l’Appel de Stockholm et la colombe de Picasso. Malgré les difficultés de transport nous serons dix mille réunis dans la salle qui me surprit par son immensité. Des hommes et des femmes étaient venus de toutes parts, de l’étranger pour certains que leurs accents dénonçaient.
Il y avait un personnage, isolé, un peu étrange, passablement antipathique : Gary Davis. Qui se souvient de ce contradicteur systématique dont l’antisoviétisme, l’anticommunisme à fleur de peau paraissaient tenir lieu de credo