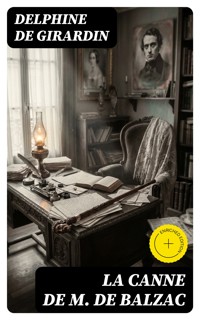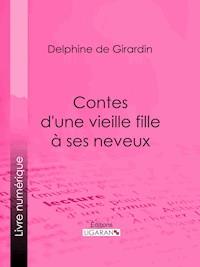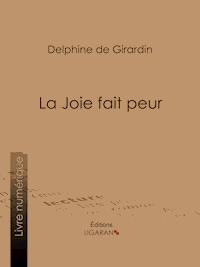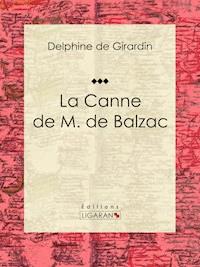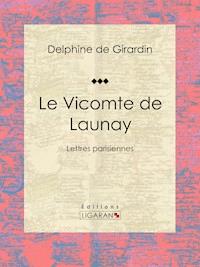
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
extrait: "Il n'est rien arrivé de bien extraordinaire cette semaine : une révolution en Portugal, une apparition de république en Espagne, une nomination de ministres à Paris, une baisse considérable à la bourse, un ballet nouveau à l'Opéra, et deux capotes de satin blanc aux Tuileries."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335028959
©Ligaran 2015
Voilà deux ans bientôt qu’elle repose sous la dalle de marbre sculptée d’une simple croix en relief, modeste tombeau qu’elle avait exigé dans ce cimetière Montmartre qui nous a déjà pris tant d’êtres chers ; et bien souvent, le premier tribut payé, aux jours mêmes du deuil, nous nous étions promis d’écrire quelque part, et plus au long, ce que nous savions d’elle, mais nous avions reculé, non sans remords, devant cette tâche douloureuse : notre cœur à peine cicatrisé craignait de voir se rouvrir sa blessure ; car, lorsque la France déplorait la perte de la Muse, nous ne songions qu’à la perte de l’amie : cette mort a été pour nous un de ces coups auxquels l’âme ne s’accoutume pas, et nous ne pouvons encore passer près de la maison aux blanches colonnes sans que nos yeux ne deviennent humides.
Que de fois nous sommes revenu à deux ou trois heures du matin, avec Victor Hugo, Cabarrus et ce pauvre Théodore Chasseriau, au clair de lune ou à la pluie, de ce temple grec qu’habitait une Apolline non moins belle que l’Apollon antique ! Libres soirées, intimités délicieuses, conversations étincelantes, dialogues du génie et de la beauté, banquet de Platon, dont les propos eussent dû être recueillis par une plume d’or, hélas ! vous ne vous renouvellerez plus : mais ceux qui ont été admis à ces charmantes fêtes de l’esprit ne les oublieront jamais ; l’exil s’en est souvenu, et ces vers sont partis de Jersey pour venir s’abattre sur le marbre funèbre :
Nous empruntons à un petit livre commémoratif, sorte de bout de l’an de la douleur où une main pieuse a recueilli tous les articles parus dans les journaux, à l’époque fatale, ces quelques lignes par lesquelles toute biographie humaine peut se résumer.
Delphine Gay, née à Aix-la-Chapelle, paroisse de Saint-Adalbert, le 6 pluviôse an XII (26 janvier 1804), fille de Marie-Françoise Nichault de la Valette, née à Paris le 1er juillet 1776, mariée en premières noces à M. Liottier, agent de change, et en secondes noces-à M. Gay, receveur général du département de la Roër, – petite-fille de Francesca Peretti, – mariée à Paris le 1er juin 1851 à M. Émile de Girardin, – décédée le 29 juin 1853, – repose au cimetière du Nord (cimetière Montmartre).
La première fois que nous vîmes Delphine Gay, c’était à cette orageuse représentation où Hernani faisait sonner son cor comme un clairon d’appel aux jeunes hordes romantiques. Quand elle entra dans sa loge et se pencha pour regarder la salle, qui n’était pas la moins curieuse partie du spectacle, sa beauté, – bellezza folgorante, – suspendit un instant le tumulte et lui valut une triple salve d’applaudissements ; cette manifestation n’était peut-être pas de bien bon goût, mais considérez que le parterre ne se composait que de poètes, de sculpteurs et de peintres, ivres d’enthousiasme, fous de la forme, peu soucieux des lois du monde. – La belle jeune fille portait alors cette écharpe bleue du portrait d’Hersent, et, le coude appuyé au rebord de la loge, en reproduisait involontairement la pose célèbre ; ses magnifiques cheveux blonds, noués sur le sommet de la tête en une large boucle selon la mode du temps, lui formaient une couronne de reine, et vaporeusement crépés, estompaient d’un brouillard d’or le contour de ses joues, dont nous ne saurions mieux comparer la teinte qu’à du marbre rose.
C’étaient de vifs transports parmi cette ardente jeunesse lorsqu’elle voyait se rapprocher ces belles mains pour applaudir son poète favori. L’admiration était, du reste, un des besoins de cette généreuse nature, qui volontiers se faisait thuriféraire du génie. Avec quelle grâce elle maniait l’encensoir d’or, sachant y mettre toujours le parfum préféré, et ne le cassant jamais sur le nez de l’idole ! Quel divin plaisir c’était d’être loué par elle ! Lamartine, Victor Hugo, Balzac le savent, et d’autres qui le méritaient moins sans doute.
Pendant quatre ou cinq ans nous ne la rencontrâmes plus ; il est vrai que nous menions alors une vie sauvage et truculente, dans cette impasse du Doyenné que le nouveau Louvre a fait disparaître, vêtu d’habits impossibles, les épaules inondées, comme par une crinière de lion, d’une chevelure plus que mérovingienne, et passant la nuit à écrire sur les arcades de la rue de Rivoli : – Vive Victor Hugo ! avec l’idée consolante de contrarier les bourgeois matineux.
Quand nous la revîmes, elle était madame Émile de Girardin. Émile venait de fonder la Presse, et, malgré notre jeunesse et notre romantisme, – ou plutôt pour ces deux motifs, – il nous avait investi du département des beaux-arts. Nous débutâmes par un article sur les peintures murales de la salle du Trône, à la Chambre des députés, d’Eugène Delacroix. Un dîner, qui réunissait la rédaction, au petit hôtel de la rue Saint-Georges, situé presque en face de la maison qu’occupait la Presse, nous mit pour la première fois en relation avec madame Émile de Girardin. L’amitié que Victor Hugo daignait témoigner à son plus fanatique séide nous fit accueillir avec indulgence, malgré nos airs de rapin, dans cet élégant salon ; et les rapports créés par le journal nous servirent de prétexte pour des visites rares d’abord, plus fréquentes ensuite, et presque quotidiennes plus tard.
Nos souvenirs sont peu nombreux sur cette période ; nous n’avions pas encore nos grandes et nos petites entrées auprès de cette reine, et nous restions perdu parmi la foule des courtisans : mais à dater de la rue Laffitte, où M. E. de Girardin, s’étant défait de l’hôtel à cour circulaire de la rue Saint-Georges, alla demeurer, nous eûmes ce bonheur d’être admis dans la familiarité de ce charmant esprit et de ce grand cœur.
Madame de Girardin était alors dans tout l’éclat de sa beauté ; ce que ses traits magnifiques avaient pu avoir de trop arrêté, de trop découpé dans le marbre pour une jeune fille, seyait admirablement à la femme et s’harmoniait avec sa taille élevée et ses proportions de statue. Le col, les épaules, les bras et ce que laissait voir de poitrine la robe de velours noir, sa parure favorite aux soirées de réception, étaient d’une perfection que le temps ne put altérer ; elle a parlé quelquefois dans ses poésies de jeunesse « du bonheur d’être belle » en personne pleine de son sujet ; et elle dit de ses splendides cheveux dont les poètes contemporains eussent fait volontiers un astre, comme de la chevelure de Bérénice :
Ce n’était pas coquetterie chez elle, mais pur sentiment d’harmonie ; sa belle âme était heureuse d’habiter un beau corps.
Tout l’appartement était tendu d’un damas de laine vert d’eau, dont le ton glauque comme celui d’une grotte de néréide ne pouvait être supporté que par un teint de blonde irréprochable ; elle avait choisi cette nuance sans méchanceté, mais les brunes égarées dans cette caverne verte y paraissaient jaunes comme des coings, ou enluminées comme des furies.
Elle recevait ses amis dans sa chambre à coucher ; – que la pudeur anglaise ne s’effarouche pas et ne crie pas à l’impropriété ! – nous avons été bien longtemps à deviner le lit sous le pli de son rideau. Là, après l’Opéra et les Bouffes, ou bien avant d’aller dans le monde, entre onze heures et minuit, venaient Lamartine, Victor Hugo, Balzac, Lautour-Mezeray, Eugène Sue, Alphonse Karr, Cabarrus, Chasseriau, non pas tous à la fois, mais quelques-uns, chaque soir, assurément : Alfred de Musset y paraissait aussi de loin en loin. – Madame Émile de Girardin était extrêmement fière de ses amis : c’était sa coquetterie, son élégance, son luxe. Elle trouvait avec raison que nulle fête avec dix mille bougies, une forêt de Camélias et les bluettes de tous les diamants de Golconde, ne valait ces trois ou quatre fauteuils ainsi remplis autour de son foyer.
Si dans quelque salon, – ce qui n’était pas rare alors, – l’on attaquait l’un de nous, avec quelle éloquente colère elle nous défendait ! Quelles reparties acérées, quels sarcasmes incisifs ! À ces occasions sa beauté flamboyait et s’illuminait d’une splendeur divine ; elle était superbe : l’on eût dit Apollon s’apprêtant à écorcher Marsyas ! Comme ses fureurs avaient toujours les motifs les plus nobles, quelque outrage au génie, quelque plate défection, quelque calomnie bête qui révoltaient sa nature chevaleresque et loyale, elles ne la défiguraient pas, elles la transfiguraient. – Nous l’avons vue plusieurs fois dans ces belles et saintes colères : – jamais peintre n’a rêvé une tête plus sublime. Autrement elle était douce, bon garçon (le mot est de Lamartine) et gaie. Malgré les ovations de sa jeunesse, ses vers récités au Capitole, son nom tiré d’un roman de madame de Staël, son admiration pour Alexandre Soumet, et le souvenir d’un temps dont l’idéal avait été « Corinne improvisant au cap Misène, » elle ne posait en aucune façon ; et son beau bras, en pendant le long de son fauteuil, ne semblait pas chercher une lyre d’ivoire. Chez elle, l’esprit avait corrigé bien vite ce que la première éducation aurait pu donner de ridicule à une nature moins bien douée. – Nous sommes trop loin de cette époque pour assigner aujourd’hui leur valeur réelle aux vers que Delphine publia de 1822 à 1828 : le Dévouement des médecins français et des sœurs de Sainte-Camille dans la peste de Barcelone, les Essais poétiques, Ourika, l’Hymne à sainte Geneviève, la Quête, la Vision, les Nouveaux essais poétiques, les vers sur la mort du général Foy, le Retour, le Dernier jour de Pompéi, obtinrent beaucoup de succès alors. La versification en est élégante et pure, racinienne, avec quelques hardiesses timides comme les risquait le romantisme encore à ses débuts. – Mais madame Émile de Girardin ne date pour nous que de Napoline, un poème qu’elle publia en 1855, après son mariage. – L’influence de Victor Hugo, et surtout d’Alfred de Musset, s’y fait sentir : la périphrase a disparu, la césure se déplace quand il le faut, la rime est plus riche, un grand progrès technique s’est opéré ; mais ce qui vaut mieux, la veine naturelle du poète s’y montre et ne tarira plus désormais. Nous sommes surpris que Napoline n’ait pas eu un plus grand retentissement ; il est vrai qu’alors avait lieu cette éclosion simultanée et magnifique de chefs-d’œuvre qui fera de notre siècle un des plus beaux siècles littéraires de la France, et, au milieu de ce bouquet, éclatant avec un fracas lumineux, cette bombe à pluie d’argent fut moins remarquée qu’elle ne le serait aujourd’hui dans notre ciel vide et noir.
Les premiers vers de ce poème, qui est un roman, et dont les chants sont des chapitres, contiennent un portrait qui ressemble au moins autant à madame Émile de Girardin qu’à l’amie qu’elle veut peindre.
Notez, s’il vous plaît, ce « femme comme il faut ; » elle était bien l’un et l’autre assurément, mais elle tenait plus encore au dernier hémistiche qu’au premier. Peut-être même, pour la perfection de son talent, eût-elle dû sortir plus souvent du salon. Elle vit trop la société, et pas assez la nature.
Pour nous, Napoline est une personnification de madame de Girardin, transposée dans des évènements imaginaires, mais très exacte et très fidèle. Nous y retrouvons même ce beau rire argenté de la jeunesse qui choqua Lamartine lorsqu’il rencontra Delphine avec sa mère au bord de la cascade de Terni.
Ce rire, madame Émile de Girardin l’avait gardé, et même longtemps après, lorsqu’elle ne riait plus, elle savait encore la faire naître : car cette belle femme, si majestueuse, si royale, qu’on abordait presque en tremblant, et dont le masque semblait moulé sur celui de la Melpomène antique, avait le sentiment du comique et du bouffe à un haut degré, ce qui ne l’empêchait pas d’avoir gardé un certain faible littéraire pour Oswald et les héros bien frisés dont elle se moquait elle-même, à l’occasion, plus spirituellement que personne.
Cette noble nature avait l’amour du beau, du bien, du vrai ; elle abhorrait le mensonge et la lâcheté. – En face de l’un ou de l’autre, elle manquait absolument de cette facile indulgence du monde ; et quand elle trépignait sur une pensée basse, elle avait des attitudes d’archange irrité foulant la croupe tortueuse du diable ; et pourtant qu’elle était bonne et facile aux erreurs, aux égarements, aux fautes même qui pouvaient donner la passion pour excuse ! comme elle savait distraire une douleur parfois méritée, en jouant autour du cœur avec sa vive et tendre causerie ! Que souvent elle nous a consolé dans nos défaillances d’artiste, dans nos découragements de poète par un de ces mots sentis, par un de ces éloges qui relèvent ! Que d’heures pesantes elle nous a rendues légères ! Que de fois nous sommes sorti joyeux après être entré chez elle abattu et triste ! Vous doutiez de votre esprit, elle vous renvoyait spirituel ; vous vous croyiez épuisé, tari, sans idée, elle vous en faisait naître mille.
Nous ne parlerons pas du Lorgnon, des Contes d’une vieille fille à ses Neveux, de Monsieur le marquis de Pontanges, de la Canne de M. de Balzac. Tout le monde les a lus : on y trouve ce mélange de sensibilité romanesque et d’observation ironique qui distingue, à dater de cette période, le talent de madame Émile de Girardin. Dans ces romans et ces nouvelles, le monde est peint par quelqu’un qui l’a vu et qui en est ; chose assez rare parmi les auteurs de profession, que leurs études en tiennent ordinairement à l’écart. Cette fois, ce n’est pas le salon jugé du fond d’un cabinet. La prose de madame de Girardin est nette, vive, acérée, claire, malgré quelques recherches ingénieuses, d’une texture excellente, d’une originalité où personne n’a rien à réclamer si parfois ses vers reflètent ses admirations du moment.
Vers 1856, madame de Girardin, sous le transparent pseudonyme du vicomte de Launay, commença ce fameux Courrier de Paris qui fit naître depuis tant d’imitations plus ou moins malheureuses. Elle le poursuivit jusqu’en 1848 avec une verve toujours soutenue, une finesse d’observation toute féminine, un bon sens tout viril. Que de pages charmantes qui resteront parmi les meilleures de la langue, que de détails en apparence frivoles, et déjà presque historiques ! Quelle mine inépuisable pour les romanciers de l’avenir, lorsqu’ils voudront peindre cette époque ! Elle est là, en effet, tout entière, semaine par semaine, avec ses mœurs, ses modes, ses ridicules, ses tics, ses façons de parler, ses engouements, ses folies, ses fêtes, ses bals, ses soirées intimes, ses commérages, jugée par cet élégant vicomte dont la badine cingle si bien et qui semble posséder le lorgnon magique d’Edgar de Lorville, tant il devine aisément la pensée vraie à travers les babillages menteurs.
Ces Lettres parisiennes, écrites au courant de la plume, éparpillées aux quatre vents de la publicité, sont peut-être l’œuvre la plus sérieuse de l’auteur, et c’est là que vont de préférence le chercher ceux qui l’aiment.
L’École des journalistes, comédie en cinq actes et en vers, fut le premier essai de madame de Girardin pour le théâtre ; reçue à l’unanimité au Théâtre-Français, la pièce fut arrêtée par la censure, mais pour que la leçon allât à son adresse, madame de Girardin fit une lecture de sa comédie – dans son salon encombré de journalistes qui n’ont peut-être pas trop profilé à cette école, mais qui étaient assez spirituels pour rire sous les verges tenues par de si belles mains : – le premier acte étincelle de traits et de mots et démontre une grande puissance comique ; la fin tourne au drame, et la pièce, commencée d’une manière éclatante, s’assombrit trop. Balzac, qui n’aimait pas beaucoup les journalistes, assistait à cette soirée et riait de son gros rire pantagruélique : il n’avait plus la fameuse massue à pommeau de turquoises sur laquelle la maîtresse du logis avait fait un roman, mais il portait encore ce bel habit bleu à boutons d’or ciselés non moins célèbre, qu’il allait prendre et remettre chez Chevreul pour ces occasions solennelles.
Nous doutons que la pièce au théâtre, même jouée par les plus excellents acteurs, eût produit autant d’effet. Madame Émile de Girardin lisait admirablement. Nous lui avons entendu dire des morceaux de Cléopâtre d’une façon que mademoiselle Rachel n’a pas égalée, à notre avis, malgré tout son art, toute sa puissance et tout son prestige.
Puis vinrent Judith, la meurtrière biblique, et Cléopâtre « le serpent du Nil, » comme l’appelle Shakspeare. Mademoiselle Rachel servit d’interprète à ces deux créations. Judith réussit faiblement, malgré des vers très purs et une idée ingénieuse, – celle d’avoir supposé à l’héroïne juive un vague amour pour le général assyrien qu’elle a mission d’assassiner ; – l’heure de la tragédie n’était pas encore venue. Cléopâtre, traitée à la fois d’une façon plus antique et plus moderne, tragédie et drame, obtint beaucoup de succès et restera le meilleur poème scénique écrit par une femme. L’apostrophe au soleil est dans toutes les mémoires.
Dans Lady Tartuffe, madame Émile de Girardin, fidèle jusque-là au vers, le quitta pour la prose, toujours mieux acceptée d’un public de moins en moins littéraire, et qui n’entend plus que difficilement le langage des dieux. Mademoiselle Rachel représentait ce Tartuffe en jupons si haïssable et si charmant qu’on lui pardonne lorsque son masque tombe, et qu’entrouvrant le noir domino de l’Hypocrisie, la femme laisse voir son corsage étincelant et rose.
Mais le triomphe de madame Émile de Girardin a été La Joie fait peur, cette comédie poignante qui vous tient haletant de la première scène à la dernière, et qui a fait verser des larmes à remplir toutes les fioles lacrymatoires des tombeaux antiques.
Nous avons déjà dit que madame de Girardin avait le génie bouffe au même degré que le génie tragique. Le long éclat de rire, du Chapeau de l’horloger, après le long sanglot de la Joie fait peur en est la première preuve.
Marguerite, ou les Deux amours, roman, Il ne faut pasjouer avec la douleur, nouvelle, se placent entre Lady Tartuffe et la Joie fait peur, de 1855 à 1854. Ce sont deux petits chefs-d’œuvre. Madame de Girardin est donc morte dans toute la forte de son talent. Pour nous qui l’avons trouvée si supérieure à ses œuvres, nul doute qu’elle n’eût progressé encore. La confidence de ses projets nous permet de l’affirmer.
Après ce court examen littéraire, ajoutons quelques détails plus intimes. La rue Laffitte avait été abandonnée pour la rue Chaillot, et ce bel hôtel bâti par M. de Choiseul, à son retour de la Grèce, sur le modèle de l’Érecthéum. Le jardin était beaucoup plus vaste alors qu’il ne l’est aujourd’hui, et à la place où grésillé maintenant cette petite fontaine dont parle M. de Lamartine, les quatre cariatides du Pandrosion, exactement copiées, soutenaient l’entablement d’un petit temple auquel ne manquait que l’olivier sacré ; des marronniers touffus voilaient à demi la façade du côté des Champs-Élysées. Une salle à manger, un grand salon et un salon plus petit composaient le rez-de-chaussée. C’est dans le petit salon que se tenait habituellement madame Émile de Girardin ; elle travaillait là, à demi entourée d’un grand paravent chinois où, sur un fond noir, voltigeaient des oiseaux bizarres à travers des bambous et des plantes exotiques, se laissant facilement distraire à l’attrait de quelque visite amicale ; elle était chez elle toujours vêtue d’un peignoir blanc, très large, dont nulle ceinture ne marquait la taille, et quand elle écrivait, elle ne pouvait souffrir ni peigne ni lien dans les cheveux, qu’elle laissait flotter en larges nappes sur ses épaules. Jamais ouvrier littéraire n’eut moins d’outils ; un pupitre en marqueterie posé sur une petite table lui servait de bureau ; et la plume de fer dont elle écrivait ses billets du matin courait vive et nerveuse sur un papier transversal : de même que Balzac, elle se vantait d’être très propre dans son ouvrage, et comme elle justifiait le vers du Dante
on pouvait voir aisément que jamais goutte d’encre n’avait taché sa blancheur d’hermine.
En dépit de son esprit viril, madame de Girardin était femme, et très femme ; elle eût monté à l’échafaud sans pâlir, comme madame Roland ; mais elle se mourait de peur en voiture et n’osait traverser le boulevard. Nous l’avons vue haranguer, avec un sang-froid et une éloquence admirables, des émeutiers qui, en 1849, venaient crier autour de l’hôtel ; et une chauve-souris, entrée par la fenêtre, qui voletait contre le plafond, la faisait presque évanouir.
Dans les dernières années de sa vie, sa beauté avait pris un caractère de grandeur et de mélancolie singulier. – Ses traits idéalisés, sa pâleur transparente, la molle langueur de ses poses ne trahissaient pas les ravages sourds d’une maladie mortelle. À demi couchée sur un divan et les pieds couverts d’une résille de laine blanche et rouge, elle avait plutôt l’air d’être convalescente que malade. – George Sand, qu’elle admirait sans aucune arrière-pensée, la vit souvent vers cette époque, et tandis que George fumait silencieusement sa cigarette, immobile et rêveur comme un sphinx, Delphine, oubliant ou cachant sa souffrance, savait encore lui adresser quelques flatteries ingénieuses, quelque mot charmant, plein de cœur et d’esprit.
Quoiqu’elle fût tendrement dévouée à son mari, dont elle avait épousé les luttes, que la gloire, le succès, la fortune, tout ce qui peut faire aimer la vie, lui fussent arrivés à souhait, que des amis fidèles et sûrs l’entourassent, elle semblait secrètement désirer d’en finir. Ce temps ne lui plaisait plus ; elle trouvait que le niveau des âmes s’abaissait, et déjà elle cherchait à pressentir l’autre monde, en causant avec les esprits qui habitent les tables : comme Leopardi, le poète italien, auquel de Musset, descendu hier dans la tombe, a adressé de si beaux vers, elle semblait rêver « de charme de la mort. » Quand l’ange funèbre est venu la prendre, elle l’attendait depuis longtemps.
THÉOPHILE GAUTIER.
28 septembre 1836.
Évènements du jour. – Paris provincial. – L’Ennuyeux et l’Ennuyé. – Esméralda. – Thémistocle et Scipion l’Africain dénoncés au commandant de la garde nationale.
Il n’est rien arrivé de bien extraordinaire cette semaine : une révolution en Portugal, une apparition de république en Espagne, une nomination de ministres à Paris, une baisse considérable à la Bourse, un ballet nouveau à l’Opéra, et deux capotes de salin blanc aux Tuileries.
La révolution de Portugal était prévue, la quasi-république était depuis longtemps prédite, le ministère d’avance était jugé, la baisse était exploitée, le ballet nouveau était affiché depuis trois semaines ; il n’y a donc de vraiment remarquable que les capotes de satin blanc, parce qu’elles sont prématurées ; le temps ne méritait pas cette injure. Qu’on fasse du feu au mois de septembre quand il fait froid, bien, cela est raisonnable ; mais que l’on commence à porter du satin avant l’hiver, cela n’est pas dans la nature.
Les spectacles et les promenades, voilà ce qui occupe la capitale en ce moment. Dieu merci, les courses sont terminées ; la dernière n’était point brillante : toujours les mêmes femmes, toujours les mêmes chevaux ; et puis toujours ce même et ennuyeux incident, ce cheval forcé de courir tout seul ; et l’on vous condamne à regarder niaisement ce lutteur sans adversaire, ce triomphateur sans rival. Depuis longtemps le solo équestre nous a paru la plus ingénieuse des mystifications. Bref, tout cela était médiocre et faisait dire aux mauvais plaisants que cette pauvre Société d’encouragement était toute découragée.
On prétend que Paris est ennuyeux ; il nous semble au contraire fort agréable à habiter en ce moment : on n’y connaît personne, c’est la province qui le peuple. On s’y trouve comme en voyage pour l’indépendance, et l’on y est à l’aise en sa demeure pour toutes les nonchalances de la vie. Quand on étudie Paris dans cette saison, on l’aime, car on n’y rencontre que des personnes qui l’admirent ; c’est une population de badauds émus qui fait plaisir à regarder : badauds d’outre-mer, badauds d’outre-monts, badauds d’outre-Rhin, excepté pourtant badauds d’outre-tombe, comme dirait M. le vicomte de Chateaubriand, et encore ne jurerions-nous pas que, dans le nombre, il ne se soit glissé quelqu’un de ces derniers.
Enfin Paris se renouvelle pour quelque temps ; le monde y est plus bienveillant ; les gens blasés en sont partis, les ennuyés l’ont déserté. L’air semble plus léger, l’espace est plus libre. Un ENNUYÉ prend tant de place ! sa présence rend l’atmosphère si pesante ! il absorbe tant d’air vital quand il soupire et quand il bâille ! Maintenant l’ENNUYÉ est absent, il chasse avec l’ENNUYEUX, qui lui raconte son gibier, et tous deux médisent de Paris, que leur absence rend aimable. Comme ils ont de la vanité, ils envoient leur gibier à Paris, et ils restent à la campagne tous les deux, l’ENNUYÉ et l’ENNUYEUX.– Oh ! l’automne est une belle saison pour Paris ! – Les théâtres renaissent, le public rajeunit ; ce n’est plus ce parterre usé et jugeur de l’hiver, ce public hostile, ce tyran jaloux de ceux qu’il paye pour l’amuser, que tout scandalise, et que rien n’enflamme ; ce public saturé de plaisir, grandi dans les corridors de théâtre ; ce vieux bellâtre de foyer, qui n’ose sourire parce qu’il n’a plus de dents ; cette vieille coquette de galeries, qui ne veut point pleurer, de peur de sillonner son rouge. – C’est un public naïf, joyeux et dispos, à la fois juge et complice, qui vous aide franchement à le faire rire, qui vous entraîne à l’émouvoir ; un public bon enfant, qui ne se formalise pas de ce qu’on l’amuse ; un public enfin qui croit au plaisir.
Aussi l’on se dépêche de lui offrir toutes les nouveautés de l’année, comme un plaideur se hâte de faire venir sa cause quand le président du tribunal est son ami.
L’Opéra presse les répétitions de l’ouvrage de M. Vicier Hugo et de mademoiselle Berlin.
Plusieurs morceaux de la musique sont déjà cités avec éloge. Les uns disent : Vraiment, c’est fort beau ! – Et l’on répond : Je le crois, c’est de Berlioz. – Les autres s’écrient : La musique est admirable ! – On leur répond : Sans doute, elle est de Rossini.
À quoi nous répliquons cela :
Si la musique est mauvaise, elle est de M. Berlioz ; si elle est lionne, elle est de Rossini. Si elle est admirable, comme on le dit, elle sera de mademoiselle Bertin.
Et voici comment nous nous expliquerions :
Si M. Berlioz a fait la musique d’Esméralda, comme il n’entre pour lui aucun espoir de vanité dans ce travail, il l’aura fait avec négligence ; et toutes les belles idées qu’il a, il les aura gardées pour lui.
Si la musique est de Rossini, elle sera bonne, parce que les négligences de Rossini sont encore des beautés.
Enfin, si la musique est admirable, elle est de mademoiselle Bertin elle-même, en dépit de tous les teinturiers qu’on lui prête ; car nous ne connaissons pas un seul auteur assez fou pour donner sottement ses chefs-d’œuvre aux autres.
Les riches d’esprit ne sont pas plus généreux que les riches d’argent, et quelle que soit la puissance d’un journal, nous ne croyons pas qu’elle aille jamais jusqu’à obtenir d’un grand compositeur l’aumône de son génie.
En fait de nouveautés, le Théâtre-Français nous a offert Tartufe et les Jeux de l’Amour et du Hasard, joués par mademoiselle Mars. Eh bien, il y avait beaucoup de monde. Ô bon public de septembre, je te reconnais là ! – Une douce voix peut encore te séduire, parce que tu ne l’as pas trop entendue la veille.
Les œuvres littéraires n’offrent rien de nouveau ; il y a disette dans les cabinets de lecture. George Sand se repose de ses procès ; M. de Lamartine préside le conseil général de son département. Muses, pardonnez-lui ! Jules Janin s’en est allé paisiblement à la campagne ; semblable à saint Louis, il rend la justice assis au pied d’un chêne : c’est de là qu’il juge les pièces nouvelles qu’on représente à Paris, au Gymnase, à l’Ambigu, au Vaudeville. Là, ses arrêts ne sont influencés par rien, pas même par la présence de ceux qu’il condamne, et ses feuilletons n’en sont ni moins justes, ni moins piquants. Que l’on dise, après cela, que cet homme manque d’imagination ! Alfred de Musset fume et se promène ; Hyacinthe de Lalouche cherche l’ombre des bois ; tous les esprits sont en vacances. Quant à nos élégants, les jours où il pleut, ils s’amusent à parier, à jouer. L’un d’eux a, dit-on, gagné cent cinquante mille francs la semaine dernière. Pauvre jeune homme !
Le monde élégant n’est pas encore organisé pour les plaisirs. Les ambassadrices ne sont encore revenues que pour leurs amis. Quelques maîtresses de maison influentes sont déjà de retour, mais chez elles point de grandes réunions. Les rideaux des grands salons ne sont pas encore posés, les lustres sont toujours voilés, la housse mélancolique cache toujours les fauteuils d’or ; le papillon est encore dans sa chrysalide ; mais patience, voici venir les fêtes, la fatigue et l’ennui. Les causeries intimes sont nos seuls plaisirs de salon. Des récits de voyages, des questions empressées, des réponses distraites, sont les seuls aliments de la conversation. – Madame une telle est-elle de retour ? – Oui, elle est arrivée hier, je l’ai vue ; elle est noircie, elle est affreuse. – Et sa sœur ? – Sa sœur est toujours jolie ; cependant elle est engraissée ; cela ne lui sied pas. – Je voulais, en revenant de Nisbaden, m’arrêter à B… citez Clémentine ; mais je n’ai pas pu, j’étais en retard. – Ne le regrettez pas, elle est à Paris. – Déjà ? mais elle n’y revient jamais avant le mois de janvier. – Cette année, elle prétend qu’elle est malade et vient consulter toute la Faculté de Paris. Si vous la voyiez, vous ne le croiriez pas ; elle est fraîche et jolie comme un ange ; elle se dit mourante pour revenir deux mois plus tôt, c’est ingénieux.
Voilà à peu près ce qu’on se dit, ce qui est assez insignifiant ; puis l’on se montre les robes, les niaiseries qu’on a rapportées de ses voyages ; on s’invente quelque aventure pendant la route ; on a toujours été à deux doigts d’un précipice quelconque ; on parle des gens aimables qu’on a rencontrés aux eaux, en France ou en Allemagne ; de Charles X, à qui l’on est allé rendre hommage en passant, que l’on a trouvé rajeuni ; de M. le duc de Bordeaux, qui se porte à merveille et qui embellit tous les ans. Remarquez bien ceci, les voyageuses seules sont de retour, les châtelaines sont immobiles, il n’est point question d’elles maintenant. On parle aussi des livres qui ont paru cet été ; les lecteurs en retard se font prêter toute une bibliothèque de romans nouveaux. On babille ainsi toute la soirée, ou bien l’on chante quelques romances, la Fuite, par madame Duchambge ; le Rêve, par mademoiselle Puget ; on joue au whist ou au reversi, puis à minuit on se sépare : c’est la vie du château à Paris.
Excepté les boulevards, que les provinciaux envahissent, les promenades publiques sont presque aussi inanimées que les salons ; l’aspect des Tuileries est triste ; les fleurs sont à demi cachées par les feuilles qui tombent : les femmes y sont laides et parées ; elles ont froid et ne veulent pas en convenir. Beaucoup d’Anglaises avec des chapeaux à trois ruches de tulle, tulle fané et languissant, tulle voyageur et plein de souvenirs, qui pleure encore le brouillard de la Tamise, qu’attriste encore le charbon de la cité ; ornement inutile qui forme autour du visage une neige grise qui n’est pas avantageuse. Ces Anglaises sont des Anglaises du troisième ordre, qu’un bateau à vapeur à bas prix transvase par flots sur le continent ; ce n’est pas encore la saison des jolies Anglaises au teint rose, aux cheveux flottants, qui viennent apprendre à nos femmes élégantes à être fraîches et jolies, et qui changent la rue de la Paix en une allée de Hyde-Park. Ô belles filles du Nord ! dans un mois vous reviendrez, n’est-ce pas, remplacer vos indignes compatriotes ? vous avez des choses bien étranges à nous faire oublier. Les Anglais admirent beaucoup les statues des Tuileries ; mais, comme nous, ils s’étonnent du peu de soin qu’on prend pour les entretenir ; en effet, il nous semble qu’avec peu de frais on pourrait les empêcher de se noircir. Le roi, qui emploie, dit-on, tant d’argent à faire mutiler ses orangers, pourrait bien en consacrer la moitié à faire débarbouiller ses dieux. Phaétuse est déjà si noire, qu’on ne sait si elle est changée en négresse ou en peuplier ; Vénus a beau se laver les pieds depuis trente ou quarante ans, il n’y paraît pas ; quant à Thémistocle, vainqueur de Salamine, et à Scipion l’Africain, vainqueur de Zama, nous les dénonçons à M. le maréchal commandant de la garde nationale ; leurs buffleteries sont dans le plus mauvais état. Du reste, le jardin des Tuileries a toujours des cygnes blancs et des poissons rouges dans ses bassins, des enfants et des cerceaux dans toutes ses allées ; l’horloge du château est toujours fort exacte et son drapeau est toujours tricolore ; ceci n’est qu’un détail, mais il ne manque pas d’importance dans les circonstances où nous nous trouvons.
19 octobre 1835.
Les déménagements d’automne. – Marie. – Portrait de M. Vatout.
Les grands évènements de la semaine sont les déménagements ; ce qu’on a transporté depuis quelques jours de pendules, de pianos, de lits et de commodes, est inimaginable : Paris est un magasin de meubles ambulant ; les habitants de la Chaussée-d’Antin semblent fuir vers le Marais, les hôtes du Marais semblent descendre dans la Chaussée-d’Antin. C’est un immense chassé-croisé. On ne peut faire un pas sans être arrêté par une voiture de déménagement ; on ne peut traverser une rue sans rencontrer un secrétaire et une commode, ou bien un canapé renversé, garni de toutes ses chaises ; chaises menaçantes suspendues merveilleusement dans les airs. Vous tournez une rue… et vous vous trouvez nez à nez avec un buste de grand homme, qui marche à reculons ; à droite, s’avance un piano avec son tabouret, sa lyre et ses pédales démontées ; à gauche, paraît un guéridon qui semble demander pourquoi son marbre, ne l’a pas suivi. Le croira-t-on ? hier nous avons surpris un innocent jeune homme rajustant sa cravate de-devant une grande et belle glace qui marchait à pas mesurés devant lui ; cette toilette ambulante nous a fait rire. Les commissionnaires doivent être bien fatigués ce mois-ci : le mois d’octobre est un bon mois pour eux. 15 octobre, jour affreux ! est-il un jour plus triste que celui d’un déménagement ? – Oui, la veille ! – Car il n’est rien de plus amer que cette pensée : Demain, à cette heure-ci, il y aura indubitablement quelque chose de cassé dans tout cela. Alors, admirant une coupe élégante, vous lui dites : Peut-être ce sera toi ! Puis, examinant quelques vieux fauteuils fanés et mal rajustés, votre cœur leur crie avec pitié : Pauvres amis, à votre âge, il est cruel de se déranger ! Le mari s’endort en songeant qu’il lui faudra remplacer bien des choses dans son mobilier ; la femme s’endort en se rappelant tous les chagrins qu’elle a éprouvés depuis six ans dans cet appartement qu’elle quitte. Peut-être se dit-elle : Serai-je plus heureuse dans l’autre ? Va, déménage, pauvre femme ! fais tous les quartiers de Paris, tes chagrins te suivront avec tes meubles, ton argenterie, ta batterie de cuisine ; un malheur de six ans n’est pas dans les évènements, il est dans les caractères, et ton mari et toi vous aurez le même caractère dans tous les pays, dans toutes les rues et dans tous les appartements. Cependant il est des chagrins de localités que nous devons reconnaître. Un appartement mal distribué peut amener de graves ennuis : deux chambres qui se commandent peuvent susciter les plus violentes querelles ; nous ne répondrions pas de l’avenir d’une femme qui ne pourrait faire de feu dans sa chambre à coucher. Une salle à manger trop petite peut ruiner un homme d’affaires ; un salon trop vaste peut conduire un honnête rentier à l’hôpital. Nous connaissons de nouveaux mariés qui nous ont avoué sérieusement qu’ils ne désiraient point d’enfants, parce que leur appartement était trop petit. Nous dénonçons ces inconvénients aux personnes qui déménagent, afin qu’elles évitent dans tous ces ennuis celui qu’elles redoutent le plus.
Le monde fashionable revient ; cela est incontestable : les théâtres et les boulevards, depuis huit jours, ont changé d’aspect. Les rues de Paris sont redevenues parisiennes. On n’y rencontre plus ces figures étranges, ces parures bigarrées dont l’inharmonie irritait le regard. Ce sont de jolis visages qu’on aime à reconnaître, d’élégantes beautés qu’on se plaît à nommer à voix basse, et dont on est fier d’être salué. – Ah ! vous connaissez madame de X… ? dit votre voisin envieux. – Oui, je l’ai rencontrée, il y a trois mois, aux eaux de Néris. – Et, malgré soi, on prend un air plus gracieux, on se tient plus droit, on se grandit de quatre lignes. Si peu de vanité qu’on ait, on se sent glorieux, il est toujours flatteur d’être salué par une jolie femme. C’est un plaisir dont plus d’un élégant a pu jouir l’autre soir à la Comédie-Française. La dernière représentation de Marie était brillante de retours. De belles voyageuses y faisaient aussi leur rentrée ; l’enthousiasme et l’émotion les embellissaient, elles prenaient pour elles toutes les vertus de Marie ; les jeunes femmes croyaient, de bonne foi, être généreuses et dévouées comme madame Forestier ; les autres se trouvaient encore jeunes et jolies comme mademoiselle Mars. Il y avait des illusions pour tout le monde. Le grand succès qu’obtient chaque jour l’ouvrage de madame Ancelot nous confirme plus que jamais dans cette remarque que nous avons faite depuis longtemps, que le public français est de tous les rois celui qui exige le plus qu’on le flatte, et que le peintre le plus habile est celui qui fait de lui le portrait le moins ressemblant. Le public français a horreur du vrai. Ce qui le séduit, ce sont les monstruosités en tous genres, monstruosités vertueuses, monstruosités criminelles. Il ne veut point qu’on lui dépeigne les gens tels qu’ils sont dans la vie, versatiles et inconséquents. Non, il lui faut des êtres parfaits en bien ou en mal : un notaire qui est un ange pendant cinq actes, un duc qui est un démon pendant le même espace de temps, cela seul fait le succès de la Duchesse de la Vaubalière ; et quand au cinquième acte le notaire recommence ce qu’il a fait pendant les quatre premiers actes, le parterre trépigne d’admiration : C’est bien lui, dit-il, c’est bien le même ; il a fait cela, il a dit cela tout à l’heure ; c’est toujours la même chose ; vertueux notaire, je te reconnais ; parfait notaire, c’est bien toi ! Bravo ! – Car, pour le parterre, la vérité dramatique, c’est une donnée fausse qu’on lui fait accepter au premier acte et que l’on traîne jusqu’à la fin. Ainsi en est-il de la comédie de madame Ancelot. Non pas que nous voulions faire entendre que le charmant caractère de Marie, soit un mensonge ; nous savons, au contraire, que la vie de plus d’une femme n’a été qu’un long et pur sacrifice ; mais nous disons que la peinture de cette vertu sublime n’est pas une vérité absolue, c’est une vérité d’exception : vérité immorale, en ce qu’elle est trompeuse ; vérité fatale, en ce qu’elle dégoûte de l’autre ; vérité stérile, en ce qu’elle livre notre âme à des rêves impuissants, à des recherches inutiles ; vérité coupable, en ce qu’elle nous rend ingrats envers des êtres quasi vertueux qui nous entourent, et que nous dédaignons pour les héros imaginaires qu’elle nous a promis ; vérité servile et flatteuse, et par cela même la seule vérité reçue au théâtre, la seule que le public veuille reconnaître. Aussi entendez-vous tous les journaux vertueux s’écrier : Voilà la bonne, la vraie comédie ; ce n’est plus le crime échevelé, la femme coupable et misérable des drames de l’école moderne : c’est le monde tel qu’il est. Entendez-vous tous les bons maris se réjouir, en voyant madame Forestier sacrifier l’amour de d’Arbelle au bonheur de son époux, et s’écrier avec confiance : C’est bien cela ! sans faire attention aux différents d’Arbelle qui sont dans leur loge, – et les susdits d’Arbelle eux-mêmes, en voyant qu’on ose inventer un homme fidèle à la même femme pendant dix-sept ans, répéter sur le même ton : C’est bien cela !… Ô comédie ! ô comédie ! La bonne comédie, la voilà !… Elle est dans la salle quand il se donne un drame vertueux. Ah ! madame Ancelot est une femme d’esprit, nous le savions déjà, mais elle l’a prouvé dans son œuvre : c’est la femme de France qui sait le mieux ce qu’il faut dire pour plaire et pour flatter. Elle a traité le public comme ses amis. Elle est bien trop habile pour lui dire ce qu’elle sait : elle veut réussir ; elle connaît trop bien le monde pour le peindre comme elle le voit.
Oui, pauvre vieux public ! il te faut des Néron et des Agrippine, parce que tu ne crains pas les applications, ou bien des notaires héroïques ou des épouses magnanimes, parce que tu te fais à toi-même de douces et caressantes allusions. Molière, sous Louis XIV, n’aurait rien osé te dire ; il a fallu un roi plus puissant que toi pour te faire entendre la vraie vérité ; tu n’aimes que les fictions, et l’on te sert selon tes vœux ; le miroir qui réfléchirait tes traits te ferait horreur, la voix qui t’appellerait par ton nom véritable te ferait fuir ; tu maudirais le génie qui t’apprendrait ce que tu es ; tu le traiterais en ennemi, et tu aurais raison : se connaître, cela est triste.
Ce qui plaît dans tout ceci, c’est que les mères de famille vont se hâter de mener leurs filles voir Marie, et que dans un mois toutes les jeunes filles de Paris auront dans l’âme cette conviction : que leurs petits cousins ou voisins, Charles, Ernest et Alfred, les aimeront pendant dix-sept ans, quels que soient les évènements ; mais vous rirez bien, vous, Charles, Ernest et Alfred, en répétant : Le théâtre est le miroir des mœurs.
Cependant les femmes sont en train de sacrifices. Au spectacle, elles portent presque toutes des bonnets pour laisser mieux voir la scène aux hommes placés derrière, elles. Cela est généreux ; car, de loin, un bonnet sied moins qu’un chapeau. Nous n’avons rien à dire contre les bonnets ornés de fleurs, c’est une coiffure élégante ; mais nous attaquons impitoyablement les bonnets à rubans. Dans un salon, sans doute, ils ont de la coquetterie ; mais, de loin, ils ont l’air de bonnets du matin. Au spectacle, une femme qui porte une douillette de soie brune et un bonnet de tulle à ruban rose a l’air d’une ouvreuse de loges égarée illégalement dans la salle ; on est en droit de lui demander un petit banc. De loin, tous les bonnets se ressemblent ; on ne peut savoir si le tulle est de soie ou de coton, du matin ou du soir ; il n’y a que les fleurs qui puissent donner de l’élégance à un bonnet lointain. Car enfin, qu’est-ce qu’un bonnet sans fleurs ? une perruque de dentelle, et voilà tout. Or, sans préjugé, la perruque est une chose qu’en général il faut éviter.
La mode, la semaine dernière, était de porter ses vieilles robes et ses chapeaux fanés ; cette mode a passé comme les autres : on s’occupe de la remplacer.
Nous avons attaqué le faux vrai du théâtre, nous ferons apprécier aussi la véracité des journaux. Il y a quelques jours, un des plus francs moqueurs entre les journalistes, spirituel et barbare s’il en fut, rencontra chez un jeune député de ses amis M. Vatout, qu’il avait longtemps poursuivi de ses épigrammes, mais qu’il ne connaissait point. La conversation était fort animée ; les questions étaient fort importantes, et chacun, par la sympathie des idées, se trouvait entraîné à dire sa pensée avec une franchise dont il était surpris. C’était une de ces conversations où les hommes se jugent, tant par ce qu’ils osent dire que par ce qu’ils ne disent pas. Après une grande heure, M. Vatout se retira. À peine avait-il fermé la porte : – Voilà, ma foi, un homme qui me plaît ! s’écria le journaliste ; toutes ses idées sont les miennes. C’est un homme d’esprit. Comment l’appelez-vous ! – C’est M. Vatout. – Quoi ! c’est là Vatout sur qui j’ai dit tant de folies ! – Et le journaliste se mit à rire, et puis il ajouta finement : – Eh bien, ce n’est pas du tout comme cela que je me le serais figuré d’après le portrait… que j’ai fait de lui.
27 octobre 1836.
L’obélisque de Louqsor.
Vraiment, c’était un beau spectacle que cette place immense remplie de monde, que cette longue terrasse des Tuileries couverte de monde, que cette longue allée des Champs-Élysées, peuplée de monde aussi ; et toute cette foule silencieuse et immobile, deux cent mille personnes, dit-on, et point de tumulte et point de bruit ! car ce n’était ni un peuple, ni une foule, c’était un public, un parterre de deux cent mille personnes, parfaitement bien composé. Les rangs des loges, c’étaient les deux terrasses des Tuileries, les avant-scènes, c’était l’hôtel de la marine, et les magnifiques hôtels qui lui servent de pendants. La famille royale occupait le pavillon de l’hôtel de la marine, le balcon qui donne sur le jardin des Tuileries ; la loge du roi était tendue en bleu ; la belle galerie de l’hôtel était occupée par le corps diplomatique, et parée des plus jolies femmes de la cour de Juillet. La terrasse qui termine l’hôtel était aussi garnie des parents et des amis des femmes de chambre et du portier de la maison ; c’était l’amphithéâtre de la salle. À une fenêtre de la rue Royale, on apercevait la comtesse de Lipano, qui se cachait comme dans une loge grillée ; nous n’avons reconnu personne dans le paradis. La représentation a duré quatre heures. Dans les entractes, un orchestre militaire se faisait entendre. Puis, dans la foule immobile, on apercevait un cercle d’hommes qui tournaient. Le cabestan ! le cabestan ! disaient toutes les voix, et l’obélisque recommençait à s’élever doucement.
Le dernier entracte fut le plus long ; on entendit des coups de marteau, comme on en entend derrière la toile lorsqu’on place une décoration importante à l’opéra. Enfin la pièce a réussi. Elle a été vivement applaudie. Sérieusement tout le monde a battu des mains quand l’obélisque s’est assis sur sa base, et l’orchestre a joué le grand duo des Puritains ; c’était un bruit charmant à entendre que ces faibles applaudissements de deux cent mille personnes qui se perdaient dans l’immensité de la salle. Malgré ce brillant succès, les jeunes spectateurs à idées nouvelles parlaient toujours avec amertume des quatre millions de la mise en scène. Ils se demandaient si la vue du monolythe superbe valait cela. Les autres étaient plus indulgents, grâce à leurs souvenirs ; ils se rappelaient d’avoir vu, sur ce même théâtre, une représentation qui avait coûté plus cher à la France ; un drame sanglant et terrible dont l’image leur serrait le cœur. Il leur tardait que cet échafaud fût détruit, ils avouaient que depuis que cet appareil de machines attristait leurs yeux, ils ne pouvaient traverser la place Louis XV sans horreur ; et ils savaient bon gré à ce monument âgé de trois mille ans d’avoir quitté les sables de l’Égypte pour venir effacer leurs affreux souvenirs. La nouvelle du jour était que le roi n’avait point été assassiné, et l’on disait cela devant la femme de Murât, la veuve du roi fusillé, et tout cela se disait sur la place de la Révolution, où tomba la tête du roi guillotiné ; et songeant à cela, nous qui ne sommes d’aucun parti, nous avons fait comme le peuple, nous avons crié vive le roi ! car notre cœur est généreux, et nous avons pitié des trônes. La famille royale a été accueillie à son passage par les plus vives acclamations. Les princesses étaient dans le fond de la voiture, le roi des Français, le roi des Belges étaient sur le devant. M. le duc d’Orléans était entre eux deux ; il était assis de manière à laisser plus de place aux deux rois, mais de manière aussi à cacher presque entièrement son père. Il y avait beaucoup de grâce dans cette attitude du jeune prince, et en se rappelant la dernière tentative d’Alibaud, on ne pouvait le regarder sans attendrissement.
Quand le spectacle fut terminé, la foule se retira en silence. Alors la salle nous sembla un immense bassin rempli de peuple dont les flots divisés en quatre fleuves allaient se répandre dans toute la ville. Le premier fleuve s’écoula sur le pont Louis XVI ; l’autre déborda du côté de la rue de Rivoli. Un troisième, mais plus faible, ce n’était à vrai dire qu’un bras de rivière, se dirigea vers la rue des Champs-Élysées. Enfin, le quatrième, le plus imposant, le plus majestueux, s’épandit comme la Loire dans toute la rue Royale. Une sorte de petite émeute, ou plutôt une espèce de tourbillon se manifesta au milieu du lac, c’était l’auteur que l’on avait reconnu, M. Lebas que l’on reconduisait en triomphe. Enfin, tout s’est bien passé. Le temps était non pas beau, mais bon. Point de soleil, c’est ce qu’il fallait pour regarder longtemps la même chose. Le parterre était meilleur encore puisqu’il est resté quatre heures sur ses pieds sans cabaler et sans se plaindre. Quand tout a été fini, deux hommes sont montés au sommet de l’obélisque pour hisser le drapeau final, sur lequel on remarquait une ancre, ce qui veut dire que la marine revendique la gloire de cette entreprise ; deux autres hommes sont allés planter sur la pointe de l’aiguille des branches de saule, c’est le laurier des maçons. Ces trophées valent bien les couronnes qu’on jette à mademoiselle Taglioni et à mademoiselle Essler.
9 novembre 1836.
Récit anticipé d’une réception à l’Académie – Modes. – Un nouveau roman de M. de Latouche. – Le prince Louis Bonaparte.
Demain jeudi, à l’heure où nous écrivons, aura lieu pour la réception de M. Dupaty, la séance solennelle dont nous nous empressons de rendre compte ; l’assemblée aura été nombreuse, une foule de femmes célèbres s’y sera fait remarquer. Les femmes auteures auront sorti leurs petits chapeaux à petites plumes qui ne voient le jour que lorsque les quatre Classes se réunissent, et leurs petites pèlerines soi-disant garnies de dentelles, mantelets de fantaisie, qui suffisent à la science. M. Dupaty, revêtu de l’habit tout neuf d’académicien, heureux de son feuillage, aura été modeste trois fois. Il aura parlé à l’Académie de son sein et de l’honneur qu’il y a d’être reçu dans ce sein ; il aura été spirituel, nous l’affirmons. Nous connaissons M. Dupaty depuis longtemps pour un homme loyal, qui n’a jamais manqué d’esprit ni de parole, et nous ne craignons point de nous engager pour lui.
M. Duval lui aura répondu avec bienveillance, puis aura glissé dans son discours quelques malices contre les romantiques, et quelques phrases de mélancolie et de découragement ; car le patriarche du drame français ne pardonne point à nos Duval modernes les belles scènes qu’ils ont puisées dans ses ouvrages ; c’est un mauvais père qui ne veut pas reconnaître ses enfants. Enfin, le bosquet académique, seule verdure qui survive à l’automne, se dispersera, et les gens de province s’en retourneront chez eux avec empressement pour écrire la lettre suivante : « Nous avons assisté ce matin à une séance de l’Académie française, » etc. Tout est plaisir pour un cœur de Bergerac, de Riberac ou Quimper-Corentin.
L’hiver s’annonce comme devant être le plus beau des hivers ; on pense sérieusement à s’amuser. La politique est un loisir d’infirmes qu’on laisse aux petits esprits ; d’ailleurs, les grands hommes d’État ont toujours allié les affaires et les plaisirs. De nos jours, on recommence à découvrir que pédanterie n’est pas science ; les ennuyeux, tout-puissants naguère, perdent beaucoup de leur crédit ; leur magnétisme a moins d’empire depuis que l’on n’a plus la foi ; on ne leur laisse plus le temps de vous endormir ; de là vient que leur influence a pâli. M. de Metternich a prouvé qu’on pouvait être ensemble homme aimable et ministre habile ; le comte de Medem, le baron de Meyendorff, savent unir la grâce de l’esprit à la gravité d’une mission importante ; bref, l’esprit français nous est rendu par les étrangers ; en venant l’étudier parmi nous, ils nous forcent à le retrouver.
Le Théâtre-Italien a l’air d’un congrès. Il n’est pas un des spectateurs qui ne soit un peu ambassadeur ou homme d’État ; chacun d’eux a été ministre quelque temps et quelque part. C’est un coup d’œil curieux que l’aspect de ce théâtre : samedi dernier surtout, jour des Puritains, la salle était resplendissante d’illustrations et de beautés.
Il y a dans ce moment à Paris une quantité de jolies femmes effrayante pour le repos de la capitale : jolies Anglaises, belles Italiennes chassées vers nous par le choléra, brunes Espagnoles que nous envoie la guerre civile. Oh ! les charmants fléaux qui nous valent ce beau coup d’œil ! Dans le nombre, il y a aussi de jolies Françaises ; car les Françaises se remettent depuis quelques années à être jolies comme les Français se remettent à être rieurs et aimables. Sous l’empire, les femmes étaient toutes belles, puis il y a eu interruption. Sous la restauration, les minois, les traits douteux, ont pris le haut du pavé. Excepté une ou deux étoiles lumineuses, les femmes de celle époque étaient plutôt agréables que belles ; et par instinct, par esprit (et elles n’en manquaient pas), elles avançaient leurs jolis pieds quand on regardait trop longtemps leur visage. Alors ce n’était pas la mode d’être belle ; aujourd’hui cette mode est revenue, et l’on peut citer beaucoup de femmes qui la suivent exactement.
Les manches tombantes, arrêtées en haut par un bracelet qu’on a le grand tort d’appeler poignet, sont les plus généralement adoptées ; les manches bouffantes en haut et justes à partir du coude sont abandonnées ; on les laisse aux geôliers de mélodrame et au tuteur des Folies amoureuses, dont elles ont fait jusqu’à ce jour le plus bel ornement.
Les nouveaux mouchoirs sont irrésistibles ; cette large rivière de jours