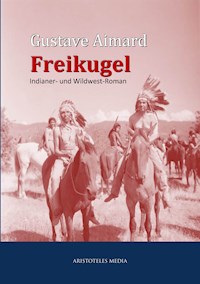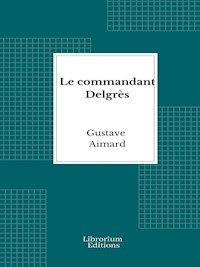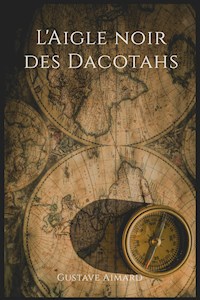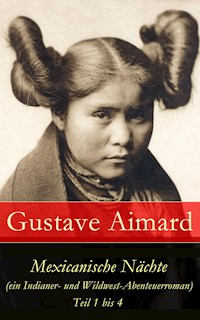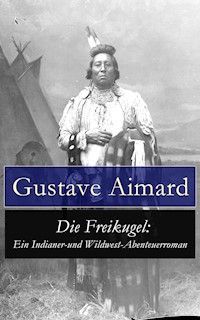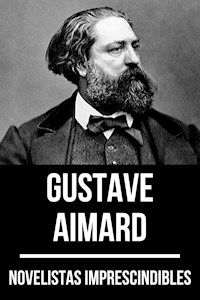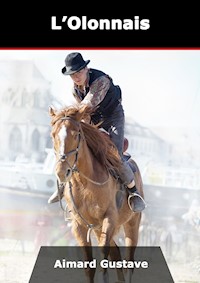14,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bauer Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Les Bandits de l'Arizona est l'un des derniers romans de Gustave Aimard (1818-1883), dont la spécialité était les romans de l'Ouest américain. Aussi populaire, en son temps, qu'Eugène Sue et Paul Féval, il a écrit une soixante de romans. Vers la fin de sa vie, pourtant, la vogue de ces romans de l'Ouest s'estompe, et Aimard, méprisé de l'élite et des universitaires, tombe dans un certain oubli. Les connaisseurs s'amuseront (ou se désoleront) de la description pour le moins manichéenne de la nation Apache, peuple politiquement incorrect de ce temps, en opposition aux gentils Comanches.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gustave Aimard
Les bandits de l'Arizona
table des matières
Chapitre 1 Comment un démon tomba du ciel et comment il fut accueilli sur la terre
Chapitre 2 Où le Coyote tombe de fièvre en chaud mal
Chapitre 3 Comment la Grande-Panthère délivra le Coyote, et de quelle façon excentrique le bandit essaya de prouver sa reconnaissance à son sauveur
Chapitre 4 Comment on soupe parfois, mais rarement, en Apacheria
Chapitre 5 Où les pirates des prairies, en cherchant un pois, trouvèrent une fève de dure digestion
Chapitre 6 Dans lequel l’Urubu et le Coyote, deux animaux sinistres, causent de leurs petites affaires peu édifiantes
Chapitre 7 Où se préparent de graves événements
Chapitre 8 Où don José de Sandoval et le colonel de Villiers sont mis d’accord par le docteur Guérin, par un coup de boutoir
Chapitre 9 Où le général Coulon de Villiers raconte son histoire
Chapitre 10 De la rencontre que firent le général de Villiers et don José de leur ami Sans-Traces et ce qui s’en suivit pour Matatrès
Chapitre 11 Comment le campement fut attaqué par les pirates du désert et ce qui s’en suivit
Chapitre 12 Du singulier voyage que fit le général de Villiers et de son profond ébahissement
Chapitre 13 Comment l’Urubu fit visite à ses prisonnières et comment l’Oiseau-de-Nuit ne fut pas de son avis et ce qui en advint
Chapitre 14 Où don Agostin prouve au général de Villiers qu’on veut, à Washington, lui faire tirer les marrons du feu
Chapitre 15 Où l’Oiseau-de-Nuit tint à l’Urubu plus qu’il lui avait promis, et ce qui en advint pour les pirates
Chapitre 16 Comment, après bien des péripéties douloureuses, cette histoire finit enfin comme un conte de fées
Les Bandits de l’Arizona est l’un des derniers romans de Gustave Aimard (1818-1883), dont la spécialité était les romans de l’Ouest américain. Aussi populaire, en son temps, qu’Eugène Sue et Paul Féval, il a écrit une soixante de romans. Vers la fin de sa vie, pourtant, la vogue de ces romans de l’Ouest s’estompe, et Aimard, méprisé de l’élite et des universitaires, tombe dans un certain oubli.
Les Bandits de l’Arizona a paru pour la première fois en 1881, chez Blériot, à Paris.
Chapitre 1 Comment un démon tomba du ciel et comment il fut accueilli sur la terre
Chapitre 1Comment un démon tomba du ciel et comment il fut accueilli sur la terre
Le nouveau récit que nous entreprenons aujourd’hui de faire à nos lecteurs se déroule tout entier dans l’ Arizona,ancienne province du Mexique, annexée par les États-Unis, après tant d’autres, à leur colossale confédération, sans autre droit que celui de la force.
Toutes les tentatives des Anglo-Saxons pour faire pénétrer la civilisation moderne dans cette terre rebelle furent faites en pure perte ; le gouvernement de Washington fut contraint d’y renoncer.
Aussi aujourd’hui l’Arizona est-elle restée ce qu’elle était lorsqu’elle se nommait Cibola**et que Cabezade Vaccala découvrit au prix de fatigues et de périls terribles ; c’est-à-dire une contrée mystérieuse, pleine de légendes sinistres, de prodiges effrayants et inexpliqués ; peuplée d’animaux inconnus et féroces, ne ressemblant à aucuns autres ; dont le sol bouleversé est rempli de ruines de toutes sortes laissées par des peuples inconnus et qui depuis des siècles ont disparu. Aussi les plus braves coureurs des bois ne se risquent qu’en hésitant et avec une terreur secrète, à s’enfoncer dans ces forêts presque impénétrables, vieilles comme le monde, au fond desquelles on retrouve d’autres ruines qui servent de repaires aux fauves les plus redoutables et semblent avoir abrité des géants dans les anciens jours de la création.
Ces déserts inexplorés, qui s’étendent à l’infini, renferment une nombreuse population nomade, composée des éléments les plus hétérogènes, hostiles les uns aux autres et se faisant une guerre sans merci, où le sang coule comme de l’eau sous les prétextes les plus futiles.
Voici quelle est la population de l’Arizona :
Les Indiens bravos,c’est-à-dire indomptés, les Comanches, les Apaches, les Pawnees et d’autres encore, qui prétendent avec raison être les maîtres du sol ; puis les coureurs des bois, les chasseurs et les trappeurs, les seuls honnêtes ; viennent ensuite les pirates des savanes, sang-mêlé pour la plupart, féroces, voleurs et assassins, sans foi ni loi ; et enfin les déclassés et les naufragés de toutes les civilisations du Vieux et du Nouveau Monde ; population anonyme sans nom dont les mauvais instincts n’ont aucun frein et ne connaissent que la force et la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et ne s’inclinent que devant le juge Lynch.
Et cependant cette contrée est la plus riche et la plus belle de l’univers, son climat est admirable, sa flore et sa faune sont incomparables et ses mines d’or, d’argent et de cuivre sont inépuisables ; aussi, espérons-nous que dans un avenir prochain l’Arizona entrera malgré elle dans la grande famille des peuples, tout**le fait prévoir : la civilisation marche en avant quand même, et le désert se rétrécit tous les jours.
Un vendredi de la fin du mois de juin 187… entre quatre et cinq heures du soir, ainsi que l’indiquait l’ombre allongée des arbres sur le sol, un homme, qui semblait être un chasseur ou un coureur des bois, après avoir traversé à gué le rio Gilaà son confluent avec le rioPuerco,fit halte sur la berge de la rivière, laissa tomber la crosse de son fusil sur le sable et, croisant ses mains sur l’extrémité des doubles canons de son arme, il examina attentivement d’un regard circulaire l’immense vallée qui s’étendait à perte de vue autour de lui.
Satisfait sans doute de sa rapide observation, un sourire releva légèrement les commissures de ses lèvres, il murmura entre ses dents, en français avec un fort accent normand :
— Allons ! je suis content de moi ; je ne me suis pas trompé d’une ligne, bien que cette fois soit la première que je vienne dans cette contrée ; et il y a loin d’ici à Montréal ; voici la vallée jonchée de poteries brisées ; voici sur ma droite la casade Moctekuzoma, là-bas les ruines d’une ville qui a dû être riche et bien fortifiée ; et, ce qui est plus important, à l’orée de ce bois de châtaigniers, l’immense mahoghani – acajou – entouré de quatre cèdres qui lui servent de gardes du corps ; donc, tout est bien et je n’ai plus qu’à attendre.
Tout en causant ainsi avec lui-même le chasseur avait remis son fusil sur l’épaule ; il alla s’asseoir au pied de l’acajou, bourra son calumet, l’alluma, posa son fusil en travers sur ses genoux et se mit philosophiquement à fumer.
Nous ferons en quelques mots connaître au physique et au moral ce personnage qui doit jouer un rôle important dans cette histoire.
C’était un homme de vingt-huit à trente ans au plus ; sa taille était haute, presque gigantesque ; il avait six pieds deux pouces ; cette stature n’ôtait rien à l’élégance et à la grâce de ses moindres gestes ; il était admirablement fait ; il devait être d’une vigueur athlétique, d’une adresse et d’une légèreté remarquables.
Son teint, couleur de brique cuite, le faisait reconnaître pour un Canadien bois brûlé.
Ses traits énergiques, ses pommettes saillantes, ses yeux gris bien fendus, un peu enfoncés sous l’orbite, mais pleins d’éclairs et regardant droit ; son front large, son nez un peu camard, aux narines mobiles, sa bouche bien faite garnie de dents magnifiques et ourlée de lèvres charnues d’un rouge de sang ; ses longs cheveux blonds tombant en épaisses boucles sur ses épaules et se mêlant parfois avec sa barbe fauve, fine et molle ; tous ses traits réunis lui composaient une physionomie des plus sympathiques et lui donnaient une ressemblance extraordinaire avec le mufle d’un lion, à la fois énergique, bon, paisible et ayant la conscience de sa force ; en somme c’était une nature d’élite.
Ce chasseur se nommait Jean Berger, mais il n’était connu dans les prairies que sous le surnom de Sans-Traces,à cause de la légèreté de sa marche qui ne laissait aucune trace de son passage à travers le désert.
Bien que très jeune encore, il avait une immense réputation comme chasseur et batteur d’estrade dans toutes les savanes depuis le Canada jusqu’au Mexique.
Du reste, il avait de qui tenir : il appartenait à une vieille famille de chasseurs tous renommés depuis plus d’un siècle et dont quelques-uns jouent des rôles importants dans plusieurs de nos précédents récits.
Nous ne dirons rien de son costume, Sans-Traces portait celui adopté depuis longtemps par les chasseurs canadiens et trappeurs blancs dans le désert.
Nous constaterons seulement que le chasseur avait des armes magnifiques, cadeau d’un officier supérieur français, auquel Sans-Traces avait sauvé la vie lors de l’expédition française au Mexique ; il avait un fusil à double canon tournant se chargeant par la culasse, quatre revolvers à six coups ; un sabre-baïonnette qu’il portait au côté, mais qui en cas de besoin s’adaptait au fusil.
Ces armes, toutes de choix, sortaient des ateliers de Lepage, l’armurier dont la réputation est universelle et que, jusqu’à présent, personne n’a égalé ni pour la justesse des armes qu’il fabrique ni pour leur élégance.
L’armement de Sans-Traces était donc formidable, puisqu’il avait vingt-six coups de feu à tirer sans être obligé de recharger.
Le chasseur, sans y songer, avait laissé son calumet s’éteindre.
Il admirait le paysage grandiose qui se déroulait sous ses yeux et devenait plus saisissant au fur et à mesure que les ténèbres remplaçaient la lumière du jour.
Partout où il reposait son regard, l’horizon n’était qu’un vaste cercle de verdure dont il était le centre ; le lit jaunâtre du rio Gila accidentait la perspective, par les replis tortueux de son cours tourmenté, qui se perdait enfin dans les derniers plans de la perspective ; çà et là, certains escarpements rocheux, blancs, bleuâtres et rouges, laissaient deviner des ravines profondes ou des ruisseaux fuyant en bavardant sous les glaïeuls ; comme chaque soir dans ces contrées au coucher du soleil, la brise se levait, agitant les feuilles des arbres, causant ces plaintes suaves de la harpe éolienne qui rappellent par leur harmonie mélancolique les gémissements des âmes souffrantes et meurent emportées à travers l’immensité sur l’aile de la brise nocturne.
La lune apparaissait comme un globe d’albâtre noyé dans des brouillards azurés : sa lumière froide blanchissait les bords du crépuscule et la cime feuillue des hauts mahoghanis, et fondait toutes les teintes dans le bleu du ciel qu’elle glaçait d’argent.
La nuit était faite.
Alors tout se tut, sauf ces bruits indistincts, sans causes appréciables, qui semblent être la respiration puissante de la nature endormie.
Le chasseur était une organisation primitive, forte et sensible à tout ce qui est grand et beau. Sans essayer d’expliquer ses sensations devant ce spectacle imposant, il se sentait, pour ainsi dire, fasciné ; la puissante mélancolie du silence et des ténèbres lui inspirait une respectueuse crainte ; son cœur se serrait douloureusement, sa pensée se plongeait dans une méditation étrange qui l’étreignait, l’élevait au-dessus de lui-même pour le transporter dans des régions lumineuses où tout un monde inconnu se révélait à son âme qui semblait avoir pris des ailes et planer au-dessus de la terre en se rapprochant du ciel.
— Oh ! murmura-t-il comme dans un rêve, je comprends maintenant la vénération des Peaux-Rouges pour cette vallée mystérieuse qui, disent-ils, est peuplée par les guerriers fameux des temps passés et la nomment la Vallée des ombres.
Ce fut le réveil : il se secoua comme s’il s’éveillait ; il fronça les sourcils, jeta un regard inquiet autour de lui et il reprit :
— J’ai failli m’oublier.
Alors il se leva, alla ramasser du bois sec, creusa un trou avec son sabre, se fit un foyer avec trois pierres placées en triangle sur les bords du trou, ouvrit sa gibecière, en retira une petite chaudière en fer, la remplit d’eau à une source voisine, la plaça sur son foyer improvisé, entassa du bois dessous et alluma le feu.
Ces préparatifs terminés, le chasseur émietta deux biscuits de mer dans l’eau, y ajouta du pennekann – chair sèche et pulvérisée –, du sel, du poivre et du piment ; puis il fit un lit de braise ardente sur laquelle il plaça un cuissot d’antilope, et, sous les cendres chaudes, il cacha une douzaine de patates.
— Là, dit-il d’un air satisfait, dans une heure le souper sera prêt, sans que j’aie besoin de m’en occuper davantage.
Il était près de huit heures du soir. Le vent s’était apaisé, la lune nageait dans l’éther au milieu d’un semis d’étoiles qui brillaient comme des pointes de diamant ; on entendait dans les profondeurs des forêts le glapissement des coyotes en chasse d’une proie et les rauques miaulements des jaguars se rendant à l’abreuvoir.
Le chasseur se leva, étendit une couverture sur le sol, versa dessus plusieurs mesures de maïs, puis, à deux reprises, il siffla d’une façon particulière.
Presque aussitôt un galop rapide se fit entendre et un magnifique mustang des prairies, noir comme la nuit, aux jambes fines, au large poitrail, à la tête petite éclairée par deux grands yeux pleins d’éclairs, apparut repoussant les buissons du poitrail et vint s’arrêter à toucher le chasseur, sur l’épaule duquel il posa sa tête, en le léchant avec des petits cris de plaisir et d’affection.
Pendant quelques minutes il y eut un échange de caresses entre l’homme et l’animal, qui semblaient parfaitement se comprendre.
Le cheval était complètement harnaché, seulement ses étriers étaient relevés, et le mors était retiré et attaché sur le pommeau de la selle, afin qu’il pût brouter en toute liberté.
— D’où venez-vous, Negro ? lui dit son maître en le flattant doucement ; pourquoi n’êtes-vous pas venu plus tôt ? le désert n’est pas bon à cette heure de nuit, les fauves sont en chasse ; mangez votre provende, demain la journée sera rude ; je me sens envie de dormir, je suis fatigué ; faites bonne garde et surtout ne quittez pas le feu de veille.
Le cheval fit une dernière caresse à son maître et alla docilement manger sa provende.
Le chasseur regagna sa place en bâillant, il s’adossa au mahoghani, étendit les jambes devant le feu, et après s’être assuré que tout était en ordre, il ferma les yeux en murmurant :
— J’ai deux heures à dormir, il ne viendra pas avant.
Presque aussitôt il s’endormit.
Son fusil était entre ses jambes et, par hasard sans doute, son sabre-baïonnette se trouvait sous sa main gauche, sur l’herbe.
Près d’une demi-heure s’écoula ainsi.
Il n’y avait plus un souffle de vent.
Un silence de plomb planait sur le désert.
Tout à coup Negro cessa de manger et coucha les oreilles.
Sans-Traces ouvrit les yeux, mais sans bouger.
Le cheval avait recommencé à broyer sa provende.
Le chasseur referma les yeux.
Presque aussitôt et sans qu’on entendît le plus léger bruit, une reata**en cuir tressé se déroula lentement à l’extrémité de l’une des branches maîtresses du mahoghani et descendit avec une précaution extrême.
Si le chasseur n’avait pas été endormi, il aurait vu, à deux mètres, au plus, de son feu de veille, cette reata pendant précisément en face de lui.
Après un instant, la noire silhouette d’un homme apparut à califourchon sur la branche à laquelle la reata était fixée.
Cet homme sembla hésiter pendant quelques secondes, mais tout à coup il se décida, il se mit un long poignard entre les dents, puis il saisit la reata à deux mains et se laissa glisser avec une rapidité vertigineuse.
Sans-Traces dormait toujours.
Aussitôt qu’il toucha la terre, l’inconnu prit son poignard de la main droite et, d’un bond de tigre, il s’élança sur le chasseur.
Mais celui-ci était debout devant son ennemi ; il saisit au vol le poignard que l’assassin brandissait sur sa tête ; il le lui arracha, le renversa sur le sol et lui posa lourdement son genou sur la poitrine en même temps qu’il lui appliqua son propre poignard sur la gorge en lui disant d’une voix railleuse :
— Quel diable de métier faites-vous donc, maître Petermann ? quel singulier chemin prenez-vous pour faire visite à vos amis, et quels compliments leur offrez-vous ?
Cet individu auquel Sans-Traces avait donné le nom de Petermann, et qui avait apparu subitement d’une façon si originale, était quelque chose d’impossible, d’illogique, un fantoche, un polichinelle, un casse-noisettes de Nuremberg ; il avait une toute petite tête ronde comme une pomme, des yeux gris et vairons, pas de front, des pommettes saillantes, un nez recourbé sur une bouche fendue d’une oreille à l’autre, un menton pointu et relevé vers le nez ; pas de barbe, à peine quelques cheveux d’un jaune sale venant jusqu’aux sourcils ; son buste était court, ses jambes et ses bras, d’une longueur hors de toutes proportions, lui donnaient, quand il marchait, l’apparence d’un énorme faucheux dressé sur ses pattes de derrière ; ce fantoche construit à coups de hache était d’une maigreur si invraisemblable que de quelque côté qu’on le regardât on ne le voyait jamais que de profil ; sa physionomie souriante avait une expression de bonhomie narquoise ; cependant quand il était en proie à une vive émotion, ce masque qu’il s’était fait tombait subitement, et alors ses traits prenaient une expression de scélératesse effrayante.
Les plus terribles bandits des savanes redoutaient cet homme à cause de sa méchanceté innée, sa cruauté, sa perfidie, ses mœurs infâmes et la force herculéenne qu’il possédait et qu’il mettait au service de ses mauvaises passions ; c’était un misérable sans foi ni loi, devant lequel chacun tremblait.
On le disait natif de Stettin, chef-lieu de la Poméranie en Prusse, où il avait commis des crimes si horribles qu’il avait été condamné à une réclusion perpétuelle dans son pays.
Comment avait-il réussi à s’échapper et à passer en Amérique, on l’ignorait ! mais, ce qui était certain, c’est que, après un séjour de quelques mois à peine à Washington, il avait été contraint de se réfugier au désert pour ne pas être lynché ; peine à laquelle il avait été condamné par la population exaspérée, pour avoir assassiné froidement et sans autre motif que sa férocité innée, toute une famille allemande, le père, la mère et trois enfants tout jeunes, qui avait eu pitié de sa misère et lui avait donné une généreuse hospitalité qui l’avait empêché de mourir de faim.
On l’avait surnommé le Coyote;jamais nom n’avait été aussi bien appliqué, car c’était une hyène, un monstre.
Tout en parlant et le tenant sous son genou, Sans-Traces l’avait en un tour de main débarrassé de ses armes, et avait retourné ses poches dont il avait jeté le contenu au loin ; par une espèce d’intuition, il ne conserva qu’un portefeuille crasseux gonflé de papiers.
Le Coyote, d’abord tout interloqué de la rude réception qui lui avait été faite sur le sein de notre mère commune, avait presque aussitôt repris son sang-froid :
— Eh ! dit-il en ricanant, vous êtes donc un pirate, compagnon ? il fallait me le dire tout de suite, nous nous serions facilement entendus.
— J’en doute, reprit le chasseur avec ironie ; je suis coureur des bois, mon maître, je chasse indistinctement tous les fauves qu’ils soient à quatre pattes ou à deux pieds ; vous en avez la preuve par vous-même.
— Vous êtes très spirituel, c’est plaisir de causer avec vous.
— Vous êtes bien bon, merci, fit-il d’une voix railleuse.
— Ah çà, vous saviez donc que j’étais ici ?
— Parfaitement, maître Coyote.
Le bandit fronça les sourcils.
— Tu sais que ceux qui me nomment ainsi risquent leur peau.
Sans-Traces haussa dédaigneusement les épaules sans répondre.
— Que me veux-tu enfin ? reprit l’Allemand en essayant sournoisement de se relever.
— Moi ? fit le chasseur, je ne te veux rien du tout.
— Alors, pourquoi m’as-tu appuyé le genou sur la poitrine et le poignard sur la gorge ?
— Tu le sais mieux que moi : crois-moi, reste tranquille, ou sinon, je te tue comme un chien enragé ; c’est à Tubac que nous nous sommes rencontrés hier soir, n’est-ce pas ?
— Je ne sais pas ce que tu veux dire ; je ne te connais pas, dit le bandit.
— Tu crois ? dit le chasseur avec ironie, tu étais avec d’autres *tunantes *–coquins de ton espèce – assis à une table dans la pulqueria**– buvette – où je suis entré pour me renseigner, car je ne connais pas ce pays où je viens pour la première fois ; vous jouiez au monte,et vous buviez du refino de cataluña à pleins verres.
— Tu rêves ; je ne comprends rien aux sottises que tu me débites depuis une heure.
— Pauvre agneau ! dit le chasseur d’une voix railleuse.
— Ah çà, est-ce que vous allez m’étouffer ainsi longtemps encore ? s’écria l’autre avec rage.
— Qu’à cela ne tienne, mon maître, cette position vous fatigue ? dit le chasseur avec une feinte pitié.
— Je ne puis plus y tenir, tout simplement.
— Alors soyez satisfait.
Et Sans-Traces, avec une adresse, une vigueur et une rapidité qui déconcertèrent le bandit, attira à lui la reata, la fit tomber sur le sol et s’en servit pour garrotter le pirate que, malgré ses efforts pour lui échapper, il réduisit en un tour de main à une complète immobilité.
— Là, voilà qui est fait ! dit le chasseur en riant.
— Maudit !… s’écria le bandit avec une colère impuissante, ah ! si tu ne m’avais pas pris en traître !…
— Allons donc ! dit Sans-Traces en réparant paisiblement le désordre de ses vêtements, vous n’êtes pas aussi terrible que vous voulez le faire croire !
— Ah ! si je puis jamais prendre ma revanche, fit le pirate en grinçant des dents.
— Ah ! pardieu, je vous trouve charmant, dit Sans-Traces, vous tombez du ciel, vous vous ruez sur moi comme un loup pour m’assassiner, et vous prétendez vous venger de la mauvaise réussite du guet-apens que vous m’aviez tendu ? vous êtes idiot, mon cher, ajouta-t-il en riant.
— Hum ! qu’est-ce que cela encore ?
— Cela, dit le chasseur toujours railleur, un bâillon pour vous empêcher de bavarder comme une vieille femme ; vrai, vous parlez trop, cela m’ennuie.
— Un bâillon, à moi ? mais…
Sans-Traces lui appliqua le bâillon et coupa ainsi brusquement sa phrase par la moitié.
— Maintenant, écoutez-moi et ne me menacez pas du regard, cela ne vous avancerait à rien, je vous en avertis.
En effet, le bandit n’avait que les yeux de libres et il profitait de cette dernière ressource pour protester contre la violence qui lui était faite.
— Vous avez voulu m’assassiner sans me connaître ; vous m’avez tendu un guet-apens horrible ; j’étais en droit de vous tuer comme un coyote immonde, je ne l’ai pas voulu ; je suis un honnête coureur des bois ; je n’assassine pas, j’attaque mon ennemi en face, homme ou fauve, et je le combats bravement ; vous êtes un bandit sans foi ni loi, vicié jusqu’aux moelles, je vous appliquerai la loi de lynch, œil pour œil, dent pour dent ; je ne vous tuerai pas, le meurtre de sang-froid me répugne ; je vous abandonnerai sans armes, sans vivres et sans feu dans le désert ; je vous laisserai mourir, c’est une dernière chance que je vous donne ; si Dieu, dont la bonté est inépuisable, vous prend en pitié et vous sauve, cette rude leçon, peut-être, vous fera rentrer en vous-même, ce que je vous souhaite sans l’espérer ; vous avez toujours abusé de votre force, je vous réduis à être plus faible qu’un enfant en vous garrottant et vous bâillonnant.
Tout à coup un cri de hibou rompit le silence en se faisant entendre à trois reprises.
Le chasseur tressaillit, ce cri était évidemment un signal.
— J’avais oublié, murmura le Canadien, cela vaudra mieux ; il me dira ce qu’il convient de faire.
Il rejeta brusquement à terre le bandit que déjà il avait placé en travers sur le dos de Negro, il enveloppa dans une épaisse couverture de laine la tête de son prisonnier afin de l’empêcher de voir et d’entendre.
Puis il répondit au signal qui lui avait été fait en poussant à son tour le cri du hibou.
Presque aussitôt on entendit le galop rapide de plusieurs chevaux lancés à fond de train, trois cavaliers apparurent dessinant leurs sombres silhouettes dans la nuit et firent halte devant le campement du chasseur qui s’était empressé de donner un dernier coup d’œil au souper.
Le repas était à point, Sans-Traces se frotta joyeusement les mains.
Chapitre 2 Où le Coyote tombe de fièvre en chaud mal
Chapitre 2Où le Coyote tombe de fièvre en chaud mal
Le premier soin des arrivants fut de desseller leurs chevaux, et de les bouchonner vigoureusement pendant près de dix minutes ; les pauvres bêtes fumaient et haletaient ; lorsqu’ils commencèrent à respirer et à s’ébrouer en tendant le cou et en dressant les oreilles, les voyageurs leur donnèrent la provende qu’ils attaquèrent aussitôt joyeusement.
Les cavaliers vinrent alors s’asseoir autour du feu sur les crânes de bison que Sans-Traces avait préparés tout exprès à leur intention, pour leur servir de sièges.
Le froid était piquant, les voyageurs se chauffaient avec un véritable plaisir.
— Vous êtes en retard de plus d’une heure, mon colonel, dit le chasseur à celui des trois étrangers qui semblait être, non pas le chef des autres, mais le plus élevé dans la hiérarchie des castes de la société. Vous serait-il arrivé quelque chose de désagréable en route ?
— Oui, nous avons été brusquement attaqués par sept ou huit malandrins, qui nous ont barré le passage à l’improviste ; mais notre ami le Nuage-Bleu nous a débarrassés de ces drôles sans effusion de sang.
— Les sang mêlés sont des chiens, dit le chef indien avec mépris, le Nuage-Bleu est un sachem dans sa nation.
— Oui, oui, en vous voyant, dit en riant le chasseur, ils ont dû être désagréablement surpris.
— Les Comanches sont les maîtres du désert, dit le chef avec emphase. Qui oserait leur résister ?
— Ce que vous dites est vrai, chef, mais il se fait tard et vous devez avoir grand besoin de manger ; n’attendons pas davantage, dit Sans-Traces.
Et s’adressant au troisième voyageur qui, dès que les chevaux avaient été bouchonnés, s’était aussitôt mis à construire un jacal :
— Eh ! Sidi-Muley, est-ce que tu n’as pas encore terminé ta construction, lui dit le chasseur en riant.
— C’est fini, s’écria celui auquel on avait donné le nom de Sidi-Muley.
Et remettant au fourreau le long sabre qui lui avait servi pour couper les branches employées à la confection du jacal :
— Mon colonel, dit-il à l’officier, votre chambre à coucher est prête à vous recevoir quand il vous plaira de vous retirer.
— Merci, mon vieux camarade, répondit l’officier, et lui indiquant une place : Assois-toi là près de moi, ce ne sera pas la première fois que nous serons côte à côte ; tu n’as pas oublié nos campagnes d’Afrique, hein ?
— Dieu m’en garde, mon colonel, vous avez monté en grade depuis ce temps-là, mais ce n’est pas encore assez, vous devriez…
— Bon ! tout est bien ainsi, mange ta soupe, vieux grognon.
Le soldat éclata de rire, s’installa sur un crâne de bison et ne souffla plus mot.
Le souper commença aussitôt avec cet entrain et cet appétit, que l’on ne rencontre malheureusement dans les villes qu’au foyer de quelques ménages d’ouvriers honnêtes travailleurs ; car la préoccupation du lendemain leur rend trop souvent le pain amer.
Nous profiterons de l’ardeur avec laquelle nos personnages attaquent le cuissot d’antilope, pour les faire connaître aux lecteurs.
Le Nuage-Bleu était le premier sagamore**de la tribu du Bison-Rouge, l’une des plus importantes et des plus guerrières de la célèbre nation des Comanches.
Le Nuage-Bleu était de haute taille, vigoureusement constitué ; il avait les attaches fines et élégantes, tous ses gestes étaient gracieux et imposants ; ses traits étaient beaux, ses yeux d’un noir de jais pétillaient d’intelligence et de finesse, sa physionomie avait une expression énergique et un peu froide, tempérée cependant par une indicible bonté.
Ce chef, très célèbre dans les Prairies, devait être âgé, au dire de gens qui le connaissaient bien, d’au moins soixante-quinze ans ; il avait des dents éblouissantes, des cheveux touffus noirs, comme l’aile du gypaète, le corbeau américain ; il était aussi vigoureux, aussi alerte et aussi léger à la course que s’il n’avait eu que trente ans ; aucune apparence de sénilité n’apparaissait dans sa personne.
Hâtons-nous de constater que ce fait n’a rien d’extraordinaire ; en général les Indiens vivent très vieux, les centenaires sont nombreux parmi eux ; beaucoup dépassent cent vingt ans et plus.
Nous parlons ici, bien entendu, des Indiens indépendants, qui ont su se préserver des liqueurs des Blancs et ne boivent que de l’eau, comme les Comanches ; les ivrognes ne sont plus que des Indiens dégénérés, méprisés et chassés des atepelts**à grands coups de bâton par les femmes et les enfants.
Le second personnage, celui que l’on traitait de colonel, était un jeune homme de trente-cinq ans au plus : il était grand, bien fait, élégant, très vigoureux, avec des mains et des pieds de femme ; sous une apparence un peu efféminée, il cachait une énergie et une volonté implacables ; il accomplissait les plus longues traites à pied ou à cheval, sans jamais se plaindre de la fatigue ; ses traits étaient d’une grande beauté ; il était blond fauve avec des yeux et des sourcils noirs, ce qui donnait à sa physionomie ouverte et bienveillante quelque chose d’étrange qui saisissait et qu’on ne pouvait expliquer.
M. le comte Louis Coulon de Villiers appartenait à une vieille famille originaire du Rouergue, dont les chroniques de cette province citent avec honneur plusieurs membres ; l’histoire du Canada mentionne les noms de deux officiers de cette noble famille :
Le capitaine de Villiers de Jumonville fut assassiné de sang-froid, dans un horrible guet-apens, malgré sa qualité de parlementaire, par Washington, alors colonel des milices coloniales de Virginie, le 29 mai 1754, à quelques lieues du port Duquesne sur l’Ohio.
Son frère Louis Coulon de Villiers obtint le commandement du détachement chargé de venger le meurtre de son frère. Washington, réfugié dans le fort Nécessité,fut attaqué à l’improviste par les Français ; après une lutte acharnée de quelques heures, il fut contraint de signer une capitulation honteuse et de reconnaître qu’il avait assassiné Jumonville, malgré sa qualité de parlementaire qui le rendait inviolable.
Ces deux exemples suffisent pour prouver que les Coulon de Villiers étaient une race guerrière.
Le troisième des voyageurs, Sidi-Muley, a joué un rôle important dans un de nos précédents ouvrages.
Au physique, il avait une certaine ressemblance avec le Coyote : comme lui, il était construit à coups de hache, était long et maigre comme un échalas, de sorte que, de même que l’Allemand, de n’importe quel côté qu’on le regardât on ne le voyait toujours que de profil.
Mais là s’arrêtait la ressemblance entre les deux hommes.
Sidi-Muley, on ne le connaissait que sous ce nom fantaisiste, était un Parisien pur sang, né en plein faubourg Saint-Antoine ; il avait été enfant de troupes, n’avait jamais connu ni père ni mère, et s’était engagé aussitôt qu’il avait eu l’âge d’être soldat ; le régiment était devenu sa seule famille.
Il était tout muscles et tout nerfs, très vigoureux et surtout très leste et très adroit à tout ce qu’il faisait ; il pouvait avoir, au moment où nous le mettons en scène, quarante-cinq ans peu ou prou.
Il avait le front haut et large, le nez long et bourgeonné, les yeux gris, ronds, vifs et pétillants de malice ; les pommettes saillantes, les narines ouvertes et mobiles, la bouche largement fendue, garnie d’une double rangée de dents un peu séparées les unes des autres, blanches et pointues, les lèvres épaisses et sensuelles ; le menton fortement accusé et avançant en avant ; les cheveux blonds et rares, une longue moustache et une impériale fauves et touffues ; le teint d’un rouge de brique, la physionomie railleuse et goguenarde, mais toujours gaie et empreinte de bonhomie ; c’était le véritable type de la pratique,qu’on nous passe cette expression, des soldats très braves, mais indisciplinables, des compagnies de discipline, de notre colonie africaine.
Son costume essentiellement débraillé, qu’il portait avec une désinvolture particulière, tenait de tous les costumes en usage dans ces régions : en partie chasseur indien, ranchero et même soldat mexicain, le tout complété par des bottes molles en assez bon état et un fez rouge outrageusement penché sur l’oreille droite ; ce fez était tout ce qui lui restait de son uniforme de spahi.
En somme Sidi-Muley était un drôle de corps, ancien spahi, bon à pendre et à dépendre ; malin comme un singe ; mauvais comme un âne rouge, brave comme un lion, voleur comme un Allemand ; dévoué à ses heures, ivrogne à lécher la tonne de Neldelberg, toujours riant et chantant ; prenant le temps comme il vient sans autre souci que de bien vivre, il était venu s’échouer dans ces parages lors de l’expédition néfaste du Mexique, à la suite de je ne sais quelle scabreuse affaire ; en réalité, c’était un véritable type, très curieux à étudier.
À son débarquement à la Veracruz, le colonel avait rencontré par hasard Sidi-Muley, qu’il avait eu sous ses ordres et qu’il connaissait de longue date ; le pauvre diable mourait à peu près de faim. Le colonel, sachant ce qu’il valait, lui avait offert de l’accompagner, offre que l’ancien spahi avait acceptée avec empressement ; depuis lors ils ne s’étaient plus quittés ; M. de Villiers se félicitait de cette singulière recrue dont le dévouement à toute épreuve était précieux pour lui.
Nous nous sommes peut-être un peu trop étendu sur le portrait de ces personnages, mais comme ils sont appelés à jouer un grand rôle dans cette histoire, il était très important qu’ils fussent bien connus du lecteur.
Le repas tirait sur sa fin ; on avait allumé calumets, pipes et cigares en buvant d’excellent café aromatisé par quelques gouttes d’eau-de-vie de France, et qu’on savourait à petites gorgées.
— Avez-vous appris quelque chose, ami Sans-Traces ? demanda le colonel en allumant un cigare.
— Depuis notre séparation, mon colonel, répondit le chasseur, je me suis donné beaucoup de mouvement, mais jusqu’à présent, je n’ai rien terminé ; et vous, avez-vous été plus heureux que moi ?
— Pour le premier point je crois avoir ville gagnée.
— Comment cela ?
— Je me suis d’abord rendu à Mexico et, malgré l’antagonisme que je craignais de rencontrer près des autorités mexicaines, je n’ai eu qu’à me louer de mes rapports avec le président de la République ; mes droits ont été reconnus complètement, sans la plus légère difficulté ; l’on m’a donné tous les papiers nécessaires pour les faire valoir et agir comme bon me semblera pour sauvegarder mes intérêts ; on m’a donné carte blanche sur les moyens que je jugerai nécessaire d’employer pour rentrer dans la propriété de ma concession.
— Mais c’est une véritable victoire que vous avez remportée, mon colonel, dit joyeusement le chasseur ; à quoi attribuez-vous ce bon vouloir du gouvernement mexicain ?
— À plusieurs causes, dit en riant l’officier, d’abord à l’absence de toute diplomatie et de tout agent français, et surtout à ceci que, aujourd’hui, ma concession se trouve sur le territoire des États-Unis, et que par conséquent, le Mexique est à présent complètement désintéressé dans la question ; que le gouvernement de ce pays n’est pas fâché d’être agréable à un officier supérieur français, sans qu’il lui en coûte rien, et en même temps de jouer un mauvais tour à la grande république des États-Unis, qu’il déteste.
— C’est juste, dit Sans-Traces, aussi je crains que vous ne trouviez pas le gouvernement de Washington aussi facile que celui de Mexico.
Le colonel sourit, et après avoir aspiré deux ou trois goulées de fumée pour raviver son cigare qui s’éteignait :
— Vous vous trompez, dit-il.
— Comment cela ?
— Vous allez le comprendre..
— Pardon, mon colonel, si je vous interromps, dit Sidi-Muley.
— Qu’y a-t-il ? demanda l’officier.
— Depuis quelques minutes je suis très intrigué par une espèce de paquet que je vois grouiller là-bas au pied du mahoghani, et je me demande ce que cela peut être.
— C’est vrai, dit le chasseur en se frappant le front, je l’avais oublié.
— Qu’est-ce donc ? interrogea l’officier.
— C’est toute une histoire, mon colonel, je remercie Sidi-Muley de rappeler mes souvenirs ; heureusement que nous avons parlé à voix basse.
— Est-ce donc un homme ?
— Oui, mon colonel, et un ennemi redoutable qui plus est.
— Oh ! oh ! un ennemi ?
— Ce paquet, ainsi que le nomme Sidi-Muley, n’est autre que le plus féroce bandit du désert dont, sans doute, vous devez avoir entendu parler.
— Son nom ?
— Le Coyote.
— Le pirate allemand ? s’écria le spahi.
— Lui-même, reprit le chasseur.
— J’ai, en effet, entendu parler de ce drôle comme d’un misérable sans foi ni loi.
— Ajoutez, mon colonel, reprit Sidi-Muley, que les plus féroces bandits tremblent devant lui, et qu’il est exécré.
— Quand je suis arrivé ce soir, à l’endroit où vous m’aviez donné rendez-vous, mon colonel, reprit le chasseur, cet homme, qui s’était embusqué au milieu des branches du mahoghani, s’est rué sur moi à l’improviste et a failli m’assassiner, sans que je sache pour quel motif.
— Je le sais, moi, dit le colonel en hochant la tête d’un air pensif, ou du moins je le devine ; continuez Sans-Traces.
— Grâce à ma vigueur peu commune, que le bandit ne soupçonnait pas, reprit le chasseur, je réussis non seulement à déjouer son attaque, mais je m’emparai de lui, je le garrottai comme vous le voyez, et j’allais le transporter bâillonné et aveuglé par une couverture dans une de ces maisons en ruine, où je l’aurais laissé mourir, car je ne voulais pas le tuer de sang-froid ; si scélérat que soit cet homme, il me répugnait de lui ôter la vie ; en entendant votre signal, je m’arrêtai, pensant que, mieux que moi, vous sauriez ce qu’il convient de faire de ce drôle ; je ne sais comment je l’ai oublié.
— Bon ! fit Sidi-Muley en bourrant sa pipe, votre idée était excellente Sans-Traces, vous avez eu tort de ne pas la mettre à exécution ; mais il n’y a pas de temps perdu, avec l’autorisation du colonel, je vais lui mettre une couple de balles dans la tête, et ce sera fini.
Et il fit un mouvement pour se lever.