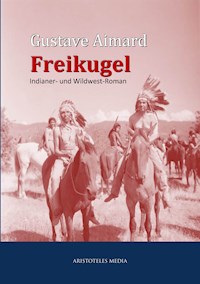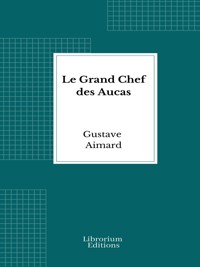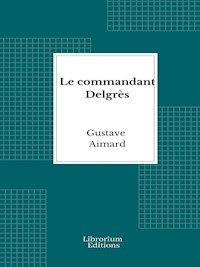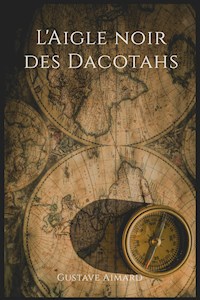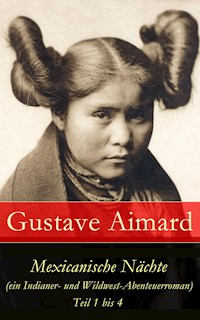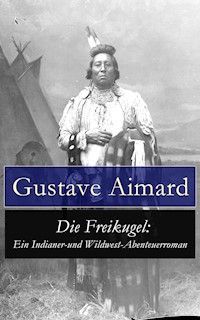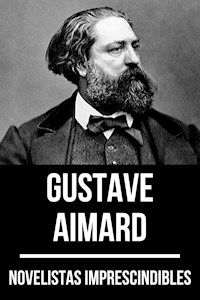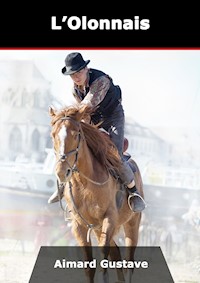14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bauer Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Je n'ai jamais connu ni mon père ni ma mère ; on m'a dit que mon père avait été tué dans les guerres avant ma naissance et que ma mère était morte en me donnant le jour. Voilà tout ce que je sais de ma famille ; son nom même n'a jamais été prononcé devant moi. Mes premières années sont enveloppées d'un nuage que je ne suis jamais parvenue à soulever ; je ne me rappelle rien, seulement il me semble que j'ai habité d'autres contrées ; que je suis demeurée longtemps sur mer, et qu'avant de me fixer à Hispaniola j'avais vécu dans des pays où le ciel est moins pur, les arbres plus sombres et le soleil plus froid ; mais ce ne sont que des conjectures qui ne reposent sur aucune base solide. Il me semble aussi avoir entendu parler et avoir parlé moi-même une autre langue que le castillan : mais quelle est cette langue, voilà ce que je ne saurais dire. La seule chose que je crois positive, c'est que je suis protégée dans l'ombre par une famille puissante, qui veille incessamment sur moi et ne m'a jamais perdue de vue. Don Fernando d'Avila, mon tuteur, n'est pas mon parent, j'en suis certaine. C'est un soldat de fortune qui, selon toute probabilité, ne doit la haute position à laquelle il est parvenu et celle plus haute encore qui lui est promise, qu'aux soins dont il a entouré mon enfance. Voici mon histoire, Philippe, elle est bien courte, bien sombre et bien mystérieuse ; mais je devais à l'amour que j'ai pour vous, je me devais à moi-même de vous la faire connaître, et, convaincue que j'ai accompli un devoir sacré, je me courberai sans me plaindre devant votre volonté, quelle qu'elle soit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Gustave Aimard
Les bohèmes de la mer
table des matières
Chapitre 1 Le Saumon couronné
Chapitre 2 La chapelle de la Vierge
Chapitre 3 L’engagé
Chapitre 4 L’ongle et le neveu
Chapitre 5 Le duc de Peñaflor
Chapitre 6 L’enrôlement
Chapitre 7 Le sauvetage
Chapitre 8 La présentation
Chapitre 9 Les Frères de la Côte
Chapitre 10 L’îlot de la Tête-de-Chien
Chapitre 11 Le jardin
Chapitre 12 Rendez-vous à trois
Chapitre 13 Don Fernando d’Avila
Chapitre 14 Santo Domingo
Chapitre 15 Le rancho
Chapitre 16 Deux anciennes connaissances du lecteur
Chapitre 17 Conversation intime
Chapitre 18 Doña Clara
Chapitre 19 La prise de l’île de la Tortue
Les flibustiers… C’étaient d’abord des aventuriers français qui avaient tout au plus la qualité de corsaires. C’étaient des oiseaux de proie qui fondaient de tous les côtés… Jamais les Romains ne firent des actions si étonnantes. S’ils avaient eu une politique égale à leur indomptable courage, ils auraient fondé un grand empire en Amérique. (VOLTAIRE.)
Chapitre 1 Le Saumon couronné
Chapitre 1Le Saumon couronné
Le 17 octobre 1658, entré sept et huit heures du soir, deux hommes étaient attablés dans la grande salle du Saumon couronné, la principale auberge de la ville de Port-de-Paix, rendez-vous ordinaire des aventuriers de toutes nations que la soif de l’or et la haine des Espagnols attiraient dans les Antilles.
Ce jour-là, une chaleur torride n’avait cessé de peser sur la ville, de gros nuages jaunâtres chargés d’électricité s’étaient étendus d’un bout à l’autre de l’horizon, sans qu’un souffle d’air vînt, même au coucher du soleil, rafraîchir la terre pâmée de chaleur.
On entendait de sourds murmures qui, s’échappant du sein des mornes, roulaient répercutés par les échos avec les éclats stridents d’un tonnerre lointain.
La mer, noire comme de l’encre, agitée par quelque commotion souterraine, se soulevait en vagues houleuses et venait lourdement se briser contre les rochers de la plage avec des plaintes sinistres.
Tout enfin présageait un ouragan prochain. Les habitants de Port-de-Paix, rudes marins pour la plupart cependant, et habitués de longue main à lutter contre les plus terribles dangers, subissant malgré eux l’influence de ce malaise général de la nature, s’étaient renfermés dans leurs maisons ; les rues étaient désertes et silencieuses, la ville semblait abandonnée, et l’auberge du Saumon couronné, qui d’ordinaire, à cette heure peu avancée de la nuit, regorgeait de buveurs, n’abritait sous les lambris enfumés de sa vaste salle que les deux hommes dont nous avons parlé et qui, le coude sur la table, la tête dans la main et la pipe à la bouche, suivaient d’un regard distrait les fantastiques spirales de la fumée qui s’échappait incessamment de leur bouche et se condensait en un nuage bleuâtre autour d’eux.
Des gobelets en étain, des bouteilles, des cartes, des cornets et des dés épars çà et là sur la table prouvaient que depuis longtemps déjà ces deux hommes se trouvaient dans l’auberge, et qu’après avoir essayé de toutes les distractions, ils les avaient abandonnées, soit par lassitude, soit parce que des pensées plus graves occupaient leur esprit et les empêchaient de jouir, comme ils l’auraient peut-être désiré, des plaisirs combinés du jeu et de la bouteille.
Le premier était un vieillard, plein de vigueur encore, balançant fièrement sur ses épaules une belle tête presque sexagénaire, à laquelle de longs cheveux blancs, des sourcils encore noirs, d’épaisses et grises moustaches et une ample royale donnaient un fort noble caractère. Son costume simple, mais de bon goût, était entièrement noir ; son épée, à poignée d’acier bruni, était jetée négligemment sur la table auprès de son feutre et de son manteau.
Le second, beaucoup plus jeune que son compagnon, n’avait que quarante-cinq à quarante-huit au plus ; c’était un homme aux formes athlétiques, trapu et carré ; ses traits, assez ordinaires, auraient été insignifiants sans une expression de rare énergie et d’indomptable volonté qui imprimait à sa physionomie un cachet tout particulier.
Il portait le costume luxueux jusqu’à l’extravagance de riches boucaniers, étincelant d’or et de diamants ; un lourde et massive fanfaronne entourait la forme de son feutre garni de plumes d’autruche, retenues par une agrafe de diamants, qui valait une fortune ; une longue rapière suspendue à son côté par un large baudrier était, pour plus de commodité sans doute, ramenée en ce moment entre ses jambes, deux pistolets et un poignard garnissaient sa ceinture, un ample manteau rouge était placé sur le dossier de son siège.
Depuis longtemps déjà un silence morne régnait entre les deux hommes ; ils continuaient à fumer et à s’envoyer réciproquement des bouffées de fumée au visage sans paraître songer l’un à l’autre.
L’aubergiste, grand gaillard maigre, sec et long comme un échalas, aux vêtements sales et sordides et à la face patibulaire, à plusieurs reprises, sous prétexte de raviver la mèche de la lampe qui n’en avait pas besoin, était venu tourner autour de ces singulières pratiques sans parvenir à éveiller leur attention, et s’était retiré tout penaud en haussant les épaules d’un air de mépris mal déguisé pour de si minces consommateurs.
Enfin, le plus jeune des deux releva subitement la tête, brisa sa pipe sur le plancher avec un geste de colère, et frappant du poing sur la table de façon à faire danser et s’entrechoquer gobelets et bouteilles :
— Vive Dieu ! s’écria-t-il d’une voix rude, ce beau muguet se moque de nous, à la fin ! Allons-nous demeurer ici éternellement ? Sur mon âme ! il y a de quoi devenir enragé, de tant attendre !
Le vieillard releva doucement la tête, et, fixant un regard tranquille sur son compagnon :
— Patience, Pierre, dit-il d’une voix calme, il n’est pas tard encore.
— Patience ! cela vous est facile à dire, à vous, monsieur d’Ogeron, grommela celui auquel on avait donné le nom de Pierre : sais-je, moi, où ce diable incarné est fourré en ce moment ?
— Le sais-je plus que toi, mon ami ? et pourtant, tu le vois, j’attends sans me plaindre.
— Hum ! reprit Pierre, tout cela est bel et bon… Vous êtes son oncle, vous, au lieu que moi je suis son matelot, ce qui est bien différent.
— C’est juste, répondit en souriant M. d’Ogeron, et, en qualité de matelots, vous ne devez avoir rien de caché l’un pour l’autre, n’est-ce pas ?
— C’est cela même, monsieur. D’ailleurs, vous le savez aussi bien que moi, vous qui, dans votre jeunesse, avez longtemps fait la course contre les Gachupines.
— Et c’était le bon temps, Pierre, fit M. d’Ogeron en étouffant un soupir. J’étais heureux alors ; je n’avais ni chagrins ni soucis d’aucune sorte.
— Bah ! nul ne peut être et avoir été, monsieur. Vous étiez heureux alors, dites-vous ? Eh bien ! ne l’êtes-vous donc pas aujourd’hui ? Tous les Frères de la Côte, flibustiers, boucaniers ou habitants, vous aiment et vous révèrent comme un père ; moi le premier, nous nous ferions hacher pour vous. Sa Majesté, que Dieu protège, vous a nommé notre gouverneur : que pouvez-vous désirer de plus ?
— Rien ; tu as raison, Pierre, répondit-il en hochant tristement la tête ; en effet, je ne saurais rien désirer de plus !
Il y eut un silence de quelques minutes. Ce fut le boucanier qui renoua l’entretien.
— Me permettez-vous de vous adresser une question, monsieur d’Ogeron ? dit-il avec une certaine hésitation dans la voix.
— Certes, mon ami, répondit le vieillard. Voyons donc cette question.
— Oh ! dame, j’ai peut-être tort de vous demander cela, reprit-il ; ma foi, c’est plus fort que moi, je le confesse.
— Bon ! va toujours. Que crains-tu ?
— Rien que de vous déplaire, monsieur d’Ogeron ; vous savez que je n’ai pas la réputation d’être timide.
— Je le crois bien, toi, Pierre Legrand, un de nos plus hardis flibustiers, dont le nom seul fait trembler les Espagnols.
Pierre Legrand se redressa avec une satisfaction évidente à ce compliment mérité.
— Eh bien ! dit-il du ton d’un homme qui prend un parti décisif, voici ce dont il s’agit. Lorsque mon engagé Pitrians m’a remis votre lettre, naturellement mon premier mouvement a été de vous obéir et de me rendre en toute hâte au rendez-vous que vous m’assigniez ici, au Saumon couronné.
— Je te remercie de l’empressement que tu m’as témoigné en cette circonstance, mon ami.
— Pardieu ! il aurait fait beau voir que je ne fusse pas venu ! c’eût été drôle, sur ma foi ! Donc je suis arrivé, nous avons joué, nous avons bu, fort bien, rien de mieux ; seulement je me demande quel motif sérieux vous a fait quitter Saint-Christophe pour venir incognito à Port-de-Paix.
— Et c’est ce motif que tu désires connaître, hein, Pierre ?
— Ma foi, oui ; si cela ne vous contrarie pas, bien entendu ; sinon, mettez que je n’ai rien dit et n’en parlons plus.
— Parlons-en, au contraire, mon ami ; j’aurais voulu ne te faire cette ouverture que devant mon neveu, ton matelot ; mais puisqu’il s’obstine à ne pas venir, tu vas tout savoir.
— Nous pouvons attendre encore, monsieur d’Ogeron, il ne tardera pas maintenant probablement.
— Peut-être, mais peu importe ; d’ailleurs, il connaît déjà à peu près mes projets, écoute-moi donc.
— Ah ! le sournois, il ne m’avait rien dit.
— Je le lui avais défendu.
— Alors, c’est différent ; il a bien fait de se taire.
— Écoute-moi avec attention, car la chose en vaut la peine. Tu te rappelles, n’est-ce pas, comment le chevalier de Fontenay, attaqué à l’improviste par une escadre espagnole, fut, après une résistance héroïque, forcé d’abandonner la Tortue ?
— Certes, je me le rappelle, monsieur d’Ogeron, et c’est un fier crève-cœur pour nous tous de voir flotter le pavillon espagnol sur le port de la Roche, et d’être ainsi nargués par ces maudits Gavachos qui semblent nous rire au nez ! Vive Dieu ! je ne sais ce que je donnerais pour jouer un bon tour à ces dons maudits et les voir déguerpir de notre île.
M. d’Ogeron écoutait en souriant le boucanier. Lorsqu’il se tut, il se pencha vers lui, posa sa main sur son épaule et le regardant bien en face :
— Eh bien ! Pierre, mon ami, lui dit-il d’une voix basse et contenue, moi aussi je veux jouer un bon tour aux Gavachos et les chasser de notre île.
— Eh ! fit Legrand avec un tressaillement nerveux, dites-vous vrai ? Est-ce bien réellement votre intention ?
— Sur mon honneur, Pierre, voici pourquoi j’ai quitté Saint-Christophe, et je suis venu incognito à Port-de-Paix ; il ne manque pas d’espions espagnols ici ; il est inutile qu’ils sachent que je me trouve si près de la Tortue.
— Ah ! bon ! s’il en est ainsi, nous allons rire.
— Je l’espère.
— C’est un coup de main, n’est-ce pas ?
— Pardieu ! nous rendrons aux Gavachos la monnaie de leur pièce ; ils nous ont surpris, nous les surprendrons.
— Parfait ! s’écria-t-il en se frottant joyeusement les mains.
— J’ai compté sur toi, Pierre.
— Vous avez bien fait, monsieur d’Ogeron.
— Tu comprends que je ne suis pas au courant de vos affaires ; j’ignore complètement ce qui se passe ici ; j’ai donc besoin d’être renseigné ; nul ne peut mieux que toi m’apprendre ce que j’ai besoin de savoir.
— Interrogez, je répondrai, monsieur d’Ogeron.
— Quels capitaines avons-nous ici en ce moment ?
— Hum ! fit-il en se grattant le front, nous sommes assez pauvres en hommes, monsieur. Cependant il y a quelques vieux Frères de la Côte sur lesquels, au besoin, on pourrait compter.
— Diable ! c’est fâcheux. Qu’est devenu l’Exterminateur ?
— Montbars est parti, il y a de cela six mois, et depuis on n’en a pas eu de nouvelles.
— Diable, diable ! dit le vieillard d’un air pensif.
— C’est comme cela. Morgan, le Beau Laurent, Belle-Tête, David, Roc le Brésilien, l’Olonnais, Vent-en-Panne, tous sont dehors, morts peut-être, nul ne le sait.
— Oh ! oh ! voilà qui est fâcheux. Qui nous reste-t-il donc alors ?
— Dame ! il y a moi d’abord.
— C’est juste, mais ensuite ?
— Ensuite, à part quatre ou cinq de véritablement solides, je ne vois personne.
— Quels sont ces quatre ou cinq ?
— Michel le Basque, Drack, le Poletais, votre neveu Philippe.
— Qui encore ?
— Je n’en vois pas d’autres.
— Hum ! c’est bien peu, car l’affaire sera rude ; les Gavachos ne se laisseront pas prendre ainsi.
— Pardieu ! je l’espère bien ; mais les noms que je viens de vous citer vous sont connus de longue date, monsieur, ce sont ceux d’hommes déterminés.
— Je le sais, mon ami, mais si nous échouions, ce serait pour nous un échec irréparable ; mieux vaudrait peut-être nous abstenir.
— Je ne suis pas de cet avis, monsieur d’Ogeron, chacun de nous peut réunir quelques aventuriers résolus.
— C’est vrai, mais la Tortue est à peu près imprenable, surtout si elle est bien défendue, et elle le sera.
— Pour cela, vous pouvez être tranquille. Don Fernando d’Avila, qui commande la garnison espagnole, se fera tuer ainsi que tout son monde plutôt que de se rendre.
— Tu vois bien, alors, que ce serait une folie de nous obstiner à tenter de le déloger avec des forces aussi restreintes que celles dont nous disposons.
— Bah ! est-ce que nous avons jamais compté nos ennemis, nous autres ? Les Frères de la Côte d’aujourd’hui sont ce qu’ils étaient de votre temps, monsieur d’Ogeron, croyez-le bien, chacun de nous vaut dix Gavachos.
— Ah ! pourquoi Philippe ne vient-il pas ? il nous aurait donné un bon avis, peut-être.
— Philippe vous aurait parlé comme moi, monsieur d’Ogeron.
— C’est possible, mon ami ; mais l’affaire est grave et mérite qu’on y réfléchisse sérieusement.
— Réfléchissez-y, soit ; mais n’y renoncez pas. Car je vous jure que maintenant que je connais vos projets, l’eau me vient à la bouche, et si vous nous abandonniez, vive Dieu ! je prendrais l’île sans vous, aussi vrai que je me nomme Pierre Legrand et que je déteste les Espagnols ! Je ne sais pas comment je ferai, par exemple ! mais c’est égal, je suis certain que je réussirai.
M. d’Ogeron se mit à rire à cette boutade du flibustier.
— Voyons, calme-toi, mauvaise tête, dit-il, je n’ai pas dit que je renonçais.
— À la bonne heure, donc !
En ce moment un homme entra dans la salle ; il s’arrêta un instant sur le seuil de la porte, jeta un regard soupçonneux autour de lui ; puis, ayant reconnu sans doute les deux personnages qui seuls se trouvaient dans l’auberge, il se débarrassa de son manteau et s’avança à grands pas vers eux.
— Eh ! s’écria Pierre, voilà Philippe, enfin ! Bonsoir, matelot, ajouta-t-il en lui tendant la main.
— Bonsoir, Pierre, répondit le nouveau venu, me voici, que me veux-tu ? Vive Dieu ! il faut que la chose en vaille la peine ! sinon je t’avertis que je te garderai rancune de m’avoir contraint à venir te trouver ici, lorsque j’avais la perspective d’un passe-temps bien autrement agréable.
Pierre éclata de rire.
— Regarde, dit-il en désignant M. d’Ogeron, qui, en voyant entrer son neveu, s’était mis un peu dans l’ombre.
Philippe se tourna vers lui.
— Eh ! mais, s’écria-t-il joyeusement, je ne me trompe pas : mon bon oncle, est-ce bien vous ?
— Pardieu, qui veux-tu que ce soit ! dit Pierre d’un ton goguenard.
— Cela vous fait donc plaisir, de me voir, mon neveu ? répondit le vieillard.
— En doutez-vous, mon oncle ? s’écria-t-il en se jetant dans les bras que M. d’Ogeron ouvrait pour le recevoir.
— Non, Philippe, je n’en doute pas, dit-il avec émotion, je sais que vous m’aimez.
— Merci, mon oncle. Ah çà ! quel bon vent vous amène ? venez-vous vous fixer parmi nous ? ce serait une bien agréable surprise à me faire.
— Peut-être, mon neveu ; je ne puis encore vous dire ni oui ni non, cela dépendra de certaines conditions.
— Voyons ces conditions, mon oncle ; je vous avertis tout d’abord que je les accepte les yeux fermés.
— Bon, voilà que tu vas trop vite en besogne, à présent.
— Pourquoi donc ? Ne dois-je pas désirer de vous voir demeurer auprès de moi ?
Tout en parlant ainsi, il avait pris un siège et s’était assis entre son oncle et son matelot.
Philippe était un beau jeune homme de vingt-cinq à vingt-six ans, à la taille élancée et bien prise ; son corps un peu grêle, mais nerveux, semblait doué d’une vigueur peu commune et d’une rare agilité.
Son visage était merveilleusement beau ; sa physionomie douce aurait paru efféminée sans l’éclat fulgurant qui jaillissait de ses yeux noirs à la plus légère excitation et l’expression d’indomptable énergie qu’elle prenait alors.
Malgré le costume plus que simple qu’il portait, il y avait dans toute sa personne une élégance native et une distinction qui perçaient malgré lui et dénotaient la race.
Son oncle l’examinait avec complaisance et semblait ne pouvoir se rassasier de le voir.
Le jeune homme sourit, et embrassant encore le vieillard :
— Voyons, lui dit-il, pourquoi ne m’avez-vous pas averti de votre venue, mon oncle ? j’aurais été si heureux de connaître l’époque de votre arrivée. C’est mal de me surprendre ainsi.
— Le regrettes-tu, mon neveu ?
— Loin de là ; seulement j’aurais préféré qu’il en eût été autrement.
— C’était impossible, Philippe ; ma présence ici doit, jusqu’à nouvel ordre, être ignorée de tous : je suis venu incognito.
— Ah ! fit-il, ceci change complètement l’affaire ; vous avez quelque projet, sans doute ?
— Oui, interrompit Pierre, et un grand projet, même.
— Tiens, tu es au courant, toi, à ce qu’il paraît, matelot ?
— Pardieu ! si je suis au courant.
— Bien, mon oncle me le dira, alors.
— Je ne demande pas mieux, d’autant plus que je désire avoir ton avis.
— Quoi que ce soit, vous avez raison, mon oncle.
— Tu ne sais pas encore de quoi il s’agit, fou que tu es ! répondit en riant le vieillard.
— Cela ne fait rien, mon oncle ; il est évident pour moi que vous ne pouvez avoir tort. Maintenant, parlez ; je vous écoute.
— En deux mots, le motif de mon voyage, le voici : je veux, avec l’aide de mes anciens compagnons, reprendre l’île de la Tortue et en chasser les Espagnols.
— Ah ! fit le jeune homme d’une voix étranglée en devenant subitement pâle comme un cadavre.
Chapitre 2 La chapelle de la Vierge
Chapitre 2La chapelle de la Vierge
A quinze ou seize lieues environ de Port-de-Paix, au milieu d’une savane magnifique, traversée par un large cours d’eau et abritée du vent de mer par de hautes montagnes boisées, s’élève une charmante petite ville espagnole, nommé San-Juan-de-Goava, qui contenait alors quatre à cinq mille habitants. À cause de sa situation qui l’exposait aux attaques des aventuriers, elle était entourée de fossés et de murs en terre battue, qui lui formaient des remparts suffisants pour résister à un coup de main de ses hardis voisins.
Presque au milieu de la rue principale de cette ville se trouvait alors une maison en briques rouges, dont le portail, soutenu par deux colonnettes artistement travaillées, supportant un fronton, donnait accès dans une vaste cour, au centre de laquelle se trouvait un puits.
Un perron à double escalier conduisait dans l’intérieur du principal corps de logis, flanqué à droite et à gauche par des tourelles curieusement sculptées.
Le jour où commence notre histoire, vers huit heures du matin, la plus grande animation régnait dans cette maison qui était alors une hôtellerie ou posada, et qui, à présent, sans doute, n’existe plus.
Des valets empressés entraient et sortaient ; des voyageurs arrivaient, d’autres partaient ; des mozos de mulas réunissaient leurs recuas, tandis que des peones sellaient des chevaux ou les conduisaient à l’abreuvoir ; les appels, les cris et les jurons se croisaient dans l’air avec cette volubilité particulière aux peuples méridionaux.
Au moment le plus animé, un cavalier, soigneusement drapé dans les plis d’un large manteau, entra dans la cour.
Un peon, qui sans doute guettait son arrivée, s’approcha vivement de lui, saisit la bride de son cheval, l’aida à mettre pied à terre, et se penchant à son oreille :
— À l’église de la Merced, lui dit-il à demi-voix.
— Merci, répondit le cavalier sur le même ton, et après avoir laissé tomber une pièce d’or dans la main du peon, il tourna le dos sans autrement s’occuper de sa monture, releva les plis de son manteau sur son visage, sortit de la cour et se dirigea à grands pas vers l’église, située un peu plus haut seulement dans la même rue.
Comme tous les monuments religieux espagnols, l’église de la Merced de la ville de San-Juan-de-Goava est un véritable joyau, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Excepté deux femmes enveloppées dans leurs coiffes, agenouillées et paraissant prier avec ferveur, l’église était déserte.
Au bruit causé par l’entrée du cavalier, dont les éperons résonnaient sur les dalles, elles se retournèrent.
L’inconnu fixa sur elles un regard perçant, puis il s’avança jusqu’à un confessionnal placé dans l’angle d’une chapelle latérale, s’arrêta, laissa tomber son manteau, croisa les bras sur sa poitrine et sembla attendre.
Les deux femmes, après avoir échangé quelques mots à voix basse, se levèrent : l’une se dirigea vers la porte de l’église ; l’autre, bien que d’un air timide et craintif, marcha droit au confessionnal auprès duquel se tenait le jeune homme.
Arrivée à quelques pas de lui elle releva ses coiffes et montra le plus délicieux visage de jeune fille de seize ans que puisse rêver un poète.
Le gentilhomme s’inclina respectueusement devant elle, en murmurant d’une voix étouffée par l’émotion :
— Soyez bénie, Juana, pour m’avoir accordé cette entrevue suprême.
— J’ai eu tort, peut-être, répondit-elle avec un accent d’ineffable tristesse, mais je n’ai pas voulu partir sans vous dire un dernier adieu encore une fois.
— Hélas ! murmura-t-il, votre départ est-il donc si prochain ?
— Ce soir, demain au plus lard, la frégate sur laquelle nous nous embarquons doit mettre à la voile ; bientôt nous serons séparés pour jamais ; vous m’oublierez, Philippe.
— Vous oublier ! Juana !… Oh ! vous ne le croyez pas ! s’écria-t-il avec douleur.
La jeune fille hocha tristement la tête.
— L’absence, c’est la mort, murmura-t-elle.
Le jeune homme lui lança un clair regard, et, lui saisissant la main qu’il pressa doucement :
— Vous m’oublierez donc, vous, Juana ? lui demanda-t-il d’une voix tremblante.
— Moi ? Oh ! non, fit-elle ; je mourrai fidèle à mon premier, à mon seul amour. Mais vous, Philippe, vous êtes beau… Séparé de moi par l’immensité des mers, ne devant plus me revoir, une autre femme viendra qui chassera mon amour de votre cœur et mon souvenir de votre mémoire.
Il y eut un court silence.
— Juana, reprit le jeune homme, croyez-vous à mon amour ?
— Oui, Philippe, j’y crois, j’y crois, de toutes les forces de mon âme.
— S’il en est ainsi, pourquoi doutez-vous de moi ?
— Je ne doute pas de vous, Philippe… Hélas ! je crains l’avenir.
— L’avenir est à Dieu, Juana. Lui, qui nous sépare aujourd’hui, peut s’il le veut, nous réunir un jour.
— Jamais je ne reverrai Hispaniola, murmura-t-elle, je le sens ; je mourrai dans ces pays sauvages et inconnus où l’on me condamne à habiter loin de tout ce que j’aime.
— Non, vous ne mourrez pas, Juana ; car si vous ne pouvez revenir, vous, pauvre enfant, moi, je suis un homme ; moi je suis fort ; je saurai vous rejoindre.
— Oh ! fit-elle avec joie. Mais, se reprenant aussitôt : Non, murmura-t-elle, je n’ose croire à tant de bonheur.
Philippe sourit doucement en entendant ces paroles.
— Enfant ! lui dit-il avec tendresse.
La jeune fille lui lança un long regard sous ses paupières demi closes.
— Hélas ! dit-elle, vous êtes un fier et vaillant gentilhomme, Philippe… Bien des femmes se disputent peut-être l’honneur de votre alliance, tandis que moi, je ne suis qu’une pauvre fille…
— Que voulez-vous dire, Juana ? reprit-il avec feu ; n’êtes-vous pas celle que j’aime, que je préfère à toutes ?
— Oui, vous le croyez, Philippe ; vous êtes sincère en me parlant ainsi, mais un jour viendra…
— Jamais ! je vous le répète, Juana.
Elle secoua tristement la tête à plusieurs reprises.
Le jeune homme l’observa avec étonnement, ne comprenant rien à cette méfiance obstinée.
— Philippe, dit-elle enfin avec un accent de tristesse qui serra le cœur du jeune homme, cette fois est la dernière peut-être qu’il nous sera permis de nous voir ; laissez-moi parler, mon ami, fit-elle en posant sa main mignonne sur sa bouche comme pour l’empêcher de l’interrompre ; je ne veux pas me séparer de vous sans que vous sachiez qui je suis. Mon nom, voilà tout ce que vous connaissez de moi… Un jour, il y a deux mois de cela, une jeune fille, qui s’était imprudemment risquée dans la grande savane, avait tout à coup été assaillie par un taureau furieux. Le féroce animal, après avoir éventré deux chevaux, blessé et mis en fuite ses domestiques, accourait vers elle tête baissée en poussant des mugissements terribles ; la jeune fille, folle de terreur, fuyait éperdue à travers la savane, emportée çà et là par son cheval, et sentant derrière elle le galop effréné du taureau qui se rapprochait avec une rapidité vertigineuse. Soudain, au moment où tout espoir la quittait, où elle recommandait son âme à Dieu dans une suprême prière, un homme apparut, se jeta résolument entre elle et le taureau, épaula son fusil : le taureau roulant foudroyé sur le sol vint avec un mugissement de rage impuissante expirer aux pieds mêmes de son vainqueur. Cette jeune fille, c’était moi, Philippe ; son sauveur, c’était vous. Vous vous souvenez de cet événement terrible, n’est-ce pas ?
— Oui, Juana, je m’en souviens pour le bénir ; car je lui dois le bonheur de vous avoir connue, dit-il avec passion.
— Maintenant, écoutez-moi, mon ami. Vous avez peut-être supposé, me voyant richement vêtue et entourée de domestiques nombreux, que j’étais riche et que j’appartenais à une noble famille ?
— Je n’ai rien supposé, Juana ; je vous ai aimée, voilà tout.
Elle soupira en essuyant une larme.
— On me nomme Juana, reprit-elle ; je n’ai jamais connu ni mon père ni ma mère ; on m’a dit que mon père avait été tué dans les guerres avant ma naissance et que ma mère était morte en me donnant le jour. Voilà tout ce que je sais de ma famille ; son nom même n’a jamais été prononcé devant moi. Mes premières années sont enveloppées d’un nuage que je ne suis jamais parvenue à soulever ; je ne me rappelle rien, seulement il me semble que j’ai habité d’autres contrées ; que je suis demeurée longtemps sur mer, et qu’avant de me fixer à Hispaniola j’avais vécu dans des pays où le ciel est moins pur, les arbres plus sombres et le soleil plus froid ; mais ce ne sont que des conjectures qui ne reposent sur aucune base solide. Il me semble aussi avoir entendu parler et avoir parlé moi-même une autre langue que le castillan : mais quelle est cette langue, voilà ce que je ne saurais dire. La seule chose que je crois positive, c’est que je suis protégée dans l’ombre par une famille puissante, qui veille incessamment sur moi et ne m’a jamais perdue de vue. Don Fernando d’Avila, mon tuteur, n’est pas mon parent, j’en suis certaine. C’est un soldat de fortune qui, selon toute probabilité, ne doit la haute position à laquelle il est parvenu et celle plus haute encore qui lui est promise, qu’aux soins dont il a entouré mon enfance. Voici mon histoire, Philippe, elle est bien courte, bien sombre et bien mystérieuse ; mais je devais à l’amour que j’ai pour vous, je me devais à moi-même de vous la faire connaître, et, convaincue que j’ai accompli un devoir sacré, je me courberai sans me plaindre devant votre volonté, quelle qu’elle soit.
Le jeune homme la considéra un instant avec une expression indéfinissable, où se mêlaient à la fois l’amour, la honte et la douleur.
— Juana, dit-il enfin d’une voix tremblante, vous êtes une sainte et noble enfant ; votre cœur est pur comme celui des anges ! Je suis indigne de votre amour, car, moi, je vous ai trompée !
— Vous m’avez trompée, vous, Philippe ? c’est impossible ! fit-elle avec un radieux sourire ; je ne vous crois pas.
— Merci, Juana… Mais à mon tour de vous faire connaître qui je suis.
— Oh ! je le sais, vous êtes un beau et brave gentilhomme que j’aime ; que m’importe le reste !
— Laissez-moi parler, Juana : lorsque vous saurez tout, vous me condamnerez ou vous m’absoudrez. Je suis gentilhomme, vous avez dit vrai, gentilhomme de grande race même, mais je suis pauvre.
— Que me fait cela, à moi ?
— Rien, je le sais ; mais il me reste un secret à vous dévoiler ; secret terrible qui, lorsque vous le saurez, brisera peut-être à jamais mon bonheur.
— Continuez, dit-elle en hochant la tête avec un mouvement de mutine incrédulité.
— Je ne suis pas Espagnol, Juana.
— Je le sais, fit-elle en souriant ; je sais encore que vous êtes Français, que, de plus, vous êtes un des chefs de cette terrible association de Ladrones, ainsi que les nomment les Espagnols, devant laquelle tremble la puissance castillane : est-ce donc là, Philippe, le secret terrible que vous hésitiez à me révéler ? Allez, mon ami, il y a longtemps que je suis instruite de tout ce qui vous touche ; n’êtes-vous pas une partie de mon être ?
— Ainsi vous me pardonnez !
— Qu’ai-je à vous pardonner, Philippe ? Je ne suis pas un homme, moi ; sais-je même seulement si je suis Espagnole ? Ces querelles et ces haines ne m’intéressent pas ; je suis femme et je vous aime, voilà tout ce qui me regarde.
— Oh ! soyez bénie pour ces paroles, Juana, elles me rendent la vie.
— Vous avez douté, Philippe ?
— Je n’osais espérer, répondit-il doucement.
— Les femmes seules savent aimer, murmura-t-elle avec tristesse ; hélas ! il va falloir nous séparer.
— Oh ! pas encore, rien ne nous presse.
— À quoi bon augmenter notre douleur en prolongeant des adieux cruels ?
— Ne voulez-vous donc plus nous revoir ?
— Hélas ! après ce que je vous ai appris, me jugerez-vous encore digne de vous, moi qui ne suis qu’une pauvre fille ?
L’œil de Philippe lança un fulgurant éclair.
— Venez, lui dit-il.
— Où me conduisez-vous ?
— Venez, Juana, c’est au pied de cet autel que je veux vous répondre.
Elle le suivit, tremblante d’espérance et de crainte, jusqu’à une chapelle latérale dédiée à Notre-Dame des Douleurs.
— À genoux près de moi, Juana, et retenez bien les paroles que je vais prononcer ; recevez le serment que je vais faire en présence de la Mère de Dieu.
La jeune fille s’agenouilla sans répondre.
— Je jure, dit alors le jeune homme d’une voix ferme, de ne jamais aimer que vous ; je jure de vous rejoindre quel que soit le lieu où vous alliez ; je jure d’être près de vous avant un an. Que la Vierge, qui voit et m’entend, me punisse si je fausse ce serment que je prononce du plus profond de mon cœur.