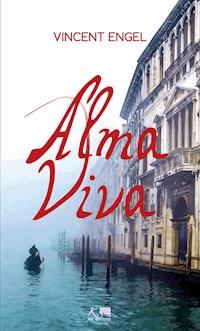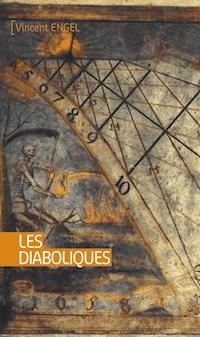
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ker
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Décor : Paris sombre du XIXe siècle
1855. Allongé dans une sordide mansarde du Marais, Gustave Morgan agonise, dévoré par la vérole et le remords. La confession qu’il livre à son homme de confiance éclaire d’un jour nouveau la vie dissolue qu’il a menée. Croyant soulager sa conscience, il ne sait pas encore que la plus belle ruse du Diable est de vous persuader qu’il n’existe pas.
Cette confession n’est que le prélude à une succession de retournements de situations qui enserrent peu à peu Gustave et tous ceux qui lui furent chers dans une logique implacable et terrifiante.
Plongez-vous sans plus attendre dans ce roman aux allures gothiques, à la découverte d’un Paris angoissant...
EXTRAIT
Ce qu’il y a à dire de ma personne tiendra en peu de lignes ; et si ces quelques renseignements n’étaient pas nécessaires à la bonne compréhension du récit qui suivra, je m’en serais abstenu avec plaisir, tant il est vrai que j’exècre me mettre au premier plan. L’abbé Ducret aurait peut-être évoqué ma « remarquable modestie naturelle » qui, selon lui, déterminait mon caractère. Mais outre que la modestie est une qualité qui se dissout sitôt qu’on se l’adjuge, je pense qu’il s’agit davantage, dans mon cas, d’un besoin inné de demeurer dans l’ombre. Il ne faut voir là qu’un souci fort commun de sérénité. Sans doute l’abbé y verrait-il encore un effet de cette vertu, ce dont je me garderai bien toutefois.
CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE
- « Vous succomberez au charme maléfique de ces
Diaboliques qui louchent du côté de Maupassant et de Barbey d’Aurevilly. Au 19e siècle, Fabian s’éprend de la fantasque Lucie. Mais une histoire familiale tue leur amour dans l’œuf. Ensemble, ils sont confrontés à une série d’épreuves effroyables et leurs chemins finissent par se séparer. Leurs confessions mutuelles – autant de coups de théâtre – vont venir clarifier les crimes du passé… et laisser le lecteur pantelant, stupéfait de s’être laissé berner par les miroirs aux alouettes tendus par un Vincent Engel très en verve. »
(Femmes d’aujourd’hui)
- « Une fable sur les turpitudes humaines aux allures de thriller. Une intrigue bluffante par son ingéniosité et sa succession de retournements. »
(L’Avenir)
- « La fascination pour le mal est à l’œuvre dans un livre qu’on ne parvient pas à abandonner en route, les engrenages savants du récit étant de ceux qui vous avalent en entier une fois que vous y avez mis un doigt. Une habileté retorse aspire le lecteur convaincu après quelques surprises que le personnage le plus diabolique ne sera pas celui qui a été désigné comme tel. »
(Pierre Maury, Le Soir)
A PROPOS DE L’AUTEUR
Professeur de littérature contemporaine à l'Université catholique de Louvain (UCL) et d'histoire contemporaine à l'IHECS, il a écrit de nombreux essais, romans, nouvelles ou pièces de théâtre. Il est aussi critique littéraire et chroniqueur ; à ce titre, il a collaboré avec Le Soir, Victoire (supplément hebdomadaire du Soir) et Mint en radio. Depuis 2014, il collabore avec La Première, en tant que chroniqueur au sein de l'équipe de l'émission CQFD.
Pour en savoir plus sur l'auteur rendez-vous sur son site :
http://www.edern.be/vincentengel/
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vous succomberez au charme maléfique de ces « Diaboliques » qui louchent du côté de Maupassant et de Barbey d’Aurevilly. – Femmes d’aujourd’hui
D’évidences en mystère, de certitudes en perplexité, on se laisse subjuguer par les soubresauts d’une histoire qui multiplie les points d’interrogation tout en instillant le trouble. – La Libre Belgique
Vincent Engel manie finement sa plume, comme le mousquetaire manie son fleuret. Précise, délicate, efficace dans la mise à mort. […] Un surprenant et magnifique Engel ! – Ubu Pan
Engel signe une intrigue bluffante par son ingéniosité et la succession de ses rebondissements. – L’Avenir
Première partie
CE QU’IL Y A À DIRE de ma personne tiendra en peu de lignes ; et si ces quelques renseignements n’étaient pas nécessaires à la bonne compréhension du récit qui suivra, je m’en serais abstenu avec plaisir, tant il est vrai que j’exècre me mettre au premier plan. L’abbé Ducret aurait peut-être évoqué ma « remarquable modestie naturelle » qui, selon lui, déterminait mon caractère. Mais outre que la modestie est une qualité qui se dissout sitôt qu’on se l’adjuge, je pense qu’il s’agit davantage, dans mon cas, d’un besoin inné de demeurer dans l’ombre. Il ne faut voir là qu’un souci fort commun de sérénité. Sans doute l’abbé y verrait-il encore un effet de cette vertu, ce dont je me garderai bien toutefois.
J’ai grandi dans un village de la Brie. Mes parents étaient propriétaires d’une des principales exploitations agricoles de la région. J’eus une enfance paisible et reçus une bonne instruction. Mes frères aînés, au nombre de trois, étaient plus attirés par les travaux des champs ; j’avais pour ma part l’âme plus sensible aux arts et aux choses de l’esprit. Trois garçons suffisaient à assurer l’avenir du domaine ; la porte d’une autre carrière s’ouvrait donc pour moi.
Pour ses affaires, mon père recevait souvent la visite de M. Francis, négociant en viande installé dans le village voisin qui fournissait les halles de Paris des meilleures viandes, dont la plupart provenaient de nos troupeaux. L’entente entre les deux hommes était à la mesure des bénéfices que leur relation commerciale générait : excellente. Mais ce n’était pas pour cette raison que j’appréciais les visites de M. Francis ; il avait coutume, du moins les jours où il n’y avait pas école, de venir accompagné par sa fille Lucie. Elle avait mon âge et nous étions amis depuis la plus petite enfance. Avec le temps, cette amitié se mua en un sentiment plus sérieux, même s’il est réputé causer des troubles chez ceux qui en sont atteints.
Lucie était enfant unique. Dans le village, on colportait la rumeur que Mme Francis ne pouvait plus engendrer. Lucie n’était point disposée comme moi pour l’école ; mais elle avait de l’esprit et une imagination très vive. Elle aimait aussi nos conversations où je tentais de lui communiquer – et souvent avec succès tant il est vrai que l’amour rend pédagogue – mes passions et mes découvertes. De son côté, elle m’éblouissait par les jeux infinis qu’elle inventait sans relâche, quand elle ne s’amusait pas à m’emmener dans les entrepôts paternels où, aussi à l’aise qu’un boucher et malgré une taille frêle et des bras fluets, elle tranchait, découpait et débitait les carcasses en riant de mon air effaré. Nous cœurs étaient, à l’évidence, destinés l’un pour l’autre ; et si mes frères en avaient parfois ri, tous se convainquirent qu’une union serait, pour les deux familles et leurs entreprises respectives, une heureuse perspective.
On pourrait croire, en me lisant, que tout le pays était au courant de notre idylle. C’était sans compter sur la discrétion naturelle des acteurs de ce jeu. Les projets économiques de nos parents nécessitaient le secret. Quant à Lucie et moi, peu sensibles à cette dimension des choses, nous n’avions nulle envie de porter sur la place publique ce qui, en outre, participait des certitudes enfantines que l’on découvre en tremblant au fil de l’adolescence.
L’âge adulte approchait, pareil à la terre promise se dessinant à l’horizon du regard de Moïse. Quoique toujours discrets, nous nous montrâmes davantage. Nous allions l’un et l’autre fêter nos dix-huit ans, en cet été 184*, lorsque l’abbé Ducret nous convoqua tous les deux dans la cure. Nous nous rendîmes au rendez-vous, intrigués mais sans inquiétude ; nous avions l’un et l’autre l’âme aussi pure et sereine que des nouveau-nés.
Nous connaissions bien l’abbé Ducret qui, comme il le faisait sans doute pour tous les enfants de sa paroisse, nous portait une attention bienveillante et discrète. Il nous fit entrer dans un petit salon et nous fûmes immédiatement surpris par son air embarrassé. Nous ne l’avions jamais vu dans cet état et cela finit par nous alarmer ; se pouvait-il que, sans le savoir, nous eussions enfreint un commandement ?
— Mes enfants, mes chers, mes pauvres enfants ! s’exclama l’abbé en nous invitant à prendre place. Les desseins du ciel sont impénétrables et je ne sais comment vous dire ce que je dois pourtant, et de toute urgence, vous révéler ce soir… Mais je ne puis me détourner de mon devoir, car le danger qui vous menace est terrible ; et il rentre une part de négligence de ma part dans ce drame, qui m’interdirait à elle seule, si j’en avais l’envie, de ne pas assumer cette impérieuse responsabilité.
Ce grave préambule l’avait épuisé et il resta un long moment la tête entre les mains, cherchant sans doute le calme et l’inspiration. Nous n’osions bouger, redoutant les paroles que l’homme de Dieu allait nous adresser ; et nous redoutions l’annonce d’un châtiment exemplaire pour quelque faute impardonnable que nous eussions commise à notre insu. Mais rien n’aurait pu nous faire supposer l’invraisemblable nouvelle que préparait avec peine l’abbé Ducret. Il se ressaisit et nous regarda, les paumes de ses mains mouillées par les larmes qui coulaient encore sur son visage.
— J’ai appris, Lucie et Fabian, que vous cœurs s’aimaient d’un amour pur et sincère…
Le faible sourire qu’il eut pour évoquer les sentiments qui nous liaient nous rassura un peu ; mais ce n’était que rendre la suite plus douloureuse.
— Je suis bien aveugle et vous, bien discrets, pour n’avoir rien remarqué plus tôt !
Nous eûmes même à ces mots un petit rire qui s’effondra devant le masque à nouveau tourmenté de l’abbé.
— J’étais trop confiant, hélas ! et trop préoccupé par d’autres soucis qui me semblaient plus urgents. Quelle erreur, juste ciel !
Il se releva d’un bond et vint nous prendre la main à chacun, qu’il serra avec force.
— Avant de vous faire cet aveu, promettez-moi, mes enfants, sur ce que vous avez de plus cher, de plus sacré, de vous soumettre au double décret de Dieu et des hommes…
Trop impressionnés, nous promîmes d’une voix si tremblante que l’abbé nous fit répéter notre serment. Il joignit alors les mains et sourit tristement.
— Ah ! mes enfants, vous êtes des anges et des exemples pour ceux de votre âge ! Voilà…
Il se mit à déambuler de long en large et parla sans cesser de nouer et dénouer ses doigts.
— Il y a dix-huit ans de cela, un homme qui m’était connu et dont la respectabilité était on ne peut meilleure, vint me trouver avec une jeune femme qui se trouvait dans une situation fort embarrassante…
Elle devait l’être, car le simple fait de l’évoquer en termes si voilés avait rendu l’abbé écarlate.
— Vous êtes si jeunes encore, et si peu avertis de ces choses ! Je sais qu’à la campagne, certains apprentissages sont plus précoces et plus… naturels, mais j’ai tant de scrupules à embrouiller vos âmes ! Pourtant, je dois poursuivre… Cet homme, dont je ne peux révéler le nom, était un des meilleurs que je connusse ; il venait à moi pour que je l’aide à se sortir de ce pas délicat dans lequel lui et cette jeune personne avaient eu l’imprudence de se mettre. Le souci sincère de réparer autant que possible la faute commise, dans les limites étroites où la loi de Dieu rencontre celle des hommes, leur volonté de s’amender, l’amitié que je lui portais, tout cela me conduisit à leur apporter mon aide. La demoiselle s’installa chez une brave femme du pays en qui je pouvais avoir toute confiance, tant pour silence que ses capacités de sage-femme. Durant quatre mois, elle vécut recluse dans cette ferme isolée. Son ami lui rendait visite aussi souvent qu’il lui était possible, ce qui ne l’était guère. Je vins aussi, plus régulièrement, et j’envisageai avec elle ce qui serait la meilleure solution pour l’enfant. Nous fîmes le tour des familles possibles et nous arrêtâmes d’un commun accord sur tes parents, mon petit Fabian.
Fallait-il que nous fussions naïfs, Lucie et moi ! À ce point de la discussion, nous n’envisagions toujours pas le moins du monde où l’abbé voulait en venir. Mais il était lancé, à présent, et parlait à vif débit, marchant sans relâche et fuyant nos regards qui le dévoraient d’inquiétude et d’incompréhension.
— Mais nous n’étions pas au bout de nos peines ! Au terme de cette attente, cette jeune personne mit au monde, à notre stupeur, non pas un enfant mais deux… nous avions convenu d’un stratagème pour que l’arrivée de Fabian soit perçue par le village comme une naissance naturelle ; mais le père des enfants exigea qu’ils fussent séparés et que le secret de la gémellité fût complet. Je connaissais par chance les Francis, qui souffraient de ne pouvoir enfanter. Tout fut organisé prestement. La vérité devait être scellée sur les liens de parenté entre les enfants, même vis-à-vis des parents adoptifs.
Enfin, Lucie et moi comprîmes ce que l’abbé cherchait à nous apprendre : par la plus extraordinaire des coïncidences, celui qui, dès notre enfance, nous était apparu comme le plus adorable des êtres n’était autre que notre jumeau ! L’abbé se tordait les mains devant notre air consterné.
— Hé oui, mes enfants, je vois que vous avez compris votre drame ! J’ai été bien négligent, j’aurais dû prévenir les parents dès le départ, les mettre en garde… Mais les conditions posées par le père, à qui je devais une complète obéissance, me l’interdisaient. Ah ! s’il avait su comment les choses évolueraient, il aurait certainement agi autrement ! Mais il est trop tard, et il ne souffre plus, depuis, que j’évoque devant lui cette affaire qui a failli ruiner sa réputation – ce qui aurait été on ne peut plus préjudiciable pour sa famille légitime autant que pour vous.
Il prit une profonde inspiration et adopta l’expression qu’il affichait pour le sermon du dimanche.
— Tant les décrets divins que la loi des hommes vous interdisent de vous aimer, sinon d’un amour fraternel. J’imagine la douleur que cela suscite en vous ; mais songez que vous avez découvert un frère, une sœur, et que les liens du sang mêlés à ceux du cœur sont les plus forts qui soient…
Il cherchait à nous réconforter. Lucie pleura d’abondance et moi-même demeurai abasourdi un long moment. Mais il fallut se rendre à la raison dont l’abbé Ducret était l’interprète. Lucie, qui était de caractère solide, s’en convainquit en même temps que moi, et l’abbé loua le ciel de notre courage et de notre sagesse. Sur-le-champ, nous convînmes avec lui de ce que nous ferions : désormais, Lucie et moi n’aurions plus l’un pour l’autre qu’une vive amitié et, sans rien dévoiler à nos parents, nous mettrions un terme à nos projets d’union. Afin de ne pas éveiller de soupçon, j’annoncerais mon entrée au séminaire, ce qui ne surprendrait pas tant j’étais studieux et pieux. L’abbé, qui ne s’était jamais vu en aussi mauvaise posture, exultait à présent.
L’annonce surprit nos parents ; mais nous parûmes si déterminés, l’un et l’autre, si heureux même que personne n’osa remettre en cause une décision que l’abbé couvrait en outre de toute son autorité. Je rentrai donc au séminaire et y approfondis les études qui furent, durant ces quelques années, ma plus vive consolation.
Je découvris cependant que je n’étais pas destiné à une mission pastorale. Déjà timide de nature, je me sentais incapable de prendre en main un groupe aussi considérable qu’une paroisse. L’abbé Ducret, qui nous suivait à présent avec un amour tout paternel, me trouva alors un poste de confident auprès d’un jeune homme très riche, Gustave Morgan, qui habitait un château dans la région d’Orléans. Il me fallait exercer auprès de lui une fonction de conseiller non seulement sur le plan spirituel mais aussi sur tous les autres aspects de ses activités. La solidité de ma formation ainsi que mon intérêt naturel pour ces matières firent que je convins parfaitement pour cette tâche et qu’une réelle amitié ne tarda pas à s’établir entre M. Morgan et moi.
Avant d’en venir à ce qui constitue le cœur de ce drame, je voudrais répondre aux remarques que ce préambule pourrait susciter. On trouvera peut-être que Lucie et moi nous sommes trop vite soumis et que nous aurions pu, tout au moins, essayer de retrouver nos géniteurs. Mais l’abbé Ducret ne dut même pas prêcher longtemps pour nous persuader que ces démarches auraient été une vaine folie, qui aurait tout détruit et n’aurait rien modifié au fait principal. Animés d’une foi véritable, nous sûmes qu’il n’y avait d’autre voie que dans le pardon et la soumission à un destin dont la finalité nous échappait. Aucun esprit sensé ne pourrait, une fois passé le choc émotif, nous donner tort.
Je quittai donc notre village et gagnai le beau pays de Loire pour entrer au service de Gustave Morgan. Il était plus âgé que moi de neuf ans et était d’un tempérament généreux et bon vivant. Ses principales activités consistaient à vivre et à fréquenter la société, et particulièrement les artistes que Gustave admirait. Ses parents étaient des négociants qui avaient fait fortune et n’avaient plus besoin de travailler pour vivre. Leur domaine était à une soixantaine de kilomètres de là. Ils manifestaient quelque humeur sur la manière dont leur fils menait son existence, laquelle ne correspondait pas exactement à ce qu’ils auraient souhaité. C’est souvent le cas des parents, surtout lorsqu’ils ont travaillé durement pour procurer à leur descendance les conditions d’une vie confortable qui se mue, sous leurs yeux étonnés, en oisiveté. Mais Gustave ne différait pas des jeunes gens de sa condition ; et je peux même affirmer, pour avoir découvert cet univers si différent du mien, qu’il s’y distinguait par une santé morale très au-dessus du niveau moyen.
Lorsque j’entrai en fonction, je me demandai d’ailleurs pour quelles raisons un homme pareil avait ressenti la nécessité de disposer d’un conseiller. Mais je compris rapidement que Gustave – il ne fallut pas trois mois pour que nous nous tutoyions – avait à la fois besoin d’une compagnie, d’un ami de confiance que ses fréquentations ne pouvaient lui offrir et d’un avocat auprès de ses parents. Non qu’il fût coupable : mais je réalisai, non sans tristesse, qu’un étrange poison de l’âme avait amené ces braves gens à considérer qu’aucune action de leur fils ne pouvait être totalement innocente. Cela tenait à peu de chose, sans doute : ils auraient souhaité qu’il devînt un brillant avocat. S’il en avait le diplôme et le titre, Gustave n’exerçait guère. Il avait certes ouvert un cabinet et reçu quelques clients dont il s’était occupé avec compétence. Mais ce labeur l’ennuyait ; il préférait se promener, chasser, participer aux bals et aux fêtes de la région. Pour le forcer à pratiquer son art, ses parents réduisirent la pension qu’ils lui octroyaient. Le droit était une matière qui me plaisait et j’en avais acquis quelques notions ; pour apaiser ses parents, je proposai à Gustave de l’épauler. Sur ses indications, je préparai les dossiers qu’il n’avait plus, ensuite, qu’à contrôler et à plaider – ce dont je n’aurais pu me charger. Après quelques mois, les cas se répétant dans l’accablante monotonie des drames domestiques, il ne dut presque plus intervenir sinon dans la phase ultime du processus – au prétoire.
— Très cher Fabian, tu es une bénédiction ! Tu es exactement le genre d’homme dont j’avais besoin…
— Cherchant un directeur de conscience, tu aurais pu tomber sur quelqu’un de moins curieux des choses séculaires.
— Dès notre première rencontre, j’ai su que tu n’étais pas de cette sorte !
Gustave était ainsi ; de sa haute stature de jeune homme un peu bouffi et jovial, le visage rond bordé d’élégants favoris, il jugeait les gens sur un premier coup d’œil, une première parole. Il n’avait pas trente ans mais en paraissait dix de plus, à cause de sa vigueur et de la fermeté de son regard. Je paraissais être un enfant à ses côtés. Mais ceux qui nous connaissaient comprirent que l’apparence était trompeuse et que j’exerçais sur Gustave une action salutaire. Ce dernier n’était d’ailleurs pas le seul à se féliciter de ma présence, et ma modestie était mise à rude épreuve lorsqu’il décidait de visiter ses parents en ma compagnie – ce qui devint la règle. Ceux-ci avaient immédiatement considéré ma venue comme un bienfait puisqu’ils avaient la certitude que leur fils ne réussirait jamais rien seul et qu’à l’évidence il n’était pas près de rencontrer la femme qui lui conviendrait. Ils se gardèrent cependant, au début, de manifester leur soulagement de manière trop ostensible, par crainte de braquer leur fils qui avait beaucoup d’amour-propre. Mais quand ils constatèrent combien Gustave s’était attaché à moi et reprenait sa vie en main sous l’effet d’une action dont luimême m’imputait tout le mérite, ils ne tarirent plus d’éloges à mon sujet, et particulièrement en ma présence. Gustave ne s’en froissait pas ; il en profitait pour obtenir d’eux ce qu’il n’aurait pu espérer avoir auparavant.