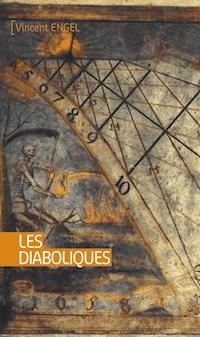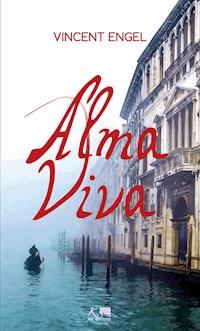Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ker
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Nous sommes tous des faits divers. Tous. Victimes ou coupables de ces gestes anodins sur lesquels le destin bascule. De ce hasard de grain de sable qui nous ensevelit ou nous ressuscite.
À travers ces quatre nouvelles, portées à la scène par Michel Poncelet et Bernard Francq, voici quatre portraits qui nous ressemblent peut-être : un enfant qui ne vit qu’au son de Bach ; un collectionneur prêt au pire pour assouvir sa vengeance ; un inspecteur à la retraite confronté au meurtrier parfait ; un messie clochard qui visite un cercle juif laïc.
Des faits divers ? Peut-être. De ceux dont on tisse l’humanité.
À PROPOS DE L’AUTEUR
Professeur de littérature contemporaine à l'Université catholique de Louvain (UCL) et d'histoire contemporaine à l'IHECS, il a écrit de nombreux essais, romans, nouvelles ou pièces de théâtre. Il est aussi critique littéraire et chroniqueur ; à ce titre, il a collaboré avec Le Soir, Victoire (supplément hebdomadaire du Soir) et Mint en radio. Depuis 2014, il collabore avec La Première, en tant que chroniqueur au sein de l'équipe de l'émission CQFD. Chez Ker, il est l'auteur de nombreuses pièces de théâtre, d'un essai ainsi que de plusieurs romans, comme
Raphael et Laetitia et
Les Diaboliques.
EXTRAIT
Antonio Araldi
L’histoire dont je voudrais vous rendre compte aujourd’hui, inconnue ou presque du grand public, a bouleversé cet univers clos et singulier à plus d’un titre des collectionneurs de voitures. Mais cet émoi ne s’attache qu’à l’accessoire, qu’à l’insupportable dénouement, aux yeux de ce cénacle, d’un drame longuement noué, à travers une destinée où un homme amoureux sacrifia beaucoup à une femme exigeante. Pour ceux qui n’appartiennent pas à ce monde et qui ont eu vent de cette affaire, il ne s’agit que d’une anecdote, une excentricité à ajouter à la panoplie déjà longue de ces amateurs tous plus ou moins fous.
Cette histoire est, en apparence et en vérité, d’une confondante banalité, nonobstant les sommes énormes qui furent nécessaires à son accomplissement – mais cela non plus n’est guère original, quand bien même on considérerait l’argent comme une cause, et non comme un aboutissement. Femme capricieuse, homme richissime, voiture monstrueuse. Sexe, argent, mort. Femme-machine, conduite-virilité. À telle enseigne, on réclamerait le silence, l’abandon d’un récit épuisant de conformisme, mille fois vu, entendu ou lu. On ne tolère pas que les extrêmes soient aussi banals que nos vies quotidiennes, et l’on interdit aux autres ce que l’on s’octroie avec complaisance.
Et c’est bien pour cela que je raconterai l’histoire d’Antonio Araldi. Tout dépend du regard que l’on pose sur les gens, sur les choses, sur les destinées. Le fruit défendu : une vulgaire pomme, sans cesse et par tous dévorée, repoussant partout et sans cesse ; ou un goût délicieux, savouré en silence. Que tout ait été vécu n’atténuera jamais ni la joie ni la souffrance d’un être, pas plus que cela n’empêchera des enfants de naître, de grandir, de mourir. Nous sommes tous des faits divers.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ROMANS Du même auteur
Un jour ce sera l’aube, Roman, Les 400 coups, 2005 (rééd.).
Raphaël et Lætitia, Roman, Ker éditions, 2011 (rééd.).
La Vie oubliée, Roman, L’Instant même, 1998.
Oubliez Adam Weinberger, Roman, Fayard, 2000.
Retour à Montechiarro, Roman, Fayard, 2001.
Mon voisin, c’est quelqu’un, Roman, Fayard, 2002.
Requiem vénitien, Roman, Fayard, 2003.
Les Angéliques, Roman, Fayard, 2003.
Le Don de Mala-Lea, Roman, Le Grand Miroir, 2006.
Les Absentes, Roman, J.-C. Lattès, 2006.
La Peur du paradis, Roman, J.-C. Lattès, 2009.
Le Mariage de Dominique Hardenne, Roman, J.-C. Lattès, 2010.
En espérant que personne ne se reconnaîtra là où il n’est pas, mais que chacun se reconnaîtra là où il pourrait être.
Avant-propos
Quand j’étais gamin, à l’école, on disait « Engel, ta gueule », en prononçant évidemment « Ennegueule ».
Quand j’ai commencé à publier, les lecteurs et les critiques ont tranché : « Engel, nouvelle », en prononçant cette fois correctement mon patronyme, mais en m’enfermant dans une catégorie.
Je n’écris pas que des nouvelles, pourtant, et ce qui m’intéresse, c’est la fiction. Mais chaque genre a ses charmes et ses forces. Parmi celles de la nouvelle, il y a cette proximité naturelle avec le théâtre. J’ai toujours été convaincu que ces deux genres étaient extrêmement proches, bien plus que le roman et la nouvelle. Et Michel Poncelet m’en a apporté la démonstration éblouissante lorsqu’il a créé, en 1995, un spectacle sur quatre nouvelles que je venais de publier, magnifiquement mis en scène par son complice Bernard Lefrancq.
J’avais rencontré Michel au cours de L’Année Nouvelle. Encore la nouvelle ! Un an d’activités que j’avais organisées à Louvain-la-Neuve, de septembre 1993 à juin 1994. Michel avait joué à l’aboyeur lors de la soirée de clôture. Magistral aboyeur !
Quelques années ont passé… Si peu ! Vingt ans durant lesquels, régulièrement, Michel et moi ravivions l’idée de remonter le spectacle. Et voilà que ce rêve devient réalité, comme on dit dans les contes de fées (un autre genre littéraire) !
C’était l’occasion de republier dans un volume distinct les nouvelles qui avaient composé le spectacle original (une a été supprimée pour cette nouvelle version, pour des questions de tempo et de cohérence narrative, mais vous pourrez la découvrir). Et pour remercier aussi mes amis Marie Taillon et Gilles Pellerin, formidables éditeurs québécois à qui je dois mes premières publications, et tout particulièrement les deux recueils dont sont issus ces textes, Légendes en attente et La vie, malgré tout.
Tiens, tout ceci me donne envie de me remettre à la nouvelle ! En est-ce une bonne ? À vous de me le dire !
Antonio Araldi
L’histoire dont je voudrais vous rendre compte aujourd’hui, inconnue ou presque du grand public, a bouleversé cet univers clos et singulier à plus d’un titre des collectionneurs de voitures. Mais cet émoi ne s’attache qu’à l’accessoire, qu’à l’insupportable dénouement, aux yeux de ce cénacle, d’un drame longuement noué, à travers une destinée où un homme amoureux sacrifia beaucoup à une femme exigeante. Pour ceux qui n’appartiennent pas à ce monde et qui ont eu vent de cette affaire, il ne s’agit que d’une anecdote, une excentricité à ajouter à la panoplie déjà longue de ces amateurs tous plus ou moins fous.
Cette histoire est, en apparence et en vérité, d’une confondante banalité, nonobstant les sommes énormes qui furent nécessaires à son accomplissement – mais cela non plus n’est guère original, quand bien même on considérerait l’argent comme une cause, et non comme un aboutissement. Femme capricieuse, homme richissime, voiture monstrueuse. Sexe, argent, mort. Femme-machine, conduite-virilité. À telle enseigne, on réclamerait le silence, l’abandon d’un récit épuisant de conformisme, mille fois vu, entendu ou lu. On ne tolère pas que les extrêmes soient aussi banals que nos vies quotidiennes, et l’on interdit aux autres ce que l’on s’octroie avec complaisance.
Et c’est bien pour cela que je raconterai l’histoire d’Antonio Araldi. Tout dépend du regard que l’on pose sur les gens, sur les choses, sur les destinées. Le fruit défendu : une vulgaire pomme, sans cesse et par tous dévorée, repoussant partout et sans cesse ; ou un goût délicieux, savouré en silence. Que tout ait été vécu n’atténuera jamais ni la joie ni la souffrance d’un être, pas plus que cela n’empêchera des enfants de naître, de grandir, de mourir. Nous sommes tous des faits divers.
*
D’abord, elle lui avait murmuré, un soir : « Je t’aime parce que tu me surprends. » Il l’avait serrée contre lui, pour faire croire qu’il était heureux ; mais il avait eu peur. Il devinait l’enchaînement logique de cette déclaration qui, tôt ou tard, tournerait en sommation : « Je t’aimerai tant que tu pourras m’étonner. Mon amour est entre tes mains. » Il avait fallu quatre ans. Quatre ans de répit, épuisants, pendant lesquels il s’était ingénié à demeurer sur la piste, piste de cirque et de course, où le jetait la passion exigeante de sa femme. Jamais il n’avait songé à lui renvoyer l’argument, il devinait que c’eût été idiot. Chacun de ses mots, de ses gestes lui faisait comprendre, depuis leur rencontre, que le plus étonnant qu’il pouvait attendre d’elle était qu’elle restât avec lui. C’était ainsi. L’argent n’y faisait rien ; elle le quitterait malgré sa fortune, et celle-ci ne lui procurerait aucune femme comparable. Il savait que des couples s’aimaient de concert, en partage, sans condition, sans marché, que certains y trouvaient du bonheur, certains de l’ennui ; il savait que d’autres, hommes et femmes, étaient dans son cas, qui tous ne se plaignaient pas de cette infériorité et de cette menace constante qui, sans doute, donnaient à leurs yeux tout son sel à leur passion. Il ne discutait pas et ne pouvait dire s’il souffrait vraiment. Il aimait sa femme parce que, se disait-il quand il essayait de se trouver une raison d’apaiser une blessure nouvelle, elle était splendide, à la fois glacée et brûlante, imprévisible, parce que les gens se retournaient sur eux, parce que, peut-être, durant ces quelques années où, chaque jour, il avait dû accomplir des exploits pour la conserver, elle avait respecté son rôle et ses répliques : elle l’avait aimé, à sa manière certes, mais exclusivement. Cette fidélité, qui ne laissait pas de surprendre les incrédules, moquant chez lui une soumission qui ne pouvait qu’être synonyme d’infortunes conjugales, cette fidélité seule, finalement, changeait son apparent abaissement en victoire. Même si, tous les matins, il lui fallait se souvenir que ce triomphe ne tenait qu’à un fil sur lequel, inlassablement, il devait accomplir des prouesses pour maintenir son bonheur en équilibre.
Antonio Araldi était donc un homme immensément riche. Dans l’Italie des années 50, près de Sienne, il avait bâti une villa somptueuse, et à proximité, une petite usine, plutôt un grand atelier. Pour ne pas rester inactif, il y construisait des véhicules de rêve, tous rentrés dans la légende et dans les nuits des collectionneurs. C’était son autre passion, celle où il conservait le contrôle, celle qui complétait le tableau de son bonheur. Il passait des mois, entrecoupés de voyages avec sa femme, à concevoir un modèle, qu’il réalisait ensuite à cinquante exemplaires, ni plus ni moins, numérotés et personnalisés selon l’acquéreur. Il n’y gagnait rien : il couvrait ses frais, payait royalement ses ouvriers et mécaniciens, ce qui suffisait à devoir exiger un prix très élevé. L’élite financière du globe se disputait ensuite le droit d’acquérir un spécimen. Quelques mois avant la mise en production, Araldi annonçait l’heureux événement. Des centaines de demandes affluaient, on lui offrait des avances, des primes ; il refusait tout, notait le nom des prétendants sur un morceau de papier. Puis, à la date fixée, il demandait à sa femme de tirer au sort les cinquante privilégiés, lors d’une petite cérémonie où tous tenaient à être présents, même les Américains les plus occupés. Libre ensuite aux malchanceux de se battre en surenchères pour tenter de racheter leur option d’achat aux gagnants.
Une seule ombre à ce tableau clinquant de chrome et d’argent : sa femme refusait de conduire une de ses voitures. Très sportives, elles manquaient, selon la Signora Araldi, de confort : équipement sommaire, sièges et suspensions trop durs… Elle préférait les coupés anglais, et s’était fait offrir une splendide Jaguar, elle aussi « série limitée ».
Araldi toléra cet affront tant que sa femme lui dit l’aimer parce qu’il la surprenait. Mais le jour où, rentrant d’un voyage un peu décevant, elle lui fit comprendre que, désormais, la cause devenait une condition, la vue de la Jaguar garée dans la cour lui devint insupportable. Sans savoir pourquoi, après quatre années, il voulut exiger qu’elle changeât de voiture, qu’au moins elle optât pour une italienne. Ce furent d’abord quelques remarques hasardées au détour d’une conversation anodine. Puis, la première dispute.
On allait procéder au tirage pour la vente du quatrième modèle Araldi. Comme de coutume, une foule de magnats étaient venus assister à cette curieuse élection et partager le plantureux buffet toscan dressé dans le parc. Antonio Araldi se tenait à côté du prototype, avec sa femme. Au moment où l’on apportait l’urne contenant les noms des six cents prétendants, un invité lança, par boutade : « Et vous, Signora Araldi, vous persévérez à rouler en Jaguar ? » Jusqu’alors, elle avait toujours répondu à cette question : « Que voulez-vous ? Il y en a trop peu, et mon mari préfère ses amis à sa femme. » Mais cette fois, elle eut un sourire cruel : « Bien sûr. J’aime trop le confort. » Son mari blêmit, et l’assistance éclata de rire, ravie de cette nouvelle réplique.
Quand ils furent seuls, il laissa éclater sa fureur, exigea la vente immédiate de la Jaguar. Elle le laissa vociférer, sans broncher, jouant distraitement avec un verre de whisky. Il se calma enfin, attendant sa réponse. Elle se releva et, avant de quitter la pièce, se contenta de dire, d’une voix glacée : « Je me demande si tu seras encore longtemps capable de me surprendre. Me surprendre agréablement, bien sûr. »
Il ne la rejoignit pas cette nuit-là. Il se promena dans le parc, puis s’enferma dans l’atelier où il s’endormit sur un matelas, à côté des pièces de carrosserie que, dès le lendemain, on se mettrait à assembler.
Il la retrouva pour le petit-déjeuner. « Si je te dessine une voiture qui serait à la fois la plus confortable et la plus sportive, tu abandonnerais la Jaguar ? » Elle le regarda avec amusement. « Sans doute, oui… Mais attention, Antonio, tu vas confondre art et amour. Il ne restera rien, ensuite, si tu échoues. Ou si tu réussis trop bien. Quoi qu’il en soit, j’ai l’impression que tu joues ta dernière carte. » Il lui répondit par un sourire fatigué, et partit se mettre à l’ouvrage.
Durant des mois, il se consacra à la création de cette voiture parfaite, évitant de rencontrer sa femme, qui fut d’ailleurs absente très souvent, préférant passer ces journées solitaires dans une villa qu’ils possédaient sur la côte adriatique. Il travaillait fébrilement, sans relâche, du soir au matin, du lundi au dimanche, hurlant de joie ou de rage au gré des étapes. Pour la première fois depuis son mariage, il se sentit devenir jaloux. Il se demandait, dès qu’il interrompait sa tâche, ce que sa femme faisait à cet instant, avec qui elle pouvait se trouver. Il la soupçonnait, mais refusait de la faire surveiller, ce qui ne pouvait qu’accroître sa suspicion. Il dormait mal. Ses employés s’inquiétaient : lui qui, jusque-là, s’était toujours amusé en travaillant, s’énervait, tempêtait. Fréquemment, le matin, on le retrouvait endormi dans l’atelier, sur des plans. Mais le prototype, lentement, prenait forme.
Pour l’habitacle, il avait débauché les plus grands spécialistes italiens. Il prévoyait d’utiliser les essences de bois les plus rares, les cuirs et les tissus les plus fins. Lui mit tout son génie dans la conception du moteur, qu’il voulait imbattable, et dans celle de la carrosserie. Il parvint à mettre au point un moteur d’une puissance jusqu’alors inégalée, pas même par un bolide de course. Placé à l’avant du véhicule, ce moteur laissait échapper de la tôle huit tubes chromés de chaque côté. La ligne était elle aussi complètement originale : très basse, large à la hauteur de l’habitacle, resserrée vers l’avant et l’arrière. Les courbes se mariaient aux angles avec une audace exceptionnelle.
Enfin, après trois saisons de souffrances et de joies, d’échecs et de réussites, il estima que le prototype était prêt. Pour la première fois, il choisit de ne pas lui donner un numéro, mais le prénom de sa femme. Il convoqua les meilleurs pilotes de compétition pour qu’ils viennent tester l’engin. Leur verdict fut cruel : effrayés par la puissance du bolide, ils estimèrent que tout, suspension, équilibre, jusqu’au profil de la voiture, était inadapté à son moteur. Ils jugèrent ce monstre impossible à maîtriser. « C’est une bête à tuer ! » déclarèrent-ils à Araldi. C’est lui qui faillit les tuer. Il les flanqua à la porte en les traitant d’incapables.
Sa femme revint le lendemain de ces essais, et elle ne put masquer son étonnement devant la beauté de la voiture, le confort de l’habitacle. Son mari exultait, tout en essayant désespérément de gommer la condamnation des pilotes qui gâchait sa joie. « Autre chose qu’une Jaguar, non ? » Elle acquiesça en souriant, et vint l’embrasser longuement. « Tu comptes la mettre en vente, comme les précédentes ? » Il s’assombrit. « Non, non… ce sera un spécimen unique. Juste pour toi. » Elle fut flattée de ce privilège. « Mais tu dois me promettre une chose, mon amour, murmura-t-il en ne pouvant contenir un léger tremblement de la voix : ne roule jamais trop vite. C’est un bolide, il peut être dangereux si on exagère… » Elle le regarda avec étonnement, puis éclata de rire : « Ne t’en fais pas, Antonio. J’ai toujours su jusqu’où je pouvais aller. » Il la prit dans ses bras. « Alors, tu vas revendre la Jaguar ? — C’est promis, mon cœur. Demain, je la conduis en ville, au garage. Tu ne la verras plus jamais. » Et ils s’embrassèrent comme aux premiers temps de leur amour.
Elle mourut le lendemain, en descendant vers Sienne. Dans un tournant, il est probable qu’elle perdit le contrôle de la Jaguar, qui quitta la route et alla s’écraser dans un ravin.
Cet accident bouleversa la vie d’Antonio Araldi. Il ferma son usine et se retrancha dans sa propriété. Plus personne ne reçut sa visite ou ne lui en rendit. Lentement, on l’oublia. Seules ses voitures restèrent, avec leur légende. Quelques initiés racontaient qu’il s’était mis à collectionner les automobiles, et qu’il avait transformé son atelier en musée — que nul jamais n’avait visité. Sans doute le dernier prototype Araldi, dédié à sa femme et conçu pour conserver son amour, y occupait-il la place centrale.
*
Je travaille pour une importante banque d’affaires européenne, à Paris. Notre directeur m’avait chargé de me rendre, pour un client privilégié, à une vente publique et d’y acquérir, à n’importe quel prix, un exemplaire rarissime de Jaguar – ne me demandez pas de détails, je suis d’une complète incompétence en la matière.
Je ne connaissais d’ailleurs rien de ce monde absurde des collectionneurs et, n’eût été l’ordre impératif de mon supérieur, je me serais enfui depuis longtemps de cette salle des ventes. Je ne sais si je dois à mon métier ou à mon éducation de ne pas supporter le gaspillage, surtout pour de telles raisons. J’ai dû monter à une somme que je qualifie de franchement infernale. Mais j’avais fait mon devoir. Ou presque. Mon directeur m’apprit que l’acheteur tenait à ce que j’accompagne le camion spécial venu d’Italie pour y ramener la voiture.
Antonio Araldi, dont je n’avais jamais entendu parler, avait alors quatre-vingt-quatre ans. C’est un vieillard qui nous accueillit devant la villa toscane où, jadis, le gratin mondial se réunissait pour l’attribution des cinquante nouvelles Araldi. Deux jeunes gens, beaux et musclés, semblables à ces esclaves fidèles que l’on découvre sur les fresques lointaines, s’occupaient de lui. Il se montra fort aimable à mon adresse, tandis que l’un des jeunes gens se dirigeait vers le camion, sans doute pour veiller au déchargement. « Vous devez avoir faim, Monsieur », me dit-il dans un français couleur de Sienne. J’acquiesçai et le suivis sur une terrasse où une table avait été dressée avec deux couverts. J’ignorais en cet instant être la première personne, outre les deux domestiques, à pénétrer dans le domaine d’Antonio Araldi et à le rencontrer depuis le décès de sa femme.
Durant le repas, il parla longuement, à mots lents et mesurés. Il sentait la mort prochaine, m’expliqua-t-il. Il voulait, avant cela, confier son histoire – « l’histoire de ma vengeance, Vendica questo sangue, comme on dit dans l’opéra ». Mais il ne fréquentait plus personne, et il avait choisi dès lors de se fier au hasard. Il me narra donc le récit que je viens de retranscrire fidèlement. Quand il eut achevé, il me regarda fixement et me demanda : « Vous comprenez pourquoi je tenais tellement à racheter cette Jaguar, la même que celle dans laquelle mon épouse a trouvé la mort ? » J’étais très embarrassé. « Puis-je vous confier le fond de ma pensée ? » Il eut un hochement de tête affirmatif. « Vous aviez joint votre amour pour votre femme à celui que vous portiez aux voitures. Il ne vous restait plus que ces dernières ; vous les avez collectionnées pour maintenir vivant le souvenir de votre femme, et lui rendre ainsi un perpétuel hommage. » Il eut un sourire étrange, et se caressa le menton. « C’est une façon de voir les choses… » murmura-t-il enfin. « Venez, vous allez être le premier à visiter mon mausolée. » Il fit signe au jeune homme qui attendait patiemment derrière lui, et je leur emboîtai le pas, intrigué, suivant le rythme lent du vieillard, jusqu’à un énorme hangar que la maison m’avait caché, et devant lequel attendait le camion et son précieux chargement. Araldi appuya sur un bouton, et deux lourdes portes coulissantes s’ouvrirent lentement, dans un grondement infernal. Sans y être invité, je m’avançai.
Au milieu du hangar, éclairé par des centaines de spots aveuglants, installée sur un podium, une idole défigurée : la Jaguar de la Signora Araldi, dont l’avant était complètement écrasé, dressé comme un dérisoire et superbe bras d’honneur. L’état de l’habitacle ne permettait aucune illusion sur le sort de l’occupante. À côté, étincelant, le dernier modèle Araldi, que nul n’avait jamais pu piloter. Sur les murs, des dizaines de photographies géantes, d’une femme très belle et très dure. À leurs pieds, des outils barbares et terrifiants, massues, leviers, pinces, enclumes, vrilles, coins… Et puis, partout dans ce hangar énorme et sinistre, des voitures, par dizaines, désarticulées, pourries, éventrées, dynamitées, déchiquetées, compressées, pour chacune de ces pièces de collection un supplice différent, mais toutes bafouées au nom d’une vengeance vaine et dramatique. Dérisoire.
Araldi, dans mon dos, me laissa faire le tour de ce sanctuaire, le tour de sa souffrance et de son combat, de sa triste victoire. Parfois difficilement, tant certaines voitures étaient devenues méconnaissables, je lisais le nom de modèles à ce point prestigieux qu’il éveillait en moi, pourtant ignare, un frisson curieux. Quelques-unes n’avaient reçu aucun coup, mais avaient dû subir des mois durant l’outrage de la pluie, portes, toit, capot ouverts : leur décomposition exhalait une odeur de cadavre. Je devinai qu’avec cette dernière Jaguar, Araldi allait dramatiquement mettre un terme à sa vengeance, avant que la mort n’en mette un à sa vie. À ce moment, dans mon dos, un bruit puissant de moteur retentit : un des deux jeunes hommes sortait la Jaguar du camion. « Avez-vous déjà vu les bœufs que l’on mène à l’abattoir, Monsieur, ou le taureau qu’on étrille pour la corrida ? » me glissa Araldi, avec le sinistre sourire du tyran à l’agonie ordonnant la destruction de son empire. Sans attendre de réponse, il marcha péniblement vers sa dernière création. L’autre garçon l’aida à prendre place au volant, puis vint s’asseoir à ses côtés. Un rugissement éclata. Je n’avais jamais entendu un bruit pareil, aussi redoutable et terrifiant.
Araldi me fit signe de venir, et me tendit une enveloppe, par la fenêtre. « Vous remettrez ceci au notaire Pignoscelli, à Sienne. Une sorte de testament. L’État italien sera peut-être content de faire de mon musée une attraction touristique. Cela n’a pas la moindre importance. Quant à vous, je vous demanderais de veiller à ce que ces deux dernières pièces viennent y prendre leur place. Je vous fais confiance. »
J’étais trop abasourdi par le spectacle et le bruit pour pouvoir réagir. L’Araldi glissa doucement vers la sortie, abandonnant la Jaguar défigurée, dont le sosie intact attendait patiemment que passe le maître flamboyant au soleil retrouvé d’une longue nuit d’attente. Un épais nuage de poussière s’éleva sur le chemin de terre sèche, tandis que le vacarme des deux voitures lancées à la poursuite de leur folie s’estompait péniblement.
Des traces de peur
Elle fait qu’à tous, petits et grands, riches et pauvres,libres et esclaves, soit donnéeune marque sur la main droite ou sur le front…
Ne me demandez pas pourquoi j’ai choisi ce métier plutôt qu’un autre. Je n’en sais rien, pas plus aujourd’hui que le jour où je me suis engagé. Où j’ai signé, comme on dit. Signé un pacte sans savoir alors avec qui, ni à quoi je m’engageais réellement. Ce matin, je suis venu chercher les quelques affaires personnelles qu’en deux ans de service j’ai réussi à amasser dans le coin de bureau que l’on m’avait affecté. Je m’en vais, et j’ignore presque autant les motifs de mon départ que ceux de mon entrée dans cette honorable maison. Mes collègues m’ont regardé à la dérobée, gênés peut-être, silencieux, gauches quand il leur fallait m’ouvrir une porte et me laisser passer, chargé du cercueil en carton où repose mon maigre passé policier.
En deux ans de police criminelle, j’ai appris qu’il n’y avait rien à apprendre, ni rien à prendre. Gabin aurait été content. Mais je n’ai pas envie de le chanter. Je regarde les sols, les murs, les portes, je repère ces traces invisibles que l’on m’a appris à dépister, et surtout, les grandes zones muettes qui les jouxtent, ces absences qui forment une trace plus néfaste encore.
Elle était belle, et dans une autre histoire, on aurait bien voulu prendre le temps de lui parler, de lui inventer un petit bonheur sur mesure, pour elle seule. Mais il n’y avait plus rien à inventer, le temps l’avait happée avant que je la rencontre, et le pouls de ma montre me parut sacrilège. C’est un voisin qui nous avait alertés, lorsqu’il avait découvert la porte de son appartement grande ouverte, et son corps dans le couloir, bien visible, sans quoi il n’aurait sans doute rien remarqué. Si on devait demander à la police d’enfoncer toutes les portes ouvertes… L’inspecteur principal Bertrand était de mauvaise humeur, il répétait souvent qu’un cadavre matinal lui gâtait sa journée et faisait cailler son café au lait. C’était un manque de savoir-vivre, grommelait-il, et ça, c’était son trait d’humour favori, qui n’avait toutefois jamais ressuscité personne. J’étais depuis trois semaines dans son service, et je le suivais fidèlement, essayant de prendre exemple sur cet expert qui ne m’adressait pas souvent la parole. C’était une caricature d’inspecteur, et moi, de potache consciencieux qui rêvait de devenir un jour caricature principale à la place de la caricature principale.
Notre morte semblait le déranger plus que de coutume, et pas seulement à cause du café caillé. Il faut dire que nous avions alors d’autres chats écrasés à enterrer, et que le climat n’était pas idéal pour la réputation de notre institution. Moi, je la trouvais touchante, mais Bertrand refusait de s’attacher plus que de raison. Non pas qu’il la trouvât laide. Il avait même déclaré, lorsqu’un policier était venu lui glisser les quelques éléments que l’on possédait sur l’identité de la victime : « Sarah L… Décidément, ceux-là, quand ils se mettent à être bien roulés, ils sont bien roulés. Enfin, ça ne l’aidera plus beaucoup, maintenant… » Ensuite, il avait tourné quelques minutes dans l’appartement, sans cacher qu’il s’ennuyait et qu’il aurait voulu s’en aller. Il n’y avait pas de famille, et Sarah — dès ce moment, je me souviens, je l’appelais par son prénom — ne pourrait pas lui en vouloir de cette désinvolture. Pas d’indice, pas de mobile apparent, pas la moindre trace. Un corps mené à l’état de cadavre sous l’action d’une strangulation, et bien entendu, l’assassin portait des gants. Après avoir inspecté les lieux distraitement, Bertrand était revenu dans le corridor et avait fait un geste du menton aux brancardiers pour qu’ils laissent tomber le rideau sur ce spectacle sans autre intérêt que la beauté, trop froide, de l’actrice. « Celle-là, je vous la laisse. Vous devriez être content, pas vrai, mon petit David ? » Et les deux caricatures se saluèrent, heureuses chacune de pouvoir compter sur la bêtise de l’autre.