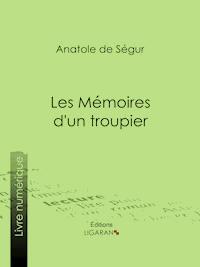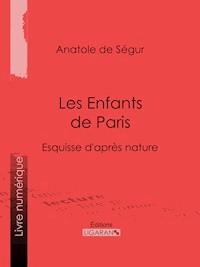
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Quoique nos esquisses et nos anecdotes ne se rapportent pas uniquement aux jeunes employés de commerce ou de bureau, et que nos réflexions s'appliquent pour la plupart à toute la jeunesse parisienne, il nous semble utile de retracer d'abord à grands traits la physionomie générale de cette classe nombreuse et attachante des enfants de Paris que nous avons particulièrement étudiés..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AUX JEUNES GENS des Patronages et des Cercles j’offre cette gerbe de fleurs parisiennes cueillies dans leur jardin par un vieil enfant de Paris
A. DE SÉGUR.
Paris, mai 1893.
Eugène Suë, antique romancier, immortel d’un jour, dont quelques-uns connaissent encore le nom et les œuvres démodés, a tracé, dans le plus célèbre de ses romans, le type un moment populaire du gamin de Paris.
À côté de Monsieur et Madame Pipelet, concierges classiques de 1840 à 1860, il avait inventé Tortillard, nom bien trouvé, qui semblait devoir vivre toujours. Mais les Misérables, de Victor Hugo, jetèrent d’un coup d’aile aux oubliettes les Mystères de Paris, et Gavroche dévora Tortillard sans en laisser rien subsister.
Nous n’avons ni l’imagination d’Eugène Suë, ni le génie de Victor Hugo, et notre prétention n’est pas de créer des types, mais d’esquisser quelques portraits d’après nature.
Ce n’est pas d’ailleurs dans le monde des pâles voyous que nous avons pris nos modèles. Le monde populaire que nous fréquentons, auquel nous sommes mêlé chaque jour par nos œuvres, est surtout celui de ces enfants des frères qui forment la moitié des garçons de Paris, monde très étendu puisqu’il égale ou dépasse la population entière de bien des grandes villes de France.
Un long séjour au milieu de ces chers petits Parisiens, depuis l’écolier jusqu’à l’employé de commerce ou de bureau, jusqu’au jeune ouvrier ou au jeune soldat, nous a familiarisé avec eux, avec leurs familles, avec leurs pensées, leurs sentiments, leurs joies et leurs peines, leurs aspirations et leurs déceptions.
Une correspondance familière et suivie nous a fait pénétrer plus intimement dans leur cœur, et nous a procuré souvent la jouissance exquise dont parle Gœthe « de voir une belle âme s’ouvrir devant soi. »
Nous voudrions, dans nos légères esquisses, donner une idée de cette classe si intéressante de jeunes gens, espérance et réserve de la France chrétienne, et, par le spectacle de leurs œuvres, de leurs qualités et de leurs vertus, reposer un moment l’âme de nos lecteurs des tristesses et des angoisses du temps présent.
A. DE SÉGUR.
Paris, 19 mars 1893.
Quoique nos esquisses et nos anecdotes ne se rapportent pas uniquement aux jeunes employés de commerce ou de bureau, et que nos réflexions s’appliquent pour la plupart à toute la jeunesse parisienne, il nous semble utile de retracer d’abord à grands traits la physionomie générale de cette classe nombreuse et attachante des enfants de Paris que nous avons particulièrement étudiés.
En France, elle compte près d’un million de jeunes gens très dignes d’intérêt par leur condition, leur instruction, leur intelligence et les difficultés de leur vie.
À Paris, ils peuplent les ministères, les grandes administrations publiques et privées, et toutes les maisons de commerce, depuis les immenses magasins, comme ceux du Louvre et du Bon Marché, jusqu’aux plus modestes comptoirs et aux plus petites boutiques de vente au détail.
Les employés de bureau et de commerce occupent une place intermédiaire entre la population ouvrière et la petite bourgeoisie. Ils sont un peu dans le monde des travailleurs ce que sont les caporaux et les sous-officiers dans le monde militaire, sortant comme eux de la troupe dont ils font partie, et s’élevant par degrés jusqu’à des grades parfois importants. Là, comme dans l’armée, beaucoup deviennent officiers, plusieurs officiers supérieurs. Seulement, leur ascension, plus facile à réaliser, est moins facile à préciser ; elle se fait par une suite d’échelons parfois imperceptibles : souvent même l’employé monte sans changer d’emploi. Sa situation s’accroît de mille façons, par son aptitude à faire plus et mieux, par l’expérience des hommes et des choses, par l’importance des affaires qu’on lui confie et du traitement qui grandit avec les affaires ; bref, d’enfant du peuple, de modeste commis de rayon ou de bureau, il devient insensiblement, et parfois sur place, un monsieur, une personnalité qui compte, un chef.
La transformation commence par le costume. Dans beaucoup d’administrations, de maisons de banque ou de commerce, spécialement dans les grands magasins, le chapeau à haute forme est obligatoire dès le jour de l’admission. L’habit noir pour les soirées vient un peu plus tard. D’abord, on le loue, puis on l’achète, et la métamorphose extérieure est complète.
Au moral, les progrès plus lents sont néanmoins rapides. Pour peu qu’un employé tienne à s’instruire, et lise des ouvrages sérieux, son style se forme vite ; s’il y joint des études littéraires, scientifiques, artistiques même, ce qui n’est pas rare, sa tenue et son langage s’épurent, et il arrive à écrire le français comme les lauréats des grandes écoles.
Les élèves des frères entrent presque tous dans le commerce ou dans les bureaux. Paris seul en compte plus de huit à dix mille, sortis de leurs classes et fréquentant leurs patronages. Nous connaissons, beaucoup de ces braves jeunes gens, élevés bien au-dessus de leur condition par l’instruction, la culture intellectuelle, et transformés par la pratique de la foi et des vertus chrétiennes. Il en est même plusieurs parmi eux qui écrivent et rédigent avec une si grande perfection de style, de convenance, de nuances, même les plus délicates, que tels de nos grands hommes politiques pourraient avantageusement les prendre pour secrétaires et leur confier le soin de composer leurs lettres, voire même de préparer et de corriger leurs discours.
Aux lecteurs qui seraient tentés de taxer de chimères de pareilles assertions, il me suffira de rappeler les souvenirs du plus original et du plus classique, du plus pur et du plus grand prosateur de son temps, Louis Veuillot, qui sut écrire le français ! en maître avant d’avoir appris le latin, et qui atteignit au sommet de la gloire littéraire sans être ni bachelier, ni licencié, ni gradé d’aucune façon. Vous me direz qu’il avait le génie des lettres, et que n’a pas du génie qui veut. C’est vrai, mais nous avons l’esprit, qui est la monnaie du génie, et nul n’ignore qu’à Paris l’esprit court les rues.
Il ne faut pas croire cependant, malgré ces brillantes exceptions, que la carrière du commerce et des bureaux soit semée de fleurs et exempte d’épines. Pour l’immense majorité de ceux qui l’adoptent ou la subissent, c’est une voie douloureuse, comme toutes les voies humaines. Sortis presque tous de familles peu fortunées et même sans autre fortune que le travail quotidien, ces jeunes gens vivent au jour le jour, côtoient la pauvreté, et ont besoin de beaucoup de patience pour supporter les difficultés, les angoisses du début.
Il faut d’abord trouver une place, travailler beaucoup pour gagner très peu, quelquefois gratuitement pendant les premiers mois. La place trouvée, il faut la conserver à tout prix, car le manque d’emploi, c’est la gêne, la misère même à brève échéance.
L’existence, l’avenir de ces pauvres employés, surtout dans le commerce, dépendent donc de bien des choses : la bienveillance du patron, la bonne volonté des employés supérieurs, souvent plus capricieuse que celle du maître, et la prospérité de la maison.
Les affaires vont-elles bien, tout va bien ; mais qu’elles viennent à se ralentir, qu’une crise commerciale ou politique éclate, et tout est remis en question ; on remercie poliment une partie des employés, quand on ne les renvoie pas brutalement, et voilà de pauvres jeunes gens jetés sur le pavé, obligés de reprendre le métier ingrat et cruel de coureurs de places.
Qu’on ajoute à tout cela les accidents de santé, trop fréquents et presque toujours suivis de perte d’emploi, et l’on comprendra à quel point est précaire et intéressante la situation de cette classe si nombreuse des jeunes employés de magasins et de bureaux.
Ceci dit, allumons notre lanterne magique, et faisons défiler nos enfants de Paris dans une série de portraits et dans le détail de leur existence, depuis l’école jusqu’au régiment et au mariage.
C’était à la veille de la laïcisation des écoles. Pour effacer plus facilement l’image du Christ des âmes baptisées des enfants, la préfecture de la Seine faisait enlever les crucifix des écoles. Le sacrilège s’accomplissait avec plus ou moins de brutalité, suivant les quartiers et les sentiments personnels des instituteurs. Le décrochage préludait au crochetage.
Dans une école d’un faubourg populaire, l’enlèvement s’était fait un matin de bonne heure, avant l’arrivée des élèves ; mais, en entrant dans la cour des pauvres petits rencontrèrent la brouette chargée des débris de l’image divine. Ce qu’ils pensèrent, ce qu’ils se dirent entre eux, je l’ignore ; mais je sais ce que fit un des plus jeunes, celui dont je raconte l’histoire.
Pâle, d’apparence chétive, c’était un de ces enfants du siège, c’est-à-dire de la faim, de la Terreur et de la souffrance. Il s’appelait Émile ; le père était indifférent, la mère chrétienne, tous les deux honnêtes, laborieux, mais malheureux. La guerre et la Commune avaient changé leur aisance en misère. Faute de ressources, ils avaient mis leur garçon à l’école laïque, les frères dans ce quartier ne pouvant alors prendre à leurs frais les fournitures scolaires. L’enfant, docile et intelligent, apprenait bien et était fort aimé de ses camarades.
À l’aspect du crucifix brisé, brouetté avec des ordures, il s’arrêta court, demeura un moment immobile, pâlit, rougit, balbutia quelques mots qui ne purent sortir de ses lèvres tremblantes ; puis tout à coup tournant le dos à l’école, il s’élança dans la rue et arriva chez lui, les poings fermés, rouge de chaleur et de colère, les yeux jetant des larmes et des éclairs. Le père raccommodait de vieilles chaussures, la mère faisait le ménage.
« Je ne veux plus aller à l’école, s’écria l’enfant sans reprendre haleine… Ils ont décroché les crucifix des classes… j’ai vu les morceaux dans une brouette… le maître est une brute… je le déteste, je ne lui obéirai plus jamais… » Et se jetant au cou de sa mère : « N’est-ce pas, maman, que tu ne me renverras plus chez ce méchant homme ? »
En l’entendant, le père avait levé la tête, et, le sourcil froncé, il grommela entre ses dents serrées : « les canailles ! » mais il ne répondit pas à l’enfant et reprit son travail.
La mère joignit les mains et pressant son fils contre elle comme pour le défendre, elle dit, se parlant à elle-même : « C’est trop ! après le siège, après les Prussiens et la Commune, après la ruine et la misère, il faudra encore qu’ils nous volent l’âme de nos enfants ! Je leur ai arraché des mains mon homme qu’ils entraînaient de force aux barricades, et voilà maintenant qu’ils veulent me gâcher mon garçon dans leur école sans crucifix ! Non ! non ! Plutôt l’envoyer dans les rues que de le renvoyer chez ces bourreaux ! » Puis interpellant brusquement son mari : « Parle donc, toi ! Pourquoi ne dis-tu rien ? Est-ce qu’il n’a pas raison, le petit ? »
Le mari haussa les épaules et renfonça son émotion : « Tout ça, c’est des paroles perdues. Le petit n’ira pas mendier ; il faut qu’il apprenne, et puisque nous n’avons pas moyen de l’envoyer chez les frères, il retournera à son école, et tout de suite. Les pauvres sont des pauvres, comme les gredins sont des gredins. Tu entends, Émile. Prends tes livres, file droit sur ta classe, et plus de pleurnichage. J’ai assez d’embêtement comme ça. »
La mère se tut, embrassa son garçon, qui ne pleurait plus et le poussa doucement vers la porte avec ces douces paroles : « Il faut obéir au père ; courage, mon Émile ; le bon Dieu t’aidera. »
Émile retourna sans broncher à l’école, fut puni pour son absence, dont l’instituteur ignorait la cause, et se remit à la besogne, mais sans goût et sans énergie. La brouette du crucifix avait emporté sa bonne volonté, son respect et son obéissance. Il bavardait avec ses voisins, et ne se gênait pas, en sortant de classe, pour dire tout haut ce qu’il pensait du crucifix brisé et de l’école sans Dieu. Les autres, montés par lui, faisaient chorus, et cela tournait à l’orage.
Un matin, avant de commencer la classe, l’instituteur, debout au milieu des enfants assis, promena sur eux un regard dramatique, et d’une voix qu’il cherchait à rendre terrible, il dit : « Je sais qu’il y en a parmi vous qui se permettent de blâmer mes actes, et qui s’insurgent contre l’enlèvement des crucifix. Je les engage, s’ils ne sont pas des cafards, à se lever et à me répéter en face ce qu’ils disent de moi quand j’ai le dos tourné. »
À l’instant même Émile se lève, croise les bras, et les yeux dans les yeux de l’instituteur, il lui jette en plein visage cette réponse : « Je suis un de ceux-là, M’sieur, et je vous répète en face que je trouve ce que vous avez fait dégoûtant. » Qui rendra l’indignation, la stupeur du pédagogue ainsi bravé par ce gamin devenu son juge devant toute la classe qui jubilait tout bas ! Il s’élança sur l’enfant, qui esquiva le coup, et lui cria pendant qu’il gagnait la porte : « Sors, petit misérable, et si tu oses jamais te représenter devant moi, c’est à coups de pied que je te jetterai dehors comme une ordure ! – Comme le crucifix ! » répliqua l’héroïque gamin, et il disparut.
Une fois dans la rue, Émile sauta d’abord de joie et entonna un chant de victoire et de délivrance. Mais bientôt son ton baissa, son pas se ralentit, il réfléchit, ce qu’il avait oublié de faire jusque-là, et il se demanda avec angoisse quel accueil il recevrait de son père après cette belle équipée.
C’était un enfant pieux : se souvenant des leçons de sa mère, il entra dans une église et pria. Et au bout d’un quart d’heure, il ressortit d’un pas résolu, se dirigeant vers l’école des frères du quartier. – « Je veux voir le frère, directeur. – Impossible, c’est l’heure des classes. » Il insiste, le concierge résiste et finit par lui fermer la porte au nez ; mais le parti du mioche était pris et il ne se découragea point pour si peu. Il resta debout ou marchant devant la porte de l’école jusqu’à l’heure de la sortie des enfants, batailla de nouveau pour entrer, fut repoussé avec perte, rejeté dans la rue pour la troisième fois de la journée, et il était sur le point de perdre courage, quand le frère directeur, attiré par le bruit, parut sur le seuil.
À son aspect, le brave petit champion du crucifix se jette en pleine rue aux pieds du bon religieux, lui prend les genoux, le supplie en pleurant de le sauver, de le recevoir chez lui, et lui déclare qu’il ne se relèvera pas avant d’avoir obtenu son consentement. Le frère, ému, le relève, écoute son histoire, le gronde un peu pour la forme, l’embrasse pour le fond, et l’admet sur l’heure au nombre de ses élèves. Et voilà comment le jeune Émile passa du jour au lendemain, de l’école sans Dieu à l’école congréganiste.
Quand il rentra chez lui ce jour-là, porteur de la grande nouvelle, il semblait grandi d’une coudée : on eût dit David rentrant au camp d’Israël, la tête de Goliath à la main. Devenir élève des frères à la veille de sa première communion, c’était la réalisation d’un beau rêve. Avoir confessé sa foi et vengé son Dieu, c’était une grande victoire. Mais avoir collé le maître publiquement, en pleine classe, sous les regards ravis et jaloux de ses camarades, c’était pour le gamin de Paris la plus enivrante des jouissances. Que voulez-vous ? on n’est pas parfait, et le soleil lui-même a des taches.
Si le héros de cette petite histoire était imaginaire, j’ajouterais qu’il fut le modèle de ses camarades à l’école des frères, puis au patronage, et qu’il est en train de devenir un chrétien d’élite ; la vérité est qu’il fut bon écolier, pieux et charmant jusqu’à l’âge critique des enfants de Paris ; qu’alors sans cesser de fréquenter le patronage, il fréquenta parfois d’autres endroits moins édifiants, et que ce n’est pas toujours par la ligne droite qu’il s’avança dans le sentier de la vertu. Mais enfin, il ne l’abandonna jamais entièrement ; il ne cessa jamais de remplir les devoirs essentiels du chrétien ; jamais il ne manqua de prendre part, le jour de Pâques, au grand festin du père de famille ; et je puis prédire sans craindre de me tromper que lorsqu’il deviendra père à son tour, il enverra ses enfants à l’école des frères, et leur enseignera de parole et d’exemple, le respect du crucifix, symbole de la foi, drapeau du peuple chrétien, résumé de la doctrine et de la charité de Jésus-Christ.
Un des traits caractéristiques du gamin de Paris est sa facilité à changer de peau, à s’adapter à toutes les situations et à se transformer du jour au lendemain, suivant les circonstances ou suivant sa fantaisie. Ce petit bout d’homme qui rit et pleure, crie et chante, se moque et s’enthousiasme sans rime ni raison, ressemble à une boutique ambulante de grainetier : il porte en lui la semence de toutes les sagesses et de toutes les folies, de tous les états, de toutes les aventures, de tous les genres de vie, des défauts et des qualités les plus contradictoires. Cette aptitude universelle vient sans doute de la nature humaine, qui est partout diverse et inconstante ; mais elle vient encore plus de l’air et du pavé de Paris.
Le Parisien pur sang est très intelligent, mais très superficiel ; il regarde sans voir, apprend et oublie, s’embrouille et se débrouille, s’emballe et se déballe avec une égale facilité : il agit, parle et pense en même temps ; et, touchant à tout, il ne saisit rien. Ses yeux, habitués à se promener sans cesse sur quelque objet nouveau, ne se posent nulle part, et son esprit, mis en mouvement de droite et de gauche par tous les bruits, tous les spectacles, toutes les péripéties de la vie parisienne, perd en force et en profondeur ce qu’il semble gagner en étendue.
Dans cette capitale de l’agitation, du brouhaha, du sens-dessus-dessous universel, où les nouveautés, les audaces, les scandales, les extrêmes du vice et de la vertu se touchent et s’entrechoquent, le grand travail de l’éducation est d’attirer et de retenir dans la vérité et dans le bien l’esprit léger et mobile de l’enfant, de lui donner l’habitude de la réflexion, du discernement, de faire naître et de graver profondément en lui la notion du devoir, de lui en montrer les principes, la forme et la sanction dans les commandements de Dieu et dans les enseignements de l’Église, et d’établir son âme sur la base immuable de la loi divine, parmi tous les sables mouvants de la corruption et de la blague contemporaines.
Ce travail n’est pas si difficile, ni si ingrat qu’on pourrait le croire. L’enfant de Paris, même le plus mal élevé, court à l’enseignement religieux comme à une nouveauté. Il l’écoute, l’étudie par curiosité, en saisit la vérité par la droiture et la vivacité de son esprit, s’y attache bientôt par la grâce latente de son baptême, et finit souvent par l’aimer au point de s’y abandonner tout entier. Cette langue de l’Évangile et de l’Église, cet accent théologique, ces notions si abstraites, si profondément philosophiques du catéchisme même le plus élémentaire, l’éternité de Dieu, la création, la nature de l’âme, le Verbe fait chair, la Trinité, l’Incarnation, la Rédemption, le plus gamin des gamins de Paris comprend et accepte tout cela, avec une netteté de conception et une soumission de cœur incroyables.
Chaque fois que j’ai expliqué et fait réciter le catéchisme à des enfants de l’école laïque, j’ai été émerveillé de cette disposition d’esprit et de volonté, de cet acquiescement naturel et surnaturel de leurs petites âmes à l’enseignement divin, et j’y ai reconnu un témoignage frappant de la vérité de la religion chrétienne. Ils saisissent, retiennent, s’approprient les expressions les plus abstraites, et s’il leur arrive parfois de dire l’assistance publique au lieu de l’assistance divine, de transformer les Pharisiens en Parisiens, et les publicains en républicains, c’est un simple effet d’étourderie ou de distraction qui n’est pas toujours involontaire.
Ainsi préparés par les catéchismes, par la première communion et la confirmation, par les œuvres de patronage où ils s’affermissent dans la foi et dans la pratique religieuse, les jeunes Parisiens deviennent souvent des chrétiens sérieux, armés de pied en cape pour toutes les luttes, toutes les épreuves de la vie. Ils conservent sans doute cette nature d’esprit un peu frondeuse qui voit du premier coup d’œil les ridicules des gens, et qui saisit le défaut de toutes les cuirasses. Ils gardent aussi leur merveilleuse facilité de changement à vue, d’adaptation à toutes les circonstances extérieures, qui font d’eux les zouaves de la grande armée populaire. Mais partout, dans tous les états, ils se montrent plus forts, plus fidèles à la pratique de la religion, que la pauvre jeunesse des campagnes, souvent moins instruite et moins bien armée contre les vicissitudes de l’existence contemporaine, et la plupart du temps, le chrétien croyant, sinon toujours pratiquant, survit en eux aux changements de lieux, d’habits et d’habitudes.
Voici un exemple assez original de cette double aptitude des jeunes Parisiens à garder leur caractère et leurs principes, en modifiant du tout au tout leur aspect, leur langage et leur manière de vivre.
Un jour que j’étais seul chez moi, songeant en mon gîte comme le lièvre de La Fontaine, j’entendis sonner à une petite porte réservée aux visites de mes jeunes amis. J’allai ouvrir moi-même, suivant mon habitude, et je me trouvai en face d’un garçon de 18 à 19 ans, en tenue de travail, très mal vêtu des pieds à la tête, à peu près comme un mécanicien ou un chauffeur qui descend de sa locomotive. Il me tendit sa main pas très propre, et, voyant mon hésitation à la prendre, il me dit avec un fort accent bourguignon :
– Vous ne me reconnaissez donc point ?
– Pas complètement, je vous l’avoue.
– Eh ben, moi je vous reconnais, quoique vous soyez changé pas mal depuis quatre ou cinq ans que je ne vous ai point vu. Voyons, regardez-moi bien : est-ce que ma tête ne vous dit rien ? Avez-vous oublié le catéchisme de Saint-Thomas d’Aquin et la rue de Babylone, ous que vous veniez voir ma mère ?
– Henri, m’écriai-je, le reconnaissant tout à coup, c’est toi, mon brave enfant ?
– « Enfin, fit-il avec un bon rire, c’est pas malheureux ! » Et, me prenant à bras-le-corps, il m’appliqua sur chaque joue un gros baiser de nourrice, que je lui rendis de tout mon cœur.
Henri était un de nos meilleurs enfants du catéchisme, fils d’un brave gardien de la paix du quartier, et par conséquent élève de l’école laïque. Il avait fait une excellente première communion, était entré au patronage des frères, et avait quitté Paris quelque temps après, pour suivre ses parents en Bourgogne. Pendant un an ou deux, il m’avait donné de ses nouvelles, puis le temps avait fait des siennes, et nous nous étions perdus de vue. Comment donc aurais-je pu reconnaître du premier coup d’œil, dans ce bon gros paysan bourguignon, le Parisien espiègle et déluré d’autrefois ? La métamorphose était complète.
– Te voilà donc redevenu Parisien ?
– Ça me fait cet effet-là, puisque vous me voyez chez vous, fit-il d’un ton goguenard.
– Et tes parents ?
– Mes parents sont restés au pays. Je n’avais pas assez d’ouvrage dans les champs, et ils m’ont renvoyé ici pour gagner ma vie.
– Es-tu placé ?
– Pour ça oui. Je suis palefrenier dans une grande écurie, ous que j’gagne cinq francs par jour.
– Cinq francs, c’est très joli. Et où loges-tu ?
– Eh bien, chez ma sœur donc !
– Ah ! tu as une sœur ?
– Ça vous étonne ? Est-ce que vous croyez que je suis un enfant trouvé ? Elle est mariée à Paris, ma sœur ; je demeure et je mange chez elle.
– Tu lui paies pension ?
– Pas du tout.
– Comment, pas du tout ?
– Je fais mieux que ça, je lui donne tout ce que j’gagne.
– Tout ! c’est très bien, et tu es un brave garçon. Mais comment fais-tu pour ton linge, tes chaussures, tes vêtements ?
– Comment ce que j’fais ? C’est pas malaisé à deviner. Quand j’ai besoin de quéque chose, je dis à ma sœur : « Ma sœur, j’ai besoin de quéqu’chose. – Bon, qu’elle me dit ; de quoi qu’t’as besoin ? » Je le lui dis, et elle me l’achète. Vous voyez que c’est simple.
– Très simple en effet, et tout à fait charmant.
– Et ton argent de poche ?
– Mon argent de poche ? je m’en passe, ou bien si par hasard, j’ai envie de vingt sous, je lui dis : « Ma sœur, j’ai envie de vingt sous. – T’as envie de vingt sous, qu’elle dit ; Eh bien, v’là vingt sous ! » C’est pas plus malin que ça !
J’admirais en l’écoutant la naïveté de ce brave garçon, son bon sens et son bon cœur, et je m’amusais fort de ce mélange de gaieté un peu moqueuse et de bonhomie campagnarde, de blague parisienne et de rondeur bourguignonne, qui donnait un cachet si original à tout ce qu’il disait. Je me réjouissais surtout de retrouver gravés dans son cœur et mis en pratique dans sa vie, les sentiments de famille, de justice et de dévouement que nos jeunes gens chrétiens de Paris observent pour la plupart avec une si touchante simplicité.
Restait la question religieuse, que je ne pouvais passer sous silence.
– Es-tu libre le dimanche ?
– Ah ! ça, non ; c’est embêtant, mais avec les chevaux, faut pas y songer.
– Alors, tu ne vas pas à la messe ?
– Comment, je ne vas pas à la messe ! j’y vas tout comme vous ; et même, si vous me permettez de le dire, j’y ai plus de mérite que vous. Je file entre deux ouvrages ; j’attrape une petite messe, et je reviens au galop.
– Comment fais-tu pour t’habiller ?
– Je ne m’habille pas, j’y vais comme je suis.
– Comme tu es en ce moment ?
– Bien sûr. Est-ce que je vous dégoûte ?
– Je ne dis pas cela, mais…
– Est-ce que, si je reviens chez vous en habit de travail comme à cette heure, vous me mettrez à la porte ?
– Certainement non !
– Eh bien, alors, qu’est-ce que vous avez à dire ? Croyez-vous que le bon Dieu, qui vaut cent fois, mille fois mieux que tout ce qu’il y a de bon, est plus difficile que vous ? Avez-vous peur qu’il se bouche le nez pour ne pas me sentir, et les yeux pour ne pas me voir ? Je vais à l’église comme je peux, ça ne vaut-il pas mieux que de ne point y aller du tout ? Il ne regarde pas aux habits, lui, ni à la figure, ni aux mains : il regarde à l’âme, et je suis bien sûr qu’il aime mieux une âme propre avec des mains sales que des mains propres avec une âme sale… Mais qu’est-ce que vous avez donc ? pourquoi que vous me regardez comme ça sans rien dire ? Est-ce que je vous ai fait de la peine ? On dirait que vous allez pleurer. Si je vous ai offensé, faut me pardonner, je ne l’ai point fait par malice, pour sûr ; car, voyez-vous, je vous aime quasiment comme mon père. »
Pour toute réponse, je l’attirai sur mon cœur, et je l’embrassai avec une vive émotion. J’étais tenté de baiser ses pauvres vêtements sales, ses mains noircies par son grossier travail, et je redisais en moi-même la parole ineffable du Sauveur : « Je vous rends grâce, ô mon Père, Dieu du ciel et de la terre, parce que vous avez caché ces choses aux savants et aux sages, et que vous les avez révélées aux tout petits. » Ce pauvre garçon d’écurie était de la famille de saint Benoit Labre, de saint François d’Assise, des pécheurs de Galilée devenus les apôtres de Jésus-Christ, et je bénis Dieu de la leçon d’humilité qu’il m’avait donnée par la bouche de son cher petit serviteur.
C’est ainsi qu’après m’avoir embrassé, rembarré, collé en forme pendant notre court entretien, cet enfant de Paris, revenu de Bourgogne, finit par m’édifier jusqu’aux larmes, et qu’il me rendit en une fois toutes les leçons de doctrine et de charité chrétienne que j’avais pu lui donner pendant une année de catéchisme.
Permettez-moi de vous présenter mon jeune ami Albéric, grand et beau garçon de dix-neuf ans, à la tournure svelte, à la physionomie fine et distinguée, excellent sujet, chrétien fervent, très estimé de ses patrons, et n’ayant gardé de ses anciennes fonctions de gamin de Paris qu’un accent un peu traînard et une forte propension à découvrir et mettre en lumière les petits ridicules des gens. La transformation ne s’est pas faite en un jour, et certes, comme vous l’allez voir, celui-là n’a pas trouvé dans son berceau, dans les douceurs du foyer paternel, dans les leçons et les tendresses d’une mère, les qualités qui le rendent aimable, les vertus qui le font respecter.
Orphelin de bonne heure, laissé, après trois ou quatre ans d’école laïque, sans direction, sans surveillance, sans affection, étranger à l’église, où nul exemple, nul conseil ne l’avait poussé, il avait grandi dans l’abandon, livré à lui-même, enfant des rues dans toute l’acception du mot. Il y avait trouvé la société qu’on y trouve, les habitudes de vagabondage, d’oisiveté, qui y poussent comme de mauvais champignons sur le fumier : et à voir traîner sur les quais ce long et maigre adolescent, à l’aspect maladif, tendant la main aux passants, poursuivant les braves gens de ses importunités lamentables, on l’eût pris pour un de ces apprentis du vice qui prépare au crime, de la chiperie qui prélude au vol et qui parfois mène à l’assassinat.
L’œil attentif d’un observateur aurait pu cependant découvrir dans la physionomie d’Albéric une mélancolie de bon augure, une sorte de dégoût mal dissimulé de la vie qu’il menait et des drôles qu’il fréquentait. Le pauvre enfant n’avait pris que leurs habitudes extérieures, et visiblement il ne se sentait pas chez lui, comme eux, dans la boue des rues et l’ombre des dessous de pont.
Il le prouva en saisissant avec joie la première occasion qui s’offrit d’en sortir. Un entrepreneur de je ne sais quoi, un de ces exploiteurs de la misère des pauvres et de la bêtise des riches, l’embaucha pour une besogne pénible, incessante, au-dessus de ses forces, sans autre rétribution que le vivre et le couvert : et quel vivre, grand Dieu ! quel couvert ! Des mets de mendiants, une paillasse de rebut sous un escalier. Mais c’était un travail avouable, une croûte de pain honnêtement gagnée, la fin du vagabondage et de la honte, et le pauvre garçon s’y lança à plein cœur.
Deux mois après, il était hors de combat, exténué, poussif, toussant à rendre l’âme, endolori des pieds à la tête. Il fallut le porter à l’hôpital, si ravagé par la fièvre, si défait, qu’il semblait déjà bon pour l’amphithéâtre. En entrant dans ce lieu de douleur, d’où la laïcisation venait d’expulser les anges, il éprouva cependant un moment de bien être : c’était la première fois depuis si longtemps qu’il couchait dans un vrai lit !
Hélas ! ce lit lui devint bientôt intolérable : la fièvre le dévorait, la souffrance s’aiguisait, et elle finit par se concentrer en un point : une tumeur s’était formée dans le ventre, et déjà les infirmiers prononçaient le mot d’opération. Une semaine se passa dans de cruelles angoisses, et un matin, le chirurgien en chef, croyant le pauvre enfant endormi, dit aux internes cette parole, qu’il entendit et qui le perça d’avance comme un fer acéré : « Le pauvre diable est perdu, il ne pourra supporter l’opération : je la tenterai cependant après-demain ; c’est une expérience à faire, qui sait ? »