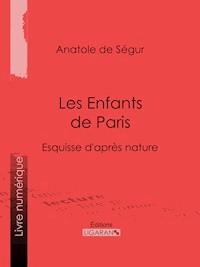Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait: "Il y a des gens, m'a-t-on dit, qui commencent leurs mémoires par le récit de faits accomplis longtemps avant leur naissance, et qui décrivent leur entrée en ce monde comme s'ils en avaient été les témoins tranquilles et désintéressés. Ceux là sont des gens illustres ou de grands savants avec lesquels je n'ai rien de commun, et que je n'imiterai pas plus en ce point qu'en tout autre."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aux camarades passés, présents et à venir qui liront ces mémoires, Jean Guérin, par la grâce de Dieu et la loi du recrutement, ancien soldat, aujourd’hui laboureur, bonne santé, bon pied, bon œil et bonne conscience.
M’est avis qu’en toutes choses il faut commencer par le commencement. Or, il paraît que le commencement de tous les livres c’est un petit mot d’amitié qu’on échange avec le lecteur, et qu’on appelle Introduction ou Préface. On dit là-dedans pourquoi on a fait son livre, dans quel but, dans quelles circonstances, à qui il s’adresse, à qui il ne s’adresse pas. Enfin, on dit tout ce qu’on veut, sauf le droit qui appartient toujours au lecteur de n’en lire aussi que ce qu’il veut. Puisque c’est la consigne, je l’exécute, et je vais vous dire en deux mots, camarades, comment il se fait que moi, Jean Guérin, âgé de trente ans au plus, ancien sous-officier au 96e de ligne, présentement de retour au pays, où je suis laboureur pour vous servir, ne sachant pas plus de grammaire qu’il ne faut, et plus habitué à manier la charrue ou le fusil que la plume, j’ai écrit mes mémoires tout comme si j’étais un colonel en retraite, un docteur en médecine, ou un faiseur de romans. Ça ne sera pas long à vous expliquer : je l’ai fait parce qu’ils m’ont tous dit de le faire.
« – Mon garçon, me répétait notre brave instituteur, tu as été à Paris, à Rome, en Grimée ; tu as vu bien des choses intéressantes, tu n’es pas mal instruit dans ta langue, et tu t’es joliment perfectionné au service ; il faut écrire les souvenirs du régiment ; ça sera instructif pour les jeunes gens et intéressant pour tout le monde. »
« – Mon enfant, me disait de son côté notre excellent curé, on ne doit pas mettre la lumière sous le boisseau, et il faut confier à quelque chose de plus durable qu’une pauvre tête humaine toutes les grandes choses dont le bon Dieu vous a fait témoin. D’ailleurs, vous êtes chrétien, et tout chrétien est apôtre dans sa sphère, quelque modeste qu’elle soit. Employez donc vos dimanches et les loisirs des longues soirées d’hiver à écrire le récit de vos lointaines aventures. Quand ce sera fait, vous me lirez la chose ; je corrigerai les fautes d’orthographe et de français, s’il y en a, et nous verrons quelle suite donner à tout cela.
Enfin, monsieur le comte de X **, le propriétaire du château, m’a donné le même conseil, et quand ma bonne mère a su qu’on voulait faire de moi un écrivain, et que je serais peut-être imprimé tout vif, il faut voir de quelle joie ses pauvres chers yeux ont brillé !
Alors, moi, voyant qu’ils me disaient tous la même chose, j’ai suivi leurs conseils ; j’ai pris la plume, rassemblé mes souvenirs ? souvenirs de garnison, souvenirs de Rome, souvenirs d’Orient, et voilà comme quoi, sans cesser d’être laboureur, je suis devenu faiseur de mémoires.
Et maintenant, chers camarades, que mon livre est fini, je vous l’offre de tout cœur ; faites-en ce que vous voudrez. S’il vous amuse, j’en serai charmé ; s’il vous instruit et vous rend meilleurs, j’en bénirai Dieu. S’il vous ennuie, au contraire, je vous en demande pardon d’avance, et je me console en pensant qu’il pourra vous servir à allumer vos pipes, et qu’ainsi, même dans ce cas, je ne vous aurai pas été tout à fait inutile. »
Mai 1838.
Il y a des gens, m’a-t-on dit, qui commencent leurs mémoires par le récit de faits accomplis longtemps avant leur naissance, et qui décrivent leur entrée en ce monde comme s’ils en avaient été les témoins tranquilles et désintéressés. Ceux-là sont des gens illustres ou de grands savants avec lesquels je n’ai rien de commun, et que je n’imiterai pas plus en ce point qu’en tout autre.
Si donc, mes chers lecteurs et mes chers camarades, vous tenez à savoir quand, où et comment je suis né, à quel âge j’ai percé ma première dent, bégayé ma première parole, envoyé mon premier sourire, demandez-le à ma bonne mère qui en sait plus long que moi là-dessus, et qui vous dira, sans que vous le lui demandiez, qu’à deux ans j’étais le plus beau garçon du mondé et que je n’avais pas mon pareil dans tout le village.
Je ne vous parlerai pas davantage de mes plaisirs d’enfant, ni de mes ennuis d’écolier, ni des douces leçons de notre excellent curé, ni de cette journée incomparable de ma première communion, ni enfin de toutes ces années fuyantes de la jeunesse qui brillent et passent comme la rosée d’avril en nos champs. Je vous ai promis les mémoires d’un troupier, et je saute à pieds joints par-dessus les vingt premières années de ma vie pour arriver de suite à l’époque du tirage au sort et du conseil de révision, ce début forcé et peu brillant de la plus brillante des carrières.
À mesure qu’approchait le jour où je devais tirer, je voyais la tristesse gagner le cœur et le visage de ma mère, comme on voit croître et s’épaissir les ombres à l’approche de la nuit. Le matin, le soir, elle m’embrassait avec une tendresse plus émue, et je voyais parfois rouler dans ses yeux une larme qu’elle cherchait à me cacher. Pauvre chère mère ! Maintenant que je suis de retour au pays, joyeux, honoré, avec la médaille militaire sur ma poitrine, et dans mon cœur tout un bagage de nobles souvenirs, elle est heureuse et fière plus que moi-même des sept années que j’ai passées sous les drapeaux. Mais à la veille du départ, à la veille même du tirage, c’était autre chose, et Dieu sait que de prières elle lui adressa, que de chapelets elle dit, que de neuvaines elle fit à la bonne Vierge pour obtenir que je ne fusse pas soldat ! Certes tout cela ne fut pas perdu, et Dieu, cette sentinelle éternelle qui veille là-haut, fut attentif à sa prière. Seulement, sachant mieux qu’elle et moi ce qui nous convenait, il arrangea les choses autrement que nous ne le lui demandions, et je puis affirmer qu’il les arrangea pour le mieux. Tant il est vrai que la plupart du temps nous ne savons pas ce que nous demandons à Dieu, et que c’est en nous refusant qu’il montre le mieux qu’il nous écoute et qu’il nous aime !
Enfin le jour du tirage arriva. Au moment où j’allais partir, entra dans la maison une vieille voisine, mauvaise langue et bonne femme, si tant est que les deux choses soient compatibles, qui depuis quarante ans poursuivait un quine à la loterie sans l’attraper jamais, et qui passait ses nuits à rêver des numéros pour tous les usages imaginables. Sachant que je devais tirer ce jour-là, elle n’avait pas perdu une si bonne occasion de faire un rêve de plus, et elle vint annoncer à ma mère, d’un air de triomphe, que j’aurais le numéro 86 : elle l’avait vu et revu, elle le savait, la chose était certaine ; or, il n’y avait pour le canton que quatre-vingt-dix numéros. On croit toujours aisément ce qu’on désire : ma mère, qui s’était moquée cent fois des songeries de sa voisine, y crut presque ce jour-là, et moi-même, sur l’autorité de cette vieille rêveuse, je partis d’un pied plus léger pour le chef-lieu de canton, avec mon père et les jeunes gens du village qui devaient tirer comme moi.
Je ne puis pas dire qu’en route la conversation fut vive et animée : l’un se taisait, l’autre ne disait rien, et quelqu’un de nous ayant essayé de lancer je ne sais quelle plaisanterie, pas une parole ne lui fit écho, pas un sourire ne lui répondit. En un mot, nous ressemblions plus à des veaux qu’on mène à la boucherie qu’à des apprentis guerriers emboîtant le pas dans le chemin de la gloire : et voilà pourtant la graine des soldats français !
Arrivé à la salle de la mairie, déjà pleine de jeunes gens avec leurs pères et leurs maires, soit dit sans jeu de mots, j’attendis mon tour pour tirer. Mon cœur bondissait dans ma poitrine à me rompre les côtes, et jamais dans ma vie je n’eus plus besoin de patience et n’en eus moins à ma disposition. Mes yeux étaient fixés sur l’urne fatale qui recelait mon sort, et il me semblait qu’en y plongeant la main j’allais en retirer une sentence de vie ou un arrêt de mort. J’étais indifférent à tout ce qui se passait dans la salle et je n’entendais seulement pas les exclamations de joie ou de désespoir de ceux qui tiraient avant moi.
Enfin, on appela mon nom. Mon père me serra la main et me dit tout bas : « Bon courage et bonne chance ! » Je m’approchai d’un pas chancelant, j’enfonçai ma main tremblante dans l’urne impassible, comme si c’eût été la gueule d’un monstre, et j’en retirai… le numéro 13 !
Non ! jamais je ne fus plus désolé, plus furieux, plus ridicule et plus mortifié ! J’aurais retiré de cette urne maudite une vipère enlacée autour de mon bras, que je n’aurais pas fait une grimace plus désespérée ! J’entendais dire en ricanant autour de moi : « Eh bien ! excusez, le numéro 13 ! J’aimerais mieux le numéro 1. – En voilà un qui n’a pas de chance, ajoutait un autre avec un accent de demi-commisération qui m’en rageait encore plus. – Il n’a pas l’air à la noce ! disait un troisième. – Tiens, il n’y a pas de quoi ! » Et mille propos de ce genre dont les plus compatissants ne méritaient pas la poignée de main, je ne dis pas d’un homme, mais d’un chien.
Ce qu’il y avait de pis, c’est que tous ces égoïstes-là avaient raison. Oui, c’en était fait, j’étais pris, je ne m’appartenais plus, j’étais condamné, à sept ans de galère, peut-être même à mort, et je me dis à part moi très sérieusement et sans me rire au nez : « Je suis un homme perdu ! » C’est triste à confesser, c’est honteux, c’est humiliant, mais c’est comme ça ! Et pourtant je n’ai pas été un plus mauvais, soldat qu’un autre, je m’en flatte ; mon grade, ma médaille et mes états de service, sont là pour l’attester.
Je ne vous peindrai pas le chagrin de ma mère quand elle apprit la fatale nouvelle. Tomber des sommets brillants du numéro 86 au bas fond du numéro 13, quelle chute pour un pauvre cœur maternel, et comment s’étonner qu’il en fût tout meurtri ! Son abattement me fit rougir du mien, et je redevins homme pour consoler cette pauvre chère femme. Je la caressai tant, l’embrassai si fort et si doux, je rentassai si bien mon chagrin et je parus prendre si gaiement mon parti, que je parvins à la rasséréner un peu et à lui faire entendre raison. C’est une merveilleuse nécessité, dans les circonstances douloureuses de la vie, d’avoir à raisonner et à consoler les autres. On se raisonne et oh se console soi-même du même coup ; et certes je n’aurais jamais trouvé pour moi tout seul ce que j’imaginai en cette circonstance pour consoler ma mère.
Comme elle commençait à se calmer, voilà que la porte s’ouvre avec fracas, et je vois entrer la vieille songeuse, notre voisine. « – Ah ! mon pauvre gars ! cria-t-elle en se jetant dans mes bras, ce dont je me serais bien passé, c’est-il vrai ce qu’on me dit, que tu as tiré le numéro 13 ? – Sans doute, lui répondis-je en essayant de sourire. – Ah ! mon bon Dieu ! quel malheur ! le plus mauvais de tous les numéros ! Pauvre petiot ! tu mourras dans l’année ! C’est sûr, répétât-elle en s’adressant à ma mère, il mourra dans l’année : le numéro 13, ça ne manque jamais ! » Et elle criait et pleurait, ou plutôt faisait semblant de pleurer ; car ses petits yeux gris ne rendaient pas plus de larmes qu’une source tarie ne rend d’eau en temps de sécheresse.
J’étais furieux de la maladresse de cette femme, je craignais que ses idées absurdes ne fissent impression sur ma mère et n’augmentassent son chagrin, et n’était le respect dû à son grand âge, je l’aurais volontiers fait sortir par la fenêtre. Je me contentai de la reconduire, moitié de gré, moitié de force, vers la porte, que je lui fis franchir vivement et que je refermai sur elle.
Grâce à Dieu, ma mère était aussi solidement chrétienne que peu superstitieuse, et les sottises de sa vieille voisine l’eussent plutôt fait rire que pleurer. Elle n’y fit donc aucune attention et n’y attacha pas plus d’importance que moi-même. Mais il n’en fut pas ainsi dans le reste du village. La vieille rêveuse, irritée de la façon dont je l’avais éconduite, s’en alla dans toutes les maisons, moins par intérêt que par ressentiment, répandre ses folles idées et ses absurdes terreurs, et, grâce à elle et à mon pauvre numéro 13, je ne tardai pas à passer pour un homme mort dans l’esprit d’une foule de gens. On me plaignait, on me pleurait de mon vivant, on faisait à qui mieux mieux mon oraison funèbre : c’était flatteur, mais ça n’était pas gai ! Enfin, à les entendre tous, j’étais condamné, perdu, fini ; il n’y avait plus qu’à m’enterrer, à dresser mon acte de décès et à m’oublier.
Telle est la sottise humaine ! Telle est la place que la superstition occupe dans tant de pauvres âmes ignorantes, où la foi est à moitié morte, et d’autant plus crédules, hélas ! qu’elles sont moins croyantes ! On ne croit guère à l’Évangile, mais on croit à la fatale influence d’un nombre ! On ne craint pas d’offenser Dieu, mais on tremble devant le numéro 13, et tel chrétien qui se mettra sans la moindre hésitation une côtelette sur l’estomac et la conscience le vendredi, ne voudra pour rien au monde se mettre en voiture ce jour-là !
Toutes ces sottises finirent par me fatiguer à la longue, et, sachant qu’il me fallait quitter le village un peu plus tôt ou un peu plus tard, je résolus de devancer l’appel dès que le conseil de révision m’aurait déclaré propre au service. Quant à ça, j’étais sûr de mon affaire : je m’étais examiné, inspecté, tâté des pieds à la tête, et je n’avais trouvé en moi aucun motif d’exemption, pas la moindre varice, pas la plus petite infirmité ; un œil de lynx, un estomac d’autruche, des dents à déchirer des cartouches de fer blanc, et des pieds à marcher huit jours sans fatigue ; en un mot, j’étais ce qu’on appelle un homme parfaitement constitué : c’était triste, mais qu’y faire ? N’est pas borgne ou boiteux qui veut !
Quant à imiter ces sans cœur qui se travaillent le corps de mille manières pour le déformer, l’affaiblir et se fabriquer des infirmités postiches à l’usage du conseil de révision, merci bien ! Je n’étais pas Français, honnête homme et chrétien pour rien ! Aussi, quand j’entrai dans la salle de la révision, je me dis en moi-même : « Mon garçon, tu sortiras d’ici soldat. » Et je ne me trompais pas. Le major ne fil que jeter un coup d’œil sur moi ; le préfet consulta ses collègues du regard, et, d’une voix unanime, je fus déclaré propre au service.
C’est un singulier spectacle et une invention bizarre que celle de la révision. Comme ça ferait rire ceux qui y passent, si ça ne les faisait pas pleurer ! D’abord, l’aspect du conseil, de ces magistrats, de ces officiers supérieurs en grand uniforme, la lunette ou le lorgnon sur le nez, rangés gravement en demi-cercle, et au milieu ces pauvres garçons qui défilent tout nus, car, sauf le respect que je vous dois, mes chers lecteurs, c’est là, pour les recrues, la tenue de l’endroit, et tel est le premier uniforme de tous les soldats français, voire même des futurs généraux et maréchaux de France : on entre dans l’armée absolument comme on vient au monde. Il faut croire que c’est nécessaire, car ce ne doit pas être plus agréable pour les juges que pour les soldats ; mais, en tout cas, nécessaire ou non, ça n’est pas propre, et si j’étais le Gouvernement, je tâcherais d’imaginer quelque chose d’un peu moins vilain et plus chrétien que cela. Il est vrai que je ne suis pas le Gouvernement, ni vous non plus, et que ce n’est ni mon affaire ni la vôtre.
Hors de la salle du conseil, la scène est plus curieuse encore. Au milieu de cette foule qui s’habille, se déshabille, s’agite, chanté, crie et pleure, on voit d’un côté de pauvres diables gambader en chemise et sauter tout joyeux, parce qu’on les a trouvés trop malingres ou trop mal bâtis pour servir ; de l’autre, de forts gaillards qui se rhabillent d’un air tout piteux, parce qu’hélas ! le bon Dieu les a faits robustes et bien découplés !
J’ai lu quelque part, étant en garnison, que chez les anciens Romains, il y avait une fête qu’on appelait les Saturnales, pendant laquelle les esclaves devenaient momentanément les maîtres, et les maitres esclaves. Eh bien, le jour de la révision est dans son genre une fête comme celle-là : c’est le jour de triomphe des infirmités de toute nature, le jour d’humiliation de la force et de la santé. Qu’on est heureux, qu’on est fier alors de ce qui attriste et humilie tout le reste de la vie ! Comme on fait valoir et ressortir ses misères physiques et morales, celui-ci ses dents noires et malsaines, celui-là ses pieds plats et mal contournés, cet autre son estomac débile, sa Chétive santé, cet autre je ne sais quelle honteuse infirmité ! Au contraire, les hommes forts et bien faits paraissent humiliés de leur vigueur et de leur beauté : ils se font petits, ils baissent les yeux, ils semblent vouloir se cacher, et si les infirmités étaient à vendre, bien des gens donneraient ce jour-là plus d’argent pour les acquérir qu’on n’en donne en temps ordinaire pour s’en débarrasser.
Je vois encore d’ici, le jour que je raconte, un petit bossu qui n’avait pas quatre pieds de haut, un vrai cep de vigne, qui, le bec levé, lançait mille railleries et faisait mille grimaces à son voisin, homme superbe que sa taille destinait évidemment à devenir tôt ou tard tambour-major. À le voir, comme un petit coq, se dresser sur ses ergots et pousser ses invectives triomphantes à trois pieds au-dessus de sa tête, on eût dit un gamin de Paris apostrophant de la rue un bourgeois au premier étage. Ce qu’il y avait de plus comique, c’est que le futur tambour-major, la tête basse et les yeux pleurants, ne répondait pas un mot et semblait envier la taille et la bosse de son insulteur.
Il y eut ce même jour un incident qui amusa beaucoup l’assemblée tout entière, le conseil comme les recrues. Un jeune homme s’avança dans la salle du conseil, dans la tenue de rigueur, l’air à la fois bête et fin, l’oreille tendue, et paraissant faire d’inutiles efforts pour entendre. Il était sourd, ou du moins prétendait l’être. À toutes les questions qu’on lui adressait, il répondait de travers, et le maire de son village attestait que cette infirmité avait commencé un an auparavant et n’avait fait depuis que s’aggraver chaque jour. Tout cela semblait un peu louche au conseil, mais le prétendu sourd jouait son rôle à merveille, et ni pièces d’argent tombant à terre, ni autres pièges du même genre n’avaient pu le convaincre de fourberie.
Enfin, de guerre lasse, on allait le renvoyer exempt, quand le préfet qui était un malin, conçut une idée lumineuse. Il parut convaincu de la bonne foi du jeune homme, et d’une voix peu élevée, sans faire un seul geste : « Décidément, dit-il, ce garçon est sourd et très sourd. Vous pouvez vous retirer, mon ami, vous êtes impropre au service. »
À l’instant même, voilà mon gaillard qui salue le conseil d’un air joyeux, et sans se le faire dire deux fois prend le chemin de la porte : dans la joie du succès, il avait oublié qu’il était sourd et s’était cru libre et vainqueur deux minutes trop tôt. Je n’ai pas besoin d’ajouter qu’on ramena mon farceur tout décontenancé au milieu des éclats de rire de l’assemblée, et qu’il fut sur l’heure et tout d’une voix déclaré valide et de bonne prise.
Je n’oserais pas dire que ce jour-là, avant de quitter le chef-lieu du canton, je ne bus pas un peu plus que de coutume : j’étais triste dans le fond et j’avais besoin de m’étourdir un peu pour avoir l’air crâne. Cependant, je ne laissai point ma raison dans mon verre, j’étais solide sur mes jambes en revenant au village, et quand j’embrassai ma pauvre mère en lui disant : « Eh bien, maman, ton garçon est décidément soldat ! » ce ne fut pas un homme ivre, grâce à Dieu, qu’elle pressa dans ses bras et qu’elle inonda de ses larmes.
Mon père m’embrassa aussi, essuya furtivement son œil humide, et me dit en me serrant fortement la main : « Allons, c’est dit, n’en parlons plus ! Dieu l’a voulu, que sa Volonté soit bénie ! » et il sortit de la Chambre, soi-disant pour aller ranger quelque chose à la grange, mais j’ai l’idée que ce fut pour aller pleurer.
Quand on se baigne dans la mer où dans une rivière, il y a deux manières de se mettre à l’eau. Les uns y entrent doucement, lentement, prudemment, plongeant d’abord un pied timide qu’ils retirent, plus la jambe, puis le resté du corps, peu à peu et par degrés. D’autres, et je suis de ceux-là, n’y mettent pas tant de façons et plongent d’un seul coup ; il y a un moment désagréable à passer, mais ce n’est qu’un moment, et deux secondes après, on est à son aise comme un poisson dans l’eau. Conformément à cette dernière méthode, je résolus de partir sans délai pour choisir un régiment et le rejoindre ; je pensais que, pour ma mère comme pour moi, il valait mieux brusquer le dénouaient, et mon père fut de mon avis. Je fis donc rapidement mes préparatifs de départ ; ça ne fut pas long, et je fixai au lundi suivant le jour des adieux et de la séparation.
La veille de ce triste jour, au sortir de vêpres, je pris congé de tous les gens du village ; hommes, femmes, enfants, tout le monde m’embrassa comme une patène, et plus d’un pleurait en m’embrassant. J’avoue que ça me fit plaisir : c’est si bon de sentir qu’on est aimé et de penser qu’en partant on laissera au moins un souvenir et un regret au cœur de ceux qui restent ! Quelques vieilles femmes, se souvenant du numéro 13, murmuraient en secouant la tête : « Le pauvre garçon n’en reviendra pas ! » Mais les anciens du village, qui avaient servi dans leur temps, haussaient les épaules, et disaient en me serrant la main : « Bah ! bah ! il en reviendra comme nous ! »
Avant de sortir de l’église, j’avais eu soin de la passer en revue des pavés à la voûte ; j’avais regardé une dernière fois les vieux bancs de bois où je m’étais si souvent agenouillé, la chaire d’où M. le curé nous avait donné tant de bons conseils, que je n’avais pas toujours écoutés ni suivis ; le confessionnal où j’étais bien des fois entre en rechignant, et d’où j’étais toujours sorti bien heureux, et la place bénie où j’avais fait ma première communion ! J’avais dit adieu du regard à l’autel et à son pauvre tableau tout noirci par la fumée des cierges, représentant la sainte Vierge et saint Joseph prosternés devant l’enfant Jésus dans la crèche, et aussi aux vieilles statues des vieux saints, patrons de la paroisse, qui, du fond de leurs niches, semblaient me sourire doucement et me souhaiter un bon voyage et un heureux retour.
En traversant le cimetière, qui chez nous entoure l’église, je m’agenouillai un instant devant la croix de bois qui indiquait la tombe de ma grand-mère, récemment décédée, et je me souviens encore que je demandai à Dieu, dans ma prière, la grâce de pouvoir un jour reposer dans ce même cimetière, près de mes parents et de mes pays, à l’ombre de l’église et du clocher natal.
Je n’oubliai pas d’aller prendre congé de M. le curé. Ce digne homme, qui m’avait toujours beaucoup aimé, je ne sais trop pourquoi, m’embrassa avec une affection paternelle, me donna quelques petits souvenirs pieux, et me dit en me bénissant : « Que le bon Dieu te garde, mon cher enfant, et qu’il te ramène au village sain de corps et d’âme après ton congé ! Tu vas avoir bien des épreuves à traverser, bien des ennemis à combattre ; mais je n’en crains qu’un seul pour toi, et puisses-tu t’en souvenir pour l’éviter : c’est le respect humain ! Demande des forces à Dieu contre celui-là ; au régiment comme ailleurs, presque tout est là pour les jeunes gens. »
Ainsi me disiez-vous en pleurant, mon bon père, et vous aviez bien raison ! J’en ai fait depuis la triste expérience, et vous ne le verrez que trop en lisant ces mémoires !
S’il faut tout dire, et pourquoi ne le dirais-je pas ? il est encore une autre demeure que je visitai en sortant du presbytère, une demeure où j’entrai avec de vifs battements de cœur, et d’où je sortis pleurant et rayonnant à la fois ; c’est la ferme du père Thomas. Le père Thomas (Dieu veuille avoir son âme !) était un brave homme et un bon fermier, et je l’aimais beaucoup. J’aimais bien aussi sa femme, la mère Thomasse, car c’est ainsi que chez nous on appelle les femmes du nom de leurs maris. Mais j’aimais plus encore leur fille Jeanne, bonne et belle enfant s’il en fut, dont la figure fraîche et riante fleurissait sur une taille droite, élancée et mignonne, comme un bouton de rose sur sa tige.
Bien des fois déjà, malgré ses quinze ans, en la voyant si jolie, si modeste et si accueillante, si bonne aux pauvres, si douce à ses parents, si pieuse à l’église, je m’étais dit que son mari serait un heureux garçon et que je voudrais bien être ce garçon-là. Mon père, qui appréciait comme moi les mérites de Jeanne, et qui savait de plus que le père Thomas avait des terres et des écus, trouvait l’idée bonne et il en avait touché quelques mots au brave homme. Celui-ci n’avait dit ni oui ni non, sa fille avait quinze ans et il n’était pas temps de songer à la marier ; mais il avait continué à fréquenter ma famille, et il me témoignait plus d’amitié qu’à tout autre garçon du village. Jeanne de son côté ne semblait pas me voir avec déplaisir ; elle rougissait quand je lui parlais, tremblait comme une feuille de mai quand par hasard ma main touchait la sienne, et toutes les fois qu’elle rencontrait ma mère, elle l’embrassait et la Caressait tout comme si elle eût été sa fille.
Quand j’entrai chez eux, le père Thomas, sa femme et Jeanne étaient assis dans la salle, ne travaillant, pas parce que c’était dimanche, et né disant rien parce qu’ils n’avaient rien où parce qu’ils avaient trop à se dire. Ils paraissaient tristes et j’espérai que c’était en pensant à mon prochain départ. En m’apercevant, Jeanne rougit beaucoup, son père et sa mère Vinrent au-devant de moi et me tendirent la main. J’étais confus, tremblant, je changeais de couleur dix fois par minute, et je ne savais trop ce que je disais. Le père Thomas me parla avec beaucoup de bonté et d’affection m’exhorta à me comporter honnêtement au régiment comme au village, et me dit en terminant, d’un ton qui me fit tressaillir de joie au milieu de mon chagrin : « Allons, mon garçon, embrasse-moi, embrassé ma femme et ma Jeanne aussi, et souviens-toi que lorsque cette enfant-là, que tu ne trouves point sotte ni laide, sera à marier dans sept ans, je ne la donnerai qu’à un bon Sujet et à un bon chrétien. »
Je serai dans mes bras l’excellent homme et la mère Thomasse qui pleurait ; puis je m’approchai de Jeanne qui était debout, immobile et rougissante, et, lui prenant doucement la main, j’effleurai sa joue de mes lèvres. Elle leva sur moi son œil bleu où brillait une larme, et d’une voix basse, mais ferme : « Ayez confiance et bon courage ! » me dit-elle.
Confiance et bon courage ! Oui, sans doute, ma Jeanne, j’ai eu l’un et l’autre, et après Dieu, c’est à toi que je les ai dus ! Ces mots-là me sont restés gravés dans le cœur avec le chaste baiser que tu reçus de moi en ce jour, et que tu me rendis sept ans après en me disant que tu m’avais attendu. Que le bon Dieu t’en récompense, chère femme, et qu’il me bénisse en te bénissant, car tu es aujourd’hui la joie, la compagne et le bonheur de ma vie, comme tu en as été l’espérance au temps des épreuves périlleuses et de la longue absence.
Je ne vous raconterai pas les détails déchirants de mes adieux à ma mère ; c’est trop triste et j’ai encore envie de pleurer quand j’y pense. Je promis à cette bonne mère de lui écrire souvent, de faire toujours mes prières, matin et soir, de garder soigneusement la médaille de la sainte Vierge qu’elle me mit au cou. Je baisai mille fois ses mains tremblantes et ses joues inondées de larmes, et, m’arrachant de ses bras, je sortis presque en courant de la maison paternelle.
Mon père avait voulu m’accompagner jusqu’à la limite du village. Il marchait, sa main dans la mienne, et ne me disait rien. Arrivé à un détour de la route, il s’arrêta, et d’une voix étouffée de sanglots : « Tu as toujours été un bon fils, me dit-il, sois un bon soldat… Adieu, mon enfant, adieu, mon Jean… que Dieu veille sur toi… au revoir !… » Et, me serrant une dernière fois sur son cœur, il reprit à grands pas le chemin du village. Je le suivis des yeux tant que je pus l’apercevoir, et je le vis enfin disparaître à l’angle de la route. Alors un flot de douleur me monta du fond de l’âme et m’envahit tout entier ; pour la première fois de ma vie, je me sentis seul, absolument seul sur la terre. Je m’assis au bord du chemin, et, cachant ma tête dans mes mains, je pleurai amèrement.
Le ciel le plus chargé de nuages ne contient qu’une certaine quantité de pluie, et le cœur le plus gonflé de déplaisir ne renferme qu’une certaine quantité de larmes. La pluie et les pleurs tombent plus ou moins fort et longtemps, puis diminuent, puis cessent. Le ciel reste gris d’abord et le front assombri ; puis viennent les éclaircies ; ici, le bleu, là, la gaieté reparaissent ; le soleil brille, le rire étincelle et le beau temps succède à l’orage.
Telle est l’histoire de presque tous les chagrins, j’entends ceux dont on ne meurt pas, et comme je ne mourus pas du mien, il s’en alla par la route commune. Je ne sais combien de litres d’eau salée coulèrent de mes yeux ; mais enfin, le réservoir se tarit. Après avoir beaucoup pleuré, je ne pleurai plus ; après avoir longtemps soupiré, je ne soupirai plus, si ce n’est à de longs intervalles, au souvenir de ma mère. Je continuai à rêver souvent à Jeanne, mais sans déplaisir et avec une secrète douceur. Enfin je retrouvai, à peu de chose près, ma gaieté naturelle, et il ne me fallut pas un mois pour me convaincre qu’on peut vivre et prospérer au régiment comme au village, et que l’uniforme militaire n’est pas une maladie dont on meurt.
Cependant, j’avais encore les yeux bien rouges et le cœur bien gros quand je me présentai au bureau du recrutement, le surlendemain de mon départ, pour choisir un des régiments où l’on pouvait s’engager. Je n’avais nul motif de préférer un corps à un autre, je ne connaissais personne dans aucun, et je ne devais compter, en fait de protection, que sur ma bonne mine, ce qui était peu de chose pour avancer. Le sergent employé près du capitaine de recrutement, petit jeune homme à l’œil vif et intelligent, à l’air un peu farceur, mais très bon enfant, vit mon embarras et me conseilla de prendre le 96e de ligne (alors 21e léger.)
« C’est de tous les régiments à choisir le plus agréable, me dit-il ; le colonel est la perle des hommes, et vous pouvez vous recommander de moi à un sergent-major de mes amis, qui est un charmant garçon. Et puis, le régiment vient d’arriver à Paris, il y restera longtemps, et quand vous passerez aux bataillons de guerre, vous ferez connaissance avec la capitale. »
C’était plus qu’il n’en fallait pour me décider, puisque j’allais choisir au hasard. Je m’engageai donc dans le 96e de ligne, et après avoir remercié mon aimable petit sous-officier, qui me donna le nom de son ami le sergent-major, je me rendis à l’intendance pour recevoir ma feuille de route.
Là, ce fut autre chose, et l’accueil que je reçus ne me parut pas pécher par excès de bienveillance. D’abord, on me dit de revenir le lendemain à quatre heures, et je dus encore traîner par la ville le reste de ma soirée et la matinée du lendemain ; puis, quand je revins à l’heure dite, on me fit attendre plus que de raison, debout près d’un banc sur lequel on ne m’invita pas à m’asseoir ; enfin un employé m’appela et me tendit ma feuille de route en me disant d’un ton bourru : « Quand vous serez à destination, vous demanderez le gros-major. Allez !
– Le gros-major, fis-je avec un étonnement qui devait ressembler un peu à de la stupidité, le gros-major, qu’est-ce que c’est que ça ? »
J’avais souvent entendu parler de tambour major, et quelquefois de sergent-major, mais de gros-major, jamais.
Un éclat de rire universel accueillit ma question, et un des militaires employés à l’intendance s’écria avec un accent de conviction profonde : « Dieu ! que ces recrues sont bêtes ! »
Le sang me monta au visage, et je répondis vivement à ce petit monsieur :
« Si les recrues sont bêtes, vous devriez vous souvenir que vous avez été l’un et l’autre !
– Allons, allons, mes petits amours, dit un sergent qui se trouvait là, pas de gros mots ni de disputes ! Si les recrues sont des recrues, ça n’est pas leur faute, et l’esprit leur viendra au régiment. Et vous, jeune homme, filez votre nœud avec votre feuille de route, et tant que vous ne serez qu’un soldat de papier, tâchez de modérer un peu la vivacité de votre bec. Tant qu’au gros major, puisque vous voulez savoir ce que c’est, désir louable et que j’approuve, apprenez qu’on le nomme ainsi parce que c’est un major plus gros que tous les autres ; ça se choisit au poids et au tour du ventre. Voilà. ».