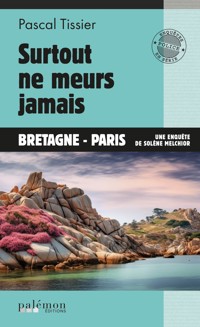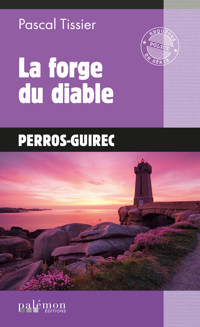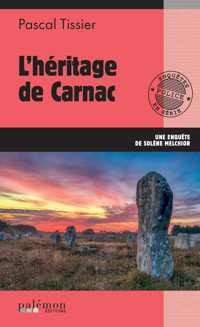Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Palémon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Une enquête de Solène Melchior
- Sprache: Französisch
Solène Melchior, capitaine de police à la Brigade criminelle de Paris, Bretonne de cœur et de sang, n’a jamais rien révélé de son passé trouble, ni des motivations secrètes qui lui ont fait choisir cette voie : le jour de son douzième anniversaire, témoin d’un crime particulièrement odieux, elle n’avait échappé au massacre que par miracle… Si mettre la main sur cet assassin reste son leitmotiv, elle se retrouve
confrontée à des enquêtes toujours plus sordides…
Alors qu’elle revient des obsèques de son père adoptif à Saint-Brieuc, elle apprend que le serial killer qu’elle venait d’interpeller, s’est échappé d’un hôpital psychiatrique et jure de se venger d’elle.
Mais c’est une tout autre enquête qu’on lui confie : un célèbre violoniste a été agressé juste avant un concert. Peu de temps après, le père du jeune homme disparaît.
Ces deux affaires seraient-elles liées ?
Les falaises maudites est le premier opus des enquêtes de la capitaine Solène Melchior, paru initialement sous le titre L’adieu.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Avant d’être romancier, auteur d’une quinzaine d’ouvrages, Pascal Tissier était expert criminaliste au sein de l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. Après plusieurs années passées à traquer l’indice le plus infime sur de sordides scènes de crime, qui inspirent ses récits, il prête son expérience et son exigence de l’exactitude dans les enquêtes qu’il mène pour exécuter ses thrillers et polars. Si son travail passionnant l’a conduit à vivre sur la plupart des continents, il a aujourd’hui posé ses valises à Perros-Guirec où il organise le festival du polar « Le Roz et le Noir ».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
CE LIVRE EST UN ROMAN.Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres, des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.
1
Cimetière de Saint-Ilan – Côtes-d’Armor
Solène le sait, cela risque d’être mal interprété. Elle n’a pas souhaité aller à l’église, entendre le prêtre se lamenter du monde dans lequel nous vivons, oubliant que depuis toujours, l’homme est un loup pour l’homme. Passant également sous silence que selon Sa bible, Adam et Ève avaient mis au monde deux garçons, et que l’un d’eux était le premier assassin et l’autre la première victime.
Non, elle n’a pas voulu écouter tous ces orateurs, amis et collègues se succéder derrière le lutrin, jurer, main sur le cœur, que Mathurin Melchior était l’homme le plus admirable que la terre n’ait jamais porté. Omettant, eux aussi, de préciser qu’il était capable de se montrer injuste, mesquin et souvent blessant. Pour en avoir souvent fait les frais, Solène lui en garde une certaine rancune, que même sa mort ne peut absoudre.
Mathurin n’était pas un mauvais homme, mais il pouvait se faire bien des ennemis. Il le revendiquait sans complexe. Pourtant, son oncle n’est pas mort sous les balles ni les coups d’un adversaire, comme elle en voit trop souvent dans son métier de flic. Alors qu’il traversait la rue, Mathurin a simplement été victime d’un chauffard ivre ayant eu la mauvaise idée de vouloir prendre la fuite. Celui que tout le monde qualifie déjà d’assassin n’a dû son salut qu’à l’intervention des gendarmes qui l’ont sauvé de la vindicte populaire.
Non, Solène n’a pas voulu entendre tout ça. Un seul enterrement aurait pu lui permettre de faire son deuil. Celui de ses vrais parents et de Titouan, son jeune frère, tués froidement sous ses yeux. Mais pour eux, il n’y aura jamais de sépulture où elle pourrait se recueillir. Depuis, l’image de leur joie de vivre ensemble et le son de leurs voix s’estompent doucement. L’atroce vision de leur mort et le visage de leur assassin restent profondément ancrés en elle, et hantent bien trop souvent ses nuits.
Le plus terrible, c’est que pour sa propre sécurité, elle n’a jamais pu évoquer cela avec quiconque. Seuls ses parents adoptifs et sa cousine Chloé ont été informés de cette folle histoire. Solène doit néanmoins reconnaître que Mathurin est l’homme qui l’a recueillie, alors qu’à douze ans, elle risquait de se retrouver à la DDASS, puis probablement dans une famille d’accueil. Il lui faut bien l’admettre, rien que pour ça, cet homme mérite un minimum de reconnaissance de sa part.
Pourtant, et elle n’en est pas très fière, Solène s’est débrouillée pour arriver en retard à la gare de Saint-Brieuc. Une demi-heure plus tard, un taxi l’a déposée tandis que la foule recueillie et compatissante sortait de l’église d’Yffiniac. Comme elle s’y attendait, sa tante Louison, éplorée, soutenue par sa fille, fond en larmes en la voyant approcher.
— Tu es venue quand même. Je n’y croyais plus.
Solène préfère ne pas relever la perfidie à peine dissimulée de la remarque.
— Désolée, le train a pris deux heures de retard, à cause d’un incident sur la ligne.
— Le principal, c’est qu’elle soit là, non ? intervient sèchement sa cousine.
Frisant de très près la quarantaine, Chloé, contrairement à ses parents, a toujours été de nature franche et plutôt joviale. Bien que brutale, la mort de son père ne semble pas l’affecter particulièrement. Elle est habituée aux sempiternelles jérémiades de sa mère et s’est rarement privée de lui faire comprendre que cela la saoulait. Mais Chloé le sait, ce n’est ni le jour ni le lieu d’étaler ses états d’âme.
Quant à Solène, si elle est reconnaissante envers son oncle et sa tante, Elle n’a jamais senti la moindre preuve d’affection dans cette famille dans laquelle on ne s’embarrasse même pas de faire semblant. Au moins, cela lui a épargné des relents larmoyants sur la disparition de ses parents Vincent et Élise. Leur discrétion à ce sujet a toujours été exemplaire… C’est tout juste s’ils ont déjà prononcé le prénom de Titouan. Il faut leur concéder qu’ils n’avaient guère eu l’occasion de les voir depuis leur départ en voilier. Périple qu’ils avaient estimé stupide et dangereux. Le drame qui s’ensuivit était forcément la preuve que Mathurin et Louison Melchior avaient raison. C’est le juge des affaires familiales qui leur avait conseillé l’adoption plénière de leur nièce, ce qui lui permet aujourd’hui de porter ce patronyme : Melchior. Ce nom si protecteur qu’elle a fini par pleinement intégrer, même s’il lui est impossible d’oublier le sien.
Autour des trois femmes, le recueillement se fait un peu moins feutré. Certains se congratulent, désolés néanmoins de se retrouver dans de telles circonstances. Quelques-uns lorgnent avec envie en direction du bar L’Angélus où ils pourraient poursuivre leur conversation. Après tout, ce Mathurin Melchior n’était qu’un cousin éloigné et ils n’étaient pas en si bons termes que cela pour faire l’effort d’aller jusqu’au cimetière de Saint-Ilan. Certains sont venus à pied jusqu’à l’église et faire trois kilomètres par cette chaleur ne leur paraît pas envisageable.
Solène aide sa tante à s’installer sur les sièges arrière du corbillard avec Chloé qui lui tend les clés de sa voiture.
— C’est la Clio bleue de l’agence. Tu peux nous suivre, s’il te plaît ?
Aussi discrètement que possible, Solène s’insère dans le convoi funéraire qui longe la grève jusqu’à un cimetière isolé en pleine nature. Les feuilles des marronniers, jaunies et flétries, font elles aussi une tête d’enterrement. Toute la nature environnante souffre de cette chaleur, hors normes pour la région. Finalement, il n’y a guère plus d’une quinzaine de personnes à avoir fait le déplacement. Pressé d’en finir et de regagner la relative fraîcheur de son église, le prêtre se fend cependant d’une courte bénédiction devant la bière croulant sous des couronnes et des gerbes de fleurs sacrifiées pour l’occasion. Après la descente au tombeau, sous l’invitation du préposé aux funérailles, la famille et les proches viennent jeter des pétales de roses dans le trou béant. Soudain, venu de la mer, un vent impétueux se lève, bousculant la chasuble mauve du prêtre, qui la prend en pleine figure. Une grand-mère qui, pour l’occasion, avait sorti sa voilette de crêpe noire, ne peut la retenir et la regarde, désemparée, s’enfuir dans les airs, sous la mine pincée des enfants de chœur. L’un d’eux ne peut s’empêcher de pouffer en baissant la tête. C’est pour tout le monde le signal tant attendu signifiant la fin de la cérémonie.
En se dirigeant vers le parking, Solène questionne sa cousine :
— Pourquoi être venus ici ? Le cimetière de Saint-Brieuc aurait été plus près pour ta mère.
Chloé lui pose un bras amical sur les épaules et d’un geste de la main, désigne toutes les tombes.
— Mon père voulait être enterré ici, près des siens. Il paraît que plus de la moitié de tous ces gens sont de notre famille. Moi, je ne me souviens que de quelques noms. De toute façon, tu me connais, je ne suis ni famille, ni cimetière, alors ne compte pas sur moi pour t’en faire l’inventaire.
Solène ralentit et prend un peu le temps d’observer la liste des défunts et leur emplacement, affichée sur un grand panneau à l’entrée. Aucun nom ne lui est vraiment familier. Celui de son vrai père n’en fait pas partie.
*
Dans le train qui la ramène à Paris, pour une raison qu’elle ne parvient pas à s’expliquer, Solène ressent comme un mauvais pressentiment. La mort de son oncle n’y est pour rien, ni la séparation avec sa cousine – et encore moins sa tante – sur le quai de la gare.
Louison ne cessait de geindre et Chloé paraissait à cran contre sa mère. Elle n’avait pris aucun gant pour lui signifier qu’elle avait rendez-vous avec des clients à son agence immobilière de Langueux pour une visite, et qu’elle la déposerait devant son appartement sans pouvoir rester avec elle.
— Un jour comme celui-ci, s’était lamenté Louison. Tu avais droit à des jours de deuil, non ?
— Tu le sais, maman, je suis à mon compte et je n’ai droit à rien. Quand vous étiez à la pharmacie avec papa, avez-vous manqué une seule journée ? Êtes-vous déjà venus à une seule réunion à l’école ? À une seule de mes compétitions de voile ? Pas que je me souvienne !
La chaleur accablante accentuait sa nervosité. Peu habitués, les gens semblaient excédés. Sentant que la litanie des reproches risquait de s’éterniser et de s’envenimer, Solène avait fait diversion :
— Que vas-tu faire, maintenant, tante Louison ?
— Puisque ma fille n’aura pas le temps de m’y conduire, je vais demander à ma belle-sœur de faire les démarches pour entrer en maison de retraite. Je ne me vois pas rester toute seule, sans mon pauvre Mathurin. Je suppose que tu ne reviendras pas de sitôt, toi non plus. Paris doit être plus intéressante que notre région. Je comprends… La jeunesse est ainsi à présent…
— Ce sont les vacances et on est en sous-effectif, mais je reviendrai le mois prochain… avait prétendu Solène.
Afin de les culpabiliser davantage, Louison avait essuyé quelques larmes imaginaires et reniflé dans son mouchoir.
— De toute façon, il te faudra revenir chez le notaire pour la lecture du testament. Vous verrez que mon pauvre Mathurin n’a pas été ingrat, lui…
2
— J’en ai marre de ces tarés, soupire Gérard.
Depuis le milieu de la nuit, les hurlements et les insultes ont repris dans la cellule dotée de solides grilles de sécurité, au fond du couloir. Les puissantes doses abrutissantes de neuroleptiques administrées durant des années à ce patient n’ont plus guère d’effets sur lui. Les autres camisoles chimiques ne se montrent pas plus efficaces. Désemparés, les médecins se sont simplement résolus à tenter d’insonoriser sa porte et à attacher le forcené sur son lit. Le personnel médical et les autres détenus en arrivent à souhaiter qu’il meure. Pour qu’il se taise, enfin.
C’est un peu par dépit que Gérard a intégré l’UMD1 de Villejuif, dans le Val-de-Marne. Ce n’est qu’à vingt minutes du petit appartement qu’il a acheté avec Blandine, sa femme. Mais le jeune homme n’a ni la carrure, ni la force psychologique lui permettant d’affronter tous ces détraqués, pour la plupart des criminels, dont le comportement les rend incompatibles avec une incarcération traditionnelle. Pour autant, il est déterminé à prendre son mal en patience pendant encore une dizaine de jours. Grâce à un médecin dont Blandine garde les enfants, il a obtenu sa mutation pour le service gériatrie à la fondation Rothschild, rue Picpus, dans le XIIe arrondissement de Paris. Avec les transports en commun, il mettra une grosse demi-heure, mais au moins, avec les vieux, il sera tranquille.
Gérard regarde sa montre en espérant qu’elle a enfin avancé. Encore deux heures à tirer avant la relève de huit heures. Comme le prévoit la note de service, il entreprend de jeter un coup d’œil dans le judas de chaque cellule. Une veilleuse permet de s’assurer que tout ne se passe pas trop mal, sauf pour l’autre furieux du bout du couloir. À la troisième porte, la position du pensionnaire lui paraît anormale. Ses jambes sont encore dans le lit, mais son buste et sa tête reposent sur le sol. Un interrupteur extérieur lui permet d’inonder la cellule de lumière.
Là, ce n’est pas normal du tout.
L’homme a la manche de son pyjama serrée autour du cou et il ne bouge pas d’un millimètre.
Oh non, pas un suicide, pas maintenant.
Les consignes sont claires. Quelle que soit la situation, ne jamais intervenir seul. À l’aide de son talkie-walkie, il appelle le bureau de veille.
— Je t’écoute, Gégé, qu’est-ce qui t’arrive ? lui répond une infirmière. Tu t’ennuies déjà de nous ?
— Déconne pas, Solange. Je crois que j’ai un suicide, à la 34. Tu peux m’envoyer Laurent ?
— 34 ? C’est celui qui a été interné la semaine dernière. Bon, j’arrive. Laurent ronfle comme un sonneur.
Gérard trépigne sur place, quand les pas couinent enfin sur le pavage brillant. Il n’est peut-être pas trop tard.
Cela fait déjà six ans que Solange exerce à l’UMD. Deux ans auparavant, la direction l’a affectée au pavillon des hommes ayant commis des crimes ou des délits graves. Malgré la surveillance drastique et les multiples précautions, des tentatives de suicide, elle en a déjà vu quelques-unes. La plupart du temps, pour exprimer une grande détresse. L’an dernier, un homme y est parvenu au bout du septième essai. La poitrine et les hanches imposantes, l’infirmière ne se laisse jamais déborder. Elle est réputée pour avoir la piquouse facile et la clé de bras redoutable. Gérard aime bien son humour en toutes circonstances. À son tour, Solange regarde par le judas.
— Il y a longtemps que tu es passé ?
Bien qu’il connaisse déjà la réponse, Gérard consulte sa fiche de travail.
— Non, trois quarts d’heure, pas plus.
— OK, ouvre !
Avec une force qui surprend souvent ses collègues masculins, Solange empoigne l’homme au visage violacé par les épaules et le repositionne sur le lit. Elle doit s’y reprendre à deux fois pour libérer le nœud qui l’étrangle. Même s’il est totalement inerte, le corps semble à température normale. Tout n’est peut-être pas perdu. Quand elle penche son oreille au-dessus des lèvres pour vérifier s’il y a un filet de respiration, tout se passe alors très vite. Le regard de fauve de l’homme s’illumine en une fraction de seconde. Sa main s’empare aussitôt du stylo qui dépasse de la poche de l’infirmière, tandis que son avant-bras entoure fermement son cou.
— Eh, toi ! réagit Gérard en bondissant sur le prisonnier.
La seconde suivante, le stylo s’enfonce dans son œil et atteint le cerveau.
Telle une marionnette dont on aurait coupé les fils, Gérard s’écroule mollement au pied du lit.
Sans que Solange n’ait vraiment le temps de réagir, le stylo encore sanguinolent se retrouve à un centimètre de sa pupille, prêt à lui réserver le même sort.
— Toi pas faire la maline, sinon toi mourir aussi. La voix gutturale, murmurée tout près de son oreille, calme toute velléité de prononcer une seule parole et de faire un quelconque mouvement pouvant être mal interprété. La suite, Solange a l’étrange impression de la vivre comme dans un film d’action, ses préférés, sans s’imaginer qu’une chose pareille soit envisageable dans un établissement aussi sécurisé que celui-ci.
C’est la sirène d’alarme qui parvient à sortir Laurent, le deuxième veilleur, de son profond sommeil. Il se rue sur les écrans de contrôle pour constater avec effroi que la cellule 34 est grande ouverte et que la dernière porte du pavillon menant dans la cour du centre hospitalier n’a pas été déverrouillée selon les règles de procédures habituelles.
En un temps record, toutes les équipes de sécurité sont mobilisées afin de patrouiller dans l’immense parc et ses jardins sculptés façon château de Versailles. En désespoir de cause, le directeur de l’hôpital psychiatrique, Paul Guiraud, se résout à appeler la police pour enclencher la procédure d’urgence.
Un dangereux fugitif s’est volatilisé, emmenant une femme en otage, après avoir tué un infirmier.
Une heure plus tard, Solange est retrouvée à l’échangeur de la porte de Saint-Cloud où, au volant de sa voiture, elle vient de percuter volontairement un fourgon de police en stationnement sur l’accotement. Remis de leurs émotions, les agents mettent plusieurs minutes à comprendre pourquoi cette femme en blouse blanche a défoncé leur véhicule.
Plusieurs témoins de la scène affirmeront ensuite qu’ils ont aperçu un homme seulement vêtu d’un pantalon de pyjama s’extirper de l’arrière de la voiture tamponneuse. Bénéficiant de la stupeur provoquée par cet accident, il a couru le long des voitures roulant au ralenti et s’est accroché à l’échelle d’un camion-benne roulant en sens inverse.
1 Unité pour malades difficiles.
3
Le brouhaha lointain de la ville semble s’inviter par la fenêtre. Malgré la climatisation, quelqu’un a décidé d’ouvrir la baie vitrée de la salle de réception. Sans doute pour que tout le monde profite de la chape de plomb écrasant tout le pays. Cette fichue canicule n’en finit pas.
Solène est rentrée la veille de Bretagne et la chaleur à Paris lui est encore plus insupportable. Mais pour rien au monde, elle n’aurait manqué le pot de départ de son patron. Pourtant, cela lui déchire le cœur de le voir partir. Pour ne pas faire jaser, Solène se tient au fond de la salle. Elle lui fait un petit signe de la main, mais il ne la remarque pas.
La bouche pâteuse, cherchant un regard complice et amical, le commissaire divisionnaire Stanislas Lawrence a l’impression d’être sur un nuage, ou plus précisément dans une brume épaisse et sombre. Probablement pour la première fois de sa carrière, il ne parvient pas à mesurer l’enjeu crucial qui se joue aujourd’hui. Cela faisait plusieurs semaines qu’il mijotait cette journée, ne sachant pas s’il devait la redouter ou la savourer.
Les mains croisées dans le dos, il observe, réfléchit, fait le bilan.
Combien de fois a-t-il prononcé de discours pour ses collègues qui quittaient l’institution ? Bien souvent, il s’est demandé ce que pouvaient ressentir ces hommes et ces femmes, tournant la dernière page d’un livre bien rempli.
Certains débordaient de gaîté, d’autres cachaient plus difficilement une grande affliction derrière une attitude faussement désinvolte.
Lawrence espérait que ce jour lui apporterait un début de réponse. Mais rien.
Il n’y croit pas, tout simplement.
Tout a été si vite.
À force d’attendre des jours meilleurs, d’espérer une promotion, l’aboutissement d’une longue et fastidieuse enquête, la réussite scolaire de leur fille – tout ce qui fait les petits détails d’une vie –, quarante années étaient passées.
Pffffuit ! Comme ça.
Et cette fois, c’est à son tour d’être sur la sellette, de subir des éloges plus ou moins sincères.
En présence de tous les chefs des Brigades, le grand patron de la DRPJ2 viendra en personne encenser les jours heureux de la carrière de ce brillant policier ayant très vite rejoint la Crim’ au 36, quai des Orfèvres. Des réussites, il y en avait pléthore.
Le directeur n’aura pas à mentir pour passer sous silence les quelques déboires calamiteux, les loupés minables et l’immense chagrin d’avoir vu mourir un jeune collègue dans ses bras. Ces choses-là ne figurent pas dans le carnet d’appréciations qui suit chaque fonctionnaire.
Stanislas Lawrence se tourne vers la fenêtre. Il ne peut s’empêcher d’avoir une pensée émue pour tous ceux partis trop tôt.
La roulette russe de la vie.
Sa glotte s’active, imperceptiblement, ses yeux s’embuent quand il songe à celle qui lui manque le plus à ce moment précis. Si tout s’était passé normalement, elle se serait mêlée, comme à son habitude, aux anonymes. De loin, son regard bienveillant l’aurait rassuré.
Putain de roulette russe de la vie !
Quelques flashs, quelques cliquetis électroniques. La presse parisienne est là, immortalisant la scène de cet homme en plein doute, complètement désemparé. Les images parleront d’elles-mêmes mais raconteront inévitablement une autre histoire.
Le divisionnaire les ignore. Bientôt, ce sera à son tour de parler. Il n’a rien préparé. Il n’aime pas ça. Inutile, puisqu’il ne lit jamais ses discours, préférant faire confiance à son sens de l’improvisation. Les mots qui font mouche, il les connaît par cœur. Cette fois, sans prévenir, un doute insidieux s’installe.
Lawrence ne sait plus où il en est. Ses idées s’entrechoquent, tournent en boucle. Il en est sûr maintenant, les mots ne viendront pas. Le spectacle de ce matin a plombé le reste de ce qui devait être une belle journée.
Le reste de sa vie.
Mais, bon sang, pourquoi était-il passé à l’hôpital si tôt ? Il n’y allait jamais le matin. Les aides-soignantes le savaient. Ainsi, elles avaient le temps d’effacer les affres de la nuit. Rendre Gaëlle présentable pour qu’il ne soit pas le témoin de cela.
Sachant que ce pot de départ risquait de s’éterniser, voire de se terminer en repas avec certains collègues, il avait voulu lui dire qu’il ne pourrait pas venir ce soir-là mais qu’il penserait à elle toute la journée, encore plus fort que d’habitude. Lui dire qu’il serait le seul à savoir qu’elle lui tiendrait la main. Pour qu’il se sente bien, pour qu’il soit heureux et qu’il n’ait pas peur.
Quelle ignominie !
Le regard comateux, Gaëlle avait eu honte qu’il la voit ainsi.
Débordées, comme d’habitude, les aides-soignantes n’étaient pas encore passées pour lui faire sa toilette. Le lit, ravagé par une nuit de souffrances, de peurs, de doutes, d’appels au secours, ressemblait à un champ de bataille.
Stanislas avait eu envie de mordre, d’insulter, de faire souffrir la première qui s’aventurerait par là.
Personne n’était passé assez près.
Tout était de sa faute. Comment avait-il pu accepter cela ?
Les yeux pleins de larmes, Stanislas l’avait pris dans ses bras comme on prendrait un enfant. Gaëlle ne pesait plus rien.
Putain de maladie !
Il lui avait enlevé sa chemise de nuit et sa couche et l’avait assise sur un strapontin dans la douche.
« Pardon, pardon », ne cessait-il de répéter, n’osant pas regarder ce corps décharné.
Que restait-il de cette plantureuse jeune femme qu’il avait tant aimée, tant caressée, embrassée ? De ce corps qui s’était mêlé au sien au point de n’en faire qu’un.
Ces petits seins flétris, presque vides, ce ventre flasque à la peau parcheminé, laissant pointer les os du bassin, du pubis…
« Mon Dieu ! Non ! Ce ne peut pas être ma Gaëlle ».
Les vestiges de sa libido reçurent le coup de grâce.
Il eut envie de hurler contre cette saloperie de crabe qui consumait sa femme de l’intérieur, se mordit les lèvres jusqu’au sang pour ne pas crier, ne pas craquer.
Pas devant elle. Pas aujourd’hui.
Ce n’était pas à lui de faire cela. Il aurait dû se rendre auprès de l’infirmière en chef pour lui dire ses quatre vérités. Exiger qu’on s’occupe de sa femme.
Immédiatement !
Un drap de bain cacha bien vite l’ignominie de la déchéance. Il l’avait prise dans ses bras, l’avait serrée doucement contre lui. Dans le creux de l’oreille, il lui avait chuchoté qu’une fois à la retraite, il la ferait revenir chez eux, paierait une infirmière pour qu’elle s’occupe d’elle à plein temps.
Lui, n’aurait plus à obéir à l’injonction sadique du réveil ou du téléphone piétinant impunément ses nuits sans sommeil. Il passerait enfin de longs moments près d’elle, pourrait l’emmener se promener dans ses endroits préférés, où parfois, trop rarement, il l’accompagnait. Ils iraient tous les jours maintenant. Si elle le souhaitait, bien sûr.
Promis.
Stanislas ne lui dit pas, mais songea qu’elle pourrait finir sa vie tranquille, dans la dignité, puisque la vie en avait décidé ainsi.
*
Pour tenter de chasser ses idées noires, Lawrence secoue la tête. Son attention est alertée par le brouhaha des invités se saluant et se congratulant. Certains, toujours les mêmes, se tiennent au plus près du buffet préparé par le traiteur. Pour être en bonne position lorsque, l’air faussement enjoué, il leur dira qu’il les invite à partager le pot de l’amitié.
Cette fois, cela ne le fait pas sourire.
Il se retourne et cherche Solène Melchior du regard, quand soudain la foule se scinde en deux pour laisser passer une haute stature coiffée d’un képi orné de feuilles de chêne. Son ami de toujours, le général François Fourcade, a tenu sa promesse. Un simple signe discret de la tête entre les deux hommes est suffisant pour laisser passer toute la reconnaissance et leur complicité de toujours.
— Comment vas-tu ? lui demande le gendarme.
Stanislas élude, se contentant de répondre :
— Et toi ?
Une petite moue lui démontre que le militaire n’est pas dupe. L’état de Gaëlle Lawrence n’a pas dû s’arranger. Mais l’heure n’est pas aux atermoiements. Il faut être fort, digne. Faire comme si…
Derrière, les conversations ont repris.
Fourcade presse le bras de son ami pour lui signifier : « courage, je suis avec toi ». Le képi coincé sous le bras, il rejoint les officiels dans un angle de la salle. Un homme lui fait un imperceptible signe de tête, avant de plonger le regard vers sa montre, impatient que cela se termine.
Le gendarme connaît le professeur Saint-Ambroix. Il n’apprécie guère cet éminent médecin légiste. Trop fier, à son goût, de son statut. Trop présomptueux de ses conclusions médico-légales, souvent péremptoires. Ils se sont déjà heurtés, verbalement.
L’un et l’autre font semblant d’oublier l’amertume de ce souvenir et se saluent, ne sachant trop quoi se dire. Opportunément, la capitaine Solène Melchior vient se hisser sur la pointe des pieds pour embrasser le gendarme. Pour bien marquer la différence, elle tend une main plus froide à Saint-Ambroix.
— Quelle chaleur, hein ?
— Vous revenez de vacances, Solène ? s’amuse le général en voyant les marques rouges sur son front et sur son nez.
— Même pas ! Je reviens des obsèques de mon… oncle à Saint-Brieuc. Enfin, Yffiniac. C’est juste à côté.
— Oh ! Je suis désolé.
Fataliste, Solène hausse les épaules.
Fourcade aime bien la spontanéité de cette jeune femme. Il flotte en elle comme un parfum de Bretagne. Ses cheveux naturellement méchés blond roux et son nez mutin tavelé de taches de rousseur lui donnent un air faussement candide, presque fragile. Seuls ceux qui l’ont affrontée savent que ce n’est pas le cas.
Six ans plus tôt, le commissaire Lawrence l’avait prise sous son aile pour lui faire gravir les échelons. Pas parce qu’elle était belle et charmante, mais parce que professionnellement, c’était probablement la meilleure de son groupe. Trois semaines auparavant, elle l’avait une fois de plus prouvé. Grâce à sa pugnacité, Stanislas Lawrence ne laissera pas cette casserole à son successeur. C’est elle qui a réussi à serrer Angel Vulpescu, le Lituanien que les médias surnomment l’Éventreur. Ce serial-killer qui écumait impunément le bois de Boulogne depuis dix-huit mois.
Solène considère Lawrence comme son père spirituel. Fourcade est convaincu que la réciproque est vraie. Cette jeune femme est la fille qu’il aurait aimé avoir. La sienne, la légitime, s’est fait la malle à dix-neuf ans avec un Américain de passage et ne donne de ses nouvelles que pour le Premier de l’an, quand elle y pense.
C’est d’ailleurs chez les Lawrence qu’il a fait la connaissance de la petite protégée. Solène venait fêter l’anniversaire de Gaëlle. Avant que sa maladie ne s’aggrave.
Son air faussement juvénile fait de la capitaine Melchior une terrible machine à broyer les plus récalcitrants. Devant elle, leur sourire gouailleur s’efface vite lorsqu’à son rythme, elle abat un à un ses atouts.
Elle n’élève jamais la voix, ne profère jamais d’injures. Sa petite taille ne le lui permet pas. Mais lorsqu’elle a en face d’elle la pire des ordures, ses grands yeux couleur d’automne prennent un reflet de blizzard sibérien.
Les premières fois que le commissaire Lawrence l’avait vue à l’œuvre dans la salle d’interrogatoire, il avait compris que ce serait un grand flic.
Mains croisées devant elle, Solène reste près du général Fourcade, espérant que son boss s’apercevra enfin de sa présence. Un murmure de surprise suivi d’un silence s’impose lorsque le célèbre journaliste Bruce Whalker, flanqué de son secrétaire, chauffeur et probablement homme à tout faire, entre dans la salle de réception.
Pendant de longues années, Whalker a fait la pluie et le beau temps au JT de 20 heures. Quelques années auparavant, TF1, la chaîne qui l’employait a elle aussi cédé au jeunisme et s’en est séparée après un procès retentissant. Afin de rester dans la course, le coléreux et impétueux journaliste a préféré monter sa propre société qu’il a pompeusement nommée Eagle-Production, pour faire honneur, prétend-il, à ses ancêtres britanniques. Pour bien montrer qu’il a tourné la page, Whalker a troqué sa petite mous-tache à la Clark Gable pour celle d’Hercule Poirot. Inévitablement, mais cela était sans doute calculé, les caricaturistes et imitateurs se sont joyeusement emparés de cet attribut grotesque. N’est-ce pas sa manière à lui de casser les codes et de se les attribuer ?
L’unique vocation de sa petite entreprise est de financer et revendre une émission très en vogue : Criminal-Story. Ce n’est donc pas la première fois qu’on le voit arpenter les couloirs de la Crim’. D’ailleurs, il réside tout près, quai d’Anjou, ce qui lui facilite la tâche. Néanmoins, c’est la première fois qu’il vient à un pot de départ. Certains enquêteurs en font l’évidente conclusion. Soit le commissaire Lawrence l’a invité, soit le journaliste vient le racoler pour participer comme intervenant dans ses émissions.
Les bavardages entre policiers de tous grades s’effacent à l’arrivée du directeur de la DRPJ et du préfet de police.
Les hauts fonctionnaires parlent à voix basse avec le commissaire Lawrence. Leurs regards se tournent alors vers Solène.
Un étau lui serre le ventre.
2 DRPJ : Direction Régionale de la Police Judiciaire de la préfecture de police.
4
Pas de gobelets en plastique pour le départ du commissaire. Le traiteur a bien fait les choses, le champagne et les petits fours ont rapidement été pris d’assaut. En tout premier lieu par ceux qui montaient la garde au fond de la salle, se moquant bien des discours des uns et des autres. Un peu étonnés, tout de même, que pour une fois, leur boss n’en fasse pas des tonnes. Contrairement à son habitude, Lawrence s’est montré soft. Sans doute l’émotion de quitter la grande maison. Et puis, c’est son pot de départ, et finalement sa modestie a dû reprendre le dessus, se disent les flics crevant de chaud dans leur veste légère, passée pour l’occasion.
Personne ne peut imaginer l’angoisse qui martyrise les tripes de Stanislas. L’obsédante vision du corps meurtri de Gaëlle ne cesse de piétiner son cerveau. Il n’a même pas entendu les éloges du directeur et du préfet de police. Seuls les applaudissements sont parvenus à crever sa bulle.
Son regard embué croise enfin celui de son ami. Fourcade lui renvoie un petit sourire triste. Il connaît son désarroi.
La touffeur se fait accablante. Dehors, le ciel embrumé de pollution vient de se charger de cumulonimbus, rendant l’atmosphère encore plus électrique.
Si seulement il pouvait pleuvoir, songent ceux qui ont pu se garer non loin du 36’.
Le commissaire a réussi à reprendre figure humaine. Quelques tapes sur l’épaule accompagnent Stanislas Lawrence tandis qu’il progresse lentement vers Fourcade et Solène, toute petite à ses côtés. Tout le monde souhaite lui parler une dernière fois. Évoquer une ou deux anecdotes sulfureuses ou mémorables. Pour faire bonne figure, il blague avec les uns et les autres, lève son verre d’eau pétillante. Un verre de champagne lui aurait fait du bien. Pas aujourd’hui, pas sans Gaëlle. Pas après ce qu’il a vécu ce matin. Ce serait indécent.
Un premier éclair fait oublier la blancheur des flashs. Les vitres vacillent, provoquant des « Ah ! » de soulagement pour certains, de crainte pour d’autres.
L’orage arrive. Enfin !
Le général Fourcade trinque poliment avec quelques collègues policiers. On lui sourit, mais on apprécie modérément la présence de la « maison d’en face ». Un général, ça ne doit pas rigoler tous les quatre matins.
Bruce Whalker tente une approche en laissant son secrétaire au loin. En l’apercevant se diriger vers elle, Solène se tourne vers Fourcade et lève la tête vers lui en buvant son jus de fruit dans une flûte. Sacrilège.
Elle murmure :
— Lawrence a l’air inquiet.
— Je pense que Gaëlle ne va pas bien.
Elle n’en dit rien, craignant autre chose. Elle n’a pas apprécié les regards du préfet et du patron. Le départ du commissaire serait-il un prétexte pour redistribuer les cartes ?
— Je sais, ça finira mal, se contente-t-elle de dire.
Le commissaire continue sa difficile progression parmi les convives.
Solène baisse la voix.
— Je vous ai vu soupirer tout à l’heure, quand le préfet a parlé de tous les célèbres policiers ayant foulé les marches mythiques de ce grand édifice.
Fourcade ne peut s’empêcher de sourire.
Toujours aussi observatrice et aussi directe.
— J’ai soupiré, moi ?
— Ouais ! Vous avez même fait une drôle de moue, comme ça.
Elle l’imite en haussant les sourcils en accent circonflexe.
Le général boit une gorgée pour se donner une contenance. Elle ne le lâchera pas avant qu’il ait dit pourquoi il avait exprimé involontairement ce doute.
— Vous vous méprenez, chère Solène. J’admire avec une réelle sincérité tous ces grands enquêteurs qui ont fait du 36, quai des Orfèvres un lieu incontournable de la police judiciaire. Que dis-je, un sanctuaire !
— Je sais ! l’interrompt-elle. C’est quand il a évoqué Bertillon.
Sans conviction, Fourcade nie de la tête, pensant que décidément, rien ne lui échappe.
— Je ne voudrais pas écorner l’image emblématique de ce pionnier de la criminalistique qui figure au frontispice du 36’. Il a fait de belles choses.
Solène ne relève pas frontispice, se disant que son ami le général rame à contre-courant, comme un forcené. Elle ne souhaite pas le mettre mal à l’aise, car elle apprécie depuis toujours son allure très digne lorsqu’il est en public. Pourtant, il ne mâche pas ses mots, parfois salaces, en petit comité. Elle décide de le titiller davantage pour oublier le regard ambigu de son boss.
— Il y a forcément un « mais » ?
— Vous savez, Solène, si je commande l’IRCGN3, ce n’est pas pour rien. Je n’aime pas dire cela, j’ai l’impression de me vanter.
— Mais ? insiste-t-elle.
— Il y a quelques années de cela, mes études m’ont amené à faire un postgrade en criminalistique à l’université de Lausanne.
— Et alors ? demande-t-elle en buvant son jus de fruit et en jetant un regard inquiet vers Lawrence qui s’approche dangereusement.
— Alors, poursuit le gendarme, Bertillon est bien connu là-bas aussi, notamment du professeur qui dirigeait les cours, je tairai son nom pour éviter les représailles.
— À ce point-là ?
— Non, peut-être pas, mais il m’en a appris de bien bonnes sur ce personnage. Mais nous en reparlerons une prochaine fois, si vous voulez bien.
La petite taille de Whalker et sa notoriété lui permettent de jouer des coudes jusqu’à Solène et Fourcade. Effrontément, il s’immisce dans leur conversation.
— Mon général, capitaine. Quel plaisir de vous rencontrer tous les deux. Figurez-vous que vous êtes probablement les deux personnes que je courtise le plus. Malheureusement, pour une raison que j’ignore et qui me préoccupe, vous semblez me bouder.
— Je n’ai jamais boudé personne, monsieur Whalker, rétorque Fourcade. Vous le savez, les demandes de visites et de reportages à l’institut sont nombreuses et doivent suivre un protocole qui incombe à l’officier communication. Si vous avez fait une demande en bonne et due forme, je peux néanmoins lui demander de l’étudier avec intérêt.
— Je vous remercie, mon général.
Le sourire mielleux, Whalker se tourne vers Solène tout en lissant nerveusement ses fines moustaches, tic récurrent chez lui et souvent imité par les humoristes.
— J’espère avoir autant de chance avec vous, capitaine. L’arrestation d’Angel Vulpescu, ce dangereux criminel, a suscité bien des commentaires au sein des médias. Bien que votre nom ait été peu cité, je sais que c’est un exploit personnel et je vous en félicite…
— Merci, riposte sèchement Solène en voyant arriver vers elle le commissaire Lawrence, le visage fermé.
— Ce pourrait être gratifiant pour la police et aussi pour vous, poursuit Whalker, si vous apportiez quelques détails sur cette incroyable arrestation. Les gens ont besoin de savoir qu’ils peuvent compter sur leur police.
— Vous le savez, Monsieur, ce n’est pas contre vous, mais je ne donne jamais d’interview.
Le visage blême, Stanislas Lawrence s’interpose.
— Il y a un problème, Patron ? lance Solène à brûle-pourpoint.
— Un sérieux, oui. Venez avec moi !
3 IRCGN : Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. Laboratoire aujourd’hui implanté à Pontoise (Val-d’Oise) au nord-ouest de Paris.
5
Le ciel est si noir, si bas, qu’il semble, telle une méduse méphistophélique, avaler les toits de Paris, les arbres, et même les péniches glissant mollement sur la Seine.
Et toujours pas de pluie.
Seules des myriades d’éclairs au-dessus de la masse nuageuse paraissent lui donner vie.
Ce doit être ça, l’apocalypse, songe Solène.
En dépit de la chaleur, elle a les mains glacées. Tout son être hésite entre transpiration et tremblements de froid. Téléphone à l’oreille, elle tourne en rond dans son bureau, traînant son angoisse tel un boulet de bagnard, et fulmine contre la sonnerie obsédante qui résonne dans le vide au bureau d’accueil de l’unité pour malades difficiles.
— Pas étonnant qu’il ait réussi à se tirer ce salopard !
Vulpescu était devenu tellement ingérable au cours de sa garde à vue et de sa présentation au tribunal, que le juge avait préféré le faire transférer dans cette structure à Villejuif, au sud de Paris.
Les secondes durent des minutes à rallonges. Solène a maintenant l’impression que cela fait des heures qu’elle tente de joindre ce service. Des heures que le commissaire Lawrence lui a appris l’évasion d’Angel Vulpescu, et qu’elle tente de rassembler tous les éléments possibles pour serrer ce psychopathe qui vient une fois de plus de tuer pour s’enfuir.
En réalité, cela ne fait que quelques minutes, mais soudain, le temps a choisi de prendre une terrible dimension.
« L’Éventreur » est en cavale et rien ne bouge.
Une voix lascive lui donne enfin un signe de vie.
« Ah, quand même ! » a envie d’aboyer Solène, mais ce n’est pas son genre.
Elle se présente, annonce sa qualification d’officier de police judiciaire. Cela ne change rien. La secrétaire qui lui répond avec un accent des îles caribéennes ne veut ou ne peut rien dire au téléphone. Les consignes sont strictes, surtout dans un cas comme celui-ci. Certains journalistes n’hésitent pas à prétendre des énormités pour extirper des renseignements. Solène sait cela, mais là, elle manque d’arguments pour espérer la convaincre.
L’Antillaise consent néanmoins à transmettre l’appel au directeur de l’UMD.
Cette fois, l’homme comprend qu’il ne s’agit pas d’un subterfuge. Le nom de la capitaine Melchior a agi comme un sésame. Pourtant, ce n’est pas elle qui a transféré ce prisonnier dans son unité. Comme elle s’en étonne, le directeur finit par lui confier l’inconcevable.
Solène se doutait bien que Vulpescu ne la portait pas particulièrement dans son cœur, mais les menaces précises qu’il a proférées à son égard sonnent comme une sentence de mort : « Dites à Melchior que je termine toujours ce que j’ai commencé ».
Elle a toutes les peines du monde à garder une attitude professionnelle. À l’autre bout de la ligne, l’homme sent son désarroi.
Angel, « l’Ange de la Mort » comme tous les médias le surnomment à présent, n’a pas hésité à tuer un infirmier d’un coup de stylo-bille dans l’œil, avant de prendre en otage une infirmière terrorisée, la menaçant de manière identique avec cette arme de circonstance, encore sanguinolente.
— On a retrouvé son otage ? demande Solène d’une voix fébrile.
— Oui ! Elle a réussi à échapper à sa vigilance en provoquant un accident avec un fourgon de police. Mais Vulpescu a pu prendre la fuite. Elle a expliqué les circonstances : il a feint de s’être suicidé avant de s’en prendre aux deux membres du personnel qui se portaient à son secours. Je pense que vous devriez prendre contact avec vos collègues en charge de l’enquête. Ils auront sûrement plus d’éléments.
Solène le remercie et raccroche.
Un coup de tonnerre plus proche et plus violent que les autres la fait sursauter. Son thermostat corporel joue au yoyo. Malgré sa force de caractère qu’elle puise dans son vécu chaotique, l’angoisse décide de siphonner son estomac. Son abdomen devient glacé. Déjà éventré par ce tueur qui a juré sa mort. Ses joues bouillonnent, son décolleté s’empourpre.
Le commissaire Lawrence arrive enfin aux nouvelles. La cérémonie s’est éternisée, alors qu’il trépignait d’envie de savoir.
Il découvre Solène assise derrière son bureau. La bouche entrouverte, les yeux hagards mais secs.
Il ne l’avait jamais vue comme ça.
— Calme-toi, Solène. On va le coincer ce salaud. Le préfet vient de m’informer que l’Intérieur mettait le paquet. Le RAID, les CRS et les gendarmes sont sur le coup. Les connaissant, ils ont dû sortir la grosse artillerie : les hélicos, les escadrons de mobiles, les chiens. Il ne pourra pas aller loin.
— Ils ne l’auront pas. Ce type est un vrai fauve. L’instinct de tuer et de fuir est inscrit à son patrimoine génétique.
Stanislas se contente d’une moue. Il sait qu’elle a raison.
Cela faisait maintenant dix-huit mois que ce monstre s’amusait avec eux. Dix-huit mois qu’il torturait, violait des prostituées dans le bois de Boulogne, avant de les éventrer et de les regarder mourir. Parfois, il s’arrêtait quatre ou cinq mois, puis il reprenait. Deux dans la même semaine. Neuf filles étaient passées ainsi de vie à trépas. Et la police piétinait. L’opinion publique s’impatientait, les pontes de la place Beauvau et le préfet de police harcelaient la brigade criminelle. Et le patron de la PJ, comme si cela ne suffisait pas, en remettait une couche à chaque réunion de travail.
À bout de stratagèmes pour le coincer, Solène et deux autres femmes policières s’étaient mêlées à la faune nocturne. Elles y avaient passé des nuits et des nuits, dans le froid, se battant parfois avec les vraies prostituées et les travestis pour conserver leur place. La meilleure place. Ces drôles de nanas qui n’acceptaient jamais les avances d’un mec, ne racolaient jamais, ne leur faisaient finalement aucune concurrence. Des amitiés avaient même fini par naître avec ces esclaves du sexe. L’une d’elles suggéra qu’il s’agissait probablement de journalistes enquêtant sur le plus vieux métier du monde. Solène n’avait pas démenti, bien au contraire.
Une nuit où elle n’y croyait plus, un homme répondant au signalement l’avait accostée. Son physique ingrat, ses yeux déments et son haleine fétide l’avaient fait frémir. Le cœur tambourinant dans sa poitrine et dans son crâne, elle avait déclenché le bouton d’alarme sur son portable avant de le suivre.
Loin de la route, loin des témoins.
Sans préavis, les terreurs de son enfance la giflèrent tel un boomerang lancé il y a longtemps, par un autre salopard. Une fois de plus, elle convoqua l’énergie qui lui avait déjà permis de sortir de situations tout aussi périlleuses.
Pour faire plus vrai, elle lui avait réclamé son dû.
Pour toute obole, elle s’était ramassée une gifle magistrale qui avait résonné longuement dans sa tête.
— À genoux, salope ! avait-il ordonné avec un accent à couper au couteau.
Ce couteau qu’elle avait aperçu dans sa main, tandis qu’il baissait son pantalon. Ce même couteau qui l’éventrerait une fois qu’il l’aurait violée.
Ses collègues arriveraient trop tard, ils ne trouveraient que son cadavre.
Sa tête tournait, son cœur se soulevait devant ce sexe arrogant. Ce sexe criminel et puant.
Le poignard avait brillé dans la nuit.
— Magne-toi, sinon…
La menace s’était enfoncée dans son oreille.
Chemin le plus court jusqu’au cerveau. Ne sachant pas comment elle pourrait se sortir de cette situation, elle avait abdiqué de la tête, en bonne fille soumise. Elle s’était montrée timide, guettant l’arme du coin de l’œil. Son sac à main avec son pistolet était tombé trop loin d’elle.
Un bruit dans les fourrés avait attiré l’attention du violeur.
Rien qu’une seconde.
Mais une seconde de trop.
Les cours de combats de rue qu’elle avait suivis avant cette mission lui étaient revenus dans cette même fraction de temps.
L’Éventreur s’était écroulé avec ce sentiment que son bas-ventre n’était plus qu’une charpie. Il avait hurlé en lituanien, roulé au sol, puis vomi en se relevant.
Son honneur, sa vie peut-être, était en jeu.
— Je vais te crever ! avait-il grondé, en français cette fois.
Par un atemi du tranchant de la main sur l’occiput, Solène avait définitivement calmé la résurrection du Lituanien. En un temps record, elle lui avait entravé les chevilles et les poignets avec deux liens Serflex retrouvés en toute hâte dans son sac à main.
*
Les grondements du tonnerre les ramènent à ce présent oppressant.
— La foudre n’est pas tombée loin, observe Lawrence en regardant par la fenêtre.
Les poings de Solène se crispent sur les accoudoirs de son fauteuil.
— Lui non plus n’est pas loin. Je le sens. Il est là.
— On l’aura, Solène, on l’aura.
Il ne l’avait jamais tutoyée auparavant, ni appelée par son prénom.
Mais ce soir, quelque chose a changé. Un besoin d’amitié, de quelqu’un à protéger, peut-être.
Stanislas en est convaincu à présent, Gaëlle s’en va.
C’est inexorable.
Il n’a plus de fille, enfin plus vraiment. Lui qui pensait lui avoir inculqué tant de belles choses, tant de valeurs auxquelles elle était restée insensible.
Hermétique.
Elle ne prenait même plus de nouvelles de sa mère. Avait-elle déjà fait son deuil ?
Et lui, y parviendrait-il ?
Combat inégal. Perdu d’avance.
Une boule ne cesse de faire le yoyo dans sa gorge.
— Vous n’allez pas voir votre femme, ce soir ?
Stanislas regarde sa montre : 20 h 40.
Il nie d’un imperceptible signe de tête.
Dehors, le ciel se venge de cette chaleur qui a trop duré. Une divine lance semble avoir crevé les cumulonimbus.
Enfin !
La pluie s’acharne sur les carreaux, nettoie les rues, les trottoirs, tel un karcher géant. Les gouttières submergées dégueulent dans la cour du quai des Orfèvres.
— Ça te dirait de dîner avec moi ?
Solène le regarde avec de grands yeux tristes.
Et l’autre malade, songe-t-elle. Il est là, il m’attend.
— Chez moi ? Je n’ai pas envie d’être seul, ce soir. En tout bien tout honneur, s’empresse-t-il d’ajouter.
Précision inutile pour la capitaine Melchior. Mais est-ce vraiment lui qui a besoin de compagnie ? N’est-ce pas plutôt pour ne pas la laisser en tête à tête avec son angoisse ?
Elle ouvre son tiroir, glisse son pistolet dans son étui et se lève pour le suivre.
6
Résigné à subir d’inévitables reproches, Gontran Saint-Ambroix secoue son parapluie sur le perron et l’abandonne dehors pour le laisser s’égoutter.
— Désolé, dit-il à sa femme qui l’attend, bras croisés sur son opulente poitrine.
— J’ai bien cru que j’allais y aller toute seule. J’ai réservé un taxi, il sera là dans un quart d’heure.
— Je serai prêt.
Fidèle à elle-même, Hortense Saint-Ambroix ne parvient pas à se départir de ce visage austère. Cela fait des années qu’elle n’a pas esquissé le moindre sourire. Rien pour éclairer ce visage ingrat que le poids des ans n’a pas arrangé. Son mari n’est guère mieux loti. Tous les deux étaient tellement laids sur leur photo de mariage qu’elle a fini au fond d’un placard dans le grenier, tout comme les lambeaux de leurs piètres sentiments.
Par chance, leurs jumeaux ne leur ressemblent pas. Trop c’est trop, et la génétique fait parfois œuvre de charité.
— Tu as pu appeler Axel ? lui demande son mari du dressing où il s’apprête.
Hortense lève les yeux au ciel en secouant la tête, comme s’il venait de proférer une incongruité. Une de plus.
— Alors ? insiste Gontran.
— Alors quoi ?
— Tu l’as eu, ou pas ?
— Je lui ai laissé plusieurs messages, il ne répond pas.
Le médecin légiste sort en boutonnant sa veste. Pour ne pas affronter le regard et le visage haineux de sa femme, il vérifie l’état de ses mocassins. Ses vernis ne vont sûrement pas apprécier le déluge, mais il peut difficilement y aller en bottes.
— Il doit se concentrer, suggère-t-il, en tentant de discipliner ses derniers cheveux rebelles. C’est quand même une première pour lui ce soir. Et Anne-Charlotte, tu n’as pas pu l’avoir non plus ?
— Je te l’ai dit hier, elle chante à Berlin depuis une semaine. Tu n’écoutes vraiment rien, hein !
C’est vrai, Gontran l’avait oublié. Il a souvent du mal à suivre les concerts et récitals de son fils et de sa bru. À dire vrai, il se préoccupe peu de cette intendance, laissant cela à sa femme. Il a suffisamment de travail et de préoccupations comme ça.
Mais ce soir, c’est différent. Son nom est sur l’affiche, auprès de celui du chef d’orchestre :
Axel Saint-Ambroix – premier violon.
Il a toujours su que son fils était doué, mais n’imaginait pas qu’il atteindrait une telle notoriété.
— Je croyais que tu n’allais pas à l’IML aujourd’hui, persifle Hortense en regardant sa montre, histoire de lui reprocher son retard.
— Tu vois, toi non plus tu n’arrives pas à suivre. Je t’ai dit ce matin que c’était le pot de départ de Lawrence. Je n’ai pas pu partir avant la fin des discours. Tout le gratin était là. Même Bruce Whalker. Je ne serais pas surpris qu’il l’embauche comme chroniqueur dans son émission.
— Lawrence a dû s’écouter parler, comme d’habitude.
Gontran soupire, cette discussion s’annonce stérile. Quel que soit le sujet, sa femme ne peut s’empêcher de dénigrer les uns et les autres. Polémiquer pour le plaisir ou par aigreur.
— Pas du tout. Je l’ai même trouvé très sobre. Par contre, le préfet et le directeur de la PJ n’en finissaient pas. J’ai fait signe à Stanislas que je devais partir, mais je ne suis pas sûr qu’il m’ait vu. Il avait l’air complètement à l’ouest ce soir. Je pensais qu’il était heureux de s’arrêter.
— Encore un qui est perdu sans son boulot !
Gontran secoue la tête d’exaspération.
Ça ne risque pas de lui arriver, à elle, ne peut-il s’empêcher de penser.
Elle qui est née avec une petite cuillère en or dans la bouche et n’a jamais rien fichu de sa morne vie. Même pour élever ses gamins, il a fallu prendre une nurse. Enfin plusieurs nurses. Difficile de tenir avec une telle pie-grièche. Inutile d’insister.
— Bon ! Qu’est-ce qu’il fiche cet imbécile de taxi ? On va être en retard… bougonne-t-elle.
Pour la faire mentir, le téléphone l’interrompt. Leur voiture les attend devant leur porte.
L’orage a fait chuter la température mais électrise l’air. Les rues de Paris rechignent à se débarrasser de toute cette ondée soudaine. Les véhicules évitent de rouler près des caniveaux encombrés. Ceux qui osent envoient des gerbes d’eau sur les trottoirs et se font conspuer par les piétons s’agglutinant sous des parapluies.
À l’arrière du taxi, Hortense, silencieuse, scrute son portable à la recherche d’une éventuelle réponse de son fils prodige. Tout aussi muet, Gontran consulte sa montre toutes les trente secondes.
Le concert est prévu à 21 heures. Dans le meilleur des cas, ils auront juste le temps de s’asseoir avant le début.
— Nous arrivons dans deux minutes, tente de les rassurer le chauffeur de taxi à l’accent incertain, tout sauf parisien.
Il n’obtient pas plus de réponse que les fois précédentes. Il a compris que malgré ses efforts pour éviter les pièges de la circulation, il pourrait s’asseoir sur son pourboire. La place de la Concorde et la rue Royale deviennent un cauchemar. Pourtant, ce chauffeur d’importation connaît bien les ficelles de la circulation parisienne. Hélas, quelles que soient les ruelles empruntées, il ne peut s’approcher de la place de La Madeleine, complètement bouchée par d’autres taxis ou véhicules avec chauffeurs voulant déposer leurs passagers au plus près de l’église.
Gontran perd patience. Les aiguilles de sa Cartier s’affolent.
— Laissez-nous ici ! Sinon, on arrivera tout juste à la fin du concert.
Hortense le regarde avec des yeux effarés, puis se résout à le suivre sous son parapluie de croquemort.
En passant sous les majestueuses colonnes de l’église de La Madeleine, Gontran aperçoit la grande affiche. Son nom de famille est affiché, à côté de celui du chef d’orchestre. Le professeur Saint-Ambroix en oublie ses chaussettes trempées et le bas de son pantalon à tordre. Il n’entend plus les sempiternelles acrimonies de sa femme.
Une hôtesse les conduit en toute hâte à leurs places, au neuvième rang. De là, ils auront une vue parfaite sur l’ensemble des musiciens. Et sur leur fils.
Derrière le rideau, les violonistes cessent leurs accords. Ils sont prêts.
Axel Saint-Ambroix est prêt. C’est l’essentiel. Les autres ne sont là que pour sublimer sa prestation.
Gontran se détend. Il va enfin pouvoir oublier les inquiétudes de ces derniers temps. Il a horreur de la pression qu’on lui inflige depuis plusieurs semaines. Quelle idée a-t-il eue de se fourrer dans un tel bourbier ?
L’appât du gain, c’est tout.
Sous un tonnerre d’applaudissements, l’immense rideau rouge et son angoisse s’effacent.
Le souffle court, Gontran et Hortense préfèrent se contenir. Ils acclameront plus fort lorsque leur fils apparaîtra, à la suite du chef d’orchestre.
La foule se calme bien vite. Une jeune femme filiforme en longue robe noire s’approche presque timidement, tenant son instrument à la main.
Ce doit être le second violon, se dit Gontran. Pas mal, cette petite blonde. Un peu mince, mais pas mal.
Qu’est-ce que c’est que ce sac d’os ? rumine Hortense. Et ce grand échalas qui applaudit à tout rompre au premier rang… Ce doit être sa mère. Quelle vulgarité !
Tans pis, elle applaudira encore plus fort quand son Axel fera son apparition. Cela ne devrait plus tarder, maintenant.
Baguette à la main, l’homme, un peu rond, à la chevelure savamment ébouriffée se tourne vers le public et salue. Nouveaux applaudissements. D’un geste auguste, il désigne la jeune blonde qui se courbe légèrement.
— Mesdames et messieurs…
Pas besoin de micro. Telle celle d’un baryton, sa voix résonne sous les hautes voûtes de l’édifice religieux.
— … Comme vous le savez, ce soir, nous avons choisi de sublimer l’œuvre du célèbre compositeur Georges Delerue4. Son œuvre est gigantesque et il a fallu faire un choix très délicat. N’y voyez surtout aucun mauvais présage si, comme le réalisateur Pierre Schoendoerffer pour son film Diên Biên Phu, nous interprétons en ouverture le Concerto de l’Adieu.
Le public se sent obligé de tressauter de rire à cette blague d’introduction.
Les lèvres pincées, Hortense ne voit pas ce qu’il y a de drôle, c’est écrit dans le programme qu’elle tient à la main. Programme sur lequel il est précisé que son fils est le maestro. Axel s’est vraiment investi dans la répétition de ce qu’il estime être le plus beau morceau du célèbre compositeur. Que fait cette pimbêche à la place de son fils ?
— Toutefois, mesdames et messieurs, poursuit le chef, vous voudrez bien excuser ce petit changement de programme. En effet, nous venons d’être informés qu’un léger accident empêche notre ami Axel Saint-Ambroix d’être des nôtres ce soir, et croyez bien que nous le regrettons.
Un léger murmure de déception parcourt les allées.
— Rien de très grave, je vous rassure…
Le brouhaha se fait plus intense, les chaises bougent.
Bouche bée, Hortense lance des œillades inquiètes vers son mari, qui, impuissant, hausse les épaules.
Le chef d’orchestre lève les bras en signe d’apaisement.
— Vous ne serez en rien déçus par l’excellente prestation de mademoiselle Clotilde Beaupré, qui nous fait l’honneur d’être ce soir notre premier violon. Je vous demande de l’applaudir bien fort.
Debout, le public, conquis d’avance, ovationne cette célèbre inconnue.
Le roi est mort ! Vive la reine !
4 Georges Delerue (1925-1992) : compositeur et musicien français. Auteur de plus de trois cents musiques de films.
7
— Non, mais quelle honte ! Quelle honte ! C’est bien la peine d’être professeur !
Hortense Saint-Ambroix ne décolère pas.
Ils ont quitté précipitamment l’église de La Madeleine, en plein début du Concerto de l’Adieu, dès les premières vibrations graves des contrebasses et des cuivres, insensibles aux regards réprobateurs des spectateurs. Finalement, le chef d’orchestre avait tort. Le choix de cette musique était un mauvais présage.
— À croire qu’il l’a fait exprès, ne peut s’empêcher de maugréer la furibonde. Et tu crois que cet imbécile nous aurait prévenus ? Axel n’est quand même pas le premier venu, bon sang !
Le médecin légiste est furieux, lui aussi. Les propos acides de sa femme n’arrangent pas les choses.
Le responsable des urgences du centre hospitalier Paul Guiraud de Meudon-Clamart l’a rassuré, mais il n’a pas pu parler à son fils, encore sous l’effet de l’anesthésie.
— Mais enfin, insiste Hortense, si c’est une agression, il faut porter plainte. Tu connais suffisamment de monde, il me semble ! Non ?
En poussant la porte de leur hôtel particulier, Gontran réprime l’envie de la lui claquer au nez. Pour qu’elle se taise. Enfin.
Pour ne plus la voir, ne plus entendre cette voix qui l’horripile chaque jour davantage.
— Merde ! Manquait plus que ça.