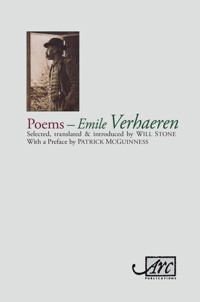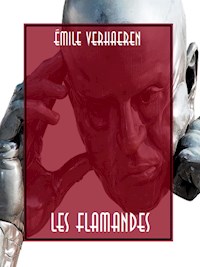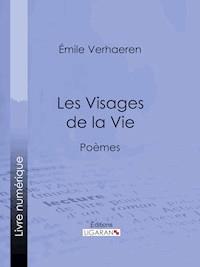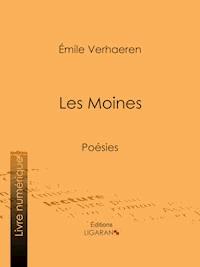Sur la mer
Le vaisseau clair
Avait des mâts et des agrès si fins
Et des drapeaux si bellement incarnadins,
Qu’on eût dit un jardin
Qui s’en allait en mer.
Comme des bras de jeunes filles,
Les flots environnaient sa quille
De leurs guirlandes.
C’était par ces soirs d’or de Flandre et de Zélande,
Où les parents
Disent aux enfants
Que les Jésus vont sur la mer.
Le vaisseau clair
S’en fut en leur rencontre,
Cherchant ce coin de ciel vermeil,
Où l’étoile
Qui conduisit par de beaux paysages,
À Bethléem, les bons rois mages,
Se montre.
Le vaisseau clair roula le jour, tangua la nuit,
Cingla vers des golfes et vers des îles
Vêtus de lune aimante ou de soleil docile.
Il rencontra le vent fortuit
Et les oiseaux de l’aventure
Qui s’en venaient se reposer,
Ailes closes, sur la mâture ;
Un air de baume et de baisers
Coulait sur les miroirs mobiles
Que les vagues dressaient et renversaient,
Tandis que le sillage, en son éclair, cassait
Les écumes d’argent et leurs prismes fragiles.
Le vaisseau clair roula le jour, tangua la nuit ;
Il fit, parmi les caps et les îles tranquilles,
Un beau voyage puéril,
Mais les Jésus ne se rencontraient pas,
Nulle lueur sur l’eau ne décelait leurs pas,
Comme jadis, aux temps sereins des Évangiles.
Le vaisseau clair revint, un soir de bruit
Et de fête, vers le rivage,
D’où son élan était parti ;
Certes, les mâts dardaient toujours leur âme,
Certes, le foc portait encor des oriflammes,
Mais les marins étaient découronnés
De confiance et les haubans et les cordages
Ne vibraient plus, comme des lyres sauvages.
Le navire rentra comme un jardin fané,
Drapeaux éteints, espoirs minés,
Avec l’effroi de n’oser dire à ceux du port
Qu’il avait entendu, là-bas, de plage en plage,
Les flots crier sur les rivages
Que Pan et que Jésus, tous deux, étaient des morts.
Mais ses mousses dont l’âme était restée
Aussi fervente et indomptée
Que leur navire à son départ,
L’amarrèrent près du rempart ;
Et dès la nuit venue, avec des cris de fête,
Ils s’en furent dans la tempête,
Tout en sachant que l’orage géant
Les pousserait vers d’autres océans
Sans cesse en proie à des rages altières,
Et qu’il faudrait quand même, encor,
Toujours, en rapporter des désirs d’or
Et des victoires de lumière.
Vivre, c’est prendre et donner avec liesse.
Toute la vie est dans l’essor.
L’art
D’un bond,
Son pied cassant le sol profond,
Sa double aile dans la lumière,
Le cou tendu, le feu sous les paupières,
Partit, vers le soleil et vers l’extase,
Ce dévoreur d’espace et de splendeur, Pégase !
Molles, des danses
Alanguissaient leur grâce et leur cadence
Au vert sommet des collines, là-bas.
C’étaient les Muses d’or ; leurs pas
S’entrecroisaient comme des fleurs mêlées,
L’amour, auprès d’elles, dormait sous un laurier,
Et les ombres du feuillage guerrier
Tombaient sur l’arc et sur les flèches étoilées.
L’Olympe et l’Hélicon brillaient dans l’air ;
Sur les versants, d’où les sources s’épanchent,
Des temples purs, ainsi que des couronnes blanches,
Illuminaient de souvenirs les vallons clairs.
La Grèce, avec ses Parthénons de marbre
Et ses gestes de Dieux qui agitaient les arbres
À Dodone, la Grèce entière, avec ses monts
Et ses villes dont la lyre berçait les noms,
Apparaissait, sous le galop du fol cheval,
Comme une arène familière
À son essor quotidien dans la lumière.
Mais tout à coup, plus loin que le pays natal,
Un jour, il vit, du fond des passés morues,
Surgir, serrant un disque entre ses cornes,
L’inépuisable et lourde et maternelle Isis.
Et ce fut l’art de Thèbes ou de Memphis
Taillant Hator, la blanche, en de roses pylônes,
Et ce fut Our et Babylone
Et leurs jardins pendus à quels clous d’astre d’or ?
Et puis Ninive et Tyr, et les décors
De l’Inde antique et les palais et les pagodes,
Sous la moiteur des saisons chaudes,
Tordant leur faîte, ainsi que des brasiers sculptés.
Et même au loin, ce fut cet Orient monté
En kiosques d’émail, en terrasses d’ivoire,
Où des sages et les sennins notoires
Miraient dans l’eau belle, mais transitoire,
Leurs visages de jouets ;
Et doucement, riaient à leur reflet,
Des gestes vains que dans la vie, ils avaient faits.
Et de cet inconnu vaste, montaient des Odes,
Suivant des jeux, suivant des modes,
Que Pégase scandait de son pas affermi ;
On eût dit qu’en ses hymnes anciens
Son chant quotidien
Avait longtemps dormi,
Avant de s’éveiller aux musiques sublimes
Qu’il propageait, de cime en cime,
À travers l’infini.
Sur ce monde d’émail, de bronze et de granit,
Passaient aussi des poètes lucides ;
Ils dévastaient la mort nocturne ainsi qu’Alcide ;
Leurs poèmes sacrés, qui résumaient les lois,
Serraient en textes d’or la volonté des rois ;
Leur front buttait contre la force inassouvie ;
Leur âme intense et douce avait prévu la vie
Et l’épandait déjà comme un beau rêve clair,
Sur le sommeil d’enfant que dormait l’univers.
Le cheval fou qu’aucun bond d’audace
Ne lasse,
D’un plus géant coup d’aile encor, grandit son vol
Et s’exalta, plus haut encor, parmi l’espace.
Alors, une autre mer, un autre sol,
À sa gauche, s’illimitèrent,
Et ce fut l’occident, et ce fut l’avenir
Dont la grandeur allait se définir
Qui s’éclairèrent.
Là-bas, en des plaines de brume et de rosée,
En des régions d’eaux, de montagnes, de bob,
Apparaissaient des temples blancs, d’où l’or des croix
Dardait une clarté nouvelle et baptisée.
Chaque ville se dessinait comme un bercail,
Où le troupeau des toits massait ses toisons rouges ;
De merveilleux palais y dominaient les bouges ;
Une abside s’y déployait comme un camail ;
Des jardins d’or y sommeillaient sous de grands arbres ;
Des rivières y sillonnaient des quais de marbre ;
Des pas massifs et réguliers de soldats roux
Couraient au loin, sous un envol de drapeaux fous ;
Sur des tertres, montaient de hauts laboratoires ;
Des usines brûlaient les vents, avec leurs feux,
Et tout cela priait, frappait, mordait les cieux,
Avec un élan tel, que souriait la gloire.
Et c’était Rome, et puis Florence et puis Paris,
Et puis Londres et puis, au loin, les Amériques ;
C’était le travail fou et ses fièvres lyriques
Et sa lueur énorme à travers les esprits.
Le globe était conquis. On savait l’étendue.
Des feux pareils aux feux des étoiles, là-haut,
Faisaient des gestes d’or : on eût dit des flambeaux
Fixés pour ramoner la pensée éperdue ;
Comme autrefois, les poètes fervents et clairs
Passaient pareils aux dieux, dans l’étendue ardente,
Ils grandissaient leur siècle – Hugo, Shakespeare, Dante –
Et dédiaient leur vie au cœur de l’univers.
Et Pégase sentit ces visions nouvelles
Si largement éblouir ses prunelles
Qu’il fut comme inondé d’orgueil et de lumière,
Et que, les dents sans frein, le col sans rênes,
Il délaissa soudain sa route coutumière.
Et désormais, le monde entier fut son arène.
II
Habille-toi de lin, Vénus, voici le Christ.
Deviens la Madeleine, et laisse en toi descendre,
Mélancoliquement, sa grâce et son esprit.
Humble, ternis tes pieds dans de la cendre ;
Et que tes larges seins immortellement d’or
Et que tes yeux, miroirs de soleil et de fête,
Tes jeux, malgré mille ans d’amour, ardents encor,
Meurent sous les cheveux qui pleurent de ta tête.
La terre exténuée a bu le sang des soirs
Et la détresse crie, aux quatre coins du monde,
Vers le calvaire et vers sa croix de gestes noirs.
Habille-toi de lin et de bonté profonde.
Voici venir le Dieu de la douceur unique,
Voici sa face et le voile que Véronique
T’apporte avec les clous, le suaire et la lance.
Voici l’heure nouvelle et douce du silence ;
Pour la première fois, avec ferveur,
L’homme s’en vient baiser les yeux de sa douleur !
Vénus, voici le sang, voici la lie,
Dans le calice ardent des chrétiennes folies ;
Voici le cœur torride et blanc du bien-aimé ;