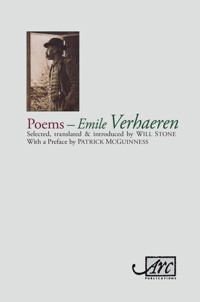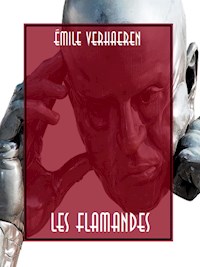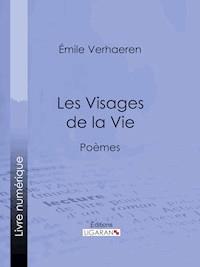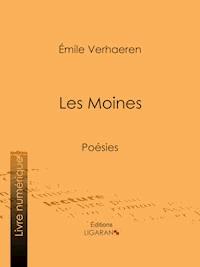1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
L’étude par laquelle débute ce volume, la Sensation artistique, est une sorte d’introduction au cours d’esthétique et d’histoire de l’art qu’il donna en 1890 et en 1891 à Bruxelles, au Palais des Académies, et dont il ne rédigea complètement que la première leçon publiée ici en appendice. Les quatre articles suivants se rapportent à des œuvres d’une beauté quasi impersonnelle dont, cette fois, Verhaeren n’a pas recherché la genèse ou l’éclosion dans le cerveau du créateur. Mais tous les autres, qu’ils aient trait aux maîtres anciens tels que Grünewald, Clouet, Rubens, Rembrandt, ou aux modernes tels que Delacroix, Millet, Rodin, Seurat, attestent sa ferveur pour la pensée d’art où l’œuvre prit naissance. Le poète enfonce son regard dans l’âme de ceux qu’il estime ses maîtres ou ses pairs et traduit sa vision pour que nous en jouissions avec lui. André FONTAINE.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Sensations
Émile Verhaeren
philaubooks
Table des matières
Avant-propos de l’éditeur
Avertissement
La Sensation Artistique
I. GÉNÉRALITÉS
Les marbres du Parthénon
Granits bretons
L’esprit académique
Les écoles de peinture
II. MAÎTRES ANCIENS
Hans Memling
Gothiques allemands
Mathias Grünewald
Un dessin de Clouet
Pierre Breughel
Rubens
Rembrandt
Le Van der Meer de Brunswick
L’homme a la ganse jaune
III. MAITRES CONTEMPORAINS (Angleterre=Allemagne)
William Blake
Ford-Madox Brown
Le « New English Art Club »
La New Gallery
L’art en Allemagne
IV. MAITRES CONTEMPORAINS (France-Belgique)
Eugène Delacroix
La Forêt de Fontainebleau
Jean-François Millet
Monticelli
L’impressionnisme
Claude Monet. - Auguste Rodin
Chronique de l’exposition de Paris (1900)
Georges Seurat
Henri-Edmond Cross
James Ensor
V. APPENDICES
1. Fragments
2. L’histoire de L’art
3. Poèmes
Avant-propos de l’éditeur
Après Rubens, Verhaeren. La Bibliothèque dionysienne offre à ses lecteurs l’année flamande. Les plus grands pétrisseurs et animateurs de matière qui furent sans doute jamais ont droit, dans cette galerie, à une place de choix. Oubliant Cellini, on m’a reproché de n’y avoir, jusqu’ici, donné la parole qu’à des Français. Il y avait, certes, des raisons pour qu’ils fussent en majorité parmi les élus, et ces raisons risquent de subsister, au moins en partie. Au XIXe siècle, la peinture française — on s’en rend à peu près universellement compte aujourd’hui — a sinon occupé, du moins dominé toute la scène. Or, ce n’est qu’à l’origine des mouvements qui aboutirent à former l’esprit de ce siècle, que la véritable littérature d’art est née, avec Diderot — un Français. Il y a donc eu entre ces mouvements et leurs commentateurs les plus vivants une rencontre passionnée, qui s’est surtout produite en France. Nous n’y pouvons rien, sinon nous en féliciter, quelque animés que nous soyons d’un esprit supérieur aux rivalités nationales.
Cependant, que ceux de nos lecteurs qui nous ont reproché cet exclusivisme se rassurent : s’ils persistent à nous soutenir, Ghiberti et plusieurs autres Italiens du Quattrocento, Goya, Albert Dürer, Walter Pater, Ruskin, Vasari, Condivi, Francesco de Hollanda, Reynolds, Constable, d’autres encore auront leur tour, — et nous ne demandons qu’à accueillir les suggestions qui pourraient nous conduire à révéler à nos lecteurs des écrivains d’art d’Allemagne, d’Angleterre, d’Italie, d’Espagne, de Hollande ou d’ailleurs aussi profonds que Baudelaire, aussi vivants que Théophile Silvestre, aussi intéressants qu’Amaury-Duval, et, — on le verra bientôt, — aussi entraînants que Michelet, aussi pathétiques que Delacroix.
Ce n’est d’ailleurs pas notre faute si le Flamand Verhaeren a choisi la langue française, même pour nous entretenir des maîtres de son pays. Ça ne l’empêche pas d’en parler en Flamand de Flandre, comme il parle en Flamand de Flandre des vieux maîtres allemands et des peintres contemporains de France et d’Angleterre. Sa langue rugueuse est celle de ses poésies, comme son esprit même où le drame et la catastrophe convulsent le mot, et où des cataractes d’images tombent en retentissant au fond d’abîmes insondables de ténèbres et de bruits. Le chantre épique des vents et des bourrasques, des usines et des chantiers, des tumultes du travail et des fumées sur les villes, a transporté dans la peinture, dont il remue en praticien la pâte épaisse, les forces inconscientes déchaînées, mais maîtrisées par l’humanité en marche. On ne s’étonnera donc pas qu’il cherche, parmi les artistes, ceux dont le génie dramatique et sensuel répond le mieux, par sa puissance souterraine circulant à même les formes et surgissant à leur surface dans les saillies lumineuses et les creux d’ombre, à son propre pouvoir de bouleverser la matière afin d’en arracher l’esprit.
Les terres, les eaux, les chairs, les arbres, il les mêle et les tord ensemble comme un forgeron le fer rouge tout fourmillant d’étincelles entre l’enclume et le marteau. Nul, plus et mieux que ce sensuel, n’était qualifié pour suivre le torrent de flamme qui se spiritualise en traversant l’arabesque lourde de sang dont Rubens soulève ses formes, nul, plus et mieux que ce mystique — au sens panthéiste du mot — pour évoquer l’ombre surnaturelle où brûle, avec des lueurs étouffées, l’humanité poignante de Rembrandt, nul, plus et mieux que ce visionnaire, pour respirer cette odeur de foudre qui flotte dans l’atmosphère sulfureuse d’où surgissent les figures de Delacroix, nul, plus et mieux que ce brutal, pour accoucher Grünewald du drame qui se tord dans ses sinistres harmonies. Il n’y a, dans la « critique d’art » d’aucun pays, d’aucune époque, rien qui ressemble aux pages qu’il a consacrées au dramaturge effrayant de Colmar, dont il est impossible de transposer le génie dans le verbe avec plus de force hallucinante. Malgré son évocation vigoureuse de Michel-Ange, où il retrouvait, moins débordante, certes, aride, intellectualisée, sa propre force torrentielle, on le sent, là, plus à son aise qu’au sein de l’eurythmie classique et méditerranéenne, dont il n’a guère parlé, je pense, parce qu’il la comprenait mal. Il faut à ce romantique — il dut en être le dernier, comme tout le monde — les brumes sauvages du nord, le bruit de la tempête à défaut du bruit des usines, le souffle des forêts germaniques et de l’océan armoricain. Il aime cette sorte de musique confuse, où les rayons et les ombres se mêlent, qui sort de la peinture septentrionale avec une grande rumeur.
Je dois le dire. J’ai comme une impression vague — une impression seulement — qu’il ne comprit pas très bien tout de suite et n’aima qu’en se faisant un peu prier, pour les raisons précédentes mêmes, la peinture française contemporaine, vers qui le conduisirent par bonheur pour nous les jeunes artistes français ou belges ses amis. Il semble — toujours pour lesdites raisons — après une pointe enthousiaste sur Rodin, autre « dernier romantique », s’être attardé un peu trop longtemps à Delacroix, qu’il glorifie d’ailleurs avec magnificence. Si Claude Monet l’attire par ses scintillements de reflets, de lueurs, les drames subtils et inattendus qui traversent pour lui l’espace, Manet, Renoir, Cézanne semblent à peine l’émouvoir. Comme il a rencontré Seurat, il n’a pu méconnaître sa haute valeur spirituelle, mais on sent tout de même que, si le théoricien le séduit, le praticien le surprend. Beaucoup, qui étaient plus jeunes que Verhaeren, sont venus tard à tous ces maîtres. Au moins les a-t-il croisés sur sa route et salués cordialement 1.
Au fond, il devait trouver que ces peintres « manquaient d’âme ». Sa critique, il me semble, n’est pas tout à fait exempte de « littérature ». Les Français de son temps — Gustave Moreau à part — n’y donnaient pas prise, et peut-être que ça gênait un peu son irrépressible besoin d’expansion lyrique. Justement il aime Moreau, et les Nazaréens, et Boecklin, surtout les Préraphaëlites d’outre-Manche. Je ne connais presque pas Madox-Brown, mais le goût de Verhaeren pour Hunt et Watts, et même pour Rossetti et le trop fameux Burne-Jones, n’est pas sans me donner quelque inquiétude sur la validité des jugements qu’il porte sur le peintre de Manchester. De même pour William Blake, furieux et déchirant poète, mais par malheur, en plastique, desservi par ses moyens. En quoi nous touchons à l’écueil de toute la peinture anglaise — si l’on met à part le grand Constable, le charmant Bonington et, dans une certaine mesure, les peintres mondains du XVIIIe siècle, qui ont accompli leur tâche avec des yeux de peintre, malheureusement inaptes à dépasser l’écorce de la vie. Écueil où les Préraphaëlites, William Blake et Turner lui-même ont démoli leur somptueuse galère, chargée de trésors spirituels : l’incapacité radicale de faire passer dans le dessin et la couleur le lyrisme éperdu qui a fait si grands les poètes de l’Angleterre, Shakespeare, Milton, Byron, Shelley.
En tout cas, Verhaeren a la grande qualité — l’unique qualité exigible — et si rare ! de ceux qui parlent peinture : le don d’animer le mot de l’esprit qui charge la forme. Sa critique sent l’effort, certes, comme ses poèmes eux-mêmes, hérissés et retentissants de ce style rocailleux et charnel à la fois qu’on lui connaît, et qui ressemble à un halètement d’athlète gravissant une pente abrupte, faisant rouler sous ses pieds les cailloux que le vent arrache, mais couronnée, en haut, de forêts sombres où circule le feu du ciel. Sa critique est toute soulevée du formidable rythme de ses vers. Cela nous suffit. C’est très grand. On sent qu’il parle de ses pairs, qu’il le sait, qu’il nous ordonne de les aimer pour que nous l’aimions lui-même et consentions à effleurer des lèvres, portés sur ses épaules titaniques, la coupe de fer et d’or où bouillonne, à son poing, notre part de divinité.
Quand j’ai demandé à Mme Émile Verhaeren de me faire l’honneur de m’associer, pour sauver ces belles pages, au saint et religieux travail qu’elle poursuit depuis la mort tragique de son mari, c’est le nom d’André Fontaine qui est apparu tout de suite dans notre conversation. Qu’il soit ici remercié d’avoir bien voulu se plonger dans l’œuvre critique, si vaste et si touffue du grand poète, pour en extraire et en classer les morceaux les plus durables, parmi lesquels il nous oriente dans l’Avertissement qui suit. Il fallait, pour mener à bien cette tâche, connaître, comme il le connaît, Verhaeren, dont il a pieusement, depuis des années, rassemblé de si magnifiques fragments, et la peinture, sur laquelle il a tant et si bien écrit. Cette œuvre de maïeutique littéraire est exclusivement la sienne. Au lieu de noyer la pensée de Verhaeren dans les mille improvisations critiques que sa verve et sa fougue, toujours en action, ont dispersées, durant plus de trente ans, dans tant de journaux et de revues de France et de Belgique, il l’a ramassée, épurée, condensée, lui restituant sa forme propre — celle que nous admirons, barbare, grandiose, humaine, — de manière à donner à ses écrits sur l’art l’allure d’une nouvelle et poignante création.
E. F.
1Dans une conversation que j’ai eue avec Paul Signac à ce sujet, quelques semaines après avoir écrit ces lignes, j’apprends que Verhaeren, dans ses dernières années, avait été définitivement conquis par ce qu’on appelait encore à cette époque l’« impressionnisme », et brûla — en partie — ce qu’il avait adoré. C’est ainsi qu’il se serait débarrassé des quelques œuvres préraphaélites qu’il possédait.
Avertissement
Des articles très nombreux de critique d’art publiés, parfois sans signature, par Émile Verhaeren, nous n’avons guère retenu ici que ceux où il applique directement sa pensée à la pensée d’un Maître pour y découvrir intuitivement le mystérieux effort de la création esthétique.
Et cependant il était singulièrement tentant de réimprimer les articles de combat qu’à l’âge de vingt-huit ans il donnait à la Revue moderne et à la JeuneBelgique, ou de faire de larges emprunts à la longue série de ses Salons de la Jeune Belgique et de l’Art moderne, ou encore d’éditer pour la première fois les études fortement documentées qu’il écrivit sur Gérard Van Opstal, sur Corneille Van Clève, sur Martin Desjardins et sur le sculpteur ornemaniste Verberckt. Mais nous nous sommes résolument borné, en suivant l’ordre chronologique des œuvres étudiées par Verhaeren, aux seuls articles où apparaissent le plus nettement, le plus énergiquement, le plus poétiquement aussi, les principes de son esthétique propre appliquée aux productions de l’art révélatrices d’une conception puissante. C’est son idéal esthétique, c’est son enthousiasme d’adorateur (lui-même s’est servi de ce mot en parlant du culte dû aux grands poètes) que nous avons voulu faire comprendre au public : de là notre sélection rigoureuse.
L’étude par laquelle débute ce volume, la Sensationartistique, est une sorte d’introduction au cours d’esthétique et d’histoire de l’art qu’il donna en 1890 et en 1891 à Bruxelles, au Palais des Académies, et dont il ne rédigea complètement que la première leçon publiée ici en appendice. Les quatre articles suivants se rapportent à des œuvres d’une beauté quasi impersonnelle dont, cette fois, Verhaeren n’a pas recherché la genèse ou l’éclosion dans le cerveau du créateur. Mais tous les autres, qu’ils aient trait aux maîtres anciens tels que Grünewald, Clouet, Rubens, Rembrandt, ou aux modernes tels que Delacroix, Millet, Rodin, Seurat, attestent sa ferveur pour la pensée d’art où l’œuvre prit naissance. Le poète enfonce son regard dans l’âme de ceux qu’il estime ses maîtres ou ses pairs et traduit sa vision pour que nous en jouissions avec lui. Nous avons éliminé, sauf en ce qui concerne l’Angleterre et l’Allemagne, tout ce qui dénotait simplement une curiosité d’amateur.
On trouvera en appendice, avant la première leçon du cours d’histoire de l’art, une lettre écrite en 1880 par Verhaeren à son ami Joseph Nève au retour d’une visite à l’exposition triennale de Gand. Dans ce compte rendu naïf et intime apparaît sa toute première vocation comme critique d’art ; comparée à la lettre écrite au sortir du musée du Prado huit ans plus tard elle permettra de mesurer le chemin parcouru. Si nous n’avons donné au sujet des artistes belges qu’un fragment du livre sur Ensor et qu’un article sur le Salon des XX en 1887, c’est que nous avons publié, dans les Pages belges, parues en 1926 à la Renaissance du Livre, ses meilleurs articles sur les plus célèbres peintres et sculpteurs de son pays. En lisant ces pages accessoires, on saisira mieux les raisons qui nous ont amené à ne pas mêler aux études incomparables sur Grünewald, Rubens ou Rembrandt, des notes rapides prises au cours de visites dans les expositions, quels qu’en fussent les mérites de spontanéité, de pittoresque, ou même de profondeur. Nous devons de particuliers remerciements à M. Bonnafous. qui nous a autorisé à reproduire d’importants fragments du Rembrandt publié à la librairie Laurens, ainsi qu’à tous ceux qui ont facilité nos recherches et notre travail.
André FONTAINE.
La Sensation Artistique
Oh ! la difficulté de sentir artistiquement ! Oh ! l’universel réfractaire des foules à cette émotion spéciale, divinement savoureuse et douce, de l’art, cet archet sur une corde spéciale de l’âme, qui manque à tant d’âmes, luths dépareillés !
Entendre, qu’est-ce ? Le fonctionnement d’un sens, l’ouïe. Une perception, mais si peu, si peu en sa matérialité mécanique, en comparaison de cette autre, subséquente, plus profonde, au plus profond de nous, dans les fibres ultimes, dans les fibres souterraines centrales : La Sensation artistique. Entendre ! et voir, et goûter, et odorer, et toucher, cette quintuple vie vers le dehors, cette tentaculaire expansion vers le dehors, tâtonnant, caressant, jouant un compliqué colin-maillard pour deviner, approximativement toujours, et mal si souvent, l’ambiance de ténèbres en laquelle nous flottons. Les cinq sens, que c’est peu, que c’est peu pour qui la vie émotive est la vraie vie qui fait vivre ! Ce sont là des facultés d’inventaire, emmagasinant les notions, formant la collection des idées, faisant le trousseau du cerveau, l’équipant pour la journalière besogne. Mais sous, et au delà de cette accumulation mobilière, derrière ces premiers appartements, ces antichambres, plus loin, plus haut peut-être, cette loge (par quels circuits, quels corridors, quels escaliers descendants et montants) où, quand l’idée arrive, mystérieusement transportée, et qu’elle touche au clavier qui est là, résonne cet ineffable : La Sensation artistique !
Là, il y a autre chose que ces matérialités baroques : une oreille, un nez, un œil, une langue, une peau. Quoi ? quel organe ? de quel tissu, de quelle forme, qu’on limiterait par quel dessin, qu’on montrerait par quelles couleurs ? Je l’ignore. Mais à l’effet, je le sens. Il est ! Il est parce qu’il produit un ébranlement qui va se répercutant partout dans le corps, battant au cœur, éclairant au cerveau, faisant vibrer les nerfs, ébranlant les muscles, infusant, diffusant partout une jouissance. Oh ! que c’est difficile à exprimer ! Une jouissance, oui, psychique et sensuelle. Différente de toute autre. Analogue pourtant à cette autre, idéale et brutale, que donne l’amour en ses fins dernières. Analogue, seulement, à cette autre, citée ici par le besoin de trouver quelque image rendant distincte cette nébulosité du phénomène artistique en sa sensation, si réelle en son effet, presque insaisissable en sa description, que comprendront tout de suite (ah ! quels souvenirs !) ceux qui l’ont éprouvée, qui restera ténébreuse pour qui n’en a jamais été secoué. Que sait l’impubère de la jouissance érotique ? Qu’en sait l’eunuque ?
Combien, en cela, sont eunuques ! Ils verront, ils entendront l’œuvre d’art, poésie, peinture, musique. Ils en comprendront les mots, les couleurs, les sons. Ils seront là en curieux, d’un goût très sûr, parfois, pour dire si vraiment c’est beau ; d’une compétence infinie, d’une érudition despotique. Et peut-être que, malgré ces amplitudes, ils resteront inaptes à la Sensation artistique. Leur situation sera celle du curieux, de l’expert, du juge disert et froid, expliquant tout, ne sentant pas. Les effluves de l’œuvre vue, entendue, les envelopperont à la surface, leur colleront à la peau, les enroberont. Mais ce ne sera qu’une juxtaposition et non une pénétration. L’intime et profond mélange ne se produira point. Pas d’entrée délicieusement sournoise par tous les pores ; pas de circulation serpentine et capillaire glissant dans la ténuité des veinules, de toutes parts, comme un glissement d’aiguilles en myriades, aboutissant à cette cible unique : Le Sens artistique, cymbale frémissant, résonnant, s’exaltant sous leurs milliers de pointes.
Pour subir cette émotion divine, point n’est besoin d’érudition, ni de compétence, point n’est besoin d’être expert. Ah ! comme l’expert, quand il fonctionne, mettant en mouvement le ronron de ses phrases et les rouages de sa technique, apparaît piteux et malheureux au bienheureux qui vibre encore de la Sensation artistique, mollissant sous le spasme en son plein, ou brisé (avec quelle douceur !) sous le spasme à peine assoupi. C’est de ces impressions surhumaines que vient à quelques-uns cette fureur pour l’art, germaine de la fureur amoureuse. Regardez-les, écoutez-les dans leurs émotions et leurs transports ; ce sont des amants d’une divinité invisible ; ils ont le trouble, l’enthousiasme, l’aveuglement, l’exaltation de ceux qui aiment. Ils sont tels, parce qu’ils ont éprouvé, parce qu’ils ont l’aptitude à éprouver, quand ils rencontrent l’art n’importe où, le frisson divin. Ils aperçoivent ce qui reste imperceptible Pour d’autres. Ils ont un sens de plus.
Et l’idée, ou la fantaisie, leur vient parfois de décrire, de raconter ces sensations. L’idée leur vient, en apportant devant des foules les œuvres qui les ont fait jouir, d’essayer si ces foules, ou quelques unités de ces foules, ne tomberont Pas, séduites, s’abandonnant dans ces mêmes jouissances. Ils Parlent, et peu à peu, en eux renaît la même émotion. Ils Parlent et suivent anxieusement sur l’auditoire la manifestation du phénomène. Ah ! c’est vite fait quand il y a là des êtres qui ont l’organe voulu. Mais s’il n’y a que des castrats, des amateurs d’anecdotes, des feuilletonistes rabâcheurs, des poupées du bel air, des bourgeois digérateurs, des compères Je-veux-me-distraire, pareille entreprise n’aboutit qu’à un immense malentendu ; l’émotionné parle à des inémotionnables, et il enrage de voir qu’il n’a qu’amusé, et que parmi les compliments dont on le fleurit, il n’est pas une de ces grandes et chaudes fleurs dont le parfum murmure : J’ai été ému comme vous.
Artistes, pour qui j’essaie d’exprimer un des inexprimables de votre ténébreuse nature, vous m’aurez compris. Vous m’aurez compris, artistes, qui produisez les œuvres capables d’agir sur le sens artistique, comme la lumière sur les yeux, les parfums sur les narines, les sons — ces couleurs qui font du bruit — sur les oreilles. Vous aussi, artistes, qui ne produisez rien, mais qui avez le don de tout sentir, esthètes. Vos deux groupes forment les deux sexes de cette humanité spéciale qui a un sens de plus ; vous en êtes, les uns, l’activité, les autres, la passivité. Vous vous complétez. Vous êtes faits les uns pour les autres. C’est entre vous qu’il faut vous aimer. Chaque fois que vous tenterez de vous mettre en union avec le vulgaire, craignez, craignez que l’accouplement soit ridicule et stérile. Et soyez certains qu’il y aura là quelque pédant imbécile ou quelque gouailleur, zwanzeur ou goguenardeur, pour confondre sa radicale impuissance à comprendre avec votre prétendue incapacité, sa misère à lui avec celle qu’il vous prête, le grotesque polichinelle !
Art moderne, 7 décembre 1890.
Partie I
GÉNÉRALITÉS
Les marbres du Parthénon
On publie qu’un comité s’est formé, à Londres, dans le but net de créer une agitation pour faire rendre par l’Angleterre à la Grèce les marbres du Parthénon.
Que cela soit, nous ne le souhaiterons jamais avec assez de violence. L’idée en est haute au point qu’on a peine à y croire. Ce peuple de marchands et d’accapareurs ne serait donc pas tel que les idées toutes faites l’ont défini. Il serait grand jusqu’à reconnaître ses torts et restituer ses vols qu’on ne lui redemande même pas. Dans ce Londres, que parmi nous tant d’artistes admirent jusqu’à lui demander la maison spirituelle où ils conçoivent et réalisent leur art, il se rencontrerait des gens et des esthètes assez purs pour écraser le bourgeois intérêt national sous un rêve de soudaine justice magnifique ? Un progrès décisif dans la conscience publique, certes. Et pour celui qui l’examine sous tel angle, ce fait est de ceux qui marquent un temps.
On sait qu’en ce siècle commençant, lord Elgin1, profitant de son crédit là-bas et usant d’habileté et de ruse, embarqua, un beau matin, les blocs de génie où Phidias avait taillé son immortalité humaine. Il les dirigea vers le Nord. Le droit du plus fort les maintint à Londres. Les protestations passèrent comme des vols de mouche. On les dissipa avec quelques gestes au bout desquels un poing était tendu.
Au British Museum, ces débris furent alignés sur des socles de bois, en une salle morne. Actuellement, on les a piédestalisés de granit. L’effet est quelconque. Taillés pour être vus à quinze mètres de haut, on les présente à niveau d’épaule, et les copistes, avec leur crayon, viennent mesurer les orteils de Déméter et de Coré. La beauté de ces groupes est tuée net. Le rêve qui habitait leurs plis de robe en fut chassé par la brutalité même de la montre. Ce sont choses hors de leur milieu, hors de leur cadre. Là-bas, sous leur ciel, elles étaient grandies et comme apothéosées, et même elles semblaient plus belles encore parce que ruines ; ici, elles ne sont qu’épaves sous un hangar.
Dernièrement, au Musée des Échanges, la surprise nous est tombée dans les yeux de voir la restitution du fronton athénien tout à coup surgir. On a reconstruit ce couronnement de portique tel qu’il est là-bas, en Grèce, et les moulages des statues ont pris place à leur place. L’effet est énorme. Le grand hall où sont représentés Verrochio, Michel-Ange, Kraft, Goujon, où s’épanouissent des chefs-d’œuvre hindous, romains et gothiques ne semble glorifier qu’un homme : Phidias. Son fragment de temple domine et écrase tout de sa beauté. Le reste n’est qu’accessoires et revêt je ne sais quel caractère de fantaisie et de bibeloterie. Il faut se reprendre à cette admiration trop haute pour regarder la tombe des Médicis et les bas-reliefs de Nuremberg. Il semble que l’art, pour s’en venir chez les modernes, soit descendu d’un Thabor.
Ceux que le voyage a menés vers Athènes et sur ce sommet d’Acropole dévasté par les Turcs et les Vénitiens en ont rapporté un éblouissement qui leur sera soleil, leur vie durant. Ces ruines des Propylées, ce temple de la Victoire, cet Erechtéion et, surtout, ce Parthénon cassé, fendu, troué, mais debout comme une idée qui ne peut pas mourir, font seuls comprendre la suprématie de l’art grec. Il est une loi de régression constatée en science qui affirme : certaines adaptations et certains progrès ne peuvent se manifester qu’en un concours de circonstances favorables à telle heure. L’heure passée, ce développement ne peut se reproduire semblable, même si les mêmes besoins d’adaptation le nécessitent. Il se réalisera autrement peut-être, mais Jamais similaire.
Il semble que cette loi s’avère en art également. Au Ve siècle avant le Christ, il s’est trouvé en un pays choisi, sous un climat glorieux, en des paysages de montagnes où l’homme se lève proportionnel au milieu, des artistes qui ont compris toutes ces concordances. L’art y a réalisé un progrès que plus jamais il ne réalisera peut-être, et, dussent les mêmes circonstances se présenter, qu’il ne réalisera, certes, jamais belles. Donc l’art grec reste unique. On ne doit plus et ne Peut plus le recommencer. Objet d’admiration totale, il serait illogique qu’il devînt objet d’imitation ou qu’il servît de modèle. Tel est-il et tel s’affirme-t-il : grand plus purement, parce que pratiquement inutile, si pas nuisible.
Mais, précisément à cause de sa signification, faut-il, Pour le juger, son ciel et son site. Il est chez lui à Athènes, il est en exil n’importe où ailleurs. Il y a sacrilège et profanation dès qu’on arrache une pierre d’un monument, fût-ce pour la monter en or. Certes, les musées conservent — bien qu’en des villes où, à certaines époques, les Communes sont souhaitables, on s’interroge sur leur sécurité. Toujours, pourtant, par le fait même d’enfermer les chefs-d’œuvre en des armoires ou en des salles, on les déshonore. Qu’ils restent sur place. Là, du moins, si la mort vient, ils mourront de leur mort à eux.
Consolant est-il, au point qu’une certaine fierté en rejaillit sur tout homme qui pense, de voir en cette fin de siècle une nation ou du moins quelques citoyens de cette nation comprendre ce respect qu’on doit aux choses d’art. L’Anglais, si en tout à coup d’ombre et de lumière, si en noir et clair comme une eau-forte de Rembrandt ou un dessin de Redon, s’impose le plus surprenant des peuples. Les contrastes se heurtent chez lui en de telles cassures de haute intelligence et de bas égoïsme qu’il en est tragique, normalement. On l’aime et on le hait en même temps. Mais il passionne quiconque et toujours ; à travers sa toute crasse de lucre et son fumier d’hypocrisie, des fleurs poussent belles et naïves comme s’il sentait se lever en lui, lui, si vieux, une magnifique âme d’enfant.
Art moderne, 14 décembre 1890.
1Chateaubriand écrit au cours de son voyage en Ionie : « Un moderne vient d’achever, par amour des arts, la destruction que les Vénitiens avaient commencée. Lord Elgin a perdu le mérite de ses louables entreprises (il a étudié la Grèce et fait beaucoup de fouilles) en ravageant le Parthénon. Il a voulu faire enlever les bas-reliefs de la frise ; pour y parvenir, des ouvriers turcs ont d’abord brisé l’achitrave, jeté bas les chapiteaux et rompu la corniche. » (Note de Verhaeren.)
Granits bretons
Sur les plages, en face des têtes de Méduse de la tempête, ils semblent — rocs, pics, promontoires et caps — des restes de monuments énormes, voués, par des peuples disparus, au culte des vents et de l’espace. Autour d’eux, sans doute, ont dû se célébrer les premiers mystères et les premiers sacrifices. En face des domaines illimités de la peur, devant la mort, chaque soir, des soleils sanglants, au bord même des gouffres, ils s’affirment protecteurs. Si un Dieu secourable existait, quoi de plus naturel que de l’adorer sur leur sommet et de même, pour conjurer les hostilités des génies de la tempête, quoi de mieux que de les apaiser du haut de ces énormes tables d’offrande ? Le mont pour les divinités du ciel, la falaise pour les divinités de la mer ont donc été, ont dû être les premiers temples. Nulle part cette évidence ne jaillit aux yeux aussi dominatrice qu’en Bretagne. Le granit, depuis que des peuples ont, sur cet antique sol, rêvé d’inconnu, n’a cessé de donner corps et d’aider à leurs pensées religieuses.
Les monuments mégalithiques de Plouharnel, les pierres de Kermario et de Kerlescan apparaissent des falaises et des écueils réalisés au milieu des plaines. Indubitablement sont-ils l’expression de cette même religion, dont les monuments, jadis uniquement debout sur les côtes, se sont mis en marche vers l’intérieur. Le Finistère et le Morbihan en sont peuplés. Si l’on pouvait déchiffrer les hiéroglyphes qui ornent les pierres de certains dolmens, peut-être y lirait-on qu’ils furent construits sur le modèle de telle grotte du bord de la mer et que tels menhirs furent disposés d’après le plan de tels écueils ou de tels promontoires. Certes, l’architecture en est plus régulière et la symétrie dans la construction s’y révèle. Les hommes de Locmariaker sont déjà des calculateurs ; ils ont à leur disposition des instruments et des outils puissants ; ils savent remuer des images colossales, bâtir de formidables galeries ; ceux de Carnac élèvent des monolithes tragiques, imposent l’équilibre à de formidables blocs debout comme des tours.
Que ce soient des alignements ou des cromlechs, une pensée d’art s’y manifeste — la même qui domina l’Égypte de Menès — qui ne sépare point l’idée de beauté et de grandeur de l’idée de masse et de volume. Monstrueuses, telles pierres kermarioniennes, à l’heure d’or des couchants, quand elles projettent leurs ombres à travers le champ voisin, jusqu’aux murs des fermes proches ! L’homme ne compte plus à côté d’elles ; il est l’humble et l’écrasé par sa propre œuvre que se sont adjugée ses dieux.
Tout comme au bord de la mer, le granit est ici dédié au mystère : on comprend sa force et ses ténèbres, sa taciturnité de pierre profonde et sombre, sa rébellion et son indestructibilité en face du temps et de la mort, sa signification d’éternité. Il convient aux cultes des nords sauvages et tristes, qui n’ont que faire de la joie et de la clarté banales des marbres. Il est, par exemple, le dur et noir témoin de la ténacité humaine contre le sort pendant la vie, et la dalle sûre et protectrice pour les os défunts qui attendent.
Au cours des âges, il est devenu chrétien, se diversifiant d’après les styles roman, gothique et renaissance. À travers tout il est resté breton, avec des marques particularistes de rudesse, de naïveté et de force.
À Dinan, le porche de la cathédrale est fruste, mal dégrossi, taciturne ; à Morlaix et à Saint-Brieuc, les colonnes gothiques sont étonnamment lourdes et barbares avec je ne sais quoi de militaire ; à Roscoff, le porche et les ossuaires renaissance témoignent d’une barbarie splendide. À Carnac, Un dais du XVIIe ou du XVIIIe siècle définit par son dessin sauvagement contourné la persistance des qualités d’art natives. Les styles chrétiens de Bretagne s’apparentent aux constructions primitives des âges antérieurs ; comme elles, ils sortent du sol, continuent à former bloc avec lui, semblent un jaillissement, une poussée soudaine de ses profondeurs. Croix de granit, tombes de granit, sanctuaires et églises de granit, calvaires de granit, le menhir et le dolmen les ont engendrés tous.
Spécialement les calvaires et les croix. Celles-ci debout dans la campagne ou sur des pointes en éperon vers la mer. Ceux-là, à Pleyben et à Plougastel-Daoulas, réalisant on dirait un énorme monolithe creusé, troué, ouvragé, les pieds écartés aux quatre coins, le sommet aiguisé d’une crucifixion. Ce qui les distingue : une touchante enfance d’art, une conviction et une croyance féroce, une tendresse nue et Profonde. C’est à pleurer devant, tellement les scènes de la Passion y sont croyantes de souffrance et pénétrées de douceur. Les poses, les gestes, les attitudes, les groupements, les dispositions, les mouvements n’ont de signification que transposés dans l’atmosphère de la légende et de la foi. Mais sitôt qu’on parvient à les voir, non plus en curieux mais en croyant, de quelle ineffabilité ne remplissent-ils Point l’esprit ! Dites, les soldats, la main contre la joue, endormis au bord du tombeau, d’où jaillit le Christ droit comme une affirmation divine, dites, l’âne pataud de l’entrée a Jérusalem, dites, le couronnement d’épines auquel on travaille comme des matelots tournant au cabestan, dites, la scène suprême et les larmes de Marie et là-haut les trois croix avec un ange, comme une petite poupée, agenouillé Sur chacun de leurs bras ! Œuvre d’émotion, toute taillée dans la pitié, tout ardente de simplicité et de bonne foi, tout immense de force persuasive. Certes trinqueballante, va comme je te pousse, avec des maladresses terribles et des inexpériences scandaleuses. Mais qu’importe ?
Quand on songe que c’est au village, pendant les soirs d’hiver, pour détourner du pays les pestes et les lèpres, qu’un tailleur d’images par son génie a témoigné de ce chef-d’œuvre, puis s’est perdu dans l’anonymat, on se sent pris de quelque pitié pour ce que les critiques appellent : avoir un talent correct et reconnu.
La force simple et rude, qui dans la matière même trouve son exemple, exalte donc tout l’art breton. Aujourd’hui encore les pierres noires et grises sont employées pour des manifestations esthétiques. Mais combien un bloc granitique moderne, rencontré à Brest, dans une église, et représentant un évêque à genoux, est d’expression piteuse, et combien la récente basilique construite en l’honneur de sainte Anne d’Auray fatigue de son luxe de marbre et de sa bonne tenue en or et en argent ! Décidément, le granit est trop fort et trop puissamment ténébreux pour notre foi pâlotte et propre, que la chromolithographie et les objets pieux en biscuit ou en papier mâché seuls traduisent adéquatement.
Art moderne, 11 septembre 1892.
L’esprit académique
Il est de nécessité, une fois qu’on a mis le pied dans certaines académies, de se reconquérir pour être artiste. Le malheur veut que tout ce qu’on apprend avant qu’on ait conscience de soi, ne sert à rien. Tout l’enseignement académique consiste à dessécher la personnalité, à la tarir. Pour devenir artiste, il faut regarder, en dedans de soi, son âme, et, en dehors de soi, la nature. Il faut se sentir et sentir les choses, établir entre son tempérament et l’extérieur une communion, un lien, soit de haine ou d’amour, de joie ou de mélancolie, de disposition ou d’abandon.
L’artiste naît ainsi, et le poète. L’académie coupe cette chaîne qui va de l’âme aux choses, et met entre l’homme et la nature le tableau, le « déjà vu », et doctorise :
« Voici un chef-d’œuvre. Rien n’existe hors de lui. Il est signé Raphaël, Ingres, David. Il vivra aussi longtemps que le monde. Il est fait selon telles règles, telles formules. Admirez-en les proportions vraies, comme la symétrie, le sacro-saint dessin, le dogmatique contour. Vous devez apprendre à faire des chefs-d’œuvre ; or il n’est qu’un moyen : c’est de ne jamais regarder au delà, ni à côté, ni par-dessus, ni en dessous de celui-ci.
« S’il vous arrive de faire un portrait, songez aux bras et au col et aux mains et aux yeux qui se trouvent peints sur ce chef-d’œuvre ; ce sera le moyen de donner de la dignité à votre travail ; s’il vous arrive d’esquisser un nu, sachez que du cheveu le plus menu jusqu’à la pointe de l’orteil, tout est parfait sur le chef-d’œuvre et que vous n’avez pas le droit d’inventer quoi que ce soit sans outrager le grand style ; de même, si vous avez à composer une scène de genre, songez encore au chef-d’œuvre, songez-y toujours, dussiez-vous peindre à un cordonnier le bras de l’Apollon du Belvédère et à une marchande de rue la poitrine de la Vénus de Milo. »
Et c’est ainsi qu’ont pris naissance les théories monstrueuses de fausseté qui toutes, une à une, comme des poisons, sont essayées sur les élèves. On connaît les axiomes esthétiques qui veulent que tout personnage ait la longueur du corps égale à celle de ses bras étendus, qui exigent que le nombril se trouve toujours au point d’intersection des deux diagonales tracées de l’extrémité du bras gauche au pied droit et du bras droit au pied gauche. On n’ignore pas l’importance des canons, des disciplinaires canons et de la hauteur du corps, qui doit être sept fois celle de la tête.
Le mal est, affirme-t-on, peu redoutable. Les vrais forts résistent à ces années de compression. Ils se raidissent et apprennent une manière de calligraphie artistique qui leur fait la main.
Pardon, outre que de beaux talents ont sombré dans les flancs de l’Académie aussi pointus de côtes que Charybde et Scylla. le diantre est qu’elle élève, qu’elle nourrit, qu’elle entretient, qu’elle couronne, qu’elle décore toute la grande séquelle des artistes nuls, veules, obstruants, superfétatoires et superfécatoires, qui tapissent, qui salissent, qui dégradent les murs des expositions. Ils sont là, vingt, cent, mille à vous insulter de leurs œuvres dès que vous entrez, ils vous torturent l’œil, ils vous gueulent leurs couleurs criardes à l’oreille, ils vous mettent des colères sur la langue, des rages dans le cœur, des procès-verbaux au collet, si vous avez le malheur d’entailler, par folâtrerie, leur envoi ; ils sont vos tortionnaires, vos cauchemars, vos haines, ils vous accablent de leurs deux mille trois cents toiles au Salon de Paris, de leurs douze cents tableaux au Salon de Bruxelles, impunément, doucement, officiellement — et l’Académie leur sourit, les présente au Roi, au Président de la République, à tous les représentants de la médiocrité moderne, et c’est elle encore qui les envoie par-dessus les monts faire des farces d’atelier à Rome sous prétexte de se perfectionner dans l’art de tuer l’art. Voilà le crime : créer des médiocrités. Tous les systèmes patronnés par l’Académie y tendent. Son idéal est vulgaire, accessible au premier venu, au chien qui passe.