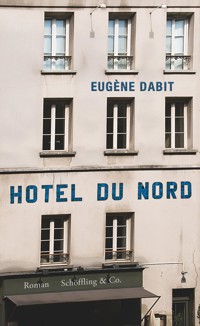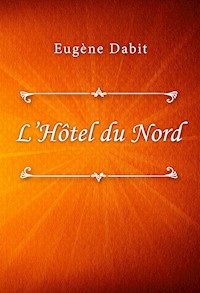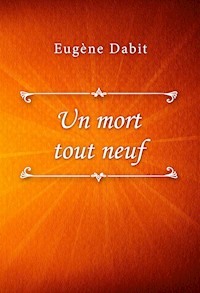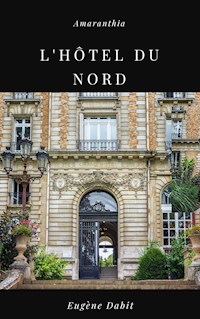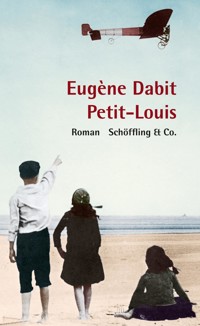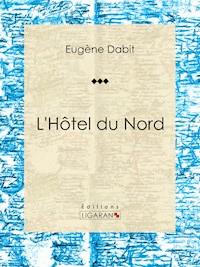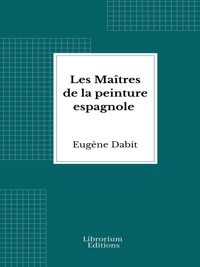
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Si j’ai donné ce titre à mon essai : Les Maîtres de la peinture espagnole, c’est parce qu’il en indiquait l’esprit, nullement pour céder à la manie qu’ont des écrivains d’art de prêter des titres majestueux à leurs ouvrages.
Cet essai constitue une introduction à la peinture espagnole, à son histoire, dont l’essentiel est l’œuvre de deux hommes. J’ajoute qu’on ne peut connaître et étudier cette peinture qu’en Espagne, que les rares tableaux dispersés dans les musées étrangers – à l’exception des Velázquez du musée de Vienne – ne font point défaut lorsqu’il s’agit de se livrer à cette étude.
Quand le Greco arrive en Espagne, en 1572, la peinture espagnole végète ; elle reste soumise à des influences italiennes ou flamandes ; chez quelques artistes, elle garde un caractère primitif. Elle ne naît, ne se développe, qu’avec le Greco ; elle s’épanouit avec Velázquez. Après eux, un long silence. Puis c’est Goya, né en 1764 ; Goya, qui d’ailleurs ne parviendra pas à tirer l’art espagnol de son sommeil.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Eugène Dabit
LES MAÎTRES DE LA PEINTURE ESPAGNOLE
LE GRECO – VELÁZQUEZ
© 2024 Librorium Editions
ISBN : 9782385746957
PRÉFACE
LE GRECO
I
II
VELÁZQUEZ
I
II
PRÉFACE
Si j’ai donné ce titre à mon essai : Les Maîtres de la peinture espagnole, c’est parce qu’il en indiquait l’esprit, nullement pour céder à la manie qu’ont des écrivains d’art de prêter des titres majestueux à leurs ouvrages.
Cet essai constitue une introduction à la peinture espagnole, à son histoire, dont l’essentiel est l’œuvre de deux hommes. J’ajoute qu’on ne peut connaître et étudier cette peinture qu’en Espagne, que les rares tableaux dispersés dans les musées étrangers – à l’exception des Velázquez du musée de Vienne – ne font point défaut lorsqu’il s’agit de se livrer à cette étude.
Quand le Greco arrive en Espagne, en 1572, la peinture espagnole végète ; elle reste soumise à des influences italiennes ou flamandes ; chez quelques artistes, elle garde un caractère primitif. Elle ne naît, ne se développe, qu’avec le Greco ; elle s’épanouit avec Velázquez. Après eux, un long silence. Puis c’est Goya, né en 1764 ; Goya, qui d’ailleurs ne parviendra pas à tirer l’art espagnol de son sommeil.
Ainsi, contrairement à la peinture italienne, la peinture espagnole n’est représentée que par trois maîtres. Les élèves du Greco ? Son enseignement fut intransmissible, on ne fera que citer les noms de son fils : Jorge Manuel, de Luis Tristan. Ceux de Velázquez ? Ils se perdent dans ce qu’il est convenu de nommer l’école madrilène. Dans l’histoire de la peinture espagnole, Zurbaran, seul, pourrait retenir longuement notre attention par une œuvre solide, simple, pure. Quant à Murillo, on ne peut que se souvenir de certaines toiles qui sont le fait d’un artisan heureux, et oublier ses compositions lourdes et conventionnelles.
En ce qui concerne Goya, je n’ai pas hésité à le rejeter de cet essai, à lui laisser la place d’isolé qu’il tient magnifiquement dans l’histoire de la peinture espagnole. Son influence s’exercera sur les peintres du XIXe siècle, particulièrement sur les impressionnistes. À son sujet, dirai-je toute ma pensée ? Il est moins grand peintre que Velázquez ; et on ne trouvera pas dans ses toiles les plus audacieuses les audaces picturales du Greco. C’est dans notre temps même que l’œuvre de Goya prend sa pleine signification, elle semble y appartenir par une qualité de sensibilité aiguë et presque maladive, par un individualisme exaspéré, par ses tentatives anarchiques, par certain contenu magique. Aussi ne saurait-il être question de situer Goya sur le plan du Greco et de Velázquez, qui sont pleinement et simplement des classiques, les seuls maîtres de la peinture espagnole.
* * *
De la peinture espagnole est née la peinture qu’on qualifie de moderne. On peut aisément établir des rapports entre le Greco et Cézanne, entre Velázquez et Renoir. Voilà une des raisons d’entreprendre cet essai. Mais il en est d’autres. On aime à parler des écoles française, flamande, hollandaise, allemande, anglaise, à reconnaître que l’école italienne les domine toutes, bien que chacune ait donné naissance à quelques grands maîtres. Ce classement ne vaut que si on en excepte l’école espagnole. À mon sens, tout au moins. Pas un instant je ne songe à l’art des primitifs italiens, à leurs fresques ; il est entendu qu’on ne trouvera pas en Espagne l’équivalent de leurs œuvres. Je parle de la peinture dans son dernier état, où l’ont amenée le Titien, le Tintoret, Véronèse.
Je n’ignore pas qu’au lendemain de cette exposition qui eut lieu au Petit-Palais, alors que beaucoup chantent encore dans les journaux ou les revues les richesses de l’art italien, faire des réserves sur cet art prête à sourire. Peu m’importent les critiques ou les moqueries. J’exprime sans réserves ma propre pensée. Précisément, je trouve qu’il y a dans ces œuvres, avec excès, l’art. Que de préciosité, de raffinement, quel souci de la beauté, conduisant à une conception extérieure et décorative de la peinture (encore que ce soit là une de ses raisons d’être). Lorsque je suis resté longtemps devant les toiles du Greco, d’une essence divine en vérité, d’un art si parfait, ensuite je ne puis voir les compositions religieuses des Vénitiens d’où toute profondeur est absente et qui ne sont que des œuvres décoratives ; pas davantage mon souvenir n’est terni par la beauté des primitifs italiens, car le Greco n’est pas moins pur. Et s’il s’agit de recréer la vie, qu’elle soit le fait miraculeux d’un artiste, les portraits de Velázquez, quelques-unes de ses compositions, me donnent une émotion violente comme jamais ne m’en procura l’art italien.
Ces pensées, je les développe au cours de mon essai. Elles n’ont cessé de vivre en moi depuis des années, depuis ma première visite au Prado. Dans ce musée, un des plus beaux, sinon le plus admirable qu’on puisse visiter, où l’on voit des Véronèse, des Tintoret, surtout des Titien, comme on n’en voit pas au Louvre, comme on n’en découvre que rarement en Italie, peinture espagnole et peinture italienne s’affrontent. Or, la peinture espagnole est le plus purement, le plus humainement : la peinture, débarrassée de toute esthétique, même lorsqu’il s’agit du Greco.
* * *
Je n’ai, pour parler de peinture, qu’un titre : celui d’avoir été peintre durant dix longues années. D’autres auteurs ont ceux de : professeur à la faculté des lettres, maître de conférences, archiviste, conservateur de musée, membre de l’Institut. Ce sont là des titres que je ne leur envie point. Ces personnages ont fait de l’art une chapelle, des musées des écoles où l’on vient apprendre cette fameuse histoire de l’art qui n’a que faire avec le vrai langage des couleurs et des formes. Ils gardent sur leurs vêtements la poussière des bibliothèques ; sur leurs doigts, des taches qui ne sont que des taches d’encre. Ils n’ont jamais tenu un pinceau, jamais ils n’ont tracé une ligne. Néanmoins, ils parlent de rapports de couleurs, de valeurs, de composition, de volumes. Puisqu’ils aiment à citer, à citer parfois certaine phrase d’Apelle, dont un cordonnier critiquait les œuvres : « Cordonnier, tiens-t’en à la chaussure », ont-ils pu penser jamais qu’elle s’appliquait à eux ? Qu’un cordonnier parle de chaussure, un menuisier de la fabrication d’un meuble, chaque ouvrier de son métier, on convient que cela est juste, nécessaire. Ce n’est pas le métier de ces érudits, que celui de peintre. Qu’ils restent enfermés dans leurs musées à remplir des fonctions administratives, dans des bibliothèques à remuer des documents, besognes utiles dont on ne doute pas qu’ils soient capables. Mais qu’ils cessent d’exploiter ce merveilleux filon de la peinture. Un des premiers qui s’en mêla, avec passion du reste, fut Diderot, en écrivant ses Salons, et ce n’est pas le meilleur de son œuvre. S’il faut nommer des écrivains qui parlèrent avec justesse, et bonheur, de la peinture, en premier lieu écrivons le nom de Baudelaire ; et, de nos jours, celui de M. B. Berenson, avec son ouvrage sur les peintres italiens de la Renaissance.
J’ai pu échouer, ou ne réussir que partiellement dans ma tentative. Du moins, que mon effort invite les peintres à parler de leur art, de leurs maîtres, de leurs admirations. Plusieurs s’y sont risqués, dont je rappellerai le plus grand : Delacroix. Je souhaiterais avoir donné à quelques lecteurs l’amour de la peinture, qui est le même que celui de la vie ; je souhaiterais aussi contribuer à rendre à la peinture sa vraie place, qui n’est pas moins haute que celle qu’occupe la littérature parmi les créations spirituelles des hommes.
LE GRECO
I
Une pensée bien connue de La Bruyère me poursuit au commencement de cet essai : « Tout est dit, et l’on vient trop tard… » Ce n’est pas que je puisse regretter de parler du Greco un des derniers ; il ne dépendait pas de moi que je naquisse cinquante ans plus tôt pour être de ceux qui en firent la découverte. Mais, sans avoir beaucoup lu sur l’œuvre du Greco, je n’ignore pas que les commentaires auxquels elle a donné lieu sont déjà nombreux. Il n’est presque personne qui, à la suite de Maurice Barrès, n’interroge le Greco pour trouver le « secret » de Tolède ; qui ne voie en lui que le visionnaire, en néglige la peinture pour ne se soucier que de sa légende. C’est dans un tel travers que je désire ne pas tomber, ce sont les seuls secrets de l’art du Greco qui m’importent. Je n’interrogerai donc que le peintre : ses compositions, ses portraits, ses esquisses. Certes, sans oublier ce qu’il doit à Tolède, à l’Espagne.
* * *
Si l’on se refuse à « romancer » la vie du Greco, peu de lignes suffisent pour dire ce qu’on en connaît avec certitude.
Il naquit, croit-on, en 1541, à Candie. Impossible de parler de son enfance. On suppose que, adolescent, il travailla dans un de ces ateliers où des moines peignaient encore des icônes dans la pure tradition byzantine. Aux environs de 1560, il quitte la Crète pour venir à Venise, ainsi que beaucoup de ses compatriotes, peintres ou miniaturistes. En 1561, il entre dans l’atelier de Jacopo da Ponte, à Basano ; il y reste probablement jusqu’à la fin de 1569. Il retourne alors à Venise. Une lettre de Giulio Clovio au cardinal Alexandre Farnèse, datée du 16 novembre 1570, nous apprend l’arrivée du Greco à Rome. C’est un des rares documents sur son séjour en Italie.
« Il vient d’arriver à Rome un jeune Candiote disciple de Titien qui, à mon jugement, est du très petit nombre de ceux qui excellent en peinture ; et entre autres choses il a fait un propre portrait de lui-même qui a rempli d’étonnement tous les peintres ici à Rome. Je serais très heureux de l’introduire sous Votre Sainte Illustrissime et Révérentissime Protection, sans qu’il soit autrement besoin de l’aider à vivre que par une chambre au Palais Farnèse à lui accorder pour quelque temps jusqu’à ce qu’il parvienne à s’arranger mieux… »
Dans cette lettre, dont je retranche les dernières phrases, simples formules de politesse, le nom du Greco n’est pas mentionné. Mais on garde un portrait de ce Giulio Clovio – qui fut un miniaturiste célèbre – par le Greco ; et certaine lettre de Giulio Clovio, conservée aux archives de la Bibliothèque Municipale de Spalato, apporte une seconde preuve de leurs relations.
Au manuscrit de Giulio Cesare Mancini, médecin privé du pape Urbain VIII, nous livre peut-être la vraie raison du départ du Greco pour l’Espagne, sans doute en mai 1572.
« Au sujet de… communément appelé le Greco. »
« Sous le pontificat de Pie V de sainte mémoire, il vint à Rome, y acquit une grande réputation et fut généralement appelé le Greco. Ce peintre, qui avait étudié à Venise et approfondi l’œuvre de Titien, était parvenu à un haut talent dans son métier et dans sa manière propre. De là il passa à Rome et y arriva à un moment où les peintres n’y étaient pas nombreux et où nul de ceux qui y étaient n’offrait dans son style cette décision, cette verve alerte qu’avait la manière du Greco. Sa hardiesse de faire s’accrut encore par suite du succès que lui valurent quelques commandes pour des particuliers. Nous en connaissons une actuellement chez le voisin de l’avocat Lancilloti, qui a été prise par quelques-uns pour un Titien. Alors qu’on était en train de recouvrir des figures de la fresque du Jugement Dernier de Michel-Ange parce que Pie V les trouvait trop indécentes pour l’endroit, il déclara soudain que, si l’on détruisait toute la fresque, il en voulait faire une autre qui serait plus chaste et plus convenable sans le céder cependant à celle-ci pour l’exécution picturale.