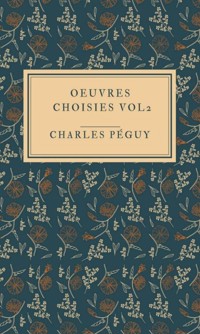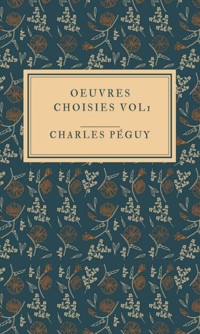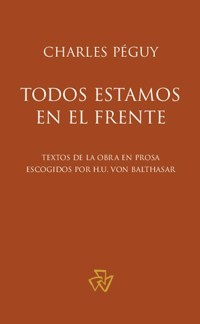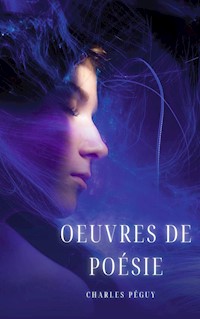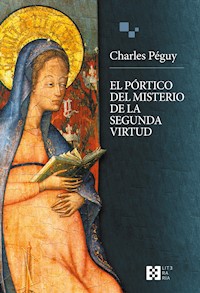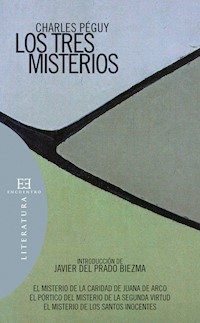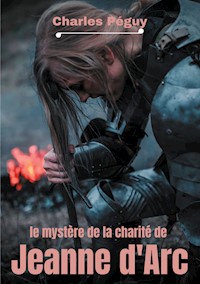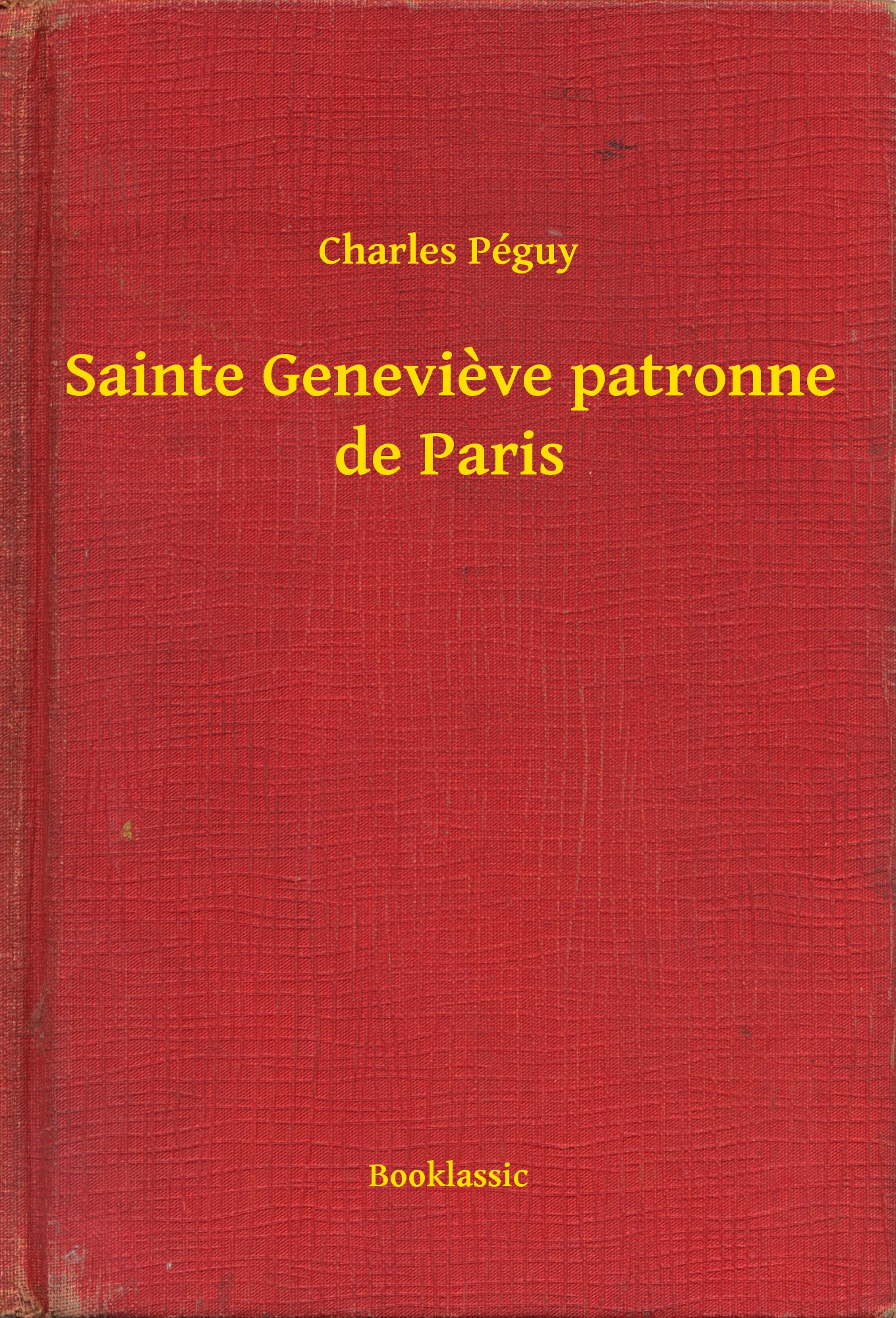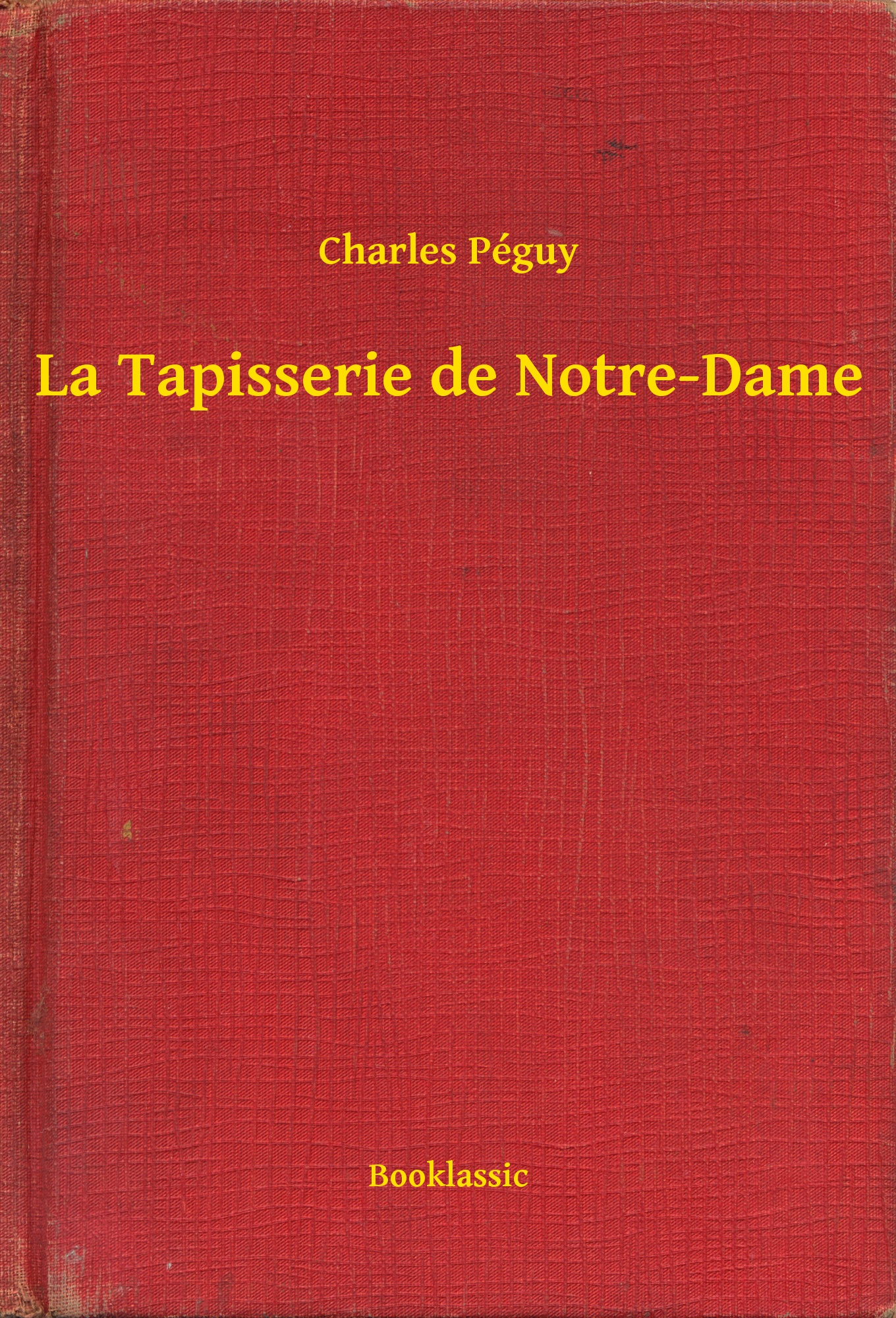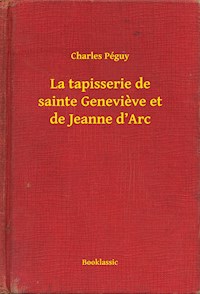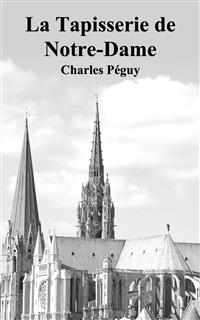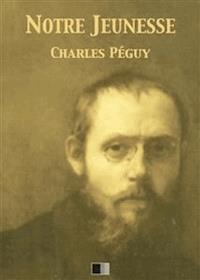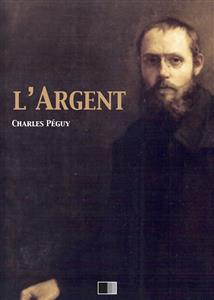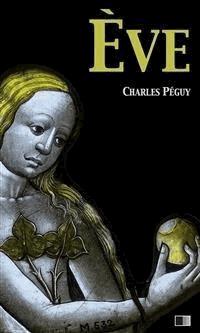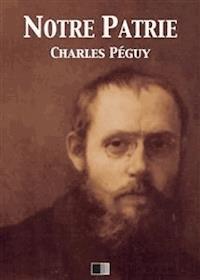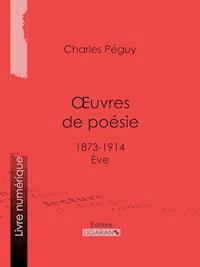1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
De Jean Coste.—Les récentes œuvres de Zola.—Orléans vu de Montargis.—Zangwill.—Notre Patrie.—Courrier de Russie.—Les suppliants parallèles.—Louis de Gonzague.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
ŒUVRES COMPLÈTES
DE
ŒUVRES COMPLÈTES DE CHARLES PÉGUY
ŒUVRES DE PROSE
Tome I
INTRODUCTION PAR ALEXANDRE MILLERAND
Lettre du Provincial. Réponse. Le Triomphe de la République.—Du second Provincial.—De la Grippe. Encore de la Grippe. Toujours de la Grippe.—Entre deux trains.—Pour ma maison (cité socialiste). Pour moi.—Compte rendu de mandat.—La Chanson du roi Dagobert. Suite de cette chanson.
Tome II
INTRODUCTION PAR MAURICE BARRÈS
De Jean Coste.—Les récentes œuvres de Zola.—Orléans vu de Montargis.—Zangwill.—Notre Patrie.—Courrier de Russie.—Les suppliants parallèles.—Louis de Gonzague.
Tome III
INTRODUCTION PAR HENRI BERGSON
De la situation faite à l'histoire et à la sociologie.—De la situation faite au parti intellectuel devant les accidents de la gloire temporelle.—A nos amis, à nos abonnés.—L'argent.
Tome IV
INTRODUCTION PAR ANDRÉ SUARÈS
Notre Jeunesse.—Victor Marie, comte Hugo.
ŒUVRES DE POÉSIE
Tome V
Le Mystère de la Charité de Jeanne d'Arc.—Le Porche du Mystère de la deuxième vertu.
Tome VI
Le Mystère des Saints Innocents.—La tapisserie de sainte Geneviève et de Jeanne d'Arc.—La tapisserie de Notre-Dame.
Tome VII
Ève.—Sonnets.
ŒUVRES POSTHUMES
Tome VIII
Clio.
Tome IX
Note conjointe sur Descartes (précédée de la note sur M. Bergson).
Tome X
Autres ouvrages et fragments inédits.
POLÉMIQUE ET DOSSIERS
Tome XI
Texte et commentaires se rapportant à la gérance et au rôle littéraire des Cahiers (préfaces).
Tome XII
Texte et commentaires se rapportant au rôle politique joué par les Cahiers (compte rendu de Congrès.—Affaire Dreyfus, etc.).
Tome XIII
Un nouveau théologien, M. Fernand Laudet.—Langlois tel qu'on le parle.—L'argent (suite).
Tome XIV
Marcel. La première Jeanne d'Arc.
Tome XV
Correspondance. Biographie et Histoire des Cahiers de la Quinzaine, par
ÉMILE BOIVIN
et
MARCEL PÉGUY
.
First Editions 1920
INTRODUCTION
PAR
INTRODUCTION
Je me rappelle ce soir de septembre, ce soir de la bataille de la Marne où dans Paris si grave et presque désert, un ami de Péguy accourut m'apporter la funeste nouvelle. J'écrivis sur l'heure un article (qu'à la réflexion j'ajournai jusqu'au 17 septembre, de crainte qu'il ne tombât dans sa famille non avertie). «La renaissance française, disais-je, tirera parti de l'œuvre de Péguy authentiquée par le sacrifice. Plus qu'une perte, c'est une semence. Un héros nous est né.»
Et de tous côtés, avec une ardeur violente, l'écho me répondait: «un héros et un saint». J'avais en outre la fortune bénie de faire surgir d'un hôpital de Laval (Mayenne) un soldat du 276e d'infanterie, Victor Boudon, blessé le 6 septembre à la bataille de l'Ourcq et qui la veille de sa blessure, le 5 septembre à Villeroy, avait vu tomber près de lui son lieutenant Charles Péguy. Il m'écrivait: «Je suis son témoin, voulez-vous recueillir mon témoignage? Voulez-vous que je dise «sa belle mort au champ d'honneur, alors que nous marchions à l'assaut des positions allemandes?»
Péguy a passé sa vie à approfondir ce problème, la notion de l'héroïsme et de la sainteté. Cette haute curiosité, poussée jusqu'à l'obsession, s'unissait en lui au sens du terre à terre, de la réalité la plus humble, de l'effort paysan, têtu, quotidien. Il avait le sentiment de la qualité surnaturelle dans les choses de chaque jour. Il disait que s'il y avait contrariété des personnages cornéliens aux hommes ordinaires, il nous serait impossible de nous retrouver en eux, mais que nous nous reconnaissons en eux parce qu'ils sont nos représentants éminents. Un tel esprit si haut, si noble était à mettre au premier plan. J'avais bien vu cela et je l'avais fait voir à ce vieillard d'une âme si jeune, si pure et si chaude, M. Thureau-Dangin qui dès 1910, sur notre proposition, rêvait de rapprocher de l'Académie ce solitaire, méconnu ou inconnu en dehors de son cénacle, mais aujourd'hui c'est bien autre chose: je comprends que j'ai approché dans ce normalien qui tenait une boutique un homme de la Légende dorée. Je comprends que pour nous rendre intelligible comment on devient un héros et un saint, il est utile d'étudier la formation de ce Charles Péguy que nous avons connu en chair et en os et qui demeure au milieu de nous en esprit.
Comment saisir un tel homme, non plus tel que les récits se déformant d'année en année nous le montreront peu à peu aux jours de pèlerinage sur la grande tombe de Villeroy, mais dans sa vérité absolue et intime? J'apporte quelques documents. Non pas un éloge, mais notre témoignage puisque nous avons eu l'honneur de le connaître. La postérité saura bien pourquoi l'honorer et l'aimer, mais elle demandera toujours plus de détails familiers et vrais sur celui qui, ayant vécu d'imagination avec les héros et les saints devient par sa mort l'un d'eux.
Péguy a reçu du fait de sa mort une telle valeur de sincérité que je me défends de rien faire d'autre ici que d'apporter quelques éléments de sa biographie spirituelle, quelques vues pour aider à la connaissance du cheminement de son âme. Péguy considéré comme une pensée héroïque. De quelle manière s'est constituée cette pensée? J'ai demandé aux témoins de sa vie les stations de son ascension.
M. Faultas, dans la Réforme sociale de novembre 1915, M. André M. de Poncheville, dans Charles Péguy et sa mère (une brochure aux Cahiers de l'Amitié de France et de Flandre) ont rassemblé pour notre attendrissement et notre instruction tout ce qu'il faut savoir sur le berceau de ce petit enfant plein de cœur et laborieux. Lui-même, dans ses conversations et dans ses Cahiers, racontait volontiers ses premières années. Il est d'une famille de vignerons orléanais. Son père, ouvrier et petit patron, meurt peu après sa naissance et comme il a été soldat en 1870, on dit qu'il meurt des fatigues de la guerre. Le voilà donc élevé par sa grand'mère, vigneronne qui ne sait pas lire, qui a travaillé la terre, qui conte des histoires, et par sa mère qui a une petite entreprise de rempaillage de chaises.
Que cette Française encore vivante, Madame Péguy, mère de Charles Péguy connaisse la gratitude et la respectueuse affection que mettent à ses pieds les admirateurs de son enfant.
«Tout ce qu'il voulait, il l'avait, a dit à M. de Poncheville, cette mère admirable dont les scrupules sont bien touchants, un livre, une boîte à couleurs. Et dire qu'on a écrit qu'il a eu de la misère! Ça n'est pas vrai, ça; on était pauvre, mais il n'a jamais manqué de rien. Son père était mort, mais nous travaillions toutes les deux, maman et moi. S'il a rempaillé avec nous? Non, il a seulement appris à canner pour s'amuser. N'est-ce pas, il voyait ma mère ou moi en train de battre la paille; alors, comme il faut toujours faire des choses toutes naturelles, c'est ça qu'il faisait.»
Péguy plus tard, avec ses amis, se flattait de savoir «pailler» les chaises en paille tordue, ce qui demande du tour de main, et non pas seulement en cannage, ce qui paraît-il est plus facile.
Retenez cette habitude qu'il prend dès l'enfance d'un travail ouvrier déterminé. Elle est de grande importance dans sa formation. De fait il demeurera et voudra demeurer ouvrier toute sa vie.
Péguy est un enfant bien doué. Il l'est à la manière d'un petit citoyen de France et d'Angleterre, et non pas à la manière orientale comme un slave ou un juif. Voyez-le, dans les récits de sa mère, recueillis par Poncheville, qui s'applique de toute son âme sérieuse à faire ses cartes de géographie. Quand un inspecteur primaire l'ayant vu à l'école, lui obtient une bourse au lycée, Péguy n'y fera que développer et mieux comprendre ce qu'il sait déjà être en lui. A seize ans, il expliquera Virgile, comme à douze il expliquait La Fontaine. C'est le même effort à comprendre un texte. Il a dit à Charles de Peslouan que jamais une nouvelle forme de travail ne l'avait surpris. Cela se relie dans mon esprit à ce qu'Albert Thomas me disait un jour qu'il était passé de l'étude du grec à l'étude des fabrications de munition sans autre étonnement, en appliquant de la même manière son esprit. Péguy toute sa vie se développera moins en extension qu'en intention. L'intention, c'est le regard de l'âme, dit Bossuet. Et c'est en ce sens que je prends ce mot. Péguy n'a pas l'esprit vif. Il ne passera guère son bachot qu'à dix-huit ans. Il sait peu de choses et continue de lire lentement en paysan. Il restera le même jusqu'à sa mort. Peslouan l'a vu à trente ans lisant pour la première fois Jacques le Fataliste et le Rouge et le Noir parce que ces ouvrages paraissaient dans un journal, l'Aurore je crois, qu'il prenait quotidiennement. Il n'a pas d'esprit au sens mondain du mot, mais pourtant le goût et le sens du comique à la manière de Rabelais ou de Courteline. Sa culture est faite purement des auteurs classiques: il lira et relira Homère, Virgile, les Tragiques grecs et français, La Fontaine, Bossuet. Il s'apparente ainsi aux hommes cultivés du XVIIe siècle, au Boileau des Remarques sur le traité du Sublime. C'est l'opposé de la culture d'un Marcel Schwob ou même d'un Montaigne.
Orléans fait partie de sa culture. C'est une ville où le passant ne voit rien d'extraordinaire, mais sur le plan invisible dans Orléans il y a Jeanne d'Arc. Le regard du petit Péguy cherchait sans doute sur le chemin de sa maison à l'école des figures, des beautés comme il y en a dans les livres, car il avait une de ces imaginations chrétiennes et classiques avides de grandeur morale et de surnaturel: il trouva Jeanne d'Arc. Le souvenir de l'héroïne remplit Orléans; il n'y est pas comme à Reims ou à Rouen noyé sous du gothique et des enrichissements; cette cité un peu stagnante n'a pas d'autre histoire. «Je ne sais pas, disait Péguy à Charles de Peslouan[1], de quel ton Rabier parle de Jeanne d'Arc dans les couloirs de la Chambre, mais à Orléans il ne le fait pas à la farce.» Péguy a été élevé dans le souvenir et le culte de Jeanne d'Arc dont sa grand'mère lui a souvent conté l'histoire. Il a suivi ses pas sur les rives de la Loire; elle est la première représentation historique dans sa vie. Il a été soumis aux rites catholiques et a fait sa première communion comme l'enfant de Domrémy. Quand il parlera d'elle, il sera soutenu par ce qui dort en lui et qu'il se sent de commun avec elle.
J'ai aimé Péguy avec familiarité tout de suite. Tout de suite il m'a été intelligible et parent. Et lui aussi m'a aimé, malgré nos différences de mœurs et bien que nous n'eussions pu nous voir d'abord qu'à travers les brèches de la barricade, parce que nous sommes de l'espèce qui passe sa vie à réveiller en soi de couche en couche les sentiments et les idées qui y dorment accumulés par les générations.
Orléans joue un grand rôle dans la formation de Péguy. Il n'y fut pas seulement un enfant et un collégien, mais encore un soldat. Il y passa son année de service militaire dans un régiment d'infanterie. Et ce fut pour sa formation une année d'importance capitale.
Cet adolescent qui vient d'être un collégien discipliné sera un soldat modèle et qui se soumet à toutes les exigences du métier. Ne croyez pas qu'il soit sans argent; il pourrait se décharger sur d'autres de certaines corvées: il ne le veut pas. Jamais un autre ne fera son lit ou ne cirera ses bottes, ou ne montera une garde à sa place. «De tous les êtres que j'ai connus, me dit Charles de Peslouan, c'est le seul qui m'ait donné une image en noblesse de la vie de caserne. C'est que dans cette vie Péguy trouvait l'expression de son éthique. Écoutez-bien: il avait un esprit révolutionnaire, que ne blessaient ni la discipline, ni la hiérarchie. La soumission à des règles lui paraissait la culture primordiale de tout esprit révolutionnaire. La cité socialiste, à l'en croire, exigera des citoyens de demain une bien autre soumission que la cité bourgeoise. L'insoumis ne pourra pas être bon citoyen de la cité. Et parmi les insoumis, rien de pire que le petit bourgeois qui coupe à la corvée, grâce à son argent, à son intrigue et à son astuce.»
Insistons sur ce point et sur l'idée qu'à cette date, Péguy se fait du bourgeois et de la classe bourgeoise. C'est une idée à priori, sans expérience personnelle. Autour de lui, au lycée même, ses camarades appartenaient au monde ouvrier. La bourgeoisie d'Orléans envoyait ses enfants aux écoles congréganistes; Péguy ne les connaît pas, ils sont les bourgeois, ceux qui n'ont pas l'esprit ouvrier. L'ouvrier, selon Péguy, a comme qualité première l'ambition de réaliser à chaque fois un travail parfait. Lui-même a travaillé le latin et le grec dans cet esprit de perfection. Mais il est persuadé que le bourgeois manque d'abnégation, qualité sans laquelle il n'y a pas d'esprit socialiste possible. La cité future ne se construira pas du dehors, mais par le désir que formeront en commun un certain nombre d'êtres qu'elle soit établie.
Ces réflexions, pleines de jeunesse et d'optimisme, Péguy déjà les notait; il les publiera en août 1897 dans la Revue socialiste sous ce titre, De la cité socialiste, et ce sera quasi son premier ouvrage (exactement sa troisième publication). Il ne voit pas qu'il décrit tout simplement la cité chrétienne. Dans cette Salente de son rêve, les fortunes ne seront pas nécessairement égalisées, les hiérarchies subsisteront, avec cette seule différence que ce ne seront pas des hiérarchies capitalistes. Dans ce sens, l'Armée est une représentation bien imparfaite, mais encore la plus tangible que Péguy ait de la cité future, et plus tard quand il parlera socialisme, ce sera souvent dans le métier militaire qu'il prendra des images. Du métier militaire, en principe, tout lui agrée. Il admire que les soldes d'officiers soient si modiques, juste ce qu'il faut pour qu'ils vivent. Cela s'accorde avec son idée d'un individu et d'une société nobles. A l'encontre des camarades qu'il allait avoir dans le parti socialiste, il ne refuse pas les galons. Aussitôt que possible il passera les examens d'officier de réserve. Il se plaît au régiment et il y plaît. Comme au lycée, l'estime de ses professeurs, il a l'estime de ses chefs. «Il demandait peu, me dit un témoin de ces premières années. A cette époque dans l'ordre social, il était extrêmement modeste. Qu'un officier, qu'un professeur causât familièrement avec lui, il en était comme le manœuvre vis-à-vis du chef d'entreprise, reconnaissant et flatté.» On n'imagine pas de jeune figure française plus sympathique que cet adolescent.
J'estime que dès la fin de son service militaire, Péguy avait complètement constitué en lui-même sa morale, morale socialiste et héroïque et qui ne pouvait se conserver que par une culture constante en héroïsme, morale d'un optimisme un peu déconcertant, morale qui l'animera encore en 1914 (à cette dernière date pourtant un peu attristée par les expériences de la vie).
Au sortir de la caserne, Péguy décida de faire une nouvelle année de rhétorique, et boursier à Sainte-Barbe suivit les cours de Louis-le-Grand, puis il entra à l'École Normale.
C'est dans ce temps qu'il commença de recruter ses troupes et ses amitiés. Dès Sainte-Barbe, je crois, les Tharaud et Charles de Peslouan. Le trait qui pour ma part me frappe le plus chez Péguy, c'est la vertu qu'il avait d'embaucher des dévouements. Je me propose dans ces pages hâtives de recueillir des témoignages qui enrichissent l'expérience personnelle que j'ai de ce noble et singulier personnage, mais pour définir mon idée propre, je devrais dire que je le tiens pour une sorte de moine destiné à réformer son ordre et à grouper des bonnes volontés.
Péguy avait le sens de l'amitié. Cela se rattache à son système d'optimisme. Il aimait toutes les formes, toutes les classes d'humanité; il voulait les introduire toutes dans la cité socialiste; il les aimait au travers de certains êtres choisis. Ses amis lui étaient des représentations à la fois réelles et sentimentales du monde. Il avait de l'amitié pour les morts aussi et même pour les êtres de pure imagination, Platon ou Polyeucte par exemple. Ses amis, il les différenciait, leur attribuait des rôles et des grades dans son armée ou si vous voulez dans l'univers que sa pensée organisait tout autour de lui et des Cahiers. Je m'obstine dans mon point de vue, et je dis que sans le savoir Péguy fondait un ordre. Il était né pour être le cœur et le foyer de quelques centaines d'hommes de bonne volonté que jadis il eût groupés dans une congrégation et dont nos mœurs ne lui permettaient plus que de faire des abonnés. A mesure que la vie s'écoulait il a eu des sévérités, des haines même, et chaque fois contre des gens qui l'avaient, disait-il, trompé, c'est-à-dire qui avaient manqué à la représentation qu'il s'était faite d'eux, bref qui s'étaient dérobés à la mission qu'il leur assignait. Ceux-là, il les rejetait proprement dans l'enfer. Tels Jaurès et Lucien Herr au moment du Combisme.
Puisque je cherche comment, à l'École Normale, il se développait, je dois noter qu'il s'occupait des pauvres. On trouvera des détails à ce sujet dans la préface de Monseigneur Batiffol au volume de J. Lotte. Péguy éprouvait pour les pauvres une tendresse à la saint Vincent de Paul. Il ne choisissait pas; il leur donnait tout ce qu'il avait, tout ce qu'il gagnait par quelques répétitions. Ses amis l'ont connu tout un hiver sans pardessus. Il ne pouvait pas voir la misère. Quand il n'avait rien à donner, il passait son pauvre du jour à quelque ami.
Pourtant rue d'Ulm, il se sentit moins à l'aise qu'au lycée et qu'au régiment. Il avait trop le goût de la discipline, l'aimait trop sur lui et sur les autres pour s'accommoder de cette maison libérale. Et puis il avait l'autoritarisme d'un jeune être qui croit posséder la vérité. L'École était divisée entre un parti catholique qui s'appuyait sur Ollé-Laprune et un parti socialiste qui se recommandait de Jaurès. Péguy donna son adhésion au parti socialiste et fut délégué à divers congrès par un groupe d'Orléans. C'était le temps de l'affaire Dreyfus. «J'ai connu à Normale, me dit un de ses camarades, un Péguy extrémiste, fanatique, presque sanguinaire; il me faisait l'effet d'un monstre.» Diable! Par ailleurs nous savons qu'à cette date, Péguy fut vraiment heureux. Pourquoi donc? L'explication m'enchante. Il paraît que jusqu'à ce moment Péguy et ses amis se trouvaient dans un état de stagnation sentimentale, vraiment sans cœur vis-à-vis des affaires publiques, étrangers à tout intérêt national. Tout d'un coup les plus grands espoirs envahirent ces jeunes intellectuels, ardents et naïfs. Ils connurent le plaisir de marcher en troupeau. Péguy voyait enfin le monde secoué par une idée, les ouvriers et les bourgeois prêts à se sacrifier pour elle. Son optimisme était satisfait; son regard sur l'horizon, immense. Nul doute que ce ne fût sous la forme la moins barbare le cataclysme, annoncé par Marx, qui doit précéder l'établissement du socialisme. Péguy décida qu'il lui fallait sa liberté pour remplir ce qu'il jugeait désormais devoir être sa «mission».
«J'étais à l'École Polytechnique, me raconte Charles de Peslouan. Péguy m'écrivit de venir le voir le dimanche suivant. L'après-midi que nous passâmes dans la cour de la rue d'Ulm demeure un des pôles de notre vie commune. Il y a pour tout être de ces jours de confidence et de sincérité qui émergent dans l'océan des souvenirs. Péguy m'annonça qu'il quittait l'École et qu'il allait s'associer à une maison d'édition; qu'il se mariait, et enfin qu'il allait publier sa Jeanne d'Arc. Il me donna les raisons de ces trois actes qui tous trois engageaient sa vie. Il quittait l'École parce que désormais apprendre ne lui suffisait plus. Il avait fait ses apprentissages et sans plus d'atermoiements devait entreprendre un travail vrai, un travail ouvrier. Il avait choisi d'être éditeur comme les Estienne, comme Balzac parce que, ainsi, il pourrait s'éditer lui-même et que le métier même d'imprimeur lui plaisait. (Et c'est vrai que c'était sa vocation: toute sa vie il a continué de corriger ses épreuves, de préparer ses mises en page avec un soin jaloux, satisfaisant là le goût ouvrier de la perfection qu'il voulait imaginer chez tous.) Il se mariait parce qu'il voulait le plus tôt possible connaître la vie avec toutes ses charges. Il serait peut-être lâche plus tard, il avait hâte d'avoir du courage. Enfin il publiait Jeanne d'Arc, bien qu'il sût que c'était une œuvre étrange et qui ne satisferait personne, parce que c'était là un coup porté et qui le dispenserait d'expliquer.
«A ce moment,m'écrit Tharaud (un de ses plus anciens amis et son camarade d'École), Péguy était encore mal renseigné sur lui-même et sur ses sympathies profondes. Il abandonnait la rue d'Ulm, et c'est encore l'École qu'il s'empressa de recréer autour de lui dans sa boutique de la rue Cujas, la vieille École que j'ai connue, l'École du socialisme intégral et de l'anticléricalisme agissant. Et cependant, comme il ressemblait peu aux camarades qu'il groupait autour de lui! Peut-on être anticlérical à la façon solennelle et naïve dont l'étaient nos camarades, quand on emporte dans sa malle—une pauvre vieille malle usée sur laquelle il avait écrit de sa plus belle écriture: Prière de ne pas toucher!—quand on transporte, dis-je, dans sa malle une masse de feuillets noircis, une Jeanne d'Arc vivante!... Quant à son socialisme, il n'avait guère de commun que le nom avec le dogmatisme de nos camarades marxistes. C'était l'expression de son dégoût pour une civilisation fondée sur la mécanique et l'argent, son appétit d'un ordre de choses où les vraies valeurs de la vie seraient mises à leur place, une systématisation bien raide et appauvrie de sa tendresse et de ses richesses intérieures, bref, la forme première de son catholicisme latent. Non, cela, en vérité, n'avait rien de commun avec les ratiocinations philosophiques et politiciennes où s'échauffaient volontiers les esprits dans les couloirs et la bibliothèque de l'École! Et ce malentendu, qui s'atténuait un peu dans la vie quasi conventuelle que nous menions rue d'Ulm, se révéla bien vite dans l'air plus libre de la boutique qu'il ouvrait rue Cujas—bien étouffée pourtant elle aussi!
«Un petit fait de rien du tout, que Péguy me raconta le soir même, représente fort bien l'opposition des points de vue. Ce jour-là, dans la boutique, se tenait un conseil pour étudier les moyens de faire marcher la librairie et par là de promouvoir l'avènement des temps nouveaux. Il faisait chaud. Comme de juste la discussion était longue! Ingénument, Lucien Herr, notre bibliothécaire à l'École, qui a les bonnes vieilles traditions de l'Alsace, proposa de faire venir des bocks du Café voisin. La stupeur, le mot est trop faible, le scandale de Péguy fut immense. Comment! On était réunis autour de cette table pour travailler à l'ère nouvelle idéale, pour étudier les moyens de réaliser la cité idéale, et l'un des précurseurs de ce monde parfait songeait à demander un bock!... C'est que, pour notre cher Péguy, sans qu'il s'en rendît compte, cette boutique n'était pas une boutique, c'était une chapelle, une petite église de la Chrétienté primitive; ses camarades n'étaient pas des étudiants, des professeurs, de jeunes bourgeois idéalistes et politiciens, c'étaient les douze apôtres. Et ma foi, il était aussi surpris d'entendre Lucien Herr demander qu'on apportât des bocks, que si là-bas, au bord de Tibériade, il avait vu Pierre et Thomas causant ensemble suspendre leurs propos pour aller boire au cabaret...[2]
«De jour en jour le désaccord moral entre ce catholique sans le savoir et ses compagnons marxistes devenait plus évident. Dix ans plus tard il éclata tout à fait lorsque Péguy publia sa Jeanne d'Arc. Quelle apparition, cette sainte avec son auréole, au milieu de la triste boutique et des rayons de livres dont je vois encore la poussière, les titres russes, juifs, allemands, barbares, et les dos usagés, car tout cela provenait de je ne sais quel vieux fonds échoué là par quel mystère et qu'on soldait à grand'peine! On devine la gêne de la Sainte toute armée de cuirasse et de prière, au milieu de ce pacifisme et de cette sociologie! On devine le silence pesant et la consternation qui accueillirent la vision charmante. Et tous ces vers et cette prose mêlés! Et cette prodigalité de feuilles blanches répandues dans le poème! Toutes ces pages pleines de silence, toutes ces blanches pages d'attente que Péguy devait plus tard recouvrir de sa belle écriture et de ce qu'allait lui inspirer son cœur enfin trouvé, elles disaient à quelques-uns d'entre nous: «Rêvez et attendez, nous sommes partis pour une longue marche. On ne peut tout dire à la fois...» Mais dans ces pages encore muettes, les compagnons marxistes, les conjurés de la rue Cujas n'entrevoyaient que trop bien le rêve encore indécis, la pensée qui se formait, quand ils lisaient les pages noires. Péguy sentit leur inquiétude, descendit jusqu'au fond de leur silence alarmé. Pourquoi ne pas le dire? il fut aussi humilié, car il était un auteur comme nous, et comme nous sensible au succès. Décidément il faisait fausse route. Il fallait renoncer à poursuivre le voyage avec les anciens camarades. Il n'avait plus rien à leur dire. Il n'avait qu'à s'en aller... Et laissant là la boutique et les grimoires sociologiques de toutes langues et de tous pays qui faisaient de ces quelques mètres carrés perdus au milieu de Paris, une Babel socialiste, il sortit sans éclats, emportant son trésor, les centaines de volumes invendus de sa Jeanne d'Arc, qui dans ses silences et ses blancs enfermait toute sa vie de demain...»
Par les trois décisions qu'il venait de prendre, Péguy se vouait délibérément à la pauvreté.
La pauvreté! Toute sa vie il en aura le goût. Pauvreté, mais non misère! Il a bien marqué la différence entre ces deux états dans sa préface à Jean Coste (Cahiers du 13 juin 1901) que l'on trouvera au cours de ce recueil. Dans cette prime ardeur de sa jeunesse Péguy pense que le riche ne peut pas faire son salut socialiste, comme il pensera plus tard, en se rattachant à la tradition chrétienne, qu'au riche le salut chrétien est difficile sinon impossible. Et pour achever de comprendre son idée de la pauvreté on pourra lire encore dans ce volume même les pages intitulées Les Suppliants, un peu confuses, subtiles, alambiquées et extrêmement curieuses.
Nous n'avons pas fini de nous rendre intelligibles la manière d'être de Péguy; nous devrions encore l'accompagner quelque temps et le suivre dans ses déceptions, déboires d'éditeur, difficulté d'existence, chagrin devant ce qu'il appellera «la faillite et la décomposition du dreyfusisme», brouille avec Jaurès et divers. Daniel Halévy donne d'utiles détails sur les conditions dans lesquelles il fonda les Cahiers. Il y a là des faits qui mettent des teintes nouvelles sur son caractère. Mais au point où nous sommes parvenus de sa biographie nous tenons l'essentiel, l'ossature de l'animal. En pleine bataille autour de Dreyfus, quand Péguy décida de quitter l'École Normale sans achever sa troisième année d'étude, il avait terminé ce qu'il nous aurait permis d'appeler son Introduction à l'héroïsme. Nous avons maintenant à comprendre sa conversion.
Comment ce jeune normalien de tempérament doctrinaire et farouche, dreyfusiste, anticlérical, comment l'apôtre de la Cité socialiste, l'homme de Marcel, dialogue de la cité harmonieuse où la vision devient si béate, si irréelle que ce vrai poète y perd son talent et presque toute sensibilité, comment un tel homme en deux ans arriva-t-il à se contredire et à se retourner de bout en bout, à retrouver en lui toutes ses hérédités, toutes ses réalités françaises, classiques et chrétiennes? Ça, c'est un beau problème.
L'ascension commença... Non, pas l'ascension, il s'agit d'un approfondissement de l'être. Péguy commence de descendre en lui-même vers sa vérité propre. Il commence à se libérer de tous ses maîtres. Les professeurs viennent verser en nous leur enseignement. Accueillons-les avec gratitude. Mais ensuite il faut que nous nous débarrassions de tout cela, pour retrouver notre vraie nature. Péguy, pendant plusieurs années, s'est débattu furieusement contre tout ce que la Sorbonne avait versé sur le petit paysan qu'il était. Comme il fut injuste! Comme il avait raison! C'est bien beau de se mettre dans de telles colères.
En 1899, au cours d'une maladie dont il parle longuement dans ses Cahiers de février 1900 et suivants, sous ce titre: De la Grippe, il lut Pascal. Jusqu'alors il connaissait fort peu les Pensées. A cette première lecture, il comprit Pascal du point de vue de l'intelligence pure. Et le fait curieux, c'est que le jour où il le comprit en croyant, il s'en détacha. L'ascétisme de cœur, l'isolement d'un Pascal lui déplaisait. Il en a fait la confidence à Peslouan. Son sentiment le porta alors vers saint Louis qui devint son guide[3]. Puis il s'attacha à la liturgie romaine, dont il aima le latin au point qu'il le prétendit bientôt supérieur à tout autre. D'ailleurs, il lisait peu l'Imitation et ne semblait guère connaître l'Ecriture.
Je n'insisterai pas sur sa formation religieuse. Mgr. Batiffol en a écrit mieux que nul de nous ne saurait faire. Lotte, d'autre part, est bien touchant. C'est le portier du couvent et c'est un saint. Simplement, si vous le voulez bien, avec ses amis dont je recueille les interprétations orales, nous allons feuilleter ce recueil auquel nos notes vont servir de préface, et nous en tirerons quelques traits significatifs?
Il y a là plusieurs essais de valeur inégale, par exemple les Suppliants, Louis de Gonzague, Notre Patrie, qui sont comme des bornes kilométriques de la voie par où Péguy accomplit son salut. «Je puis bien vous dire, me confie Louis Gillet, que Péguy, que je tiens pour un héros et pour un saint, à l'École normale me faisait horreur pour sa violence dreyfusiste. C'est à partir des Suppliants et de Louis de Gonzague que j'ai commencé à l'aimer.»
Péguy lisait le grec et le savait fort bien; il était bon humaniste et en était très fier. Il adorait les tragiques grecs. Louis Gillet, meilleur juge là dessus qu'aucun de nous, me dit: «C'est le dernier écrivain que j'aie connu véritablement nourri de la substance antique et pour qui Homère, Sophocle, Virgile fussent autre chose que des noms.» Dans les Suppliants parallèles, Péguy part de cette idée que le suppliant, l'exilé, le proscrit, dans le drame antique est un personnage sacré: il est reçu avec tremblement, comme un représentant de la divinité: chargé d'une mission ou d'un châtiment auguste, il a au milieu des autres hommes un rôle surnaturel; il est un peu prêtre, il est à part; il ne supplie pas du tout, il commande, il ordonne, on tremble devant lui; l'hôte qui lui refuse sa porte est puni. Le Suppliant est revêtu de toute la majesté de la misère humaine. On voit en lui un ambassadeur de la Némésis. Et Péguy de nous découvrir les rapports de cette idée avec la doctrine chrétienne du pauvre: le pauvre est l'ami de Jésus, il est le véritable maître de la Société chrétienne; c'est lui qui récompense et condamne; pour comprendre sa fonction, sa mission divine sur la terre, relisez le sermon de Bossuet sur «l'éminente dignité du pauvre». Quelle majesté dans ces deux doctrines religieuses! Combien en comparaison est plate et misérable la doctrine socialiste! «Nous, socialistes, dit Péguy, en quelque sorte, ayons au moins la pudeur de rougir de notre infériorité. Serait-il vrai que le socialisme ne vaille pas même en beauté, en religion morale ces religions désuètes, qu'il ne vaille pas le paganisme ni l'église chrétienne? Remontons à nos sources, incorporons au socialisme cette éminente beauté. Faisons la cité future avec les trésors du passé. Bâtissons la cité nouvelle, mais transportons-y les anciens dieux.»
Ah! Péguy, vous êtes de ceux qui ne maudissent pas le passé? Alors vous ne tarderez guère d'être excommunié par les bandes avec lesquelles vous croyez que vous êtes accordé. J'en ai déjà vu beaucoup de ces socialistes peu à peu suspects aux leurs, puis odieux et rejetés, parce qu'ils ne reniaient pas leurs sources et qu'on voyait un jour qu'à leur insu peut-être, ils les aimaient pieusement.
Mais laissons! ce que je voudrais dessiner en marge de cette belle page des Suppliants, c'est Péguy lui-même quand il venait si honnêtement, comme un pèlerin, comme un moine-mendiant de l'ancienne France, solliciter pour les Cahiers et non pas solliciter, mais nous faire l'honneur de nous annoncer d'une voix monotone et d'un air grisâtre, d'un air toujours égal, toujours assuré et si fin, qu'il nous donnait le témoignage fraternel de nous demander un service. Et qu'il avait raison, comme il nous faisait honneur de bien vouloir penser à nous, lui qui allait mourir pour la France et pour une conception héroïque de la vie!
Louis de Gonzague est un souvenir du catéchisme, une anecdote qu'on raconte à tous les enfants de paroisse. Vous la connaissez: des enfants en récréation parlent de la fin du monde. «Que ferais-je si la fin du monde devait arriver dans une minute?»—«J'irais à la chapelle», dit l'un.—«Je courrais me confesser», dit l'autre.—«Moi, dit Louis de Gonzague, je continuerais à jouer.»... Vous voyez comment cette anecdote se relie à l'ordre de pensées que nous venons d'indiquer. La révolution, pour le croyant socialiste, se présente comme une apocalypse, mais déjà Péguy ne croit qu'à la continuité du travail. Le révolutionnaire se croit dispensé de tout devoir, en vertu d'une formule sacro-sainte. Péguy a horreur de tout sabotage. Il aime la conscience, l'effort «moléculaire», le scrupule, le travail, le devoir. Il prétend que le monde ne se tient que par les gens dévoués qui aiment «l'ouvrage bien faite». La morale enfantine de Louis de Gonzague, il la préfère aux théories paresseuses de Jaurès. Je suis persuadé qu'il a mis une certaine malice à jeter dans les jambes de Jaurès cette petite histoire de sacristie. Il ne pardonnait pas à Jaurès ses lâchetés envers la démagogie, ses flatteries aux passions basses qui démoralisaient le peuple et lui abîmaient, à lui Péguy, ces bons travailleurs qu'il adorait. C'est le commencement de ces thèmes empruntés à l'Hagiographie, aux vies des saints, à Joinville surtout et qui lui servent à faire une si fine critique des mœurs vulgaires de son parti. «Je me souviens encore, me dit Louis Gillet, de l'effet de surprise que me fit la lecture de ce Cahier. Péguy devenait donc quelque chose comme un membre de l'opposition socialiste, un dissident, l'enfant terrible du parti! Je crois qu'il s'amusait beaucoup à taquiner Jaurès. «Vous voyez, lui dit-il, mon vieux catéchisme d'Orléans est meilleur socialiste que vous, le grand pontife.» Au fond, tout en croyant rappeler le socialiste à sa vraie tradition, à sa mystique, comme il disait, il retrouvait tout bonnement la vieille religion française et la foi de sa mère. Quelle surprise et quel charme pour moi qui l'avais connu extrémiste et si farouche!...»
Notre Patrie (1905). Ça, c'est une date dans la vie de Péguy, et c'est un chef-d'œuvre. Je le lis avec émerveillement. Les familiers de Péguy s'accordent à dire qu'ici pour la première fois, il a composé dans sa vraie manière personnelle; c'est le type achevé, avec Notre Jeunesse[4], m'expliquent-ils, de son art comme poète en prose: rythme, mouvement, idées, style, il est là pour la première fois tout entier. C'est une des réussites de cet ordre de méditations déjà religieuses, sinon mystiques, qui aboutirent dans Victor Marie, Comte Hugo (octobre 1910), à d'étonnantes et infinies considérations sur l'ordre charnel, l'ordre temporel et l'ordre surnaturel, à des analyses de Polyeucte et de «Booz endormis». Le christianisme, vu du centre des croyances juives, le mystère de l'incarnation, le problème de la sainteté, tout cela occupe une place immense dans la pensée de Péguy: c'est le fond de son poème de Jeanne d'Arc, la Charité, le Porche; c'est le fond même de sa poésie, dont le livre sur Victor Marie, Comte Hugo, n'est que le discours ou le manifeste.
Le jour qu'il écrit Notre Patrie, Péguy découvre en lui un fait nouveau, l'idée de patrie. A quelle occasion? Les premières tensions franco-allemandes dans l'été de 1905. Tout cela est indiqué dès le début: «Ce fut une surprise... Ce fut une découverte... Ce fut une trouvaille.» Mais la révélation ne se produit qu'à la dernière page, en quelques lignes, d'une façon subite, inattendue, étonnante, mystérieuse. Tout le livre est composé sur une seule période; tout le livre est un agrandissement démesuré sur le fameux dessin d'Hugo (Napoléon II).
O revers! O leçon! Quand l'enfant de cet homme
Eut reçu pour hochet la couronne de Rome
Quand ............. etc., etc.
.............................
Quand........................
.............................
Un cosaque survint qui prit l'enfant en croupe
Et l'emporta tout effaré.
Je crois que l'imitation est flagrante et le modèle indiscutable, mais le résultat est magnifique.
1º C'était une semaine comme toutes les autres, une semaine ordinaire, un jour très ordinaire.
2º On venait de recevoir le roi d'Espagne. C'était une distraction. Péguy badaud, Péguy peuple, Péguy parisien. Digression sur Paris: Paris ville royale; peuple de Paris, peuple-roi, le seul qui sache recevoir les rois, qui ait à sa disposition des monuments, un décor plus royal qu'aucune autre ville... Notre-Dame, les Invalides, l'Arc de Triomphe, la Colonne Vendôme, les quatre monuments éternellement monuments..... Digression sur Hugo, poète de Paris et de la gloire de Paris.
3º Donc, on reçoit le roi d'Espagne. Le cortège, gardes municipaux; vision, merveilleux tableau. En passant, un coup de patte aux universités populaires.
4º Tout s'était bien passé, tout allait rentrer dans le train-train accoutumé, quand... Ici suspension: la bombe de la rue de Rohan. Impression désagréable, mauvais présage.
5º Enfin le présage se dissipait, quand (ici le véritable effet) arrivent les mauvaises nouvelles d'Allemagne; on apprend que la guerre est possible, et brusquement, impérieusement, Péguy découvre à cette menace qu'il aime sa patrie.
L'effet de cette chute soudaine, religieuse, de ce balbutiement final, de cet aveu sourd, étouffé, rapide, définitif est prodigieux. Pour qui veut jouir du plaisir littéraire, Péguy n'a rien fait de plus fort. Pour qui veut jouir du plaisir de comprendre, nul texte chez Péguy de plus haute importance. Péguy n'avait jamais pensé qu'en partisan, en fanatique; tout à coup l'expérience fait jaillir en lui un flot de sentiments inconnus. Il retrouve toute sa tradition, toutes ses vérités vivantes, non plus ses passions factices, mais son amour, ou du moins les vrais objets de son amour.
Voilà, à mon sens, ce qui fait l'importance de ce morceau. Il est capital dans l'évolution spirituelle de Péguy. C'est vraiment un très beau document pour l'histoire d'une conversion. Il acheva de nous mettre sur la voie pour que nous saisissions le ressort essentiel de Péguy.
Notre ami se tenait avant tout pour un historien, et il a souvent traité de la manière d'écrire l'histoire. Toutes ses explications ne valent pas un certain mot qu'il a dit à plusieurs fois sur le ton du secret à Charles de Peslouan: «L'historien est un homme qui se souvient.» Les documents sont des éléments capitaux, mais il ne s'agit pas de les interpréter, il s'agit de les vivre. Nous avons une mémoire secrète de notre histoire, nous portons en nous nos ancêtres; servons-nous des documents pour les réveiller dans notre être. Péguy prétendait que les Allemands ne peuvent rien comprendre à l'histoire de France. Il leur défendait même d'écrire l'histoire romaine. Qui saura le mieux comprendre et écrire la vie de Jeanne d'Arc? Un petit plébéien des bords de la Loire, élevé dans la pensée et le culte de la Pucelle d'Orléans. Péguy entendait reconstruire l'histoire de cette paysanne de génie en réveillant en lui l'âme paysanne de ses ancêtres, et dans ce travail il faisait intervenir toutes les qualités par lesquelles il se sentait ouvrier et qu'il voulait garder pures en lui. Ainsi s'expliquent en quoi diffèrent les deux Jeanne d'Arc qu'il publia à dix années d'intervalle, la figure de l'héroïne ayant d'ailleurs obsédé ou mieux dominé toute sa vie. La première, déjà si étrange, est au sens de l'auteur une reconstitution historique; la seconde, où il se livre magistralement à sa méthode, tenons-la pour une création mystique, une effusion, une prière. Enfin le destin et le vœu de son cœur lui permirent, pour couronner toutes ses pensées, de se sacrifier à l'imitation de la Sainte.
Je crois que ce qui resterait à préciser c'est le point exact où la guerre a surpris Péguy. Est-ce que je me trompe? Il y avait chez lui une nuance de désillusion et certaines ombres étaient venues sur ses espérances.
Je lui disais: «Laissez donc votre boutique et vos Cahiers. Soyez comme tout le monde, député, académicien, Dieu sait quoi! mais commerçant, quel fardeau! Servez-vous, pour dire ce que vous avez dans le cœur, des moyens de tout le monde, la Revue des Deux Mondes, les grands journaux, les plus hautes tribunes. Je ne comprends pas pourquoi il vous plaît de compliquer votre affaire...» Il me répondait sans développement, de cet accent terne et resserré qu'il avait parfois en marchant la tête baissée, qu'il ne serait pas libre ailleurs. Défendait-il sa liberté ou son excentricité? Je ne tenais pas auprès de lui le rôle déplorable du tentateur qui veut dénaturer un être et dévoyer une mission. Je lui offrais des moyens meilleurs que les siens pour mettre en œuvre ses convictions. Mais j'entendais bien qu'il me répondait comme eût fait jadis un Maurras: «Ma pensée réformatrice ne peut germer que dans la solitude et c'est là, non ailleurs, que je trouve mes libertés pour tout conquérir.» Peut-être avait-il raison. C'est classique et c'est très beau de s'en aller dans le désert pour y attirer à soi la foule.
A la grande tombe de Villeroy, Péguy convoque les générations. Il leur a donné une tombe à vénérer. Elles se demanderont si le jour qu'il recueillit sa couronne glorieuse, il avait rempli toute sa tâche. Nous répondons nettement que la France a perdu en Péguy le peintre du peuple à la guerre et un puissant réconciliateur. Comme nul autre, il aurait su décrire le paysan sous les armes. Il était peuple, ancienne France, parisien, soldat de l'An II; il avait fait des Le Nain, il avait fait des Raffet; lisez ce qu'il écrivit des armées de l'Empire: s'il avait survécu, nous aurions «des bonhommes», comme aimait à dire le soldat (qui n'employa jamais le mot de poilu), nous aurions des gens de labour, des gens de métier, des hommes de notre terre, des hommes des vieilles croisades en bleu-horizon. Et puis Péguy, rien qu'à réagir contre ses maîtres de la Sorbonne, nous disait de bien belles choses, et contre eux furieusement il ameutait toute l'histoire de France qu'il portait en lui. Qu'est-ce donc qu'il a dû tirer de l'histoire de France sur le champ de bataille, en face des envahisseurs? Quel secours intérieur ne lui fut-elle pas? Comme il a dû réconcilier et appeler à son aide tous ceux qui se battent dans notre passé! S'il avait survécu, il aurait nommé, dénombré et rendu sensibles, pour les plus querelleurs même d'entre nous, les ressources de la France Éternelle, tout l'invisible qui nous assiste et nous anime et qui respire positivement dans notre sang.
Maurice BARRÈS.
[1] Charles de Peslouan, à la fois savant et lettré, un des premiers: et des plus intimes amis de Péguy, possède une correspondance, des manuscrits, des épreuves, des souvenirs, tout un trésor que nous le remercions de nous avoir ouvert, et le même remerciement nous l'adressons à Louis Gillet, aux Tharaud. Des jugements, la postérité s'en charge, mais des renseignements elle veut que nous les lui fournissions.
[2] Par la suite me font remarquer les Tharaud, Péguy avait beaucoup changé. Il s'était détendu. Il avait laissé là toute aigreur puritaine. Il n'aurait plus été surpris s'il avait vu Pierre et Thomas poursuivre leur causerie à l'auberge devant un verre de vin, comme on pourrait l'imaginer dans un tableau flamand. Et c'est devant un bon «demi» chez Amédée Balzar, que fuyant sa boutique des Cahiers, dont le bavardage et l'austérité finissaient par l'ennuyer, qu'il me raconta le thème de son éblouissant et si familier poème sur la chère petite Espérance!...
[3] Sainte-Beuve disait: «Avoir le Saint Louis de Joinville,—le Saint Louis de Tillemont,—le Saint Louis de M. de Wailly,—le Saint Louis de M. Zeller,—le petit Saint Louis de M. de Chennevières». Et moi j'ajoute: se mêler à la familiarité de Joinville comme faisait Péguy.
[4] Dans Notre Jeunesse (juillet 1910), les amis de Péguy déclarent que les pages consacrées à Bernard Lazare sont les cinquante plus belles qu'on ait écrites sur Israël. J'aime à enregistrer de ces déclarations. On ne connaît une génération qu'autant qu'on est à même de se placer à son point de vue pour examiner avec elle son horizon et ses sommets.
DE JEAN COSTE
DE JEAN COSTE
Ce qui fait que je n'avais pas de la joie de ce que les gendarmes embarquaient les sœurs en troisième, c'est que j'avais reçu un peu avant le commencement des vacances la lettre suivante:
Montée de Charente
22 juillet 1902
Monsieur Charles Péguy,
gérant des Cahiers de la Quinzaine
8, rue de la Sorbonne, Paris
Monsieur
Mon mari fait depuis quelque temps partie de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, et nous lisons les Cahiers de la Quinzaine, qu'un autre membre de la ligue veut bien nous passer obligeamment.
J'ai pensé que, étant donnée l'importance de la publication dont vous êtes gérant, vous devez être en relation avec beaucoup d'hommes de lettres, de journalistes, d'éditeurs, de libraires. L'esprit démocratique qui anime les articles des cahiers me donne bonne idée de la fraternité qui doit unir les auteurs et les lecteurs; c'est pourquoi je me permets de vous demander un service.
Nous sommes de très pauvres gens. Mon mari est employé de perception aux appointements de 60 francs par mois; je gagne 80 francs comme institutrice publique. Nous sommes mariés depuis trente-trois mois et j'aurai dans un mois et demi mon troisième bébé.
Tant de besoins et de si maigres ressources vous laissent deviner que nous vivons étroitement. L'arrivée d'un nouvel enfant, la perspective des dépenses prochaines, qui vont être si lourdes à notre petite bourse, nous fait désirer de travailler un peu plus afin d'augmenter nos ressources. Or il nous est bien difficile de trouver, dans la campagne où nous sommes, des occupations supplémentaires.
J'ai pensé que peut-être vous pourriez nous procurer quelque travail de plume: adresses à faire, manuscrits à copier, etc. J'espère n'avoir pas trop présumé de votre obligeance; je pense que vous voudrez être assez bon pour me répondre. Puisse votre réponse m'apporter une bonne nouvelle, je vous serai infiniment reconnaissante! Je prends mes vacances le 2 août; j'aurai un mois et demi de loisirs et je serai si heureuse de pouvoir les employer utilement!
Daignez agréer, monsieur, avec mes excuses pour la peine que je vais vous causer, l'expression de mes remerciements et de mes sentiments les plus distingués.
Marguerite Meunier,
Institutrice primaire publique
à la Montée de Charente
Charente
Bien entendu, j'ai modifié les noms propres, le nom de la commune, la signature. Une institutrice qui cherche du travail pour nourrir ses enfants serait mal notée des grands chefs; de telles démarches feraient croire que les familles des instituteurs ne sont pas complètement heureuses.
Mais si quelqu'un de nos abonnés veut entrer en relation avec cette famille et peut lui procurer du travail, nous serons heureux d'établir la communication. Écrire à M. André Bourgeois.
⁂
Cette lettre nous parvint quelques jours avant le commencement des vacances. Nous recevons un assez grand nombre de lettres écrites par des instituteurs; j'aime cette écriture soigneuse, régulière, grammaticale, presque toujours modeste, calme, et déjà conforme à la typographie; ce papier écolier; cette encre violette, qui sert à corriger les devoirs.
Tout y était, dans cette lettre: d'abord la répartition des genres entre la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen et les cahiers; la Ligue, dont on fait partie; les cahiers, qu'on lit; la Ligue, chargée de préparer les cérémonies des nouveaux cultes; les cahiers, à qui on s'adresse pour demander du travail.
Puis cette idée, cette illusion des pauvres gens que les cahiers sont déjà une importante publication, dont je suis le gérant important, que je suis en relation avec beaucoup d'hommes de lettres, de journalistes, d'éditeurs, de libraires, et qu'en outre les cahiers ont un esprit démocratique; cette confusion presque universelle, et dont vivent les politiciens, entre l'esprit démocratique et l'âme populaire; cette confusion non moins universelle entre la fraternité, la solidarité socialiste et la charité bourgeoise, le travail demandé comme un service.
Enfin et surtout cette illusion suprême des pauvres gens: que l'on peut trouver facilement du travail honnête; qu'il suffit d'être courageux, vaillant au travail, soigneux, pour avoir le droit de vivre en travaillant; que nous pouvons sauver de la misère les gens que nous aimons; que nous pouvons sauver nos amis de la faim; que nous sommes assurés nous-mêmes contre le déficit, contre la misère, contre le dépérissement et contre la mort.
Singulière illusion des pauvres gens, mais dont une cause au moins est évidente. Quand il s'agit d'organiser des cérémonies cultuelles, ou des cérémonies culinaires, enterrements, banquets, ou de bâtir des monuments, nous lisons dans nos journaux que des milliers de francs par jour tombent; les pauvres gens en concluent qu'à plus forte raison ils pourront trouver de quoi vivre en travaillant; ils ne peuvent imaginer que l'argent aille aux représentations, et qu'il manque à l'organisation du travail.
C'est pourtant ce qu'il faut se représenter; le vice bourgeois, d'entretenir le luxe avec ce qui est dû au travail, n'a peut-être jamais sévi avec autant de férocité dans le monde bourgeois que dans un certain monde prétendu socialiste. S'agit-il de commémorations, de fêtes et banquets, de meetings, d'élections, de manifestations politiques, de voyages, de monuments morts, d'exhibitions, de listes publiées, de romantisme et de théâtre, l'argent tombe aux mains des innombrables Puech et des innombrables Barrias. Et non seulement l'argent des nombreux bourgeois égarés dans le mouvement prétendu socialiste et demeurés snobs, mais, hélas, l'argent des véritables petites gens. Car les petites gens n'ont rien de plus pressé que d'imiter les grands de leur monde. Qu'il s'agisse au contraire d'œuvres vivantes et d'hommes vivants, et que l'on demande un dévouement anonyme, je manquerais aux nombreux et solides amis qui travaillent pour nous et qui travaillent pour plusieurs institutions vraiment socialistes si je disais que l'on ne trouve personne et que l'on ne trouve rien; mais tous ceux qui ont essayé de préparer ou d'organiser du véritable travail savent, à considérer l'ensemble du marché, de combien le rendement qui intéresse le travail est inférieur aux flots qui alimentent la représentation. Loin qu'ayant alimenté la représentation les souscripteurs habituels se croient tenus d'autant plus, à plus forte raison, à nourrir le travail, ils arguënt, au contraire, de ce qu'ils ont dépensé en représentations pour ne pas dépenser en travail: Nous sommes épuisés; il faut, vous le savez, contribuer tous les jours; les occasions ne manquent pas.—Nous ne sommes pas les seuls à qui on ait accoutumé de tenir ce langage; tous ceux qui ont voulu organiser du travail sans luxe, ni boniment, sans affectation, sans gloire, sans pose ni publicité, se sont heurtés aux mêmes refus, qu'ils voulussent faire des coopératives ou des écoles, des livres ou du pain, c'est-à-dire, en dernière analyse, quelles que fussent les coopératives de production qu'ils voulussent faire, car nous ne faisons rien jamais qui ne soit, en dernière analyse, de la coopérative de production; et fabriquer des livres n'est pas moins indispensable que de fabriquer du pain; aussi quand les initiateurs, quand les fondateurs, quand les gérants des institutions laborieuses, leurs démarches finies, et mal consommées, rentrent dans leur atelier, dans leur boutique maigre, et dans leur misérable bureau, vienne le même jour une occasion de grande liste, ils ont le même jour l'amère consolation de retrouver, affectés de coefficients variables, mais plutôt considérables, notés de sommes importantes, les noms de ceux qui se trouvaient trop pauvres pour fournir des moyens de travail. Et ce qu'il faut noter parce que c'est un événement considérable moralement, c'est que l'argent des pauvres se refuse aux pauvres presque autant que l'argent des riches; les pauvres qui sortent de l'égoïsme et de la misère, au lieu d'acquérir directement une solidarité de classe, commencent par se donner un orgueil de parti, une affectation de grandeur, un goût bourgeois de la cérémonie et de la représentation.
A ces aberrations des pauvres et des riches nous savons qu'il y a des exceptions nombreuses; nous savons qu'elles sont beaucoup plus nombreuses pour les pauvres que pour les riches; nous sommes ici mieux situés que partout ailleurs pour estimer à leur valeur juste les dévouements anonymes de quelques riches et de pauvres nombreux; nous reviendrons sur cette répartition; mais ce que je veux indiquer dès aujourd'hui, c'est que dans les partis et dans les compagnies républicaines, socialistes, révolutionnaires, anarchistes, laïques, et parmi les individus correspondants, sous les mêmes étiquettes, sous les mêmes aspects, deux genres d'hommes coexistent, et cohabitent: les uns soucieux de travail, et que nous devons nommer les classiques, les autres, préoccupés de représentation, et que je suis bien forcé de nommer les romantiques; ces deux genres d'hommes s'interpénètrent partout; et partout depuis le commencement du mouvement révolutionnaire les classiques sont gouvernés par les romantiques; ceux qui travaillent sont gouvernés par ceux qui représentent; l'introduction du gouvernement parlementaire parmi nous, je ne dis pas avec tous ses abus, mais je dis: de préférence par ses abus, sous ses formes d'abus, n'est qu'une introduction particulière de ce gouvernement général, et sauf de rares et d'honorables exceptions, les travailleurs émancipés pensent à gouverner plutôt qu'ils ne pensent à travailler; les romantiques et les classiques vivent partout ensemble, de bonne amitié, parce que les classiques sont bonne pâte, parce que les romantiques sont imposants, parce que les classiques ne demandent qu'à s'en laisser imposer; tous les romantiques sont gouvernementaux, ministériels, étatistes, quand même ils font profession, par démagogie électorale, d'être antigouvernementaux, antiministériels, antiétatistes; c'est que l'État militaire, totalement incapable d'organiser le travail, est assez capable d'organiser les représentations, les manifestations romantiques. Ces deux genres d'hommes vivent ensemble parce que les classiques, bonnes têtes, ont accepté l'asservissement romantique. En réalité, il y a peut-être plus de différence entre ces deux genres qu'il n'y en a entre les ennemis politiques et sociaux les plus acharnés. Il y a peut-être entre ces deux genres la plus profonde, et la plus grave des séparations contemporaines. Ceux qui aiment le travail sincère et ceux qui aiment les mensonges rituels des cultes romantiques sont peut-être séparés par le plus profond des dissentiments contemporains. Il est permis d'espérer qu'on s'en apercevra quelque jour. Déjà des présages laissent voir que les travailleurs sont las du gouvernement des théâtreux. Et il se peut que cet affranchissement le plus vaste fasse toute l'histoire de la période où nous entrons.
⁂
Cette lettre d'une institutrice était écrite parfaitement. Ceux de nos abonnés qui n'ont jamais manqué de pain ne peuvent imaginer comme il est difficile d'en demander. Demander une circonscription à la tourbe électorale n'est rien: il suffit, sauf de rares et d'honorables exceptions, d'être plat; demander un gouvernement à la tourbe parlementaire n'est rien: il suffit, sauf de rares et d'honorables exceptions, d'être plat; mais demander du pain, même par le moyen du travail, quand on est bien né, sans platitude, sans déclamation, est une opération délicate.
Par hasard, et par intermédiaire, je pus mettre cette famille en relation avec un auteur qui avait à faire faire un travail de copie; mais le plus souvent je n'ai rien; je ne puis procurer du travail aux pauvres gens qui en demandent; je ne puis trouver des leçons pour les camarades qui en ont besoin; je ne puis répondre à leurs lettres, parce que je suis moi-même surmené; j'en ai du remords; et ce remords m'empêche de partager la joie laïque d'État.
⁂
Personnalités. Jean Coste est un personnage. Il n'est pas imaginaire. Il n'est pas littéraire. Il est vrai. On en parle comme de quelqu'un. Nous savons qui c'est. On a commencé par le vouloir ignorer. Mais il s'est fait connaître par sa force propre. Aujourd'hui les députés, les journalistes, les chroniqueurs de l'enseignement, Téry, parlent de lui souvent, comme de quelqu'un de bien connu.
Je n'ai pas reproché à Téry d'avoir étouffé totalement le Jean Coste. Il ne le pouvait pas. Il ne le voulait pas. Je lui ai reproché de n'avoir pas accueilli, soutenu le Jean Coste à l'origine avec toute la justice, avec toute la force que cette œuvre méritait. Je persiste à croire que Jean Coste, sous son nom, valait un article de tête, en première page de la Petite République. La Petite République se sert beaucoup des instituteurs. Elle pouvait lancer le Jean Coste.
⁂
On a dit: Je ne puis m'intéresser à Jean Coste; il est prétentieux, poseur, mièvre.
Nous savons de reste comme il est. Il n'est pas parfait. Il n'est pas un saint. Il est un homme. Il est un instituteur de village. Il est comme il est. Aux vertus que l'on exige des pauvres, combien de critiques et combien d'éditeurs seraient dignes d'être des maîtres d'école?
On veut qu'il soit parfait. On ne voit pas que c'est la marque même de la misère, et son effet le plus redoutable, que cette altération ingrate, mentale et morale; cette altération du caractère, de la volonté, de la lucidité, de l'esprit et de l'âme. Ceux qui font de la philanthropie en chambre, et qui sont, à parler proprement, les cuistres de la philanthropie, peuvent s'imaginer que la misère fait reluire les vertus. On peut se demander alors pourquoi ils combattent la misère. Si elle était pierre ponce, ou tripoli à faire briller les vertus précieuses, il faudrait la développer soigneusement. En réalité la misère altère, oblitère les vertus, qui sont filles de force et filles de santé.
On dit qu'il est faible, et que fort il pourrait s'évader de son bagne. Ceux qui font du moralisme en chambre, c'est-à-dire, à parler proprement, les cuistres de moralité, peuvent s'imaginer que la misère fait un exercice de vertus. C'est la pesanteur et c'est la force inévitable de la misère qu'elle rend les misérables irrémédiablement faibles et qu'ainsi elle empêche invinciblement les misérables de s'évader de leurs misères mêmes. Dans la réalité la misère avarie les vertus, qui sont filles de force et filles de beauté.
La misère ne rend pas seulement les misérables malheureux, ce qui est grave; elle rend les misérables mauvais, laids, faibles, ce qui n'est pas moins grave; un bourgeois peut s'imaginer loyalement et logiquement que la misère est un moyen de culture, un exercice de vertus; nous socialistes nous savons que la misère économique est un empêchement sans faute à l'amélioration morale et mentale, parce qu'elle est un instrument de servitude sans défaut. C'est même pour cela que nous sommes socialistes. Nous le sommes exactement parce que nous savons que tout affranchissement moral et mental est précaire s'il n'est pas accompagné d'un affranchissement économique.
C'est pour cela qu'avant tout nous devons libérer Jean Coste, ainsi que tous les miséreux, des servitudes économiques.
⁂
On confond presque toujours la misère avec la pauvreté; cette confusion vient de ce que la misère et la pauvreté sont voisines; elles sont voisines sans doute, mais situées de part et d'autre d'une limite; et cette limite est justement celle qui départage l'économie au regard de la morale; cette limite économique est celle en deçà de qui la vie économique n'est pas assurée, au delà de qui la vie économique est assurée; cette limite est celle où commence l'assurance de la vie économique; en deçà de cette limite le misérable ou bien a la certitude que sa vie économique n'est pas assurée ou bien n'a aucune certitude qu'elle soit ou ne soit pas assurée, court le risque; le risque cesse à cette limite; au delà de cette limite le pauvre ou le riche a la certitude que sa vie économique est assurée; la certitude règne au delà de cette limite; le doute et la contre-certitude se partagent les vies qui demeurent en deçà; tout est misère en deçà, misère du doute ou misère de la certitude misérable; la première zone au delà est celle de la pauvreté; puis s'étagent les zones successives des richesses.
Beaucoup de problèmes économiques, moraux ou sociaux, politiques même seraient préalablement éclairés si l'on y introduisait, ou plutôt si l'on y reconnaissait comme due la considération de cette limite. Nous y reviendrons si nous le pouvons. Nous examinerons si cette limite existe en fait, si cette limitation vaut en droit, dans quelle mesure, sous quelles conditions.
En fait on s'apercevrait sans doute que cette limite n'existe pas universelle, qu'elle n'est pas fixe, qu'on ne la constate pas dans tous les cas, et que dans les cas où on la constate elle est variable; mais on reconnaîtrait qu'elle se présente dans un très grand nombre de cas, même aujourd'hui; qu'elle a une importance capitale dans les sociétés fortement constituées; qu'elle a une grande importance encore dans une société troublée, comme est la société contemporaine; aujourd'hui même, on reconnaîtrait qu'un très grand nombre de situations sociales sont définies parce qu'elles sont condamnées à demeurer en deçà de cette limite; et un assez grand nombre d'autres sont définies parce qu'elles ont franchi cette limite sans risque de retour; toute une zone sociale est déterminée parce qu'elle est située au delà de cette limite, juste au delà, sans la déborder beaucoup vers l'aisance, mais sans aucun risque de bavure en deçà; ainsi on étudierait cette crise morale et sociale de première importance, qui survient à vingt-sept ans, et par qui l'immense majorité des révolutionnaires deviennent et restent conservateurs, soit qu'ils aillent faire de la conservation dans les partis de la conservation, soit, communément, qu'ils restent faire de la conservation dans les partis prétendus révolutionnaires, par opportunisme ou par surenchère, soit qu'ils pratiquent cette conservation publique et privée, de ne plus faire de l'action après avoir commencé par s'y intéresser; on reconnaîtrait que le souci de certitude, le besoin de sécurité, d'assurance, de tranquillité, est un facteur moral considérable; on distinguerait que ce besoin entre comme un élément respectable dans beaucoup de vocations religieuses; on éprouverait enfin que tant qu'un homme, jeune ou adulte, n'a pas dépassé l'âge de cette crise, on ne peut ni le juger, ni le présumer.
La misère est tout le domaine en deçà de cette limite; la pauvreté commence au delà et finit tôt; ainsi la misère et la pauvreté sont voisines; elles sont plus voisines en quantité, que certaines richesses ne le sont de la pauvreté; si on évalue selon la quantité seule, un riche est beaucoup plus éloigné d'un pauvre qu'un pauvre n'est éloigné d'un miséreux; mais entre la misère et la pauvreté intervient une limite; et le pauvre est séparé du miséreux par un écart de qualité, de nature.
Beaucoup de problèmes restent confus parce qu'on n'a pas reconnu cette intervention; ainsi on attribue à la misère les vertus de la pauvreté, ou au contraire on impute à la pauvreté les déchéances de la misère; comme ailleurs on attribue à l'humilité les vertus de la modestie, ou au contraire on impute à la modestie les abaissements de l'humilité.
Ainsi à l'égard de la consommation la différence du pauvre et du miséreux est une différence de qualité, de mode, comme à l'égard de la production la différence du travailleur et du théâtreux était une différence de nature.
En droit, en devoir, en morale usuelle on reconnaîtrait que le premier devoir social, ou pour parler exactement, le devoir social préalable, préliminaire, celui qui est avant le premier, le devoir indispensable, avant l'accomplissement duquel nous n'avons pas même à discuter, à examiner quelle serait la cité la meilleure, ou la moins mauvaise, car avant l'accomplissement de ce devoir il n'y a pas même de cité, on reconnaîtrait que l'antépremier devoir social est d'arracher les miséreux à la misère, d'arracher les miséreux au domaine de misère, de faire passer à tous les miséreux la limite économique fatale.
Comme il y a entre les situations où gisent les miséreux et la situation où les pauvres vivent une différence de qualité, il y a ainsi entre les devoirs qui intéressent les miséreux et les devoirs qui intéressent les pauvres une différence de qualité; arracher les miséreux à la misère est un devoir antérieur, antécédent; aussi longtemps que les miséreux ne sont pas retirés de la misère, les problèmes de la cité ne se posent pas; retirer de la misère les miséreux, sans aucune exception, constitue le devoir social avant l'accomplissement duquel on ne peut pas même examiner quel est le premier devoir social.
Au contraire, étant donné que tous les miséreux, sans aucune exception, seraient sauvés de la misère, étant donné que toutes les vies économiques, sans aucune exception, seraient assurées dans la cité, la répartition des biens entre les riches différents et les pauvres, la suppression des inégalités économiques, l'équitable répartition de la richesse entre tous les citoyens n'est plus qu'un des nombreux problèmes qui se posent dans la cité instituée enfin. Le problème économique de répartir également, ou équitablement, les biens entre tous les citoyens n'est pas du même ordre que le problème économique de sauver tous les citoyens, sans aucune exception, de la misère; sauver tous les miséreux de la misère est un problème impérieux, antérieur à l'institution véritable de la cité; attribuer à tous les citoyens des parts égales, ou équitables, de richesses est un des nombreux problèmes de la cité instituée; le problème de la misère est un problème incomparable, indiscutable, posé, posé d'avance, dans la réalité, un problème de la cité à bâtir; nous devons le résoudre et nous n'avons pas à discuter si nous devons le résoudre; nous n'avons qu'à discuter comment nous pouvons le résoudre; c'est un problème sans relâche; au contraire le problème de la pauvreté est pour ainsi dire un problème de loisir, un problème de la cité habitée, un problème comparable, discutable, que les citoyens se poseront après, s'ils veulent; avant d'examiner comment ils pourront le résoudre, ils pourront examiner même s'ils doivent se le poser.
Qu'on me permette une comparaison théologique: l'enfer est essentiellement qualifié comme l'effet d'une excommunication divine; le damné est un excommunié de par Dieu; il est mis par Dieu hors de la communion chrétienne; il est privé de la présence de Dieu; il subit l'absence de Dieu; les différentes et innombrables et lamentables peines où se sont excitées les imaginations sont dominées par cette peine d'Absence, qui est la peine capitale, incomparable; d'ailleurs l'enfer est essentiellement modifié comme éternel, c'est-à-dire comme infini dans le temps, ou comme infini dans ce qui serait le temps et qui exclut le temps; à cet égard l'enfer se connaît à ce qu'il n'admet aucune espérance; l'horizon du damné est barré d'une barre infinie; l'enfer est cerclé; aucun espoir absolument ne filtre, aucune lueur.