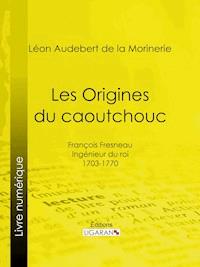
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Extrait : "La savant La Condamine au cours de sa Relation abrégée d'un voyage fait dans l'intérieur de l'Amérique méridionale, signalait en ces termes, à la date de juillet 1743, les propriétés d'une résine désignée sous le nom de cahuchu en la province de Quito : « Fraîche, on lui donne avec des moules la forme qu'on veut, elle est impénétrable à la pluie ; mais ce qui la rend plus remarquable, c'est sa grande élasticité."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 115
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INGÉNIEUR DU ROI
1703-1770
Découverte et application, le caoutchouc est chose toute moderne.
Le savant La Condamine, au cours de sa Relation abrégée d’un voyage fait dans l’intérieur de l’Amérique méridionale, signalait en ces termes, à la date de juillet 1743, les propriétés d’une résine désignée sous le nom de cahuchu en la province de Quito : « Fraîche, on lui donne avec des moules la forme qu’on veut, elle est impénétrable à la pluie ; mais ce qui la rend plus remarquable, c’est sa grande élasticité. On en fait des bouteilles qui ne sont pas fragiles, des bottes, des boules creuses qui s’aplatissent quand on les presse, et qui dès qu’elles ne sont plus gênées reprennent leur première figure. Les Portugais du Para ont appris des Omaguas à faire avec la même matière des pompes ou seringues qui n’ont pas besoin de piston : elles ont la forme de poires creuses, percées d’un petit trou à leur extrémité, où ils adaptent une canule de bois : on les remplit d’eau, et en les pressant lorsqu’elles sont pleines, elles font l’effet d’une seringue ordinaire. Ce meuble est fort en usage chez les Omaguas. Quand ils s’assemblent entre eux pour quelque fête, le maître de la maison ne manque pas d’en présenter une par politesse à chacun des conviés, et son usage précède toujours parmi eux les repas de cérémonie. »
En vérité, c’était un étrange raffinement de précaution gastronomique chez des sauvages !
La Condamine donna lecture de sa Relation à l’Académie des sciences, dans la séance publique du 28 avril 1745. Le cahuchu ou caoutchouc, avait-il soin de noter, ne figurait là surtout que comme trait de « coutume singulière. » On l’accueillit donc en souriant, à titre de curiosité.
Voilà pour la découverte.
L’aimable académicien lui-même n’y pensait plus ; – il n’y avait du reste attaché qu’un intérêt assez minime, – lorsqu’en 1749 il fut saisi par l’Académie d’un Mémoire sur le caoutchouc, œuvre d’un ancien ingénieur de la marine à Cayenne, qui, lors de ses fonctions, de 1732 à 1748, avait rencontré l’arbre Seringue, et, d’expériences en expériences, était parvenu à en dissoudre la résine et à l’utiliser d’une façon pratique.
Cette fois c’était l’application.
Le mémoire de l’ingénieur était bien fait pour piquer l’attention de ce grand curieux de La Condamine. Il en rendit compte à la docte compagnie, encadré dans un rapport élogieux, où, comme s’il pressentait l’avenir réservé au caoutchouc, il s’empressait de prendre date, rappelant que dès l’année 1736 il avait envoyé à l’Académie, par l’intermédiaire de M. du Fay, le directeur du jardin du roi, quelques rouleaux de cette matière d’aspect noirâtre, au sujet de laquelle il avait inséré une note dans son extrait d’observations du 24 juin. L’extrait n’ayant pas été imprimé, il jugeait à propos de le faire connaître au public, et il le reproduisait ainsi : « Il croît dans les forêts de la province d’Esmeraldas un arbre appelé par les naturels du pays Hhévé… Il en découle par la seule incision une résine blanche comme du lait ; on la reçoit au pied de l’arbre sur des feuilles qu’on étend exprès ; on l’expose ensuite au soleil où elle se durcit et se brunit d’abord extérieurement et ensuite en dedans. On en fait des flambeaux… J’ai appris depuis mon arrivée à Quito que l’arbre d’où distille cette matière croît aussi sur le bord de la rivière des Amazones et que les Indiens Maïnas la nomment caoutchouc ; ils en couvrent des moules de terre de la forme d’une bouteille, ils cassent le moule quand la résine est durcie : ces bouteilles sont plus légères que si elles étoient de verre et ne sont point sujètes à se casser. C’étoit tout ce que j’en savois… Dans les séjours que j’ai faits en divers lieux sur les bords de l’Amazone, et pendant le cours de ma navigation, j’étois surtout occupé d’observations astronomiques, de détails topographiques et de tout ce qui pouvoit contribuer à la perfection de la carte que je levois du cours de ce fleuve, ce qui ne me permettoit pas de donner aux recherches d’histoire naturelle tout le temps que j’aurois désiré… Comme je n’avois écrit aucun détail sur l’arbre qui produit le caoutchouc, ni sur la préparation de sa résine, j’attendois de nouvelles instructions du Para lorsque je reçus un mémoire qui laisse peu de chose à désirer sur ce sujet. Il est de M. Fresneau, chevalier de l’ordre militaire de Saint-Louis, ci-devant ingénieur à Cayenne, où il a passé quatorze ans. Après de longues recherches il a enfin découvert dans cette colonie l’arbre d’où distille le caoutchouc ; il s’est informé soigneusement des Indiens du Para de la manière dont ils le mettoient en œuvre. Il a fait ensuite lui-même, avec l’adresse et l’intelligence dont il a donné bien d’autres preuves, des expériences qui ont été suivies du plus heureux succès… » C’est de la sorte que la plume de La Condamine amenait en scène le Mémoire de l’ingénieur Fresneau. Ceci se passait à la séance de l’Académie des sciences, le 26 février 1751.
Quel était cet ingénieur ? On consulte en vain tous les dictionnaires de biographie : ils ne le disent point. Son nom est à peine inscrit dans quelques encyclopédies, et encore, le plus souvent, d’une façon vague ou dédaigneuse : M. Fresneau, Fresneau, un nommé Fresneau, un certain Fresneau, un colon français.
La Condamine avait entrevu, au pas de course du voyageur ; Fresneau chercha et découvrit ; s’absorba dans l’expérimentation scientifique et trouva le premier la solution pratique et industrielle. On doit saluer en lui l’initiateur d’une invention des plus intéressantes et des plus populaires, par la multiplicité, l’imprévu et le bon marché de ses applications. N’est-ce pas une mémoire à tirer de l’oubli ? La tentative me plaît. J’ai sous la main divers documents qui me sollicitent ; j’en ai recueilli d’autres et je publie cette étude. L’homme, d’ailleurs, était un philosophe, un curieux qui avait la passion de l’utile, dévoué au bien public, – un vrai patriote.
François Fresneau appartenait à une famille notable des Îles de Saintonge. On sait d’après lui « qu’il étoit de condition. » Il avait pour père François Fresneau de La Ruchauderie, et pour mère Anne Regnauld, dame de La Gataudière. Il naquit le 29 septembre 1703, à Marennes, et fut tenu le lendemain sur les fonts baptismaux en l’église Saint-Pierre de Salles, par son bisaïeul, M. de Pinmuré, et par sa tante, Mlle de Beauroche – une La Morinerie.
Son père remplissait alors à Bordeaux les fonctions de receveur de l’émolument du sceau de la chancellerie près le Parlement ; plus tard il occupa une charge de secrétaire du roi. C’était un homme instruit, très expert en matière de droit féodal, ce qui lui offrait la ressource de pouvoir rédiger de nombreux mémoires en revendication et en défense contre les empiétements ou les prétentions de ses voisins. Il dirigea lui-même l’éducation de son fils. Celui-ci avait l’esprit grave, réfléchi et appliqué. Quand il fût en âge de songer à une carrière, son choix était fait. Le goût des sciences exactes et du dessin, peut-être aussi les conseils de M. de Beaupoil, l’ingénieur de l’île de Ré, beau-frère de sa sœur, Mme Du Vivier des Landes, avaient-ils influé sur sa vocation : il serait ingénieur. Pour cela, il fallait suivre des cours spéciaux, passer des examens ; enfin de compte aller à Paris. La mère jette les hauts cris. Qu’on ne lui parle point de Paris : un lieu de perdition. Certes les désordres du Régent et de sa cour, les scandales du Cardinal-ministre, les folies de l’exemple, les tripotages financiers, l’avilissement des caractères avaient bien pu effaroucher une honnête provinciale vivant de sa vie uniforme et régulière. Elle a peur, même sous le cardinal Fleury. Elle résiste donc ; lui, il attend. Elle finit par céder.
Voilà Fresneau à Paris en 1726. Il entre en pension rue Saint-Honoré, proche le Palais royal, chez Dupin-Duplessis qui lui donne des leçons de mathématiques et de dessin. Le professeur dut être content de son élève ; il lui rend ce témoignage « qu’il s’est fort appliqué pendant tout ce temps où il a fait beaucoup de progrès ; qu’il luy a conneu de l’imagination et une grande disposition pour tout ce qui concerne le génie. »
L’apprenti ingénieur suit également les cours de l’Observatoire, et le certificat de Cassini le montre « appliqué avec assiduité à l’Astronomie ; ce qui le met en état de faire avec succès dans les différents lieux où il plaira à Sa Majesté de l’envoyer, des observations astronomiques et géographiques pour être communiquées à l’Académie royale des Sciences. »
Ainsi préparé, Fresneau croit pouvoir, en mars 1728, affronter les chances de l’examen : ordre lui est donné en conséquence par le marquis d’Asfeld, le directeur général des fortifications, de se présenter devant Chevallier, membre de l’Académie des sciences, maître de mathématiques du roi, chargé de l’examen des ingénieurs. Il est reçu, et l’examinateur d’informer M. de La Ruchauderie que son fils a fait un bon emploi de son temps à Paris et qu’il l’a jugé très digne d’être porté sur l’état des ingénieurs. Il le déclare en outre « très instruit… et possédant tous les talents nécessaires… » Malgré ces attestations de haute valeur, la nomination se fait attendre. Fresneau qui connaît le prix du temps ne demeure pas oisif et il prend du service « pendant cinq ans en France avec l’approbation de ses supérieurs. » Il le note sans plus de détails. J’y vois la marque d’un esprit soucieux de se perfectionner dans les diverses parties de sa profession. Au moment d’être nommé, une maladie longue et douloureuse se jette à la traverse : il est atteint de la petite vérole.
En 1731, on le trouve encore à Paris. La prolongation de son séjour, l’absence de ses nouvelles semblent avoir mis le trouble au cœur de la mère : on s’inquiète au foyer de la famille ; on va jusqu’à suspecter la conduite du jeune homme : lettres sur lettres orageuses. Mais surgit un défenseur de la vertu outragée qui répond, et de bonne encre, aux suppositions de M. de La Ruchauderie :
« À Cramayel, ce 2 juin 1731.
On ne peut estre plus surpris, Monsieur, que je l’ay esté de voir par une lettre de vous et une de Madame votre femme, le mécontentement que vous témoignez avoir de Monsieur votre fils qui asseurément ne le mérite pas. Je n’ay jamais veu un jeune homme si sage et si réglé. Il y a trois mois qu’il est icy à une terre de Mme la marquise d’Ambres, ma nièce, pour lever un plan en relief de cette maison. La plupart du temps il est seul icy à s’occuper. C’est le garçon le plus sage que j’aye connu, et dont les mœurs sont les meilleures. Je suis prest à l’attester devant Dieu et devant toute la terre. Repentés-vous donc, Monsieur, de votre injustice. L’état où l’ont mis vos lettres, Monsieur, m’ont excité de mon propre mouvement à vous écrire pour vous désabuser. M. votre fils a mille talents. Sans le malheur qu’il a d’avoir le visage gâté, il auroit de l’employ. Je fais ce que je puis pour luy en procurer.
Je suis, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur :
LE BAILLY DE MESMES. »
Quelle chaleur de conviction, jusque dans la brusque répétition du mot : Monsieur ! Le bailli est ambassadeur et représente le très vénérable ordre de Malte. La nièce est femme du marquis d’Ambres, lieutenant général de la Haute Guyenne. Lui, est le frère, et elle, la fille du comte d’Avaux, un des quarante de l’Académie française. Dans cette aimable famille de Mesmes, la dignité des mœurs et la bienveillance, comme l’esprit et le goût des lettres, sont héréditaires.
On peut avoir confiance dans l’excellent bailli : il a promis au père de s’employer pour son fils, et il tiendra parole. Mme d’Ambres agira de son côté avec cette persévérance féminine qu’un refus ne rebute pas, qui y puise un élément d’excitation, se passionne et ne s’arrête qu’après le désir accompli. D’ailleurs le rôle de protectrice sied si bien à la femme ! Mme d’Ambres compte au nombre de ses amis, le ministre de la marine, le spirituel, l’aimable, le léger, le futile Maurepas. Auprès de lui elle entreprend sa campagne de solliciteuse, et elle parvient à enlever, le 19 août 1732, un brevet d’ingénieur à Cayenne pour son protégé. Avec quelle bonne grâce mêlée de raison et d’appréciations flatteuses, elle l’annonce à M. de La Ruchauderie !
« À Paris, ce 6 septembre 1732.
Il y a plaisir, Monsieur, à s’intéresser pour M. votre fils : c’est un fort bon sujet et qui mérite la protection de ceux qui sont en estat de luy rendre service. Il a des talents qui, à ce que j’espère, le feront réussir en quelque pays que sa destinée le conduise. J’ay été fort aise de luy procurer une partie de ce qu’il désiroit. Je ne l’oublîray pas, et j’espère faire mieux pour luy par la suite. Je souhaite de tout mon cœur qu’il se trouve bien de s’estre adressé à moy. J’ay eu le temps de le connoistre, et je ne me suis employée pour luy que bien assurée qu’on seroit content de luy. J’espère que je ne me tromperay pas dans l’opinion que j’en ay. Je seray ravie, Monsieur, que vous et luy soyés contents de moy.
Je suis très parfaitement votre très humble et très obéissante servante :
DE MESMES MARQUISE D’AMBRES. »
Au tour du bailli – deux jours après – et il n’est pas moins expressif :
« Je me suis fait un vray plaisir de rendre tous les services qui ont dépendu de moy à M. votre fils qui a du mérite et beaucoup de talents. J’en agiray de mesme dans toutes les occasions qui se présenteront lorsqu’il sera question de son avancement. Mme d’Ambres est dans les mêmes sentiments que moy. »
Le jeune ingénieur a pour mission spéciale l’étude et la construction de nouvelles fortifications à Cayenne.





























