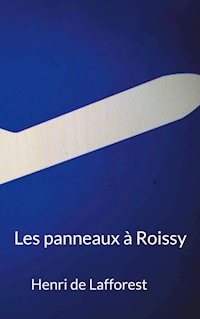Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Ah! Mais c'est toute une époque!
La nôtre en fait.
Das E-Book Les petits maîtres wird angeboten von BoD - Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
politique,société,professions,Idéaux,comportement
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Chapitre 25
Chapitre 26
Chapitre 27
Chapitre 28
Chapitre 29
Chapitre 30
Chapitre 31
Chapitre 32
Chapitre 33
Chapitre 34
Chapitre 35
Chapitre 36
Chapitre 37
Chapitre 38
Chapitre 39
Chapitre 40
Chapitre 41
Chapitre 42
Chapitre 43
Chapitre 44
Chapitre 45
Chapitre 46
Chapitre 47
Chapitre 48
Chapitre 49
Chapitre 50
Chapitre 51
Chapitre 1
DANS LES ANNEE 60, quand on arrive à Paris, il faut trouver un point de chute.
Pour ça il faut téléphoner.
Pour téléphoner il faut trouver un café, muni d’un taxiphone. On tombe en général sur un bougnat grognon qui vous jette :
- Faut consommer !
On commande un café, il vous tend sans vous regarder un jeton, la cabine est au sous sol avec les toilettes.
Vous descendez un escalier sombre et poisseux, là, derrière une porte vitrée le taxiphone.
C’est accroché au mur, une boite métallique mastoc, couleur gris vert.
Sur le côté un combiné téléphonique en bakélite noire pend au bout d’un crochet. Sur le devant un cadran rond avec des chiffres et des lettres. En dessous une espèce de petit bénitier en plastique noir pour recevoir les jetons qui n’ont pas servi.
On compose le numéro :
BOTzaris 11 22
Le petit rond transparent cliquette …
Ça y est, ça sonne.
- Allô
- Allô, c’est toi Robert ?
-
- Robert, c’est moi, Alfred, tu m’entends ?
- Allô, si vous êtes dans une cabine téléphonique, appuyez sur le bouton pour faire tomber la pièce.
Quel bouton, ah oui, il y a un gros bouton carré, Alfred appuie, le jeton tombe.
- Ça marche ?
- Salut Alfred, le métro est direct tu descends à porte d’Auteuil.
Alfred sort dans la rue, il fait déjà noir à Paris, c’est son premier jour. Il arrive de Bayonne, il a pris un train qui a roulé toute la journée, il est six heures du soir, il sort de la gare, il a vingt ans, il est étudiant, enfin il va l’être et c’est la première fois qu’il monte à Paris.
Il traîne sa valise, il va prendre le métro. Il avise une station. Il consulte longtemps le plan mystérieux dans son cadre en fer forgé style nouille, les gens le bousculent, regardent par dessus son épaule, il va mettre un quart d’heure à trouver sa destination.
Pour le premier soir, il va coucher chez un vague cousin dont les parents ont accepté, mollement, de l’héberger à son arrivée.
Ses parents sont enseignants, son père prof de maths, sa mère institutrice, ils ont deux enfants, un garçon une fille, sa mère est de santé fragile.
Dans ces années là on prend le métro avec des tickets jaunes, un préposé à casquette dans une petite guérite fait un trou avec une petite pince.
Alfred est chahuté, les compartiments sont des caisses brinquebalantes avec des sièges en bois et des portes qui claquent bruyamment en se refermant.
Pour lui tout est nouveau, bruyant, agressif. Debout contre une paroi, sa valise coincée entre les jambes il regarde défiler les murs de faïence blanche des stations.
Il ne connaît que Bayonne, jolie ville sur la Nive et l’Adour. L’été il allait en colonie de vacances à Capbreton, ou chez ses grands parents, dans les Landes. Ses copains sont restés dans les Pyrénées, mais lui était trop bon élève pour rester au pays, sa place est réservée dans un lycée à Paris, il sera khâgneux, l’agrégation, une carrière, enfin c’est la volonté de ses parents, il n’a pas eu trop le choix, il a toujours baigné dans une atmosphère studieuse.
Il est grand, brun, maigre, le poil noir et il se rase une fois par semaine. Il a le grand nez béarnais, et l’accent aussi. De ses ancêtres landais il a la vivacité, une pointe d’humour malin.
Mais quand il arrive à destination, rue d’Auteuil, il n’en mène pas large. Un grand immeuble fraîchement ravalé, avec des moulures au dessus des fenêtres, c’est au quatrième, il se bat avec un bouton doré, avec une lourde porte en fer forgé et cuivres brillants.
L’ascenseur est une petite cabine en bois qui monte dans une cage noire à clair voie.
Il sonne à la grande porte double, des pas de femme, on ouvre.
C’est sa tante, il ne l’a vue qu’une fois, à Hossegor, ils étaient en vacances, c’était il y a huit ans, il avait dix ans, elle était en maillot de bain, avec des lunettes de soleil.
- Bonsoir Alfred, entre donc, fais comme chez toi.
Elle a dit ça comme elle aurait dit le facteur est déjà passé pour le calendrier.
C’est une grande femme avec un collier de perles un ensemble tricoté couleur poil de chameau.
L’appartement est tout en longueur avec un long couloir qui semble desservir toutes les pièces, ses talons résonnent sur le parquet ciré, elle le guide vers une petite pièce en retrait au plafond en pente. On y a installé un lit, une tablette qui supporte un miroir, un meuble bas « tu pourra y mettre ta valise ». Il y a une petite fenêtre grillagée, Alfred jette un coup d’œil elle donne sur une sorte de puits avec en bas une cour mal éclairée.
- Si tu veux faire un peu de toilette, il y a une salle d’eau à côté, avec une douche. On ne va pas dîner tout de suite, ton oncle rentrera tard, il a une réunion. Rejoins nous au salon quand tu auras fini, prends ton temps.
Alfred pose sa valise, il y a des marques au sol, on a du déménager quelque chose, un meuble, un aspirateur.
Il se déshabille dans la salle d’eau, il y a une douche avec un rideau. Il se bat avec des robinets coincés, sous le chrome il y a des taches jaunes.
Rhabillé ses cheveux noirs mouillés et coiffés lui donnent un genre un peu italien.
Il tente de retrouver le chemin du salon. Guidé par une conversation il ouvre une porte, grand salon, plafond très haut, avec des moulures, larges fenêtres avec des appuis en fer forgé torsadé, parquet, tapis, meubles cossus. Dans un coin un poste de télévision, énorme, ventru.
Un garçon de son âge est vautré dans un canapé en cuir noir, blue jean, pull en mohair, c’est son cousin, Robert.
- Ça va depuis ce matin ? Les taxiphones ?
- Les taxiphones, le métro, je débarque…
- On ne va pas dîner tout de suite, Papa a une réunion, ça va finir tard, c’est les cocos.
- Les cocos ?
- Ben oui, la C.G.T. Il y a une grève à la boite.
Alfred se souvient. Son oncle dirige une grosse société. Ses parents n’ont pas pu lui dire quoi exactement, ce sont des mondes qui communiquent peu.
Une fille rentre dans la pièce, brune, menue, un petit minois caché derrière de petites lunettes rondes de nihiliste, une masse de cheveux bruns tombant sur le dos, sur les épaules, elle pourrait presque être jolie, dans le genre elfique, sans les lunettes, elle est en jean, avec un gros pull poilu.
- Tiens, voilà Joan Baez, dit le garçon
- Je t’emmerde, gros con.
Ça c’est la petite sœur, Anna, pense Alfred, elle doit avoir dans les seize, dix sept ans.
- Elle joue de la guitare, elle chante, protest song, des conneries comme ça.
La fille ne répond même pas, elle se glisse sans bruit derrière le poste de télévision, soulève une lourde tenture marron, regarde dans la rue.
- Quand est ce qu’on mange ?
Un bruit de clés à l’entrée, des pas sur le parquet, le père rentre, jette sa serviette sur un fauteuil, c’est un grand type mince, en costume sombre, sa silhouette est jeune, mais il est presque chauve et ses cheveux sont blancs. Il a l’air crevé.
La mère entre à pas pressés.
- Alors ?
- Alors rien, ça devient politique, ils veulent faire un exemple, faire monter la mayonnaise, j’ai eu le Ministère tout à l’heure. On va dîner ?
Il se tourne vers Alfred.
- Ah, c’est vrai, tu es le fils de Georges et Emma, ils vont bien ?
Son visage est gris de fatigue, il se tourne vers sa femme.
- On peut passer à table, on en parlera au dîner.
Tout le monde se lève.
Chapitre 2
LES PREMIERS JOURS D’ALFRED furent très difficiles.
Ses condisciples étaient d’une précocité et d’une vivacité d’esprit terrifiantes. Ils se renvoyaient les idées et les concepts comme des balles de tennis Ses professeurs étaient brillants, narcissiques et parfois méprisants. Certains s’appliquaient à traiter leurs élèves comme du bétail.
Il comprit plus tard que la plupart d’entre eux s’étaient réfugiés dans l’enseignement faute d’accéder aux plus hautes fonctions que leurs diplômes prestigieux auraient du leur fournir.
De par la concurrence, la politique, les mondes des affaires et des lettres s’étant refermés devant eux.
En ce temps là, les khâgneux passaient aussi les examens de la faculté, formalité triviale pour ces beaux esprits. Pour Alfred ce fut l’occasion de découvrir le quartier latin, la Sorbonne, les cafés alentour, où il n’osait pénétrer, faute d’argent.
Il connut le Luxembourg, les cinémas de la rue Cujas, le Boul’Mich, et ses libraires. Cet automne là fut beau, et les étudiantes faisaient danser leurs sages jupes plissées dans les allées du Luco.
Dans un amphi bondé, comme ils le sont pendant quinze jours à la rentrée, il retrouva son cousin Robert, qui commençait une licence.
Il était entouré de deux filles, jolies en plus, et il se frayait un chemin dans les travées surchargées.
Une odeur de fauve régnait, l’automne était encore chaud.
Alfred l’appela, il se retourna, lui fit un signe et cria dans le brouhaha :
- On se verra à la sortie.
Puis se retourna vers une des deux filles en la serrant de près. La fille se tourna vers Alfred, puis se pencha vers le cousin Robert qui lui dit à l’oreille quelque chose qui la fit rire.
Puis silence, entrée du professeur. Petit discours de bienvenue. (La moitié d’entre vous ne seront plus là dans un mois, un dixième seulement présenteront les examens à la fin de cette année etc…etc…)
Puis une profession de foi communiste. A cette époque tous les professeurs étaient communistes et, par honnêteté intellectuelle, une bien mystérieuse vertu, se faisaient un devoir d’en prévenir les étudiants.
Alfred étudia l’homme, un grand type, avec une voix creuse et puissante, lunettes, un pull en v sous une veste fatiguée, l’homme était donc communiste, c’était la première fois qu’il en voyait un.
Dans le Sud Ouest on est plus porté sur le radical socialisme, ses parents votaient à gauche, bien sûr, en tant qu’enseignants, mais un communiste, un vrai!
L’homme était brillant. Il était célèbre et respecté. On écoutait une des grandes voix intellectuelles de l’après guerre, il avait été de tout les combats et ses écrits faisaient référence.
Après une heure de silence religieux, les étudiants sortirent avec fracas pour se retrouver dans la cour carrée, le dôme de la chapelle, la statue de Victor Hugo, les pavés.
Il se heurta à Robert, toujours escortée d’une brune, jolie, qui lui lança un regard amusé.
- Salut Alfred, tu prends un pot ?
Par manque d’argent pour payer, Alfred déclina l’invitation et reprit lentement la direction du bahut voisin.
Chapitre 3
UNE VIE DE LABEUR intense commençait pour lui. Latin, grec ancien, philosophie, lettres classiques et modernes, les devoirs pleuvaient, dissertations traductions, cours magistraux. Les journées commençaient tôt, finissaient tard.
Parmi ses condisciples il y avait deux grands types.
- Les besogneux, qui ramaient, qui cachaient leur copies, parlant peu, et encore moins de leur travail.
- Et les lions, ceux dont on disait qu’ils allaient « intégrer » facilement. Intégrer c'est-à-dire franchir les portes de cette école dont on n’osait dire le nom. Ceux là entourés de disciples admiratifs et de groupies énamourées, dispensaient culture encyclopédique et discours brillant et paradoxal.
Dans cette cohorte il y avait des jeunes filles, souvent rattachées au premier type. En général elles « intégraient », plus bûcheuses et mieux organisées.
Une seule était très belle, les autres l’appelaient Bérénice, elle en avait l’allure.
Grande mince, de longs cheveux bruns, un visage très pâle, une voix de contralto un peu rauque qui faisait se retourner les gens dans la rue.
Un des professeurs lui faisait réciter du Racine, ou des choses de Baudelaire, rien que pour le plaisir d’entendre sa voix.
Cette Bérénice avait un Titus, un grand pendard à la crinière léonine, qui faisait partie de la race des seigneurs.
Titus en fait s’appelait Ivan, il était le sekh une sorte de chef de classe, prérogative convoitée quoique de peu d’effet. Ses centres d’intérêt étaient assez nombreux, littérature, cinéma, théâtre, jazz contemporain, politique aussi, qu’il dispensait largement lors des rares moments de détente dans la cour médiévale du lycée.
Chapitre 4
LA FRANCE ALORS vivait sous la figure tutélaire du Général de Gaulle, sauveur et roi légitime d’un pays un temps bouleversé par la guerre d’Algérie et ses blessures profondes.
Du haut de l’Olympe, par la voie des « étranges lucarnes » comme les impertinents appelaient la télé en noir et blanc, le Général répandait sur le pays les trésors de sa sagesse politique.
Sa voix tremblait un peu mais ses idées étaient claires, son français élégant quoiqu’un peu vieillot. Dans son petit œil rond de vieil éléphant brillait parfois un humour surprenant.
Alfred et ses condisciples ne comprenaient pas bien l’engouement qui avait porté cet homme au pouvoir.
Le rôle joué par lui dans un conflit qui avait fait de la terre un charnier pendant cinq ans, ils ne l’avaient pas vécu et ne le soupçonnaient pas. Ils n’avaient donc pas pour lui la reconnaissance de leurs aînés et le considéraient simplement comme un vieux c…
A propos de de Gaulle, Titus, enfin Ivan, criait à la dictature, il faut dire que sa culture politique devait tout à un certain nombre de courants marxistes-léninistes venus de Chine, du Vietnam ou de Cuba. Che Guevara était vivant, et son portrait ornait les chambres des jeunes filles à côté de ceux de Rudolf Noureev et Mick Jagger.
Alfred l’écoutait, dans un silence respectueux, glanant ça et là des lambeaux de culture comme on n’en trouve pas dans les manuels, tout était bon sauf le jazz qui l’ennuyait. Tous ces khâgneux étaient en train de passer à coté de ce qui était, selon lui, le plus grand apport à la culture contemporaine : le Rock & Roll.
Les Beatles, les Stones, les Who, les Kinks, Hendrix, Aretha Franklin, Elvis, Chuck Berry. La France suivait péniblement. Qui se souvient aujourd’hui de Frank Alamo ? Des Vautours ? De Nancy Holloway ?
Pendant ce temps Alfred et ses camarades sous les ordres d’un maître sadique traduisaient du Saint John Perse en latin, et, lorsqu’il était satisfait des résultats :
- Messieurs je dois dire que je n’attendais pas d’aussi bonnes choses de la part de la vile tourbe que vous êtes. Aussi j’ai une récompense pour vous. Vous allez pouvoir recommencer… En grec cette fois ! (Soupir général)
Chapitre 5
BOB DYLAN finit « Mister Tambourine Man » elle se dresse sur un coude pour relever le bras du Teppaz mettant ainsi en valeur un arrière train juvénile.
Alfred se dit que sa cousine commence à avoir des formes. Il chasse cette (mauvaise) pensée.
Elle enlève ses lunettes, secoue ses cheveux, le regarde dans les yeux.
- On est cousins…À quel degré ?
- Qu’est ce que j’en sais ?
- Ton père…
- Ce n’est pas mon père, je crois que c’est ma mère. Et toi ? C’est par ton père ou ta mère ?
- On s’en fout, non ?
Elle se tortille sur son lit pour mettre l’autre face du 45 tours.
- Tu as déjà fumé ?
- Non, personne ne fume à la maison.
Elle sourit.
- De la dope, je veux dire.
- De la dope !
Elle a seize ans à tout casser pense Alfred.
- Et tu en as fumé toi ?
- Moi non, mais Robert oui.
Pause
- J’aimerais bien savoir ce que ça fait.
- Tu as quel âge ?
- Seize ans.
Il sourit, elle regarde le plafond, excédée.
Il a été pris en pitié par sa tante, et il peut venir passer ses dimanches dans l’appartement du seizième arrondissement avec son cousin. Pour l’heure il est dans la chambre de sa cousine. Robert est sorti hier soir et se lève rarement avant midi.
Elle lui a joué « Jeux interdits » à la guitare, bousillé un air des Stones en secouant sa crinière, et, épuisée par l’effort, s’est jetée sur son lit pour mettre des disques. Il est midi, mais l’appartement est au premier étage et la chambre donne sur la cour, il fait presque nuit, une petite lampe avec un abat jour écossais donne une lumière intime, genre boite de nuit.
- J’ai faim, on va déjeuner ?
- On n’attend pas les autres ?
- Les parents ne rentrent pas, ils déjeunent avec des grosses légumes, un Ministre, un truc comme ça.
- Il déjeune souvent avec des ministres, ton père ?
Elle se lève.
- Tout le temps.
- Allez !
- C’est vrai, c’est à cause de son job, et de son école, il connaît plein de gens, mon père, dans son boulot c’est normal.
Dans la cuisine il y a un gros frigo, le genre qui fabrique des glaçons. Elle sort une bouteille de lait, du jambon, coupe du pain.
Ils s’assoient commencent à manger.
- Qui est ce qu’il connaît ton père comme ministre ?
Monique soupire.
- Je n’en sais rien, il y a Machin, et puis Truc, et Chose aussi. Il a même rencontré le Général une fois.
- Et… comment ça s’est passé ?
- Il n’était pas tout seul, c’était un groupe, de P.D.G., quoi.
- Il est comment le Général ?
- Grognon, à ce qu’il parait.
Le frère rentre dans la pièce, il est en tee shirt avec un pantalon de pyjama rayé. Cheveux emmêlés, visage blanchâtre, des boutons d’acné.
- Tu manges avec nous ?
- Pourrais rien avaler, j’ai trop picolé hier soir.
Il fourrage dans le frigo, sort une bière, décapsule.
- D’abord, rallumer la chaudière.
Il boit une gorgée, rote avec emphase.
- Ahhh ! Ça va mieux.
Il s’assoit. Monique demande ;
- C’était bien hier soir ?
- Nul, que des nazes, un orchestre pourri.
- Il y avait qui ?
- Tu connais pas, ah si tiens, il y avait Olga, ta copine.
- Olga, mais elle a quinze ans !
- Et alors ? Si ses vieux sont d’accord ?
Monique croise les bras sur sa poitrine naissante, rentre la tête dans les épaules. Son frère rigole.
- Et toi, Alfred, tu fais quoi cet aprème ?
- Je retourne au bahut.
- Bosser ? Un dimanche après midi ?
- J’ai une dissert à rendre pour demain en première heure.
Alfred sent que l’atmosphère se tend, sa cousine est furieuse il la sent au bord de l’explosion. Il se lève.
- D’ailleurs il faut qu j’y aille, merci pour le déjeuner.
Il se tourne vers sa cousine, elle a le regard fixe, Robert lui est hilare.
- Bon courage, je ne te raccompagne pas, tu connais le chemin.
Du côté de la jeune fille, pas un signe. Après un vague salut il enfile le couloir sonore. En passant, une porte ouverte, jetée sur un lit une veste noire à revers de soie. Par terre une chemise blanche froissée.
Quand il sort dans la rue il tourne la tête à droite, puis à gauche, pas un chat. On est dimanche, il fait gris, personne.
Il a dix minutes de marches pour aller au métro, en chemin il regarde les immeubles qui bordent la grande avenue, ils se ressemblent tous, en pierre grise, cossue, ça sent l’argent mais on s’ennuie. Pas un magasin, où les gens font ils leurs courses ?
Les arbres qui bordent les trottoirs sont entourés de grilles rondes en fer forgé luisantes d’humidité. Ces grilles joueront bientôt un rôle important de boucliers et de projectiles dans des événements à venir.
Une femme âgée passe, Alfred dit « Bonjour », ça se fait au Pays basque, elle s’écarte précipitamment en agrippant son sac.
Drôle de quartier !
Cet après midi là, en rentrant au lycée, Alfred eut un moment de découragement. De quelque côté qu’il se tourna il était entouré de gens importants, brillants, privilégiés, qui le toisaient. Sa cousine était la seule à vaguement l’apprécier.
Il pensa à Bayonne, à ses amis de classe, les matchs de pala, les grasses plaisanteries autour du fronton. Aujourd’hui c’était dimanche, la saison du rugby allait commencer, ils se retrouveraient aux matchs de l’Aviron Bayonnais, ou dans les vieux cafés sur les quais.
Ici les gens étaient pleins de morgue, ambitieux, trop pressés pour profiter de la vie. Dans le Sud Ouest on sait manger boire et chanter et il fait beau. Il se demanda ce qu’il foutait là.
Il rentra dans sa cellule et s’attela à sa dissertation du soir.
Philosophie. Le sujet tenait en deux mots, sur une feuille de papier :
L’Idée, l’Idéal.
Il regarda un moment la feuille, les deux mots qui le narguaient, sa tête était vide.
Puis, pour la première fois, les écailles tombèrent de ses yeux.
L’Idée, l’Idéal…. plus c’est bidon, plus c’est bon si c’est comme ça on va voir.
Et, pris d’une fureur sacrée, il écrivit comme dans une transe un texte foutraque de six pages qu’il pensait bien être son dernier puis , épuisé, il se mit au lit.
Chapitre 6
ON ETAIT EN FRANCE à la fin d’une époque de reconstruction. La guerre et ses destructions étaient presque oubliées.
Vers 1960, l'économie était engagée dans une période de croissance soutenue. On passait de la pénurie à une relative abondance, aux débuts de la consommation de masse.
Les héros de cette époque n’étaient plus les guerriers, mais les bâtisseurs, promoteurs, chefs d’entreprise, publicitaires de tout poil.
Dans les films de cette époque, Michel Piccoli ou Yves Montand sont des promoteurs immobiliers, des médecins ou bien ils exploitent une casse de bagnoles.
Georges Delambre, Monsieur Georges Delambre, père de Robert et Monique était bien dans le tableau.
Sorti dans un bon rang d’une école prestigieuse, dont les élèves portent encore aujourd’hui une petite épée au côté, il avait gravi les échelons d’une grande entreprise industrielle.
Son esprit logique et sa formation d’ingénieur lui avaient permis de maîtriser aisément la complexité de l’hydraulique, des barrages, des turbines.
Il fabriquait des ouvrages solides et efficaces, même s’ils n’étaient pas du dernier cri.
Il gagnait beaucoup d’argent, dont il ne profitait pas, son seul luxe était sa voiture, une DS 19 carrossée par Chapron le carrossier de l’élite, qu’il conduisait lui-même, alors que son statut aurait largement justifié un chauffeur avec la casquette et tout les attributs.
Sa femme et ses enfants par contre avaient découvert l’aisance et les sports d’hiver.
La famille au fil des années avait visité Val d’Isère, Courchevel ou Verbier. Les enfants avaient fait des études poussives dans des collèges ultra chics. Sa femme courait les magasins.
Il voyait peu sa famille, parcourait le monde entier. De l’Inde mystérieuse ou de la Chine insondable il ne connaissait que les aéroports, les suites dans les hôtels et les salles de réunion.
Parfois, à travers la vitre teintée d’une limousine, il voyait des gens basanés, aux dents blanches, gesticulant autour d’une échoppe en plein vent ou penchés sur le guidon d’un scooter surchargé, puis, après un vol long et épuisant, il rentrait chez lui, à Paris, la tête pleine de chiffres.
Chapitre 7
A CE MOMENT DE L’HISTOIRE, son fils Robert entre en fac, faute de mieux, dit son père. La famille habitant un quartier huppé, il fréquente une récente émanation de l’Université Française, la Faculté de Nanterre.
Créée au départ pour désengorger la Sorbonne, elle draine à la fois des étudiants venus d’un peu partout, regroupés dans les locaux de la nouvelle « cité U » et les enfants du seizième arrondissement.
La cité U avec 4 tours de 9 étages et 4 barres de cinq étages, cuisine collective au bout du couloir de 20 ou 30 chambres, 3 douches, WC et un seul téléphone au milieu, donne sur le bidonville du Pont de Rouen, on est donc très loin du quartier Latin et du décor Louis XIII de la Sorbonne.
Robert va donc découvrir les bidonvilles, la sociologie et bien d’autres choses encore.
Les situationnistes, les maoïstes, les trotskystes, Marcuse, le petit livre Rouge, la sociologie, le Viêt-Nam, le Mouvement du 22 Mars forment dans sa tête un galimatias indigeste.
Vêtu d’un pull over en shetland et chaussé de mocassins à glands, il court après les étudiantes plus ou moins bien lavées de la nouvelle fac.
Justement, une d’entre elles arrive, c’est une grande fille brune, potelée, avec de la poitrine et une grosse tresse noire qui danse dans son dos.
Elle s’appelle Mireille et, bien sûr, elle vient du midi. Elle essaye de cacher les dernières traces d’un accent provençal.
Dernière fille d’une famille de quatre, dont trois garçons, elle a quitté sa Provence, avant tout pour échapper à l’ambiance patriarcale et virile de sa maisonnée de Marseille.
Son père est communiste, travaille pour une usine de la banlieue de la ville. Il est un des caciques de l’Union locale C.G.T., à l’époque d’une C.G.T. puissante, reconnue, en partie issue de la guerre et de la résistance.
Ses frères ont donc trouvé de bonnes places, qui à la voirie, qui aux jardins publics de la ville. La famille, sans être dans l’aisance, vit bien, au soleil. L’été on passe le dimanche, invités dans les cabanons des voisins.
Mireille enfant était très myope. Pas question pour elle de jouer dans la rue, seul sport possible, nager. Elle aimait nager, son école la fit participer à de petites compétitions.
Elle fut remarquée, fut pressentie par le Cercle des Nageurs de Marseille et commença de participer à des entraînements. Vers quatorze ou quinze ans, grande, avec des épaules, elle faisait partie des espoirs locaux.
Le Cercle est une institution, à Marseille, une sorte de promontoire bétonné accroché sur une pointe rocheuse au bout d’une plage, la plage des Catalans, on y vient nager, mais aussi déjeuner face à la mer, ou jouer au bridge
Au Cercle elle rencontra un monde plus bourgeois, plus policé, elle pris des manières, du vocabulaire.
Ses études marchaient bien, ses résultats sportifs lui donnèrent de l’assurance, grâce à une bourse elle monta à Paris.
Elle fait une licence de lettres, vit dans une chambre en ville, repousse gentiment les assauts de la meute d’étudiants aux hormones en folie.
Elle est en cela aidée par sa grande taille et son allure sportive. Elle éconduit son monde avec un sourire lumineux qui fait que ses soupirants lui pardonnent tout.
On la voit de loin, elle attire le regard, elle attire la lumière, même ses condisciples femmes l’adorent, d’autant plus que, sage comme elle est, elle ne leur fait pas d’ombre.
- Salut Mireille, tu déjeunes ?
- Pas de problème, resto U ?
- Je connais un petit bistrot, il faut repartir vers Neuilly.
- Si c’est toi qui payes…
C’est un italien, avec nappe à carreaux.
- J’ai quelque chose à déclarer.
- ….
- Il n’y a aucune chance pour que je couche avec toi, je t’aime bien, on est copains, mais nous deux ça ne finira pas sous les draps. Je peux quand même commander ?
- Oui mais pour le dessert… On verra.
- Je préfère comme ça, j’aurais eu l’impression de te rouler.
- Dis donc, rigueur et honnêteté !
- Que veux tu je suis née d’un père communiste et d’une mère pieuse et catholique.
- Ça doit être schizophrénique.
- Pense tu, à Marseille un tiers des couples sont comme ça, et si tu vas en Italie, c‘est la moitié.
Les pizzas arrivent.
- C’est bizarre comme les pizzas sont rondes, ici. Là d’où je viens elles sont carrées.
- C’est la capitale, ici, c’est Paris, c’est pour ça. Et ça se trouve où les pizzas carrées ?
- A Marseille, sur le vieux port, il y a des femmes en tablier, qui se promènent avec de grandes plaques de fer comme on en met dans les fours. Sur ces plaques il y a une grande pizza, toute chaude, coupée en carrés, elles vendent ça à la criée : « Achetez ma pizza, elle est toute chaude »
- C’est vrai que tu as l’accent un peu, Vas y, attaque ou la tienne ne va pas rester chaude longtemps.
La pizza est avalée, à vingt ans on a faim. Robert se cale sur sa chaise.
- Tu veux faire quoi, toi, plus tard ?
- Je ne sais pas encore, prof, peut être.
- Et à Marseille il n’y a pas de fac, pour être prof ?
- Si, mais je nage.
- Tu nages, comment ça, tu nages ?
- En compétition, je fais les championnats de France, depuis trois ans, c’est pour ça que je suis à Paris, j’ai été « repérée » par le Racing, je fais les entraînements avec eux, ils m’ont même trouvé une piaule dans Paris, autrement je n’aurais pas pu venir, mes parents n’avaient pas les moyens.
Robert la regarde d’un œil nouveau, elle est grande, avec des épaules, c’est ça, elle nage. Elle est bien jolie.
- Et toi ? Tu veux faire quoi ?
Là il part dans une grande tirade ou arrivent en avalanche Herbert Marcuse, le Che, Mao Tse Toung, la liberté sexuelle, le mouvement du 22 mars , Daniel Cohn Bendit….
Mireille l’écoute, fascinée, avec le sentiment que son éducation commence vraiment. A Marseille on est un peu loin de tout ça. Bien sur, étant jeune et fille de militants elle a suivi des manifs.
A cinq ans elle était mignonne, elle a même eu sa photo dans La Marseillaise, perchée sur les épaules de son père.
Bien sûr c’était plutôt bon enfant, et les slogans portaient sur les salaires ou les conditions de travail. A écouter son vis-à-vis elle a l’impression d’être associée à quelque chose de large, de grand, de planétaire.
- Tu le connais, le Rouquin ?
- Dany ? Oui.
Il hésite.
- Enfin, pas bien, mais oui, par les A.G.
- Je n’y vais pas, aux A.G.
- Tu devrais, c’est là que tout se passe.
- J’ai déjà les entraînements, Oh zut, c‘est vrai, je commence à trois heures, il faut que j’y aille, je vais être en retard.
Elle se lève, rafle son sac, une chose kaki genre militaire avec des dessins au feutre bleu marine.
- Je vais te ramener.
- Pas la peine, d’ici le métro est direct, je vais à la piscine, salut, et merci pour la pizza.
Elle passe en courant la porte en verre du troquet, jeune Junon aux longues jambes, son buste à la Maillol moulé dans un vieux pull râpé.
- ET NOTRE JEUNE ELIACIN, probablement touché par la grâce, arrive pour la première fois à se hisser, rouge et suant, jusqu'à la moyenne. Bravo jeune homme qu’aviez vous donc fumé ?
Et le professeur de philo dépose majestueusement sur le pupitre d’Alfred sa copie (l’Idée, l’Idéal). Alfred sous les lazzis de ses camarades reste impassible. Il aurait pourtant bien envie de faire avaler son papier à cette vieille pourriture narcissique, dont le seul titre de gloire est d’avoir été l’éphémère chef de cabinet d’un obscur Ministre de l’enseignement, un ancien copain sûrement.
Mais le cuir s’endurcit. Il ne sait pas s’il pourra « intégrer », il se demande même s’il en a encore envie, mais il a encore beaucoup à apprendre de tout ces cuistres, il est à Paris, il observe, il enregistre.
Plus tard dans la cour il croise le regard moqueur du bel Ivan. Il fait face, les regards se croisent l’autre se détourne entraînant sa compagne. Elle a le temps d’évaluer la situation, le garçon bien découplé, les joues rouges, l’allure sportive, peu courante dans ce temple de l’esprit, puis son ami l’entraîne.
Chapitre 8
DANS LA CHAMBRE VOISINE résonne une guitare, rythme lent saccadé, des bribes de paroles lui parviennent.
KingKong, little elves On the rooftop they dance Valentino-type tangos While the make-up man's hands Shut the eyes of the dead Not to embarrass anyone.
C’est Bob Dylan, “Farewell Angelina”, son frère trouve ces paroles stupides :
« King Kong les petits elfes dansent sur le toit des tangos à la Valentino pendant que le maquilleur ferme les yeux des morts pour ne gêner personne. »
Ce que Robert ne sait pas, c’est que Dylan a beaucoup lu, beaucoup écouté, et beaucoup piqué :
- Dylan Thomas pour les paroles, poète gallois, bourré, auteur de stances hallucinées et imbitables.
- Woody Guthrie pour la musique, trois accords de guitare, un rythme binaire.
Vous ajoutez une vois nasillarde et rauque, trois allusions à la guerre du Viet Nam, vous secouez et vous avez un superbe guerrier protestataire qui va entraîner à sa suite toute une génération qui fera sa gloire et sa fortune.
Qui d’entre nous n’a pas chanté « Blowing in the wind » avec un frisson, pensant avoir ainsi fait faire un pas important à la cause de la paix ?
A côté Anna commence à avoir mal aux doigts, elle rejette la guitare sur son lit, la caisse émet un bruit sonore. Elle regarde le bout de ses doigts .A la main gauche elle a des cals, marqués d’une entaille noircie au milieu. Elle sourit, c’est le métier qui rentre.
Un ami lui a appris trois accords. Il lui a dit avec ça on peut tout faire, elle les a répétés jusqu’à ce que sa main tombe.
Elle a seize ans, elle est dans un collège pour filles. Sous la protection de la Vierge Marie, elle va passer son premier Bac avec un an d’avance. Elle porte l’uniforme, pull bleu marine, jupe plissée bleu marine, chaussettes blanches. Dans sa classe ses amies ne pensent qu’aux garçons et aux fringues, dans cet ordre. Pour l’heure elle méprise ça complètement.
Comme beaucoup de jeunes filles de bonne famille, elle a commencé jeune le piano. Elle était douée, le déchiffrage ne lui faisait pas peur, Bach, Beethoven, Scarlatti, elle aimait ça.
Son frère écoutait les radios anglaises, Radio Luxembourg, Radio Caroline, pour elle c’était du bruit. Un jour elle a entend une voix de femme très haute, très pure, elle s’est renseignée, c’était Joan Baez.
Seize ans c’est l’âge de la révolte, elle a envoyé promener le répertoire classique. L’achat d’une guitare avec la complicité d’une vieille tante a déclenché un conflit ouvert avec les parents.
Un séjour linguistique en Angleterre n’a rien arrangé, au cours duquel elle n’a sauvé sa virginité qu’au prix d’écœurantes concessions. En revanche elle y a découvert le folk song le protest song.