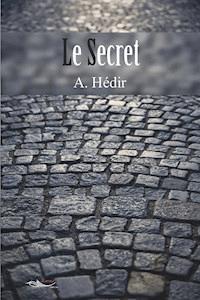Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Zarah a fini par épouser un gradé, le cruel fils d’un monarque. Ce qui déshonore Galid, amoureux déchu. Il s’engage dans l’armée de terre et, après avoir gagné ses galons, part à la recherche de Zarah. Quand la jeune femme quitte le foyer conjugal en emmenant son fils, Galid l’approche et renoue avec elle, mais Zarah s’est définitivement affranchie de son passé, elle n’est plus à prendre, et l’honneur de Galid est une fois encore mis à rude épreuve…
À PROPOS DE L'AUTEUR
Ahcène Hédir né en Algérie et vit en France depuis de nombreuses années. Il est à la fois Ingénieur de formation, chef d’entreprise et auteur de nombreux articles et critiques littéraires. Dans ce roman et les précédents, il nous révèle des vies et des destins de femmes qui de par leur passion parfois violente portent le désordre dans une société en pleine mutation.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ahcène Hédir
Les pierres des danseuses
Roman
Du même auteur
– Les Réfugiés du Cap Caxine, roman
5 Sens Editions, 2018
– Le Secret, roman
5 Sens Editions, 2017
« Ne dors point, dit la passion, avant que la justice soit vengée ; mais il faut dormir d’abord. »
Alain
Quelques jours avant son départ, en ce mois d’octobre où tombaient du ciel de grosses boules de coton, abondantes, étonnantes – car, dans cette ville où les jours sont chauds et les nuits glaciales, il ne neigeait presque jamais –, Galid avait pris la décision de confier son journal à Zarah. À demi-mot, il dit vouloir la retrouver dans un lieu symbolique, un lieu qui évoquait des souvenirs lointains, confus et flottants, de l’époque où ils étaient très jeunes.
Zarah avait d’abord hésité à revenir dans ce marché grouillant de femmes, puis elle finit par céder, « juste pour lui faire plaisir ». Elle pressentait le mystère et le drame qui entouraient le jeune homme, celui qu’elle surnommerait longtemps après « Philotimos ». Ce jour-là, ils ne s’étaient pas dit un mot, juste quelques regards plus pénibles qu’un long aveu, et un tour de passe-passe dans la discrétion la plus totale.
La jeune femme, sans manifester la moindre curiosité qui aurait tranché sur son caractère jovial, emporta le journal qu’elle garda chez elle un temps, sans jamais le parcourir. Un jour, elle le mit à l’abri avec le sien dans un coffret qui contenait aussi une croix chamarrée de motifs géométriques et une petite clé en forme de dents de lapin.
C’est après le décès de sa grand-mère que Zir le retrouva dans la maison familiale perchée sur les collines. Une coïncidence heureuse : Zir n’était pas revenu ici depuis bien longtemps…
Partie I
Cette femme est libre
1
Galid le savait à présent. Dès le lendemain de sa première comparution, à la demande du juge, Zarah était surveillée et épiée. On la guettait et on la filait nuit et jour. Des policiers en civil l’arrêtèrent plusieurs fois de suite, dans le train, dans le bus, à l’entrée de l’immeuble et même, une fois, cachés sur le palier, ils l’ont surprise, et ont fouillé son sac.
Son avocate lui avait alors suggéré de ne sortir qu’en cas de nécessité et de cesser de travailler jusqu’à la fin du procès. Des journalistes de tout bord frappaient quotidiennement à sa porte. Mais il n’y avait rien d’autre à leur dévoiler : Zarah avait tout raconté maintes fois et, maintes fois, lu la même chose dans la presse.
Quant à sa mère, elle en était certaine. Il s’agissait bien d’Aslan. La description détaillée du juge, son âge et les deux prénoms qui reprenaient le sien, celui de son père et de son grand-père, ne laissaient aucun doute.
Personne ne pouvait imaginer combien sa douleur s’était aggravée. Zarah recommençait à mutiler son corps, progressivement. Sa foi s’ébranlait. « Que l’abbé Lambert m’en excuse et que Dieu me pardonne. » Émue et au bord des larmes. Ses idées lui paraissaient en vérité tantôt claires, tantôt beaucoup trop obscures. « Je n’atteindrai guère cette mansuétude que l’abbé lui-même aurait tant espérée. »
2
Seul le chant pouvait la guérir, de ses douleurs, la prémunir de celles de sa propre mère. Elle réalisait combien cette période où elle chantait était salutaire, car pleine d’insouciance et d’exaltation. Sur scène, elle vivait, suait, et souvent même son corps frôlait la jouissance physique. Elle était bien consciente du pouvoir doux et subtil qu’elle exerçait inévitablement sur des hommes qui se croyaient indomptables.
Elle prend maintenant son fils dans les bras et elle l’embrasse.
« Tu pleures ? » se plaint-il de sa voix d’enfant.
Elle l’observe longuement et se rend compte combien Zir a grandi.
« Dieu sait si je dormirai cette nuit à la maison », dit-elle à son fils, quand sa mère s’interpose : « Ne dis jamais pareilles sottises ! »
Zarah réfléchit en gardant l’œil fixé sur le front de Zir :
« Occupe-toi de ta grand-mère… »
Après avoir embrassé son fils une dernière fois, Zarah se dirigea droit vers sa chambre pour s’habiller. Elle ferma la porte derrière elle et fondit en larmes. Des larmes de peur, à laquelle s’ajoutait une forme de désespoir, actif et malicieux. Elle avait peur pour Zir, pour sa mère, et peur aussi pour elle. « Mon courage me lâche brutalement », pensa-t-elle, puis, l’instant d’après, une minute, pas plus, les larmes cessèrent brusquement. Et une idée étrange tentait de remonter en surface, on aurait dit une mauvaise herbe qui tente de percer la croûte d’une terre aride et, pour cela, cherche la faille, là où elle pourrait se révéler pour exister. Zarah monta sur une chaise pour accéder au sommet de l’armoire. En tâtonnant légèrement, elle attrapa la sacoche qui contenait le pistolet. Dure et froide comme un bloc de glace. Elle l’empoigna et descendit de la chaise tout excitée. Son cœur s’enflammait, son corps tendu une minute auparavant se relâcha et sa respiration devint bizarrement silencieuse et régulière. La sacoche était vide. Galid a-t-il eu raison de l’emporter ? pensa-t-elle avec frénésie. À présent, la sacoche noire se trouvait couchée dans ses deux mains. Elles s’y accommodaient aisément mais la sacoche noire et brillante lui semblait beaucoup plus légère que l’autre fois où Galid l’avait mise pleine entre ses mains, énorme et lourde. Elle se rappela encore les propos de Galid au sujet des soldats poltrons.
« Et comme ils sont nombreux, lui avait-il confié, ceux qui se sentent forts et puissants, à peine ont-ils empoigné cet engin. »
Elle frissonna en pensant au moment où il l’avait réprimandée, lorsqu’elle avait dirigé le pistolet vers lui qui restait debout à la regarder, fascinée et surprise. Elle n’avait pas eu le temps de comprendre qu’il l’avait déjà empoignée par-derrière, immobilisant sa main sur le pistolet.
« On ne joue jamais avec une arme, dit-il l’air agacé et la mine crispée, sait-on jamais ! Il suffit d’ôter la sécurité, d’un simple clic enfantin, pour que ce morceau de fer a priori inoffensif devienne, le temps d’une inconscience ou d’une brève folie, une ignoble créature. Il se trouve à présent, dans le ventre de ce petit monstre, trois petites balles qui patientent en attendant qu’on les titille, qu’on les provoque, et hop ! elles partent, l’une derrière l’autre, d’un bruit sourd, pour aller chercher la mort… »
Zarah empoigna tristement la sacoche et son corps se redressa un peu plus. Elle avait tout à coup grandi de quelques centimètres. Rien en elle n’était femme. Tout en elle se raidissait, dur et impénétrable. Ses yeux s’écarquillaient et ses bras semblaient s’allonger. Elle remit la sacoche à l’endroit où elle l’avait prise, s’habilla légèrement, un peu de rouge, beaucoup de noir, et s’empressa d’aller au tribunal.
« C’est pénible, ce sentiment de mauvais augure. Ne plus revoir mon fils. » Cette idée pénétrait profondément dans ses entrailles en affectant son âme d’une violence sans précédent.
3
Journal de Zarah
C’est aujourd’hui le jour de ma deuxième comparution. J’ai reçu la convocation hier tard au soir, au moment où j’allais souper…
L’abbé Lambert m’a dépêché une émissaire pour me prévenir que la prochaine comparution serait encore plus pénible, mais il dit prier pour moi. Il m’exhorte au courage et me somme de garder la foi. Moi-même, me transmet-il, qui suis ici depuis plus de quatre décennies, je me trouve dans l’obligation de partir. Ma carte de résident n’est pas en bonne voie d’être renouvelée. Et il ajoute : Un prêtre du diocèse a été condamné à un an de prison pour avoir prié hors d’un lieu de culte.
C’est une petite femme frêle, gracieuse et vive qui m’apporte le message. Ses gestes et ses paroles pleines d’onction m’emplissent de grâce, de piété et de douceur. Elle répète inlassablement qu’en tant que chrétienne, un danger de mort me guette : certains groupes proches de radicaux religieux menacent tous les chrétiens. Allez ailleurs, me conseille-t-elle, partez ! Partez du pays pendant qu’il est encore temps… Elle promet de me procurer assez rapidement un passeport et un visa…
4
Ce matin-là, le ciel était gris, il pleuvait des cordes, la mer s’agitait comme jamais et, au loin, l’écume cachait l’horizon sous le bruit de la houle qui s’abattait sur les digues. La brume s’élevait à chaque fois un peu plus, à vouloir décrocher le ciel.
Arrivée au tribunal, Zarah se fraya difficilement un chemin parmi la foule des curieux et des journalistes. Certains lui posaient des questions de tout ordre, pendant que d’autres décochaient coup après coup des flashs déroutants. Son état était au-delà de toute description. Imaginez une feuille mi-jaune, mi-verte, qui réalise, impuissante, que le printemps est fermé et qu’indubitablement, c’est la terre qui va la ramasser. Mais avant de jaunir absolument, elle a un compte à régler avec la bise qui l’a éventée, la pluie qui l’a durcie et le soleil qui l’a abandonnée.
Son avocate l’attendait à l’intérieur du tribunal. Elle lui fit signe d’avancer. Un policier accourut, la somma de s’arrêter et commença à la fouiller. Son courage s’ébranla, elle se laissa faire, sereine et calme. Lorsque le policier tenta le bas-ventre, elle hurla de toutes ses forces :
« Tu n’as pas honte ? »
L’homme retira sa main d’un geste brusque, en tournant la tête dans tous les sens. L’air confus et embarrassé, il se rangea de côté en lui cédant le passage.
« Tu es en retard, observa son avocate. Mais rien de grave, on fait comme la dernière fois. » Elle lui demanda de suite si elle avait pris des renseignements sur le juge.
« Oui. »
Et le visage de l’avocate s’éclaira. Elle l’écouta attentivement puis réclama des précisions sur sa mère, son père, son départ du village ; elle l’interrogeait calmement, dans un chuchotement qui ne déplaisait guère à Zarah, car elle le trouvait apaisant. Alors, elle lui dit en un murmure obscur :
« Mon frère a été tué…
– Tué ? s’exclama l’avocate d’un air abasourdi.
– Il y a très longtemps…
– Par qui ? »
L’avocate lui murmurait à l’oreille en guettant l’œil vif de l’avocat général, un homme à la physionomie pouparde.
« Le père du juge… »
À cet instant, l’avocate avança brusquement sa chaise en émettant un bruit pénible et son visage fut traversé d’une tempête glaciale. Elle n’adressa plus la parole à sa cliente jusqu’à ce qu’Aslan fasse son apparition. Elle lui conseilla alors de ne pas parler de cela aujourd’hui. Zarah opina du chef.
Le juge réitéra les questions de la première comparution. Il ne changea pas une virgule ; Zarah se déconcentra un instant et perdit le fil de la discussion, jusqu’au moment où son avocate tenta de protester et où le juge la désavoua avec autorité. Il assurait être en possession d’éléments nouveaux. Et lorsqu’elle demanda lesquels, il répondit que l’accusée avait été prise en possession de documents compromettants, des gens affirmaient l’avoir vue les distribuer. L’avocate exigea des précisions sur la nature des documents et le juge, à son habitude, répliqua en arborant un sourire sarcastique :
« Des bibles et des évangiles. »
Il promenait un regard diffus sur la salle.
« Avions-nous besoin de cela, alors que notre livre sacré est partout ? ajouta-t-il avant de jeter sur l’accusée un regard noir, furieux.
– Des témoins ? interrogea l’avocate.
– Oui ! »
Et quand l’avocate insista, le juge dit avoir enregistré des dépositions. Il répondait paresseusement, puis il ajouta avec plus de conviction :
« S’il y a lieu, nous les convoquerons à la barre. »
Pendant que son avocate et l’avocat général se relayaient à tour de rôle en s’adressant au public et aux membres du jury, le corps de Zarah la brûlait. Elle suait de partout, son cœur ne se sentait plus en mesure de battre calmement et sa raison devenait de moins en moins cohérente. Des lumières du tribunal, elle ne percevait plus rien d’autre que de légers faisceaux disparates et évanescents…
5
Journal de Galid
Je suis le dernier de ceux qui diront que tout ceci nous convient et le premier parmi ceux qui diront que rien n’est normal. Alors nous commencerons à bâtir et nous vaincrons la paresse et la misère. Ça va changer !
6
De fil en aiguille, Youna, l’air quasi flegmatique, racontait au juge, comme elle y avait été conviée. Et cette dame madrée et hardie se demandait si le vieillard abêti n’avait pas quelque délit à se reprocher.
Après des mois de répétitions, disait-elle, Zarah avait été engagée comme chanteuse de cabaret. Elle est douée, cette fille. Personne ne peut l’ignorer.
L’endroit s’appelle Laroussa. Il se trouve isolé à la sortie de la ville, et c’est là aussi que travaille Didi, son amie d’enfance. C’est elle qui me l’a présentée, affirme Youna en regardant le juge dans les yeux, comme si elle le reconnaissait ou même qu’elle le menaçait.
Un village dans un village, dit-elle, il a été construit à la hâte en dehors du monde. Ici, seules quelques rares maisons possèdent une porte, et certaines d’entre elles affichent un écriteau griffonné à la peinture blanche : « Maison Honnête ». C’est la seule distinction qui puisse les différencier de toutes ces petites maisonnettes mi-closes, éparpillées dans un village bordélique. Les autres ne protègent parfois leur intimité que d’un simple rideau. Vous n’avez qu’à l’écarter d’un geste pour accéder à une entrée exiguë dont l’odeur putride vous coupe le souffle. Parfois, le père, la mère et tous les enfants vivent là. Celle qui offre son corps vous aborde dès l’entrée, souvent assise sur un tabouret, dans une tenue légère exhibant généreusement et ostensiblement ses meilleurs attraits. Elle ne se lève même pas ; elle attend votre regard, flaire vos battements de cœur avant de vous indiquer soit la sortie, si elle pressent que vous la rejetez, soit la chambrette où elle vous exhibera le reste de son corps, si elle s’aperçoit que vous êtes fixé comme un arbre. Youna prenait un plaisir visible et obsédant à raconter ce lieu alors que le juge levait parfois le bras pour protester.
« Les soldats qui viennent, les plus nombreux de tous les habitués, disent être au « Left’Vilej ». Ce qui signifie le village aux navets. Vous le savez, n’est-ce pas ? » Le juge ne dit rien. La foule ronflait et le soleil rossait les vitres. Des mouches pivotaient, virevoltaient et renvoyaient un bruit sourd d’accusées.
« Les clients grouillent, fouillent, passent parfois rapidement et d’autres fois s’attardent et demandent le coût d’une passe.
Laroussa est un cabaret chic. Les lumières sont tamisées, les fauteuils confortables et les boissons coulent à flots. Ici viennent les plus fortunés de tous les clients pour terminer leur soirée après s’être épuisés d’errances et d’amours. La nuit appartient à tous ces hommes parfumés. Certains possèdent des parts de gain sucées dans le sang de ces filles abandonnées par un père ou un frère à l’honneur bafoué. Non loin d’ici, ces hommes de l’ombre ont blanchi leur argent dans des commerces de bijoux, de tissus et autres frous-frous. Ne sait-on jamais, si un jour le vent soufflait dans l’autre sens !
Mais Laroussa doit son nom à cette danse si populaire qu’on vient de très loin pour la voir au moins une fois. La chorégraphie est simple. Un couple de jeunes danseurs, la fille habillée en blanc et l’homme en noir, danse sur un rythme de plus en plus endiablé pour évoquer la nuit de noces. Cela dure une bonne heure, ensuite arrive le chant, c’est au tour de Zarah. Au début, certains spectateurs partaient avant la fin, mais, avec le temps, plus personne n’est sorti avant qu’elle finisse de saluer une fois, puis une seconde fois, revenant de derrière le rideau vers cette salle où des regards avides s’impatientent. Le chant se termine toujours par le même couplet, bien que les larmes de Zarah ne soient plus aussi abondantes qu’à ses débuts… Je vous l’ai dit, elle est douée, cette fille…
C’est une Callas, dit haut et fort Youna. La voix du siècle. Elle aurait été la « Bible de l’opéra », la nôtre, vivre à New-York, pourquoi pas, et mourir à Paris sans doute, si elle n’avait manqué d’une mère et aussi d’un père, et si par circonstances elle avait croisé des artistes comme en avait connu la diva : des Giulietta Simionato, des Giuseppe Di Stefano, des Mario del Monaco, des Boris Christoff… Et on entendait mûrir des applaudissements éparses et continus qui obligèrent Youna à s’interrompre, ce qui donna l’occasion au juge d’étouffer la voix de cette femme décidée à le désavouer et plaider la liberté et la justice. »
7
Journal de Zarah
Chaque soir, pour venir chanter, je prends le train puis un bus nommé « Rue Ambulance ». Il doit ce nom à l’ancienne époque. Celle où le Phénix Hôtel recevait les soldats blancs de la légion accompagnés de belles jeunes femmes indigènes. On raconte que ces filles de joie désignaient les jeunes soldats du nom de « navets ». Allez savoir le rapport !
Le trajet dure une bonne heure. Pour passer inaperçue, je me voile complètement et passe, aux yeux du commun des mortels, pour une femme pieuse.
Ce n’est qu’en arrivant à Laroussa que je me découvre dans une chambrette située tout en haut du bâtiment. Je m’habille souvent d’une robe de moire bleue ornée d’un joli col en guipure fait main. Je me maquille et prie les yeux fermés avant de rejoindre la scène.
Ainsi passent mes jours : le matin, je m’occupe de mon fils, le promenant un peu plus à mesure qu’il en ressent le besoin en grandissant, je déjeune ensuite avec lui et, le soir, une dame d’une autre époque, âgée d’une cinquantaine ou d’une soixantaine d’années, bien éduquée et plutôt moderne, qui parle convenablement deux langues étrangères, le français et l’espagnol, vient le garder jusqu’au lendemain matin. Zir est entré à l’école ce mois de septembre. Je l’ai inscrit en pension et je ne le revois qu’en fin de semaine. Toujours excitée à l’idée de le retrouver sur le perron à m’attendre avec des yeux pleins de bonheur. Zir est un garçon débordant d’énergie. Curieux et insatiable.
8
Journal de Zarah
C’est la première fois que trois policiers en civil me hèlent et, comme j’ai pressé le pas, ils m’ont traitée de mécréante, puis j’ai couru aussi vite que je le pouvais : je voyais bien que les trois hommes me poursuivaient sans l’intention de me rattraper.
Et cette nuit, nous avons dormi ensemble, dans le même lit avec Zir ; maman l’a souhaité. Depuis qu’elle est tombée malade, c’est la seule nuit, le seul moment où nous étions, maman et moi, toutes les deux ensemble, en phase et sans doute guéries.
Ce matin, je me réveille et, dans ma tête, une seule image : la koubba. Une seule idée : aller la revisiter. La koubba me hante, m’appelle. Je ne résisterai pas longtemps à cet appel. C’est une question de jours…
Et cette nuit à Laroussa, je chante, je pleure.
Mes larmes retrouvent leur source et leur lit, comme elles les avaient laissés, un peu moins creux, peut-être.
Mettez-y de la musique, disait ma tante, et vos histoires seront moins tristes.
9
Et de la musique, il y en avait cette nuit-là. Y compris le timbre chaud et plein d’une mandoline qui berçait ses souvenirs.
Il y avait aussi du monde ce jour-là, beaucoup de lumière et presque pas de chuchotements. Dans le fond, un regard fascinant ; il guettait et observait. L’homme applaudissait si bruyamment et si ostensiblement qu’il se faisait remarquer. Mais comme il était assis, on ne pouvait distinguer que ses larges épaules et ses cheveux courts.
Pendant que la salle se désemplissait, Zarah rejoignait sa chambre. Et, de la petite fenêtre voûtée, elle jeta au loin, hissée sur la pointe des pieds, un regard tendre et affectueux sur la ville qui dormait. La nuit sauve les apparences. Dans le ciel, bien loin de tous, une seule étoile brillait au coup par coup.
« Zarah ! » susurrait Youna derrière la porte.
Elle entra.
« Quelqu’un veut te voir. »
Elle le lui annonça avec un léger sourire. « Il est resté collé à sa chaise depuis que tu as fini. »
Zarah la regardait en silence, la tête suspendue à cette étoile qui lui donnait un air rêveur, mais dans le même temps surprise et alertée, car Youna refusait à quiconque de l’approcher avant ou après le spectacle.
« Il a l’air décidé, insista-t-elle. Je n’ai pas pu résister. »
Youna sortie, l’homme apparut. La mine visiblement fatiguée, le regard grave tempéré par l’irrésistible sourire qu’il arborait. Zarah le reconnut sur-le-champ. C’était Galid. Il resta muet, sans un mot. Et quand il finit par parler, il dit avoir trouvé sa voix superbe et ses émotions authentiques, et que cela l’avait vraiment bouleversé. Zarah le regardait avec surprise et étonnement. Puis après un temps, il ajouta qu’il avait assisté au spectacle plusieurs fois
« J’ai longtemps hésité à venir te voir », lui avoua-t-il debout, tel un groupie face à son idole.
« À ses yeux, j’ai l’air d’une prima donna, se dit Zarah, je n’ai jamais eu d’aussi hautes prétentions. » Elle montrait cependant une froideur voulue, accentuée, qui ne découragea aucunement cet homme prêt à tout affronter. La jeune femme recherchait de la douceur dans le regard du jeune homme qu’elle avait connu vierge, elle insistait, mais tout cela avait laissé place à de larges rides contenues dans un visage aux muscles tordus comme ceux d’un sportif de haut niveau, et à un regard si brûlant que Zarah baissa les yeux au bout de quelques secondes…
L’homme l’observait. Attendait ses premiers mots. Il la voyait de plus près pour la première fois depuis si longtemps. « Dieu, ce qu’elle a changé ! » Il lui trouvait l’air endormi de quelqu’un qui sortirait brutalement d’un sommeil profond. Disposé à lui dire encore une fois qu’il l’aimait, mais il n’oserait plus, même écrit sur du papier comme il le faisait autrefois. Des silences s’ensuivirent et des regards perdus dans les souvenirs d’un passé lointain.
C’est ainsi que furent les retrouvailles. Sans grande émotion, sans surprise. Galid ne cachait pas néanmoins son désir de montrer maintenant à cette femme « qu’il la méritait, qu’il la voulait » et qu’il ferait encore plus pour qu’elle puisse l’aimer. Toutes ces rides qui avaient façonné son visage, dans le froid le plus insupportable des hivers glacés et les étés chauds de toutes les villes sahariennes où il avait séjourné pour mériter ses galons. Toutes les bassesses, toutes les humiliations qu’un homme décidé pouvait supporter. Il s’était engagé dans l’armée et il n’était pas conscient à cet instant de toutes les routes qu’il faudrait parcourir, des montagnes qu’il faudrait escalader et du temps qu’il faudrait pour arracher étoile par étoile. Aujourd’hui, il en avait trois.
Dans l’esprit de Zarah couraient des excuses, une volonté de demander pardon, mais elle se ravisa. Subjuguée par l’allure de cet homme, sa force, elle se sentait déjà rassurée d’être à ses côtés, bien qu’à cet instant elle n’imaginât pas à quel point il pouvait être encore amoureux, au point de vouloir réparer les erreurs du passé et se montrer enfin capable de la protéger…
Pour Zarah, Galid ne pouvait être que l’homme providentiel. Tombé du ciel, ou d’on ne savait d’où, mais c’était bien Galid en chair et en os. L’espoir renaissait dans l’esprit de la jeune femme, si prompte à croire que tout dans sa vie n’était qu’échec et désespoir.
L’apparition inattendue de cet homme fort, viril et décidé, rendait tout possible, et elle commença à rêver d’un nouvel amour. Un amour qui serait une attraction transcendée en générosité et en don de soi. Et elle était prête, prête à affronter tous les dangers pour être à la hauteur, combattante, ne plus apparaitre aux yeux de Galid comme une lâche, être enfin digne des attentes de cet homme qui l’aimait encore plus qu’avant. Zarah espérait d’elle comme de lui, toute la noblesse du sentiment qui leur avait manqué.
Et en cette période où le monde entier l’acculait, la justice, les souvenirs, les remords, Zarah était aussi persuadée que son jeune frère n’était pas mort en chutant dans un ravin, mais jeté volontairement de la falaise par la volonté morbide d’un tueur…
10
Galid se mit immédiatement au service de la jeune femme. Chaque soir, après avoir rassemblé ses troupes, les avoir comptées, saluées puis fait se disperser, il se préparait à sortir. Il revêtait son costume et courait presque pour la rejoindre. Il s’échafaudait entre eux une relation qui cherchait dans leurs souvenirs le geste, le mot, l’événement ou tout autre correctif tel que l’eau de l’amour puisse retrouver son lit. Le week-end, Galid rentrait chez lui pour s’occuper de son enfant qui n’était en fait que le fils de sa propre sœur. Il n’y avait eu ni contrat ni décision de justice. Dès qu’il avait atteint l’âge de six ans, ses parents, d’un commun accord et sans avoir touché le moindre sou de dédommagement, l’avaient confié au couple pour le mettre entre « de bonnes mains ». Son avenir, disait-on, était assuré. Car un enfant de militaire ne pouvait mourir de faim, ni dormir dehors, quitte à blinder davantage les chars, à provoquer un génocide ou à laisser s’il le fallait tout un peuple dans l’incertitude et la misère.
On savait au village que c’était Galid qui était stérile et non pas son épouse ; dans le cas contraire, il aurait répudié cette jolie femme rousse qui aurait bien pu enfanter, belle, grande et charpentée, d’un caractère docile et joyeux : elle aurait pu donner vie à une belle et forte progéniture.
Cette situation arrangeait tout le monde : la femme entretenue qui n’avait rien à envier à une princesse, le militaire dévoué et content de sa vie de caserne, les géniteurs qui voyaient grandir leur fils dans la soie et les dorures, et tout le village qui se félicitait d’avoir évité à la jolie villageoise une vie pénible de femme divorcée, triste, sous les verrous de ses propres parents.
11
Galid gardait le bras levé vers un ciel orné d’une lune flottante. L’arme à la main gauche. Des galons brillaient sur ses épaules larges. Et la nuit était bien avancée. « Ces monarques indus et profondément iniques, confiait-il à Zarah, se sont accaparés le pouvoir par la ruse. Des armes comme celle-ci, fit-il en levant le plus haut possible le pistolet automatique, et des grades comme ceux-ci, ajouta-t-il en palpant une à une de l’index ses trois étoiles qui scintillaient d’or. Ces monarques dénigrent, décrient, paraissent. Ils se protègent. Un masque en couvre un second et on ne les reconnaît que dans leur folie. Et au vu du petit peuple, ils poussent dans le monde leurs enfants maladroits et ingénus, ne sachant jamais ce qu’est un peuple ni ce qu’est une vraie nation, leur emplissant les poches à défaut de la cervelle… »
Galid, à aucun moment de sa vie, n’avait été subjugué par les armes ; on aurait même cru le contraire, car ce jeune homme avait toujours haï les uniformes, la poudre et les décorations. « J’ignorais pourtant combien j’étais façonné et plus encore dressé pour une vie de militaire », pensait-il. Obéissant, rugueux, élevé par un homme de caractère, protégé par une femme soumise, au fond, il se sentait apte à reproduire sans remords toutes les imbécillités, les affres, les humiliations qu’on exige d’un militaire comme on en connaissait dans ce pays, et souvent d’un gradé sur son subalterne. « Il était admis, dira Galid, dans cette optique militaire, que de haut en bas, chaque gradé pisse sur son subalterne qui en faisait autant jusqu’au simple soldat qui, diable, pissait, pissait encore sur lui-même. Sans être aussi pisseux que ces généraux ! Si tous ces nantis, nés dans la soie, gardent les avantages que nous perdons, c’est qu’ils n’ont jamais connu la faim et la rue. Toujours un gîte et toujours une pitance. »
12
Journal de Galid
J’ai revu ce soir la femme que j’ai aimée et il ne m’en fallait pas plus pour être heureux. J’en veux à tout ce peuple, y compris à nous deux. Mais à quoi bon fustiger cette foule ? Cet amas d’individus où chacun pense agir librement alors que, dans toute action qu’il entame, apparait plutôt l’instinct du troupeau dirigé et non pas celui de l’individu qui décide. C’est bien là le souci car, avec cette façon de se sentir libre, apparaissent les remords et bien plus, la mauvaise conscience. Je hais ce peuple comme jamais, et Dieu sait que j’en fais partie.
13
Zarah attendait Galid et elle était préoccupée de voir partir le train. Ce soir, tout lui semblait étrange. La gare, les voyageurs, l’air et l’ambiance, tout paraissait sur le point d’exploser, de dérailler. D’abord ce train, immobilisé sur le Quai ; il aurait dû avoir quitté la gare depuis une heure. Ces gens qui y montaient, en descendaient puis y remontaient : dans leurs gestes et dans leurs regards, l’agacement était palpable. Personne ne savait si le train finirait par quitter le quai. Et aussi cette fraîcheur qui commençait à tomber subitement : de petites gouttes d’air timides bousculaient la tension brûlante déversée par un temps habituellement sec et oppressant.
Un autre train se rangea sur le quai. Il répandit d’un trait une foule de jeunes gens, des étudiants pour la plupart. Ils se bousculaient, se pressaient, mais leurs mouvements se résumaient en des va-et-vient incessants…
Quelqu’un poussa la porte vitrée.
Zarah sursauta. Un homme entra, il était grand, brun et mince, la bouche large, fine. C’était Galid. Il dit bonjour et s’assit sur la banquette d’en face en se décalant légèrement sur le côté pour pouvoir allonger les jambes.
Un silence s’interposa et, dans cette ambiance paisible, Zarah pensa qu’il ne lui reparlerait plus. Puis l’homme fouilla dans sa poche, en retira un paquet de cigarettes et lui demanda s’il pouvait fumer, elle répondit oui, cela ne me gêne pas, alors il ouvrit légèrement la fenêtre, alluma sa cigarette et resta ainsi longtemps, l’œil rivé dehors. Un instant après, il lui demanda si elle comprenait ce qui se passait.
Zarah se retourna légèrement.
« Un putsch ! »
Il la regarda, sourit.
« Il y a votre croix… » lui dit-il, le doigt pointé vers son cou.
En y posant la main, nerveusement, Zarah tâta la croix du bout des doigts. Dans la précipitation, l’habitude, elle avait oublié de la recouvrir de son voile. Elle la rangea alors délicatement, avec un léger sourire. L’homme tira sur sa cigarette au filtre jaune, souffla une fumée grisâtre qui ondulait en se précipitant vers l’extérieur.
« Cela vous évitera des malentendus. »
Il la regardait droit dans les yeux.
« Les voilà qui arrivent », ajouta-t-il alors que deux soldats pénétraient dans le wagon en claquant la porte. L’un d’eux, le moins excité, se positionna immédiatement sur le côté. L’autre s’approcha et, d’un air hautain, se dirigea vers Zarah et l’exhorta à lui présenter ses papiers. Elle lui tendit sa pièce d’identité qu’il arracha d’un mouvement brusque, bestial. Sans attendre, il la tendit à son compère qui la dévisagea comme un aveugle et finit par lui chuchoter à l’oreille. Il revint vers elle et lui demanda son livret de famille. Comme elle prenait son temps pour fouiller dans son sac, les soldats la pressèrent.
À ce moment, Galid, resté jusque-là impassible, se leva d’un bond. Leur jetant un regard furieux, il s’adressa aux deux soldats qui s’agitaient :
« Patientez ! »
Il les fixait du regard.
« Vous voyez bien que la dame fouille dans son sac ! »
L’un des soldats recula suffisamment pour se positionner hors du champ de vision de Galid. L’autre vint récupérer les papiers en lorgnant la femme et l’homme avant de se retirer prudemment. Le soldat tenait fermement les papiers, les scrutait sans vraiment lire quoi que ce soit ; il semblait embêté ou contrarié. Galid se retourna vers lui.
« Alors caporal, tu ne sais pas lire ? » demanda-t-il d’un ton ferme. Il regarda Zarah et lui sourit.
Le visage du soldat surpris par cette moquerie se crispa et se tendit comme un mauvais ressort. Son front se rétrécit et ses joues s’assombrirent. Il semblait être pris dans un piège. Il revint jeter les papiers sur les genoux de Zarah. Galid présenta alors au soldat le plus proche une carte couleur kaki qu’il tendit à son tour au caporal.
Ce dernier la récupéra précipitamment, se retira d’un mouvement brusque bien que hiératique et se mit instantanément au garde-à-vous.
« Mes respects, mon capitaine ! » balbutiaient les deux soldats l’un après l’autre, visiblement terrifiés.
Tous deux, l’air abattu, se retournèrent ensuite vers Zarah.
« Excusez-nous, Madame ! » dit l’un d’eux d’un ton contrarié. « Partons ! » marmonna l’autre.
« Allez ! Allez, circulez ! » leur cria Galid.
Il allongeait les bras pour les chasser.
Les soldats, pétrifiés, n’osaient pas bouger, et, pour les convaincre de disparaître, Galid leur lança en se levant :
« Vous attendez quoi ? Un billet d’écrou ! ? »
Sans demander leur reste, les deux soldats ouvrirent frénétiquement la porte et se jetèrent sur le quai pour s’enfuir. Zarah resta sans un mot devant l’autorité et le courage du jeune homme. Debout avec un air d’invincibilité, il continuait de regarder par la vitre.
Partout, dès leur sortie du train, des étudiants étaient accostés par des militaires qui les plaquaient brutalement contre les murs. Certains se faisaient bousculer, d’autres franchement battre à l’aide de grandes matraques, et d’autres enfin étaient extraits de la foule et conduits derrière le quai, là où les attendait un autre groupe de soldats.
Galid s’avança pour coller son visage à la vitre, et observa un jeune étudiant qui se couvrait la tête de son cartable pour parer les coups de matraque.
« Vous avez raison, dit enfin Galid en s’installant, la mine sérieuse. Il se passe quelque chose de grave.
– Vous pensez à quoi ?
– Un coup d’État, un soulèvement populaire, ou… »
Il se tut et scruta les alentours avant d’ajouter :
« À moins que le président soit mort !
– Le pensez-vous vraiment ? demanda Zarah toute confuse.
– Moi, répondit Galid fièrement, je rêve de révolution, mais peut-être que cela n’est plus possible ; le peuple n’a ni l’envie ni le courage… »
Le train démarra dans un brusque sursaut. Galid se tut ; le bruit des rames glissant sur les rails l’empêchait de finir sa phrase. Il resta longtemps à observer Zarah en se demandant pourquoi une femme voilée portait une croix au cou. Mais son regard doux se faisait discret. Une heure de trajet. Le train s’immobilisa, Galid se chargea des deux sacs de Zarah, l’aida à descendre. Un peu plus loin, il lui rendit les sacs. Dans ses yeux se trahissait une envie silencieuse, une raison inconnue l’empêchait de s’exprimer.
Alors qu’il s’éloignait, sa voix tournait encore dans la tête de la jeune femme. « Galid a bien changé, pensait-elle, je n’ai aucun souvenir d’une voix pareille, d’une telle autorité… » Elle resta à l’observer discrètement. Ses pas, cadencés et précis, le lançaient en avant comme s’il partait au combat, et ses longs bras se balançaient au rythme d’un pendule harmonieux.
14
« Il est arrivé depuis longtemps », se dit Zarah en retrouvant Galid pensif. Mais cela ne semblait pas déranger la jeune femme. Tout près, des gens attendaient, nombreux, tous la même personne sans doute. À l’instant, celle que tout le monde guettait arriva. Une jeune fille habillée sobrement. Un foulard jaune serrait fort des cheveux noirs et abondants. Elle se présenta, les pria de la suivre. Une foule se forma assez rapidement et s’apprêtait à escalader le mont Murdjadjo en empruntant un chemin parsemé d’agaves. Le guide expliquait en se retournant que ces agaves étaient prêts à fleurir pour la première et la dernière fois avant de mourir.
« C’est pour cette raison, confia-elle, qu’elle jette ses graines tout autour pour renaître à nouveau. »
Ils arrivèrent quelques efforts plus tard. Le sommet du mont offrait à la vue un port maritime de moindre effervescence, séparé de la houle par un serpent bétonné qui se brisait au centre en formant un W bien étrange. La ville, quant à elle, somnolait lourdement sous un soleil de plomb.
Située tout en haut du mont, érigée en pierre et semblable à un nid de vautour, bien plus étrange encore que la digue bardant l’avant-port, il y avait l’église Santa-Cruz.
Galid laissa entrer Zarah au moment où les cloches sonnaient. À l’intérieur, seule dans un coin, elle sembla tout à coup apaisée. Comme après une longue absence, vous rentrez chez vous et vous découvrez ce plaisir et ce goût de retrouvailles. « Moi qui longtemps me suis posé la question de savoir où est Dieu, je le découvre, amour, sérénité, comme si ma croix trouvait sa voie et sa raison d’exister. »
Au loin, on entendait l’explosion miraculeuse de la mer. Un éclat d’effluve dans le cœur de cette jeune femme qui entrait pour la première fois dans une église. « Voilà enfin la personne qui jamais ne me décevra. »
La rencontre fut impétueuse mais intérieure et calme. Le temps d’un mouvement de cils, d’un battement de cœur suffit pour que la foi l’apaise en pénétrant la profondeur de son âme.
Galid n’avait point remarqué ce qui se refaisait en elle. Il la laissa à son aise dès qu’elle fut sortie et n’osa la regarder que lorsqu’ils furent arrivés tout en bas de la colline, au niveau de la mer. Il s’arrêta, la dévisagea.
« Zarah ! »
Elle se retourna.
« Tu as l’air d’avoir vu un ange… »
15
Journal de Galid
Qui a tué la volonté de ce peuple ? Dieu, rient les fous ; la lâcheté, répondent les fidèles. Qui a mangé nos terres ? Qui a bu notre mer ? Qui a rendu fous nos enfants ? Qui a élevé des barrières entre nous et nos idoles ? Nous tous ! Nous méritons le vide, la misère, l’ennui, la barbarie, mais pas la mort, jusqu’à ce que nous ayons tué le dieu mauvais qui est en nous !
16
Galid raccompagna Zarah chez elle ; ils avaient peu parlé, Galid aussi avait bien du mal à retrouver son âme, laissée en bas du mont Murdjadjo. Ils marchaient à pas légers, la tête dans les étoiles. « Je ne sais de quoi il a rêvé mais moi, je sais : il me faut d’abord retourner au village, fouiller la koubba. »
Zarah, pressentant les velléités de Galid, réalisait que le moment était venu de le solliciter. Elle lui dit brièvement, avant qu’il ne s’en aille, qu’elle tenait à ce qu’il l’accompagne à la koubba.