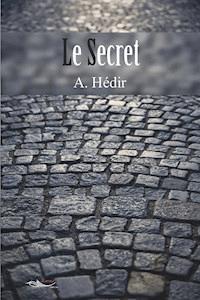
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
C’est l’histoire d’un homme qui débarque à Paris dans l’espoir de reconstruire sa vie sous une autre identité : un nom emprunté au désordre infligé à sa propre existence, et un secret si bien gardé que Vialacant lui-même doit en perdre jusqu’au souvenir.
C’est à la fois une renaissance et un naufrage. Un naufrage dans la perte de la mémoire personnelle, et une renaissance dans un environnement qui reste pourtant étrangement étranger. Jusqu’à la rencontre avec Élise, une jeune enseignante : le narrateur se réveille dans une existence toute neuve. Et cette enseignante pourrait signifier l’oubli total des ombres du passé. Mais le secret ne se laisse pas refouler si facilement : il resurgit sous les traits de Zainab, une femme sombre qui va entraîner Vialacant dans ses obsessions mortifères…
Dénouant au fur et à mesure les repères chronologiques, le récit défile ou éclate comme l’existence de cet homme soumis à la fatalité absurde d’un secret qu’il avait fini par oublier.
EXTRAIT
Hier ou avant-hier, peut-être même beaucoup plus tôt, je ne me souviens plus vraiment. Ce dont j’ai la certitude, c’est qu’un jour en plein été, j’ai débarqué à Paris avec un grand secret.
L’avion a pris du retard au décollage, une demi-heure, peut-être davantage. Nous volions depuis au moins deux heures. Un homme qui était installé à l’avant de l’appareil, la joue collée au hublot depuis le départ, s’est levé brusquement, s’est retourné et a laissé entendre que l’avion faisait demi-tour. J’ai regardé dehors, sans rien voir, et j’ai senti mon corps se tordre quand l’appareil s’est incliné légèrement, avant de prendre carrément sa trajectoire vers la droite ou vers la gauche, je ne sais plus.
Le commandant de bord a alors expliqué d’une voix sobre, plusieurs fois de suite, que le trafic matinal culminant était la cause principale du changement de cap. Au lieu de l’aéroport de Paris-Orly, qui était la destination prévue au départ, l’avion devait atterrir dans quelques minutes à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Il s’agissait, d’après lui, d’un problème de routine, fréquent pour un tel vol. Au même moment, une dame a parlé derrière mon dos d’une voix fière et fluctuante. C’était semble-t-il, une hôtesse de l’air, qui avait longtemps travaillé pour la même compagnie et qui avait connu ce genre d’ennuis. Je l’ai entendue chuchoter que le commandant de bord ne livrait pas toute la vérité. Il était contraint d’opérer un long détour alors qu’au sol, les autorités concernées examinaient les modalités d’atterrissage de l’avion et la suite à donner à certains passagers indésirables.
J’en faisais partie. Je l’ai su plus tard.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né en Algérie,
Ahcène Hédir vit en France depuis plusieurs années. Il est à la fois Ingénieur de formation, chef d’entreprise et auteur de nombreux articles et critiques littéraires. Le secret, son premier roman, nous plonge au cœur d’une histoire originale dont l’écriture s’avère subtile et poétique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le secret
A. Hédir
Le secret
Roman
Hier ou avant-hier, peut-être même beaucoup plus tôt, je ne me souviens plus vraiment. Ce dont j’ai la certitude, c’est qu’un jour en plein été, j’ai débarqué à Paris avec un grand secret.
L’avion a pris du retard au décollage, une demi-heure, peut-être davantage. Nous volions depuis au moins deux heures. Un homme qui était installé à l’avant de l’appareil, la joue collée au hublot depuis le départ, s’est levé brusquement, s’est retourné et a laissé entendre que l’avion faisait demi-tour. J’ai regardé dehors, sans rien voir, et j’ai senti mon corps se tordre quand l’appareil s’est incliné légèrement, avant de prendre carrément sa trajectoire vers la droite ou vers la gauche, je ne sais plus.
Le commandant de bord a alors expliqué d’une voix sobre, plusieurs fois de suite, que le trafic matinal culminant était la cause principale du changement de cap. Au lieu de l’aéroport de Paris-Orly, qui était la destination prévue au départ, l’avion devait atterrir dans quelques minutes à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Il s’agissait, d’après lui, d’un problème de routine, fréquent pour un tel vol. Au même moment, une dame a parlé derrière mon dos d’une voix fière et fluctuante. C’était semble-t-il, une hôtesse de l’air, qui avait longtemps travaillé pour la même compagnie et qui avait connu ce genre d’ennuis. Je l’ai entendue chuchoter que le commandant de bord ne livrait pas toute la vérité. Il était contraint d’opérer un long détour alors qu’au sol, les autorités concernées examinaient les modalités d’atterrissage de l’avion et la suite à donner à certains passagers indésirables.
J’en faisais partie. Je l’ai su plus tard.
J’étais arrivé dans une période où les décisions paraissaient floues et incertaines, un peu comme mon secret, et cette période m’était cependant favorable.
Ce secret, me suis-je dit, finira par m’étouffer ; il me rendra la vie difficile, me malmènera. Il est et restera en moi, coulera dans mes veines. Je vivrai avec ce fardeau ; je le porterai comme une croix partout où j’irai. C’est que personne ne devra le savoir. Comment serait-il possible de porter une cyphose qui ne doit pas être visible aux yeux des passants, des gens, des êtres vivants ?
Un jour ou l’autre je me trahirai. Tout s’écroulera.
Ce secret m’obsédait, mais je n’arrivais pas à le cerner, à le matérialiser. Je le voyais cependant comme de vulgaires verrues qui pousseraient sur une partie cachée de mon corps et qui, au fil du temps, prendraient du volume pour passer par-delà mes habits et me dévoiler au grand jour…
C’était là le fond de ma pensée depuis le départ jusqu’à l’atterrissage de l’avion.
Au sol, cependant, mes pensées ont laissé place à la curiosité et à l’attente. Une dizaine de policiers formaient une ronde plus au moins serrée autour du carrousel à bagages. Ils suivaient des yeux les rares sacs et valises qui tournaient à l’infini.
Un peu plus loin, d’autres policiers encerclaient une file d’attente dans un état d’effervescence. Il y avait un nœud dans la file : un couple avec un enfant en bas âge sans passeports. Un agent en civil leur a demandé comment ils avaient réussi à embarquer, l’homme et la femme ont répondu tous les deux par un sourire dérangeant.
Les téléphones sonnaient par intermittence et les haut-parleurs rappelaient à intervalles rapprochés les consignes de sécurité, incitant les voyageurs à la patience et à l’ordre. Certains des débarqués, usés par l’attente, ont fini par s’allonger à même le sol, s’endormant ensuite la tête sur un sac bleu blanc frappé de deux lignes rouges – peut-être roses –, décolorées.
J’ai pris mes bagages, j’ai contourné la longue file d’attente et je me suis assis sur un banc au fond du hall, à proximité du stand d’Air France. Pas loin, deux jeunes hôtesses discutaient sans me prêter attention. L’une était blonde, assez coquette, le nez légèrement camus, et l’autre brune ; elle souriait sans cesse en montrant des dents blanches et fines. Elles feuilletaient le magazine Dépêche Mode et parlaient de l’antifashion et du rejet du matérialisme des années précédentes. Je n’y comprenais absolument rien, mais ça me changeait les idées.
« Tiens, tiens ! dit la brune, la bouche grande ouverte, les trois rescapés du groupe anglais de pop électronique sortent un deuxième album.
La blonde recula légèrement et montra du doigt :
– Il est beau, dit-elle, je l’aime, ce Dave Gahan.
La brune la scruta.
– Regarde ! dit-elle à son tour, Stallone se prépare pour Rocky 6… »
Je suis resté ainsi un long moment à écouter ces deux jeunes femmes qui ouvraient le magazine page après page en s’arrêtant sur chaque photo.
C’est seulement le micro qui m’a brutalement séparé d’elles. « Les voyageurs munis d’un passeport diplomatique sont priés de se présenter au guichet 5. »
Je me suis levé sous le regard hébété des deux hôtesses qui se sont regardées drôlement. Peut-être se sont-elles dit des choses que je n’aurais pas dû entendre. Elles m’ont souri d’une façon complice ; j’ai fait la promesse au fond de moi-même d’oublier ce que j’avais entendu ; elles avaient en tout cas l’air de me comprendre ; elles ont laissé tomber le magazine pour rejoindre leur poste. J’ai tendu mon passeport à l’agent des douanes. C’était une femme brune, aux cheveux soigneusement attachés, le front complètement dégagé, de grandes oreilles piquées de toutes petites boucles d’oreilles dorées presque invisibles. D’habitude, je ne remarquais rien de tout cela. Ici, je suis devenu tout à coup un enfant curieux de tout. La femme m’observait avec ses grands yeux de biche et j’ai vu le grain de beauté sur son menton effilé en forme de poire émincé.
Elle a pris mon passeport, l’a ouvert sur la photo puis m’a scruté deux secondes, elle a feuilleté ensuite le passeport en faisant défiler une liste sur l’écran de son ordinateur qu’elle parcourait des yeux. « Ah voilà ! C’est bon. » Elle n’a rien dit de plus. Elle a fait signe à un autre agent, lui a tendu mon passeport et l’homme m’a fait signe à son tour de le suivre. Il avait une tenue de parachutiste. Le képi vert remonté d’un côté cachait à peine une brûlure cicatrisée au crâne.
Il m’a expliqué brièvement la procédure. « Peu importe, m’a-t-il dit, que votre passeport soit vrai ou faux, que vous soyez diplomate ou non. Dorénavant, il ne vous sert plus à rien. » Il m’a dit cela avant de le mettre dans la grande poche de son veston. Il a sorti ensuite de la poche de son pantalon une feuille de papier pliée en deux et me l’a tendue. « C’est à présent votre pièce d’identité… en attendant votre convocation à la préfecture de police », m’a-t-il dit sans expression sur le visage. C’était pour lui une habitude. Je me suis demandé pourquoi cet homme m’avait remis lui-même ce papier et pas l’agent qui était au guichet. Avait-il des choses à cacher ? Pourquoi ne m’a-t-il pas reçu dans un bureau ? Ces choses-là se font généralement dans ce genre d’endroit. Et je l’aurais signé ou même lu avant.
Nous avons ensuite traversé en silence de longs couloirs alternant avec des tapis roulants où nous nous reposions, et des halls plus au moins longs où l’officier de police courait presque pour rattraper le retard de la halte précédente. Partout où nous sommes passés, un son de radio nous accueillait puis nous abandonnait au fur et à mesure que nous avancions. On annonçait une fin de mois de mai chaud, plus de vingt-deux degrés, et un cumul de précipitations avoisinant le zéro. On craignait déjà la sécheresse. Même les rafales de vent étaient au plus bas, trente-cinq kilomètres à l’heure, disait la voix sèche. Elle avait eu bien raison. Dehors, l’air ne bougeait plus, même pas une brise. Le policier m’a abandonné à un arrêt de bus, à la sortie de l’aérogare, et je l’ai vu repartir. J’ai eu l’impression qu’il me guettait de loin, de si loin ; je n’ai plus regardé de son côté ensuite.
Quand le bus 351 est arrivé, un petit soleil gêné a fait irruption. La verdure a pris une couleur plus claire ; j’ai senti un parfum de rose. Je suis monté dans le bus qui a démarré lentement et j’ai revu l’agent que j’ai vu pourtant partir me faire un signe et un sourire. Pourquoi ? Aucune idée précise ! Il était sans doute rassuré de me voir enfin partir, car j’avais attendu au moins une demi-heure. Le chauffeur m’a demandé où j’allais, j’ai dit à Paris. Il a souri, et les gens me regardaient drôlement. « Paris, c’est vaste », m’a dit le chauffeur. Alors j’ai sorti un bout de papier sur lequel était inscrite une adresse. « Paris Gare de l’Est, le terminus », a fait le chauffeur qui m’a prié par la même occasion de composter mon ticket. Le trajet a duré une heure trente. L’air à Paris était suffocant. Le ciel très brumeux. La radio dans le bus avait annoncé des incursions nuageuses, venues de la Manche et de la mer du Nord, recouvrant la Normandie, la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. Des brouillards épais et des gelées bien présentes en banlieue et dans les zones moins urbanisées. Attention à la pollution de l’air, avertissait la présentatrice. C’était bien le cas. J’ai senti ma gorge se serrer, et la faim qui surgissait m’a poussé vers le Relay Payot Librairie et Presse de la gare de l’Est. La lumière était si forte, les vitres si propres que je me suis vu dans l’une d’elles en entrant dans le magasin. Mes lunettes étaient un peu poussiéreuses et mes yeux fatigués. Le pantalon crème trop long débordait de mes chaussures de ville et mon gros sac à dos écrasait une veste K-Way fluo. J’ai payé un journal quand je me suis aperçu qu’on ne vendait rien à manger, je suis alors parti chercher un sandwich un peu plus loin.
Un sandwich à base de fromage frais, disait l’étiquette, au piment d’Espelette, une rangée de lomo (goût légèrement fumé, extra) et quelques tranches de brebis des Pyrénées. Les pimientos del piquillo (origine : Anglet-Pays-basque) donnent de la fraîcheur et une jolie couleur à l’ensemble. On en redemande, était écrit en bleu tout en bas de l’étiquette. Je l’ai pris surtout parce qu’il ne contenait que du fromage. Mais il est vrai que le fromage était frais.
Tout au coin, j’ai aperçu une cabine téléphonique ; j’ai composé le seul numéro de téléphone qui était en ma possession. Quelques sonneries après, une voix sourde a décroché. L’homme a attendu que je parle en premier. Il a glissé d’une voix grave et claire : « Oui. » Il m’a ensuite dit qu’il attendait mon appel. Il m’a demandé d’où je l’appelais, j’ai répondu que j’étais à la gare de l’Est comme on me l’avait indiqué. Il m’a semblé entendre un petit rire. « C’est parfait », a-t-il dit. Un silence, puis : « On se voit dans une heure à la station de métro Château-Landon. C’est à moins de cinq cents mètres de l’endroit où tu es », m’a-t-il précisé.
*
L’article du journal qui faisait référence au magazine Pingeot était incompréhensible. C’était la fatigue ou l’attente, mais je ne saisissais pas le fond du sujet. Je me suis alors posé la question de savoir s’il n’y avait pas une énigme qui se cachait derrière cet article et que les lecteurs devaient décrypter. J’ai fini par poser mon journal sur le banc.
Quelques minutes après, un homme très grand, la quarantaine environ, l’a pris et s’est assis avec une autorité incontestable. Bien entretenu. Chemise blanche à la coupe slim-fit et au tissu stretch, poignets mousquetaires et col italien, suffisamment ouverte pour laisser paraitre un pendentif en or. Étrange cependant, cette veste de costume noir tombant sur un jean bleu sombre. Moitié classique et moitié moderne. Je l’ai pris pour un Français. Il m’a salué en arabe. Quand on s’est levé tous les deux, j’ai vu que j’étais aussi grand que lui. Ça m’a redonné un peu d’assurance.
Jakali parlait sans cesse. Il pouvait supporter une discussion pendant des heures de sujets divers : la bourse qui s’effondre à cause du dollar, la guerre qui se prépare en Tchétchénie, le conflit israélo-palestinien… mais sans être ni pour ni contre. Il passait de la Tora à l’Évangile et de l’Évangile au Coran comme on passe d’un plat de hors d’œuvre à un plat de résistance puis à un dessert. Cependant, on n’y décelait aucune morale, même quand il concluait par cette phrase : le nerf de la guerre, c’est encore et toujours l’argent.
Jakali m’a demandé si j’avais d’autres bagages, j’ai dit non, si j’avais une préférence pour un hôtel, j’ai répondu que peu m’importait. Il a souri d’une façon bizarre, les lèvres penchées d’un seul côté, et nous sommes partis. Quelque temps après, nous sommes arrivés dans une rue plus propre que les autres. L’hôtel se trouvait au 21 rue des Recollets. Jakali s’est chargé de toutes les formalités. Nous sommes montés dans la cabine d’ascenseur qui tardait à venir, sous le regard étrange de la réceptionniste. Au quatrième étage, Jakali m’a confié la clé et m’a demandé d’ouvrir. Une fois la porte fermée derrière nous, il m’a réclamé le dossier. Tout était scellé dans une chemise verte que je lui ai donnée. Il y a jeté un œil assez rapide et il m’a dit qu’il faudrait patienter quelques jours, le temps de prendre connaissance des éléments du dossier. Il m’a assuré que l’hôtel était payé pour une semaine. Et, avant de partir, il m’a remis une grande enveloppe : « C’est de quoi te débrouiller jusqu’à ce que je revienne », m’a-t-il dit.
Jakali est revenu trois jours plus tard. Je commençais à m’impatienter. J’étais resté tout ce temps ou presque enfermé dans ma chambre. Je passais ma journée à regarder par la fenêtre les gens qui passaient dans le petit parc d’en face. C’étaient toujours les mêmes personnes qui y revenaient, et chacune avait des habitudes bien ancrées.
Il y avait une jeune femme qui ne cessait de parler à son chien, je ne sais de quoi. Elle changeait de robe tous les jours. Bien que les couleurs aient été les mêmes : le fond était rouge et vert. C’était une petite femme qui paraissait discrète, un peu méfiante. Je n’ai pas pu voir son visage, ses cheveux étaient bruns et très fins, je crois, car la moindre brise les faisait s’envoler ; elle s’appliquait à les remettre en arrière quand ils l’empêchaient de voir son chien qui s’éloignait parfois. Un yorkshire, assez petit. Ses poils longs et blancs touchaient presque le sol. Il avait l’air d’être affectueux et possessif. Même qu’elle lui murmurait à l’oreille.
Je me demandais vraiment si elle ne le lui faisait pas une confidence. Tandis que je les observais, mes oreilles bruissaient en permanence de murmures étranges.
Si cette jeune femme détenait vraiment un secret qu’elle confiait à cet animal, c’est qu’elle ne voulait pas que ce secret soit dévoilé, sinon elle l’aurait confié à une amie. Elle n’en avait peut-être pas.
Il y avait aussi un couple de personnes âgées qui venait s’asseoir sur un banc de façon singulière. Collés l’un à l’autre, ils se réchauffaient mutuellement et se parlaient à l’oreille. À eux deux, ils avaient leur propre secret. Mais les gens qui passaient à proximité et les observaient se doutaient évidemment que ce couple en avait un. Ils ne le faisaient pas volontairement, cependant leur secret m’aguichait et, chaque jour, je guettais leur arrivée.
Le secret de ces gens me brûlait de curiosité et, en même temps, me faisait oublier quelque peu le mien.
Jakali a sonné quand la femme qui parlait à son chien venait de quitter le parc. Plus souriant que l’autre jour. Il s’est assis et a ouvert le dossier. Il ne semblait pas avoir beaucoup de temps à me consacrer, peut-être que je me trompais. « Les affaires sont bonnes ! », a-t-il fait en décelant mon inquiétude. J’ai dit que j’étais d’accord. « Je vous fais confiance. » Je ne sais pas pourquoi j’ai dit ça. J’ai voulu ajouter un mot ou deux pour m’expliquer, mais Jakali m’a devancé. « Ta maison sera vendue la semaine prochaine. L’acheteur a versé la moitié de la somme. » J’ai dit : « Oui. » Cela a semblé le surprendre. Il pensait sans doute que j’allais sauter de joie. Je ne pouvais pas. Je me suis demandé s’il fallait sourire ou rire aux éclats. Je ne savais pas comment on pouvait être heureux ici, alors je me suis abstenu, pensant qu’il fallait réagir comme cette fille qui parlait à son chien, ou comme le couple de vieux sages qui se chuchotaient leurs confidences.
« La voiture aussi », a dit Jakali, avant d’ajouter : « Quant aux terrains, le plus vaste est délimité et métré, il doit mesurer trois hectares environ. Deux solutions possibles. Soit il sera vendu à un industriel, soit à une coopérative. Dans les deux cas, cela prendra du temps. Il faut compter six mois ou plus. Par contre, a-t-il poursuivi en montrant de l’inquiétude, pour le petit terrain et la superstructure, comme il n’y a pas d’acte notarial, nous serons contraints d’attendre la signature du maire pour un désistement de la part du premier acquéreur. » J’ai hoché la tête, surpris. « Tu sais comment ça marche ! » a-t-il ajouté en me décochant un clin d’œil.
Jakali a loué un appartement pas loin de l’hôtel. Je pouvais l’occuper dès le lendemain. Il a pris une photo de l’immeuble qu’il m’a présenté avec un peu d’ivresse dans la voix. L’appartement était situé au deuxième étage. « C’est une résidence classe », m’a-t-il signifié. Puis il a ouvert une petite valise grise qu’il avait apportée. Je ne l’avais pas remarquée auparavant. Il en a sorti deux chemises, un pull, une paire de chaussures et des sous-vêtements. « Je déposerai à l’hôtel un costume et un manteau. C’est compris dans le prix », m’a-t-il précisé. Il m’a observé ensuite et il m’a confié d’un air de camaraderie : « Il faut raser ta moustache et couper tes cheveux. » Je n’ai rien osé répondre. Il ne me l’avait pas proposé pour rien. « C’est important », me suis-je dit une fois qu’il est reparti.
Une heure après, on m’a apporté mon costume et mon manteau.





























