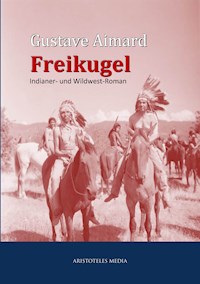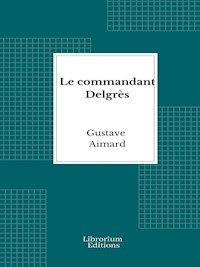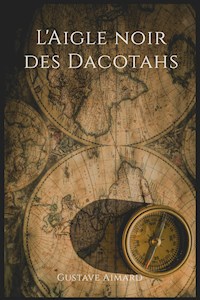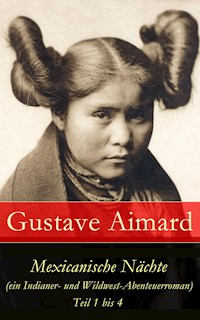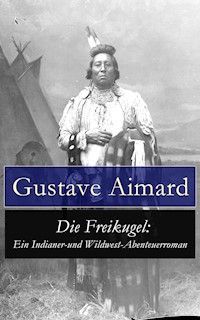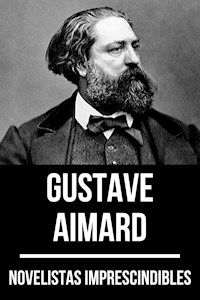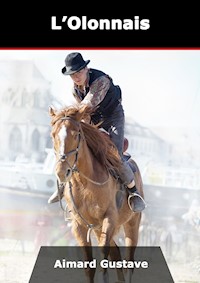0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bauer Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Extrait : Lorsque la cache est assez profonde, on en garnit les parois avec des peaux de bison, de crainte de l'humidité, et l'on dépose les marchandises en les recouvrant de peaux de bison ; ensuite on remet la terre, que l'on tasse avec soin ; on replace dessus le gazon, en ayant soin de l'arroser pour qu'il reprenne facilement, et la terre qui reste est portée au fleuve, dans lequel elle est jetée jusqu'à la dernière parcelle, afin de faire disparaître les moindres traces de la cache que l'on réussit, du reste, à dissimuler si bien, que l'œil seul d'un homme d'une adresse inouïe parvient parfois à les reconnaître, et encore, souvent, ne retrouve-t-il que des caches anciennes qui ont été fouillées déjà, et dans lesquelles il ne reste plus rien. Les objets confiés aux caches peuvent se conserver pendant cinq ou six ans sans se détériorer. Combien de choses enfouies de cette façon sont perdues à cause de la mort de leurs propriétaires tués au coin d'un buisson, dans une embuscade, en emportant avec eux dans la tombe le secret de la place où ils ont déposé leurs richesses~!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Gustave Aimard
table des matières
Chapitre 1 La cache
Chapitre 2 L’affût
Chapitre 3 Une ancienne connaissance du lecteur
Chapitre 4 Le Cèdre-Rouge aux abois
Chapitre 5 La grotte
Chapitre 6 La proposition
Chapitre 7 Ellen et Doña Clara
Chapitre 8 La fuite
Chapitre 9 Le téocali
Chapitre 10 La Gazelle blanche
Chapitre 11 Les Apaches
Chapitre 12 Le Chat-Noir
Chapitre 13 Le Bih-oh-akou-es
Chapitre 14 Le secours
Chapitre 15 Sur l’île
Chapitre 16 Le Rayon-de-Soleil
Chapitre 17 L’hospitalité indienne
Chapitre 18 Amour
Chapitre 19 La danse des Vieux Chiens
Chapitre 20 Combat corps à corps
Chapitre 21 Le vengeur
Chapitre 22 Explications
Chapitre 23 Apaches et Comanches
Chapitre 24 La danse du scalp
Chapitre 25 La torture
Chapitre 26 Deux cœurs de femmes
Chapitre 27 Schaw
Chapitre 28 Départ
Chapitre 29 Le guet-apens
Chapitre 30 La confession du pirate
Chapitre 31 Amour
Chapitre 32 Fray Ambrosio
Chapitre 33 La piste
Chapitre 34 La chasse
Chapitre 35 Combat
Chapitre 36 Cataclysme
Chapitre 1 La cache
Chapitre 1La cache
Deux mois se sont écoulés. Nous sommes dans le désert. Devant nous se déroule l’immensité. Quelle plume assez éloquente oserait entreprendre de décrire ces incommensurables océans de verdure auxquels les Américains du Nord ont, dans leur langage imagé, donné le nom poétique et mystérieux de Far West (Ouest lointain), c’est-à-dire la région inconnue par excellence, aux aspects à la fois grandioses et saisissants, doux et terribles, prairies sans bornes, dans lesquelles on trouve cette flore riche, puissante, échevelée et d’une vigueur de production contre laquelle l’Inde seule peut lutter ?
Ces plaines n’offrent d’abord à l’œil ébloui du voyageur téméraire qui ose s’y hasarder qu’un vaste tapis de verdure émaillé de fleurs, sillonné par de larges rivières, et paraissent d’une régularité désespérante, se confondant à l’horizon avec l’azur du ciel.
Ce n’est que peu à peu, lorsque la vue s’habitue à ce tableau, que, quittant l’ensemble pour les détails, on distingue çà et là des collines assez élevées, les bords escarpés des cours d’eau, enfin mille accidents imprévus qui rompent agréablement cette monotonie dont le regard est d’abord attristé, et que les hautes herbes et les gigantesques productions de la flore cachent complètement.
Comment énumérer les produits de cette nature primitive, qui s’élancent, se heurtent, se croisent et s’entrelacent à l’infini, décrivant des paraboles majestueuses, formant des arcades grandioses et complétant enfin le plus splendide et le plus sublime spectacle qu’il soit donné à l’homme d’admirer par ses éternels contrastes et ses harmonies saisissantes ?
Au-dessus des gigantesques fougères, des mezquitès, des cactus, des nopals, des mélèzes et des arbousiers chargés de fruits, s’élèvent l’acajou aux feuilles oblongues, le moriché ou arbre à pain, l’abanijo dont les larges feuilles se développent en éventail, le pirijao qui laisse pendre les énormes grappes de ses fruits dorés, le palmier royal dont le tronc est dénué de feuilles et qui balance au moindre souffle sa tête majestueuse et touffue, la canne de l’Inde, le limonier, le goyavier, le bananier, le chirimoya au fruit enivrant, le chêne-liège, l’arbre du Pérou, le palmier à cire distillant sa gomme résineuse.
Puis ce sont des champs immenses de dahlias, des fleurs plus blanches que les neiges du Coffre de Perote et du Chimborazo, ou plus rouges que le sang, des lianes immenses se roulant et se tordant autour du tronc des arbres, des vignes éblouissantes de sève ; et dans ce pêle-mêle, dans ce tohu-bohu, dans ce chaos inextricable, volant, courant, rampant dans tous les sens et dans toutes les directions, des animaux de toutes sortes et de toutes espèces, oiseaux, quadrupèdes, reptiles, amphibies, chantant, criant, hurlant, bramant et sifflant sur tous les tons et toutes les notes du clavier humain, tantôt moqueurs et menaçants, tantôt doux et mélancoliques.
Les cerfs, les daims bondissant effarés, l’oreille droite et l’œil au guet ; le longue-corne sautant de rocher en rocher pour se poser immobile au bord d’un précipice, les bisons pesants et stupides à l’œil triste, les chevaux sauvages dont les nombreuses manades ébranlent le sol dans leur course sans but ; l’alligator le corps dans la vase et dormant au soleil ; l’iguane hideux grimpant nonchalamment après un arbre ; le puma, ce lion sans crinière, les panthères et les jaguars guettant sournoisement leur proie au passage ; l’ours brun, le gourmand chasseur de miel ; l’ours gris, l’hôte le plus redoutable de ces contrées ; le cotejo à la morsure venimeuse ; le caméléon, dont la robe reflète toutes les nuances ; le lézard vert, le basilic enfin, pêle-mêle et rampant silencieux et sinistres sous les feuilles ; le monstrueux boa ; le serpent corail, si petit et si terrible ; le cascabel, le macaurel et le grand serpent tigré.
Sur les hautes branches des herbes et cachée sous l’épais feuillage, chante et gazouille la gent emplumée : les tanagres, les curassos, les loros braillards, les haras, les oiseaux-mouches, les toucans au bec énorme, les pigeons, les trogons, les élégants flamants roses, les cygnes se balançant et se jouant sur les rivières, et de liane en liane, de broussaille en broussaille les légers et charmants écureuils gris vont sautant avec une grâce inimaginable.
Au plus haut des airs, planant en longs cercles sur la prairie, l’aigle de la Sierra-Madre, à l’envergure immense, et le vautour à tête chauve, choisissent la proie sur laquelle ils vont s’abattre avec la rapidité de la foudre.
Puis, tout à coup, écrasant sous les sabots de son cheval le sable et les cailloux pailletés d’or étincelant au soleil, apparaît, comme par enchantement, un Indien à la peau rouge et luisante comme du cuivre neuf, aux membres robustes, aux gestes empreints de grâce et de majesté et à l’œil dominateur ; un Indien Pawnie, Navajoé, Comanche, Apache ou Sioux, qui, faisant tournoyer son lasso ou son lakki autour de sa tête, chasse devant lui une troupe de buffles épouvantés ou de chevaux sauvages, ou bien une panthère, une once ou un jaguar, qui fuient en bondissant avec de sourds hurlements de frayeur et de rage.
Cet enfant du désert, si grand, si noble et si dédaigneux du péril, qui traverse les prairies avec une vélocité incroyable, qui en connaît les mille détours, est bien réellement le roi de ce pays étrange, que seul il peut parcourir de nuit et de jour, dont il ne redoute pas les dangers sans nombre ; luttant corps à corps contre la civilisation européenne qui s’avance pas à pas, l’accule dans ses derniers retranchements et l’envahit de toutes parts.
Aussi, malheur au trappeur ou au chasseur qui se risque à traverser isolément ces parages ! Ses os blanchiront dans la prairie et sa chevelure ornera le bouclier d’un chef indien ou la crinière de son cheval.
Tel est l’aspect sublime, saisissant et terrible que présente encore aujourd’hui le Far West.
Le jour où nous reprenons notre récit, au moment où le soleil atteignait son zénith, le silence funèbre qui planait sur le désert fut tout à coup troublé par un léger bruit qui se fit entendre dans les buissons touffus qui bordent le Rio-Gila, dans un des parages les plus inexplorés de ces solitudes.
Les branches s’écartèrent avec précaution, et au milieu des feuilles et des lianes un homme montra son visage ruisselant de sueur et empreint d’une expression de terreur et de désespoir.
Cet homme, après avoir regardé autour de lui avec inquiétude et s’être assuré que nul ne l’épiait, dégagea lentement et avec hésitation son corps des herbes et des broussailles qui le cachaient, fit quelques pas dans la direction du fleuve et se laissa tomber sur le sol en poussant un profond soupir.
Presque en même temps, un énorme molosse croisé de loup et de terre-neuve bondit hors des buissons et se coucha à ses pieds.
L’homme qui venait d’apparaître si inopinément sur les rives du Rio-Gila était le Cèdre-Rouge !
Sa position semblait des plus critiques, car il était seul dans ce désert, sans armes et sans vivres !
Nous disons sans armes, parce que le long couteau pendu à sa ceinture de peau de daim lui était presque inutile.
Dans le Far West, cet océan infini de verdure, un homme désarmé est un homme mort !
La lutte lui devient impossible contre les innombrables ennemis qui le guettent au passage et n’attendent qu’une occasion favorable pour l’attaquer.
Le Cèdre-Rouge était privé de ces richesses inestimables du chasseur : un rifle, un cheval.
De plus, il était seul !
L’homme, tant qu’il voit son semblable, quand même ce semblable serait un ennemi, ne se croit pas abandonné. Au fond de son cœur, il reste un espoir~~vague dont il ne se rend pas compte, mais qui le soutient et lui donne du courage.
Mais, dès que toute figure humaine a disparu, que l’homme, grain de sable imperceptible dans le désert, se retrouve face à face avec Dieu, il tremble, car alors le sentiment de sa faiblesse se révèle à lui ; il comprend combien il est chétif devant ces œuvres colossales de la nature et combien est insensée la lutte qu’il lui faut soutenir pour soulever un coin du linceul de sable qui s’abaisse peu à peu sur lui et l’enserre de tous les côtés à la fois.
Le Cèdre-Rouge était un vieux coureur des bois. Maintes fois, pendant ses excursions dans les prairies, il s’était trouvé dans des situations presque désespérées, et toujours il s’en était tiré à force d’audace, de patience et surtout de volonté.
Seulement, jamais encore il ne s’était vu aussi complètement dénué de tout qu’en ce moment.
Il lui fallait cependant prendre un parti.
Il se leva en poussant un juron à demi étouffé, puis, sifflant son chien, seul être qui lui fût resté fidèle dans son malheur, il se mit lentement en marche, sans même se donner la peine de s’orienter.
En effet, qu’avait-il besoin de choisir une direction ? toutes n’étaient-elles pas bonnes pour lui et ne devaient-elles pas, après un laps de temps plus ou moins long, aboutir au même point… la mort !
Il chemina ainsi pendant quelques heures, la tête basse, voyant autour de lui bondir les asshatas et les bighorns, qui semblaient le narguer. Les bisons daignaient à peine relever la tête à son passage, et le regardaient, de leur grand œil mélancolique, comme s’ils comprenaient que leur implacable ennemi était désarmé et qu’ils n’avaient rien à redouter de lui.
Les elks, posés en équilibre sur la pointe des rochers, sautaient et gambadaient autour de lui, pendant que son chien, qui ne comprenait rien à cette chose toute nouvelle pour lui, regardait son maître et paraissait lui demander ce que tout cela voulait dire.
La journée se passa ainsi tout entière, sans apporter le moindre changement en bien dans la position du squatter, mais, au contraire, l’aggravant.
Le soir arrivé, il se laissa tomber sur le sable, épuisé de fatigue et de faim.
Le soleil avait disparu. L’ombre envahissait rapidement la prairie.
Déjà se faisaient entendre les hurlements des bêtes fauves qui, la nuit, sortent de leurs repaires pour se désaltérer et aller en quête de leur pâture.
Le squatter désarmé ne pouvait allumer de feu pour les éloigner.
Il regarda autour de lui ; un dernier instinct de conservation, peut-être cette suprême lueur d’espérance, étincelle divine qui ne s’éteint jamais au cœur de l’homme le plus malheureux, l’engagea à chercher un abri.
Il monta sur un arbre, et, après s’être solidement attaché de crainte d’une chute, si, ce qui n’était pas probable, il s’endormait, il ferma les yeux et chercha le sommeil, afin de tromper au moins quelques instants la faim qui le consumait et oublier sa déplorable position.
Mais le sommeil ne visite pas ainsi les malheureux, et c’est justement lorsqu’on l’appelle de tous ses vœux qu’il s’obstine à ne pas venir.
Nul, s’il ne l’a pas éprouvé lui-même, ne peut se figurer l’horreur d’une nuit d’insomnie dans le désert.
Les ténèbres se peuplent de spectres lugubres, les bêtes fauves hurlent, les serpents s’enroulent après les arbres, prennent parfois dans leurs anneaux froids et visqueux le misérable à demi mort de frayeur.
Personne ne peut dire de combien de siècles se compose une minute dans cette effroyable situation, et quelle est la longueur de ce cauchemar, pendant lequel l’esprit bourrelé et maladif crée, comme à plaisir, les plus monstrueuses élucubrations, surtout lorsque l’estomac est vide et que, par cela même, le cerveau est plus facilement envahi par le délire.
Au lever du soleil, le squatter poussa un soupir de soulagement.
Pourtant, que signifiait pour lui l’apparition de la lumière, si ce n’est le commencement d’un jour de souffrances intolérables et d’effroyables tortures ? Mais au moins il voyait clair ; il pouvait se rendre compte de ce qui se passait autour de lui ; le soleil le réchauffait et lui redonnait un peu de force.
Il descendit de l’arbre sur lequel il avait passé la nuit et se remit en route.
Pourquoi marchait-il ? Il ne le savait pas lui-même, cependant il marchait comme s’il avait eu un but à atteindre, quoiqu’il sût pertinemment qu’il n’avait de secours à attendre de personne, et qu’au contraire, dans ce désert immense, le premier visage qu’il apercevrait serait celui d’un ennemi.
Mais l’homme dont l’esprit est fortement trempé est ainsi fait. Jamais il ne s’abandonne, il lutte jusqu’au dernier moment, et, s’il ne veut pas compter sur la Providence, il espère, sans oser se l’avouer à lui-même, dans le hasard.
Il nous serait impossible d’expliquer quelles étaient les pensées qui tourbillonnaient en foule dans le cerveau du squatter, tandis que, d’un pas incertain, il parcourait, silencieux et sombre, les vastes solitudes de la prairie.
Vers midi, la chaleur devint tellement intense que, vaincu par tant de douleurs morales et physiques, il se laissa tomber, accablé, au pied d’un arbre.
Il resta longtemps étendu sur la terre.
Enfin, poussé par le besoin, il se leva chancelant, se soutenant à peine, et chercha des racines ou des herbes qui pussent tromper, sinon assouvir, la faim qui lui brûlait les entrailles.
Ses recherches furent longtemps infructueuses ; pourtant il finit par trouver une espèce de yuca, racine pâteuse assez semblable au manioc, qu’il dévora avec délices.
Il se fit une certaine provision de cette racine, qu’il partagea avec son chien, et, après avoir largement bu au fleuve, il se préparait à reprendre sa marche, un peu réconforté par ce repas plus que frugal, lorsque tout à coup son œil éteint lança un éclair, sa physionomie s’anima, et il murmura d’une voix tremblante d’émotion :
— Si c’en était une !
Voici ce qui avait causé l’exclamation du Cèdre-Rouge.
Au moment où il reprenait sa marche en jetant machinalement un regard autour de lui, il lui sembla remarquer qu’à une certaine place l’herbe était plus drue, plus haute et plus forte que partout ailleurs. Cette différence, visible seulement pour un homme habitué de longue date à la prairie, et encore en regardant avec la plus minutieuse attention, ne lui échappa pas.
Les Indiens et les chasseurs, obligés souvent à une course rapide, soit pour éviter une embuscade ennemie, soit pour suivre le gibier, sont dans la nécessité d’abandonner une grande partie du butin qu’ils possèdent ou des marchandises qu’ils portent avec eux pour traiter.
Comme ils ne se soucient nullement de perdre ce butin ou ces marchandises, ils font ce que, dans la langue des trappeurs, on nomme une cache.
Voici comment se pratique une cache :
On commence par étendre des couvertures et des peaux de bison autour de la place où on veut faire la cache ; puis, avec une bêche, on lève de larges plaques de gazon en rond, en carré ou en ovale, suivant la forme qu’on veut donner à la cache ; alors on creuse, en ayant soin de mettre toute la terre qu’on sort du trou sur les couvertures préparées à cet effet.
Lorsque la cache est assez profonde, on en garnit les parois avec des peaux de bison, de crainte de l’humidité, et l’on dépose les marchandises en les recouvrant de peaux de bison ; ensuite on remet la terre, que l’on tasse avec soin ; on replace dessus le gazon, en ayant soin de l’arroser pour qu’il reprenne facilement, et la terre qui reste est portée au fleuve, dans lequel elle est jetée jusqu’à la dernière parcelle, afin de faire disparaître les moindres traces de la cache que l’on réussit, du reste, à dissimuler si bien, que l’œil seul d’un homme d’une adresse inouïe parvient parfois à les reconnaître, et encore, souvent, ne retrouve-t-il que des caches anciennes qui ont été fouillées déjà, et dans lesquelles il ne reste plus rien.
Les objets confiés aux caches peuvent se conserver pendant cinq ou six ans sans se détériorer.
Combien de choses enfouies de cette façon sont perdues à cause de la mort de leurs propriétaires tués au coin d’un buisson, dans une embuscade, en emportant avec eux dans la tombe le secret de la place où ils ont déposé leurs richesses !
Nous avons dit que le squatter croyait avoir découvert une cache.
Dans sa position, cette trouvaille était pour lui d’un prix inestimable ; elle pouvait lui offrir les objets de première nécessité dont il était dépourvu, et le faire, pour ainsi dire renaître à la vie, en lui fournissant les moyens de recommencer son existence de chasse, de pillage et de vagabondage.
Il resta quelques minutes le regard fixé sur l’endroit où il soupçonnait que se trouvait la cache, l’esprit agité de sentiments indéfinissables.
Enfin il modéra son émotion, et, le cœur palpitant de crainte et d’espoir, avec cette honnêteté innée dans les hommes accoutumés à la vie des prairies qui, quelque bandits qu’ils soient, et tout en volant sans scrupule le bien d’autrui, se font pourtant un point d’honneur de ne pas le gaspiller et de ne priver le légitime propriétaire que de ce qui leur est absolument nécessaire, il étendit avec soin auprès de la cache sa robe de bison et sa couverture, afin de recueillir la terre ; puis, s’agenouillant, il dégaina son couteau et enleva un carré de gazon.
Il est impossible de rendre le frémissement et l’anxiété de cet homme lorsqu’il plongea pour la première fois son couteau dans le sol.
Il détacha ainsi avec précaution, l’une après l’autre, toutes les plaques de gazon qui lui semblèrent former le contour de la cache.
Ce premier travail terminé, il se reposa un instant pour reprendre haleine et en même temps pour savourer quelques minutes cette émotion pleine de volupté et de douleur qu’on éprouve en accomplissant un acte dont dépendent la vie ou la mort.
Au bout d’un quart d’heure, il passa sa main sur son front couvert de sueur et se remit résolument au travail, fouillant avec son couteau la terre qu’il enlevait ensuite avec ses mains, et qu’il posait soit sur la couverture, soit sur la robe de bison.
C’était réellement une rude besogne que celle-là, surtout pour un homme accablé de fatigue et affaibli par les privations.
Plusieurs fois, à bout de forces, il fut contraint de s’arrêter : l’ouvrage avançait lentement ; aucun indice ne venait corroborer la croyance du squatter.
Maintes fois il fut sur le point d’abandonner cette vaine recherche, mais là était pour lui la seule chance de salut ; là seulement, s’il réussissait, il trouverait les moyens de redevenir un franc et libre coureur des bois : aussi se cramponnait-il à cette dernière planche de salut que le hasard lui avait offerte, avec cette énergie du désespoir, force immense, levier d’Archimède qui ne trouve rien d’impossible.
Pourtant depuis longtemps déjà le malheureux creusait avec son couteau ; un large trou était béant devant lui, rien encore ne lui faisait entrevoir une réussite ; aussi, malgré l’énergie indomptable de son caractère, il sentit le découragement envahir une autre fois son esprit.
Une larme de rage impuissante perla à ses paupières rougies par la fièvre, et il jeta son couteau dans la fosse en poussant un blasphème et en lançant au ciel un regard d’amer défi.
Le couteau rendit en tombant un son métallique et rebondit sur lui-même.
Le squatter le saisit vivement et l’examina avec soin. La pointe était cassée net.
Il recommença avec frénésie à creuser avec ses ongles, comme une bête fauve, dédaignant de se servir de son couteau plus longtemps.
Bientôt il mit à découvert une peau de bison.
Au lieu de soulever immédiatement cette peau qui recouvrait sans doute tous les trésors dont il convoitait la possession, il se prit à la couver de l’œil avec une anxiété terrible.
Le Cèdre-Rouge ne s’était pas trompé.
Il avait bien réellement découvert une cache.
Sa vieille expérience ne lui avait pas failli.
Mais que contenait cette cache ?
Peut-être avait-elle été fouillée et était-elle vide.
Lorsqu’il n’avait qu’un mouvement à faire pour s’en assurer, il hésitait !
Il avait peur !
Depuis plus de trois heures qu’il travaillait pour en arriver là, il s’était bercé de tant de rêves, il s’était forgé tant de chimères, qu’il redoutait instinctivement de les voir s’évanouir tout à coup et de retomber de la hauteur de ses espérances déçues dans l’affreuse réalité qui le pressait dans ses griffes de fer.
Longtemps il hésita ainsi ; enfin, prenant subitement son parti, d’une main tremblante d’émotion, le cœur palpitant et l’œil hagard, d’un mouvement brusque et rapide comme la pensée, il arracha la robe de bison.
Alors il eut un éblouissement et poussa un cri de joie semblable au rugissement d’un tigre.
Il était tombé sur une cache de chasseur.
Elle contenait des trappes de toutes sortes en fer, des rifles, des pistolets doubles et simples, des cornes à poudre, des sacs remplis de balles, des couteaux, et ces mille objets indispensables aux coureurs des bois.
Le Cèdre-Rouge se sentit renaître ; un changement subit s’opéra en lui, il redevint l’être implacable et indomptable qu’il était avant la catastrophe dont il avait été la victime, sans crainte et sans remords, prêt à recommencer la lutte contre la nature entière et se riant des périls et des embûches qu’il pourrait rencontrer sur son chemin.
Il choisit le meilleur rifle, deux paires de pistolets doubles, un couteau fortement emmanché, à lame large, droite et longue de quinze pouces.
Il s’empara aussi des harnais nécessaires à l’équipement d’un cheval ; deux cornes de poudre, un sac de balles et une gibecière en peau d’elk richement brodée à l’indienne, contenant un briquet et tout le nécessaire pour un campement.
Il trouva aussi du tabac et des pipes, dont il se chargea.
La plus grande privation qu’il avait endurée était de ne pouvoir fumer.
Lorsqu’il se fut chargé de tout ce qu’il trouva à sa convenance, il replaça tout dans son état primitif, et fit adroitement disparaître les indices qui auraient dénoncé à d’autres la cache qui lui avait été si utile.
Dès que ce devoir d’honnête homme fut rempli envers le propriétaire qu’il avait dépouillé, le Cèdre-Rouge jeta son rifle sur l’épaule, siffla son chien, et s’éloigna à grands pas en murmurant :
— Ah ! ah ! vous croyez avoir forcé le sanglier dans sa bauge ! nous verrons s’il saura prendre sa revanche !
Par quel enchaînement de circonstances inouïes le squatter, que nous avons vu s’enfoncer dans le désert à la tête d’une troupe nombreuse et résolue, s’était-il trouvé ainsi abandonné, sur le point de périr dans la prairie ?
Chapitre 2 L’affût
Chapitre 2L’affût
Nous avons dit en terminant notre deuxième partie que, derrière la troupe commandée par le Cèdre-Rouge, une autre troupe était entrée dans le désert. Cette troupe, dirigée par Valentin Guillois, se composait de Curumilla, du général Ibañez, de don Miguel Zarate et de son fils.
Ce que cherchaient ces cinq hommes, ce n’était pas un placer, c’était la vengeance.
Arrivés sur le territoire indien, le Français jeta un regard interrogateur autour de lui, et, arrêtant son cheval, il se tourna vers don Miguel :
— Avant d’aller plus loin, dit-il, nous ferons bien, je crois, de tenir conseil, afin de bien convenir de nos faits et d’arrêter un plan de campagne dont nous ne nous écarterons plus.
— Mon ami, répondit l’hacendero, vous savez que tout notre espoir repose sur vous ; agissez donc comme vous le jugerez convenable.
— Bien, fit Valentin. Voici l’heure où la chaleur oblige dans le désert toutes les créatures vivantes à se réfugier sous l’ombrage des arbres, nous nous arrêterons donc ; l’endroit où nous sommes est des mieux choisis pour une halte de jour.
— Soit, répondit laconiquement l’hacendero.
Les cavaliers mirent pied à terre et ôtèrent le mors de leurs chevaux, afin que les pauvres animaux pussent prendre un peu de nourriture en broutant l’herbe maigre et brûlée qui poussait à grand-peine dans ce terrain ingrat.
Le lieu était effectivement des mieux choisis : c’était une clairière assez vaste traversée par un de ces nombreux ruisseaux sans nom qui sillonnent les prairies dans tous les sens, et qui, après un cours de quelques kilomètres, vont grossir les grands fleuves dans lesquels ils se perdent.
Un épais dôme de feuillage offrait aux voyageurs un abri indispensable contre les rayons verticaux d’un soleil vertical.
Bien qu’il fût environ midi, l’air, rafraîchi dans la clairière par les émanations de la source, invitait à goûter ce sommeil au milieu du jour si bien nommé siesta.
Mais les voyageurs avaient autre chose de plus sérieux à faire que de se laisser aller au sommeil.
Dès que toutes les précautions furent prises en cas d’une attaque possible, Valentin s’assit au pied d’un arbre en faisant signe à ses amis de prendre place à ses côtés.
Les trois blancs acquiescèrent immédiatement à son invitation, tandis que Curumilla allait sans rien dire, selon son habitude, se placer le rifle à la main à quelques pas de la clairière afin de veiller au salut de tous.
Après quelques minutes de réflexion, Valentin prit la parole :
— Caballeros, dit-il, le moment est venu de nous expliquer franchement : nous sommes à présent sur le territoire ennemi ; autour de nous, dans un périmètre de plus de deux mille milles, s’étend le désert. Nous allons avoir à lutter non seulement contre les hommes blancs ou les Peaux Rouges que nous rencontrerons sur notre route, mais encore contre la faim, la soif et les bêtes fauves de toutes sortes. Ne cherchez pas à donner à mes paroles un autre sens que celui que j’y attache moi-même ; vous me connaissez de longue date, don Miguel, vous savez quelle amitié je vous ai vouée.
— Je le sais, et je vous en remercie, répondit l’hacendero d’un ton pénétré.
— Bref, continua Valentin, aucun obstacle, de quelque nature qu’il soit, ne sera assez fort pour m’arrêter dans la mission que je me suis donnée.
— J’en suis convaincu, mon ami.
— Bien, mais moi, je suis un vieux coureur des bois ; la vie des déserts avec ses privations et ses périls m’est parfaitement connue ; cette piste que je vais suivre ne sera presque qu’un jeu pour moi et pour le brave Indien mon compagnon.
— Où voulez-vous en venir ? interrompit don Miguel avec inquiétude.
— À ceci, répondit franchement le chasseur : vous autres caballeros, habitués à une vie de luxe et de loisirs, peut-être ne pourrez-vous pas supporter cette rude existence à laquelle vous allez être condamnés ; dans le premier moment de la douleur vous vous êtes bravement élancés sans réfléchir à la poursuite des ravisseurs de votre fille, sans calculer autrement les conséquences de votre action.
— C’est vrai, murmura don Miguel.
— Il est donc de mon devoir, reprit Valentin, de vous avertir : ne craignez pas de reculer, soyez franc avec moi comme je le suis avec vous ; Curumilla et moi nous suffirons pour accomplir la tâche que nous nous sommes donnée. À dix kilomètres au plus derrière vous s’étend la frontière mexicaine, reprenez-en le chemin, et laissez-nous le soin de vous rendre votre enfant, si vous ne vous sentez pas capable d’affronter sans faiblir les innombrables dangers qui nous menacent. Un malade, en retardant notre poursuite, nous mettrait dans l’impossibilité non seulement de réussir, mais encore nous exposerait à être tués ou scalpés. Réfléchissez donc sérieusement, mon ami, et, mettant de côté toute question d’amour-propre, faites-moi une réponse qui me donne complètement ma liberté d’action.
Pendant cette espèce de discours dont intérieurement il reconnaissait la justesse, don Miguel était demeuré la tête penchée sur la poitrine, les sourcils froncés. Lorsque Valentin se tut, l’hacendero se redressa, et prenant la main du chasseur qu’il serra chaleureusement :
— Mon ami, répondit-il, ce que vous m’avez dit, vous deviez me le dire ; vos paroles ne me choquent en rien, d’autant plus que seul l’intérêt que vous me portez et l’amitié qui nous lie vous les ont dictées ; les observations que vous me faites, je me les suis déjà faites à moi-même, mais quoi qu’il arrive, ma résolution est immuable, je ne reculerai pas jusqu’à ce que j’aie retrouvé ma fille.
Je savais que telle serait votre réponse, don Miguel, fit le chasseur, un père ne peut consentir à abandonner son enfant aux mains des bandits sans tenter tous les moyens pour la délivrer ; seulement je devais vous dire ce que je vous ai dit. Ne parlons donc plus de cela, et occupons-nous, séance tenante, à dresser notre plan de campagne.
— Oh ! oh ! dit en riant le général, voyons un peu.
— Vous m’excuserez, général, répondit Valentin, mais la guerre que nous faisons est complètement différente de celle des peuples civilisés : dans le désert, la ruse seule fait triompher.
— Eh ! rusons ; je ne demande pas mieux, d’autant plus qu’avec le peu de forces dont nous disposons, je ne vois guère comment nous pourrions faire autrement.
— C’est vrai, reprit le chasseur : nous ne sommes que cinq ; mais, croyez-moi, cinq hommes déterminés sont plus redoutables qu’on ne pourrait le supposer, et j’espère bientôt le prouver à nos ennemis.
— Bien parlé, ami, s’écria don Miguel avec joie. Cuerpo de Dios ! ces gringos maudits ne tarderont pas à s’en apercevoir.
— Nous avons, continua Valentin, des alliés qui, le moment venu, nous seconderont vaillamment : la nation des Comanches s’intitule avec orgueil la Reine des prairies ; ses guerriers sont de redoutables adversaires. L’Unicorne ne nous fera pas défaut avec sa tribu ; nous avons, de plus, des intelligences dans le camp ennemi, le cacique des Coras.
— Que nous disiez-vous donc ? fit gaiement le général ; caraï ! notre succès est assuré alors.
Valentin secoua la tête.
— Non, dit-il ; le Cèdre-Rouge a des alliés aussi ; les pirates des prairies et les Apaches se joindront à lui, j’en suis convaincu.
— Peut-être, observa don Miguel.
— Le doute n’est pas admissible dans cette circonstance ; le chasseur de chevelures est trop rompu à la vie du désert pour ne pas chercher à mettre de son côté toutes les chances de réussite.
— Mais si cela arrive, ce sera une guerre générale, s’écria l’hacendero.
— Sans doute, reprit Valentin ; c’est ce à quoi je veux parvenir. À deux jours de marche du lieu où nous sommes, il y a un village navajoé. J’ai rendu quelques services au Loup-Jaune, son principal chef ; il faut nous rendre auprès de lui avant que le Cèdre-Rouge tente de le voir, et, à tout prix, nous nous assurerons son alliance. Les Navajoés sont des guerriers prudents et courageux.
— Ne craignez-vous pas les suites de ce retard ?
— Une fois pour toutes, caballeros, répondit Valentin, souvenez-vous que dans le pays où nous sommes la ligne droite est toujours la plus longue.
Les trois hommes courbèrent la tête avec résignation.
— L’alliance du Loup-Jaune nous est indispensable ; avec son appui il nous sera facile de…
L’arrivée subite de Curumilla coupa la parole au chasseur.
— Que se passe-t-il donc ? lui demanda-t-il.
— Écoutez ! répondit laconiquement le chef.
Les quatre hommes prêtèrent anxieusement l’oreille.
— Vive Dieu ! s’écria Valentin en se levant précipitamment, que se passe-t-il donc ?
Et suivi de ses compagnons il se glissa dans le fourré.
Les Mexicains, dont les sens étaient émoussés, n’avaient rien entendu dans le premier moment, mais le bruit qui avait frappé l’ouïe exercée du chasseur et de son compagnon depuis longtemps était déjà parvenu à leurs oreilles.
C’était le galop furieux de plusieurs chevaux dont les sabots résonnaient sur le sol avec un roulement semblable à celui du tonnerre.
Tout à coup des cris féroces éclatèrent mêlés à des coups de feu.
Cachés derrière les arbres, les cinq voyageurs regardaient.
Ils ne tardèrent pas à apercevoir un homme qui détalait, monté sur un coureur blanc d’écume, poursuivi par une trentaine de cavaliers indiens.
— À cheval ! commanda Valentin à voix basse, nous ne pouvons laisser assassiner cet homme.
— Hum ! murmura le général, nous jouons gros jeu, ils sont nombreux.
— Ne voyez-vous pas que cet individu appartient à notre couleur ? reprit Valentin.
— C’est vrai, dit don Miguel ; quoi qu’il arrive, nous ne devons pas le laisser ainsi massacrer de sang-froid par ces Indiens féroces.
Cependant les poursuivants et le poursuivi se rapprochaient de plus en plus du lieu où se tenaient les chasseurs embusqués derrière les arbres.
L’homme après lequel les Indiens s’acharnaient ainsi se redressait fièrement sur sa selle, et, tout en galopant à fond de train, il se retournait de temps en temps pour décharger son rifle dans le groupe de ses ennemis.
À chaque coup un guerrier tombait ; ses compagnons poussaient alors des hurlements effroyables et répondaient de leur côté par une grêle de flèches et de balles.
Mais l’inconnu secouait dédaigneusement la tête en ricanant, et continuait sa course.
— Caspita ! fit le général avec admiration, voilà un brave compagnon !
— Sur mon âme ! s’écria don Pablo, ce serait dommage qu’il fût tué.
— Il faut le sauver ! ne put s’empêcher de dire don Miguel.
Valentin sourit doucement.
— Je vais essayer, dit-il. À cheval !
Chacun se mit en selle.
— Maintenant ; continua Valentin, restez invisibles derrière les broussailles. Ces Indiens sont des Apaches ; lorsqu’ils arriveront à portée de fusil, vous ferez feu tous ensemble sans vous montrer.
Chacun arma son rifle et se tint prêt.
Il y eut un moment d’attente suprême ; le cœur des chasseurs battait avec force.
Les Indiens approchaient toujours, penchés sur le cou de leurs chevaux haletants, brandissant leurs armes avec fureur et jetant, par intervalles, leur formidable cri de guerre ; ils arrivaient avec une vélocité vertigineuse, précédés, à une centaine de pas au plus, par l’homme qu’ils poursuivaient et qu’ils ne devaient pas tarder à atteindre, car son cheval fatigué et à demi fourbu râlait péniblement et ralentissait visiblement sa course.
Enfin l’inconnu passa avec la rapidité d’un éclair devant le fourré qui recélait, sans qu’il lui fût possible de le soupçonner, ceux qui allaient tenter pour son salut une diversion qui pouvait les perdre.
— Attention ! commanda Valentin à voix basse.
Les rifles s’abaissèrent dans la direction des Apaches.
— Visez avec soin, reprit Valentin, il faut que chaque coup tue un homme.
Une minute s’écoula, une minute longue comme un siècle.
— Feu ! cria tout à coup le chasseur, feu maintenant !
Cinq coups de feu éclatèrent avec un fracas terrible. Cinq Apaches tombèrent.
Chapitre 3 Une ancienne connaissance du lecteur
Chapitre 3Une ancienne connaissance du lecteur
A cette attaque imprévue, les Apaches poussèrent un hurlement de frayeur. Mais avant qu’il leur fût possible de maîtriser leurs chevaux, une seconde décharge fit cinq nouvelles victimes dans leurs rangs.
Alors une terreur folle s’empara des Indiens, ils tournèrent bride et se mirent à fuir dans toutes les directions.
Dix minutes plus tard ils avaient disparu.
Les chasseurs ne songèrent pas un instant à se montrer et à les poursuivre.
Curumilla avait, lui, mis pied à terre, était sorti du fourré en rampant, et, parvenu sur le champ de bataille, il avait consciencieusement achevé et scalpé les Apaches qui étaient tombés sous les balles de ses compagnons.
Il avait en même temps lassé un cheval sans cavalier qui était venu passer à quelques pas de lui, puis il était venu rejoindre ses amis.
— À quelle tribu appartiennent ces chiens ? lui demanda Valentin.
— Le Bison, répondit Curumilla.
— Oh ! oh ! fit le chasseur, nous avons eu la main heureuse alors ; c’est, je crois, Stanapat qui est le chef de la tribu du Bison.
Curumilla baissa affirmativement la tête, et, après avoir entravé le cheval qu’il avait lassé auprès des chevaux des chasseurs, il alla tranquillement s’asseoir sur le bord du ruisseau.
Cependant l’inconnu avait été surpris au moins autant que les Apaches du secours imprévu qui lui était si providentiellement arrivé au moment où il se croyait perdu sans ressource.
Au bruit de la fusillade, il avait arrêté son cheval, et, après un moment d’hésitation, il revint lentement sur ses pas. |
Valentin surveillait tous ses mouvements.
L’inconnu, arrivé devant le fourré, s’élança à terre, écarta d’une main ferme les broussailles qui lui barraient le passage, et se dirigea résolument vers la clairière où les Mexicains étaient embusqués.
Cet homme, que le lecteur connaît déjà, n’était autre que l’individu que le Cèdre-Rouge nommait don Melchior et qu’il semblait si fort redouter.
Quand il se trouva en présence des Mexicains, don Melchior se découvrit et les salua avec courtoisie.
Ceux-ci lui rendirent poliment son salut.
— Viva Dios ! s’écria-t-il, j’ignore qui vous êtes, caballeros ; mais je vous remercie sincèrement de votre intervention de tout à l’heure ; je vous dois la vie.
— Dans le Far West, répondit noblement Valentin, une chaîne invisible lie les uns aux autres les hommes d’une même couleur, qui ne forment pour ainsi dire qu’une seule famille.
— Oui, fit l’inconnu avec un accent pensif, il devrait en être ainsi ; malheureusement, ajouta-t-il en secouant négativement la tête, les beaux principes que vous émettez, caballero, sont fort peu mis en pratique ; mais ce n’est pas en ce moment que je me plaindrai de les voir négligés, puisque c’est à votre généreuse intervention que je dois d’être encore compté parmi les vivants.
Les assistants s’inclinèrent.
L’inconnu continua.
— Veuillez me dire qui vous êtes, caballeros, afin que je conserve dans mon cœur des noms qui me seront toujours chers.
Valentin fixa sur l’homme qui parlait ainsi un regard clair et perçant qui semblait vouloir lire jusqu’au fond de son cœur ses plus secrètes pensées.
L’inconnu sourit tristement.
— Pardonnez-moi, dit-il, ce qu’il y a d’amer dans mes paroles ; j’ai beaucoup souffert, et, malgré moi, souvent un flot d’amères pensées monte de mon cœur à mes lèvres.
— L’homme est sur la terre pour souffrir, répondit gravement Valentin. Chacun de nous a ici-bas sa croix à porter ; don Miguel de Zarate, son fils et le général Ibañez sont la preuve de ce que j’avance.
Au nom de don Miguel Zarate, une vive rougeur empourpra les joues de l’inconnu, et son œil lança un éclair, malgré tous ses efforts pour rester impassible.
— J’ai souvent entendu parler de don Miguel de Zarate, fit-il en s’inclinant ; j’ai appris les dangers qu’il a courus, dangers auxquels il n’a échappé que grâce à un brave et loyal chasseur.
— Ce chasseur est devant vous, dit don Miguel. Hélas ! il nous reste d’autres dangers plus grands à courir encore.
L’inconnu le regarda un instant avec attention, puis il fit un pas en avant, et croisant les bras sur la poitrine :
— Écoutez ! dit-il d’une voix profonde, c’est Dieu réellement qui vous a inspiré de me venir en aide, car dès ce moment je me voue corps et âme à votre service, je vous appartiens comme la lame à la poignée. Je sais pourquoi, vous, don Miguel de Zarate, vous, don Pablo, vous, général Ibañez, et vous, Koutonepi, car, si je ne me trompe, vous êtes ce chasseur célèbre dont la réputation s’étend dans toutes les prairies de l’ouest…
— C’est moi, en effet, répondit Valentin avec modestie.
— Je sais, dis-je, continua l’inconnu, quelle raison a été assez forte pour vous obliger à rompre toutes vos habitudes pour venir vivre dans les affreuses solitudes du Far West.
— Vous savez ? s’écrièrent les chasseurs avec étonnement.
— Tout ! répondit fermement l’inconnu : je sais la trahison qui vous a obligé à vous livrer entre les mains de vos ennemis ; je sais enfin que votre fille a été enlevée par le Cèdre-Rouge.
À cette révélation, un frémissement parcourut les membres des chasseurs.
— Qui donc êtes-vous, pour être si bien instruit ? demanda Valentin.
Un sourire triste plissa une seconde les lèvres de l’inconnu.
— Qui je suis ? dit-il avec mélancolie ; qu’importe, puisque je veux vous servir ?
— Mais encore, puisque nous avons répondu aux questions que vous nous avez adressées, vous devez, à votre tour, répondre aux nôtres.
— C’est juste, reprit l’inconnu ; soyez donc satisfaits. Je suis l’homme aux mille noms : à Mexico, on me nomme don Luis Arroyal, associé de la maison de banque Simpson, Pedro Muñez, Carvalho et Compagnie ; dans les provinces du nord du Mexique, où je me suis depuis longtemps rendu populaire par les plus folles dépenses, el Gambusino ; sur les côtes des États-Unis et dans le golfe du Mexique où, par manière de passe-temps, je commande un cutter et fais la guerre aux négriers de l’Union, the Unknown (l’Inconnu) ; chez les Nord-Américains, the Blood’s Son (le Fils du Sang) ; mais mon vrai nom, celui que me donnent les hommes qui connaissent de moi le peu qu’il me convient d’en laisser savoir, est la Venganza (la Vengeance). Êtes-vous satisfaits maintenant, caballeros ?
Personne ne répondit.
Les chasseurs avaient tous entendu parler de différentes façons de cet homme extraordinaire, les bruits les plus étranges couraient sur son compte au Mexique, aux États-Unis et jusque dans les prairies ; à côté d’actions héroïques et de traits de bonté dignes de tous éloges, on citait de cet homme des actes d’une cruauté inouïe et d’une férocité sans exemple. Il inspirait une mystérieuse terreur aux blancs et aux Peaux Rouges qui, chacun de leur côté, redoutaient de se trouver en contact avec lui, sans que, cependant, aucune preuve fût jamais venue corroborer les récits contradictoires que l’on faisait sur lui.
Souvent Valentin et ses compagnons avaient entendu parler du Blood’s Son, mais c’était la première fois qu’ils se trouvaient en face de lui, et malgré eux ils s’étonnaient de lui voir une si grande mine et une si noble prestance.
Valentin fut le premier qui recouvra son sang-froid.
— Depuis longtemps, dit-il, votre nom est arrivé à moi ; j’avais le désir de vous connaître, l’occasion s’en présente, j’en suis heureux, puisque je pourrai enfin vous juger, ce qui m’a été impossible jusqu’à présent à travers les récits exagérés que l’on fait sur vous. Vous pouvez nous être utile, dites-vous, dans l’entreprise que nous tentons, merci ; nous acceptons votre offre aussi franchement que vous nous la faites. Dans une expédition comme celle-là, l’appui d’un homme de cœur ne saurait être à dédaigner, d’autant plus que l’ennemi que nous voulons forcer dans son repaire est redoutable.
— Plus que vous ne le supposez, interrompit l’inconnu d’une voix sombre. Depuis vingt ans je lutte contre le Cèdre-Rouge, et je n’ai pu encore parvenir à l’abattre. Oh ! c’est un rude adversaire, allez ! Je le sais, moi qui suis son ennemi le plus implacable et qui jusqu’ici ai vainement employé tous les moyens pour tirer de lui une vengeance éclatante.
En prononçant ces paroles, le visage du Blood’s Son avait pris une teinte livide ; ses traits s’étaient contractés. Il semblait en proie à une émotion extraordinaire.
Valentin le considéra un instant avec un mélange de pitié et de sympathie. Le chasseur qui avait tant souffert savait, comme toutes les âmes blessées, compatir aux douleurs des hommes qui, comme lui, portaient dignement l’adversité.
— Nous vous aiderons, répondit-il en lui tendant loyalement la main ; au lieu de cinq, nous serons six à le combattre.
L’œil de l’inconnu s’éclaira d’une lueur étrange ; il serra fortement la main qui lui était tendue et répondit d’une voix sourde, avec une expression impossible à rendre :
— Nous serons cinquante, j’ai des compagnons au désert !…
Valentin jeta un regard joyeux à ses compagnons à cette nouvelle qui lui annonçait un appui formidable sur lequel il était loin de compter.
— Mais cinquante hommes ne suffisent pas pour lutter contre ce démon qui est associé aux pirates des prairies et allié aux Indiens les plus redoutables.
— Qu’à cela ne tienne, reprit Valentin ; nous nous allierons aussi à des tribus indiennes ; mais je vous jure que je ne quitterai pas la prairie sans avoir vu jusqu’à la dernière goutte couler le sang de ce misérable.
— Dieu vous entende ! murmura l’inconnu. Si mon cheval n’avait pas été aussi fatigué, je vous aurais engagé à me suivre, car nous n’avons pas un instant à perdre si nous voulons forcer cette bête fauve ; malheureusement, nous sommes obligés d’attendre quelques heures.
Curumilla s’avança.
— Voici un cheval pour mon frère pâle, dit-il en désignant du doigt l’animal que quelques instants auparavant il avait lassé.
L’inconnu poussa un cri de joie.
— En selle, s’écria-t-il, en selle !
— Où nous conduisez-vous ? demanda Valentin.
— Auprès de mes compagnons, répondit-il, dans la retraite que j’ai choisie. Là, nous nous entendrons sur les moyens qu’il convient d’employer pour abattre notre ennemi commun.
— Bon, fit Valentin, parfaitement raisonné. Sommes-nous éloignés de votre retraite ?
— Non, vingt ou vingt-cinq milles au plus ; nous y serons au coucher du soleil.
— En route alors, reprit Valentin.
Les associés se mirent en selle et s’élancèrent au galop dans la direction des montagnes.
Quelques minutes plus tard ce lieu était retombé dans son calme et son silence habituels, il ne restait plus comme preuve du passage de l’homme dans le désert que quelques cadavres mutilés au-dessus desquels les grands vautours fauves commençaient à voler en cercle avec des cris rauques et sinistres avant de s’abattre dessus.
Chapitre 4 Le Cèdre-Rouge aux abois
Chapitre 4Le Cèdre-Rouge aux abois
Les six hommes marchaient à la suite les uns des autres, suivant une de ces inextricables sentes tracées par les bêtes fauves, et qui sillonnent le désert dans tous les sens. Le Blood’s Son servait de guide à la petite troupe, suivi immédiatement par Curumilla.
Le chef indien, avec le génie particulier à sa race, s’avançait silencieusement, comme toujours, mais jetant à droite et à gauche ces regards perçants auxquels rien n’échappe, et qui font des Peaux Rouges des êtres à part.
Soudain Curumilla se jeta à bas de son cheval et se courba vers le sol en poussant une exclamation de surprise.
C’était une chose si extraordinaire et tellement en dehors des habitudes de l’ulmen araucan de l’entendre parler, que Valentin pressa le pas de son cheval afin de s’informer de ce qui se passait.
— Que vous arrive-t-il donc, chef ? lui demanda-t-il dès qu’il fut auprès de lui.
— Que mon frère regarde, répondit simplement Curumilla.
Valentin descendit de cheval et se pencha vers la terre.
L’Indien lui montrait une empreinte à demi effacée, mais qui cependant conservait encore l’apparence d’un fer de cheval.
Le chasseur le considéra longtemps avec la plus grande attention, puis il se mit à marcher avec précaution du côté où l’empreinte semblait se diriger ; bientôt d’autres plus visibles apparurent à ses yeux.
Ses compagnons s’étaient arrêtés et attendaient silencieusement qu’il s’expliquât.
— Eh bien ? dit enfin don Miguel.
— Il n’y a pas de doute possible, répondit Valentin, comme se parlant à lui-même, le Cèdre-Rouge a passé par ici.
— Hum ! fit le général, croyez-vous ?
— J’en suis sûr. Le chef vient de me montrer l’empreinte parfaitement marquée du fer de son cheval.
— Oh ! oh ! observa don Miguel, un fer de cheval est un bien petit indice ; tous se ressemblent.
— Oui, comme un arbre ressemble à un autre, reprit vivement Valentin. Écoutez, le chef a remarqué que le squatter, je ne sais par quel hasard, se trouve monter un cheval ferré des quatre pieds, tandis que les hommes qui composent sa troupe n’ont les leurs ferrés que des pieds de devant ; en sus, son cheval rejette, en marchant, les pieds de côté, ce qui fait que l’empreinte n’est pas nette.
— En effet, murmura le Blood’s Son, cette observation est juste, un Indien seul pouvait la faire ; mais le Cèdre-Rouge est à la tête d’une troupe nombreuse qui n’a pu passer par ici, sans cela nous verrions ses traces.
— C’est vrai, dit le général ; que concluez-vous de cela ?
— Une chose bien simple : il est probable que le Cèdre-Rouge aura laissé, pour des raisons qui nous sont inconnues, ses hommes campés à quelques milles d’ici, et qu’il se sera momentanément éloigné.
— J’y suis maintenant, dit le Blood’s Son ; non loin de l’endroit où nous nous trouvons se trouve un repaire de pirates, le Cèdre-Rouge aura probablement été les joindre pour leur demander assistance en cas de besoin.
— C’est cela, fit Valentin ; les traces sont toutes fraîches, notre homme ne doit pas être loin.
— Il faut le poursuivre, dit vivement don Pablo, qui, jusqu’à ce moment, avait gardé un morne silence.
— Qu’en dites-vous, caballeros ? dit Valentin en se tournant vers les assistants.
— Poursuivons-le, répondirent-ils tout d’une voix.
Alors, sans plus délibérer, ils se mirent, sous la direction de Valentin et de Curumilla, à suivre les empreintes.
Ce que le chasseur avait dit était en effet arrivé. Le Cèdre-Rouge, lorsqu’il fut entré dans le désert, après avoir installé sa troupe dans une forte position, était remonté à cheval et s’était éloigné en avertissant ses compagnons que, dans deux jours ou dans quatre au plus, il serait de retour, et en les laissant, provisoirement, sous les ordres du moine.
Le Cèdre-Rouge ne se croyait pas suivi d’aussi près par Valentin, aussi n’avait-il pris que peu de précautions pour dérober sa marche.
Marchant seul, malgré l’empreinte découverte par Curumilla, il aurait sans doute échappé aux recherches du chasseur et de l’Indien, mais sans qu’il s’en aperçût, en quittant son camp, un de ses chiens l’avait suivi ; les traces laissées par l’animal servirent de guide à ceux qui le poursuivaient au moment où ils avaient complètement perdu sa piste.
Cependant les chasseurs continuaient leurs recherches.
Valentin et Curumilla avaient mis pied à terre et s’avançaient doucement la tête baissée, examinant avec soin le sable et la terre sur lesquels ils passaient.
— Prenez garde, disait Valentin à ses compagnons qui le suivaient pas à pas, ne marchez pas si vite ; lorsque l’on suit une piste, il faut faire attention où l’on pose le pied et ne pas regarder ainsi de côté et d’autre. Tenez, ajouta-t-il en se baissant tout à coup et en arrêtant don Pablo, il y a ici des empreintes que vous alliez effacer. Voyons un peu cela, continua-t-il en regardant de plus près, ce sont les traces du fer que nous avions perdues depuis quelque temps ; le cheval du Cèdre-Rouge a une façon toute particulière de poser les pieds, que je me fais fort de reconnaître au premier coup d’œil. Hum ! hum ! continua-t-il, maintenant je sais où le trouver.
— Vous en êtes sûr ? interrompit don Miguel.
— Ce n’est pas difficile, comme vous allez voir.
— En route ! en route ! crièrent don Pablo et le général.
— Caballeros, observa le chasseur, veuillez vous souvenir que dans les prairies il ne faut jamais élever la voix. Au désert les branches ont des yeux et les feuilles ont des oreilles. Maintenant remontons à cheval et traversons le fleuve.
Les six hommes, réunis en une troupe compacte, afin d’offrir plus de résistance au courant très fort en cet endroit, firent entrer leurs chevaux dans le Gila.
Le passage s’exécuta sans encombre, et bientôt les chevaux prirent pied sur l’autre rive.
— Maintenant, dit Valentin, ouvrons les yeux, la chasse commence ici.
Don Pablo et le général restèrent sur le bord du fleuve pour garder les chevaux, et le reste de la troupe se mit en mouvement, formant une ligne de tirailleurs d’une soixantaine de pas d’étendue.
Valentin avait recommandé à ses compagnons de concentrer leurs recherches dans un espace de cent cinquante mètres au plus en demi-cercle, de façon à aboutir à un fourré presque impraticable situé au pied d’une colline qui bordait la rive du fleuve de ce côté.
Chaque homme s’avançait à pas de loup, le fusil en arrêt, regardant de tous les côtés à la fois et ne laissant pas en arrière un buisson, un caillou ou un brin d’herbe sans l’examiner attentivement.
Tout à coup Curumilla poussa un cri imitant, à s’y méprendre, le cri de la pie, signal de rassemblement en cas d’une découverte importante.
Ils se précipitèrent vers l’endroit d’où partait le signal.
Au milieu des hautes herbes, la terre était piétinée, et les basses branches des arbres cassées.
— Le cheval du Cèdre-Rouge a été attaché ici, dit Valentin ; attention ! nous allons forcer l’ours dans sa tanière. Vous savez à quel homme nous avons affaire ; soyons prudents, sinon il y aura bientôt des os brisés et des peaux trouées parmi nous.
Sans ajouter un mot de plus, le chasseur reprit la tête de la ligne ; il écarta avec soin les broussailles et s’enfonça dans le fourré sans hésiter.
En ce moment on entendit les hurlements furieux d’un chien.
— Holà ! dit une voix rude, qu’y a-t-il, Black ? Est-ce que les Peaux Rouges n’ont pas assez de leur leçon de cette nuit et veulent recommencer l’attaque ?
Ces mots furent suivis du bruit sec d’un rifle qu’on arme.