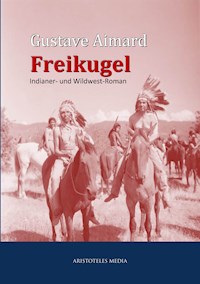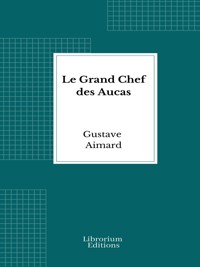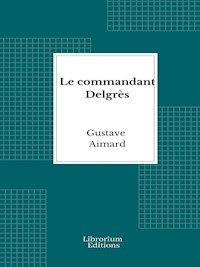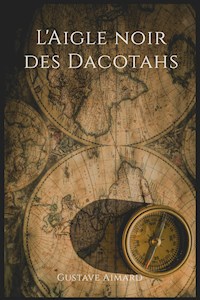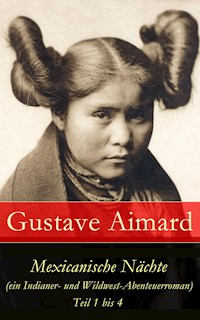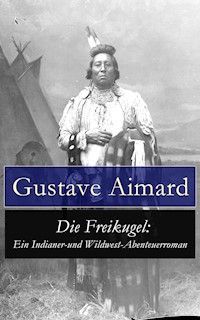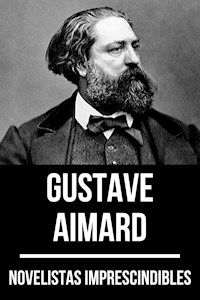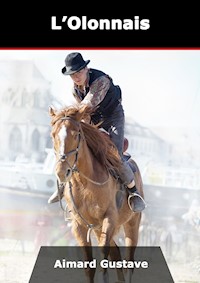Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Nous avons abandonné l'Olonnais, au moment où, grâce à l'appui qui lui avait prêté Vent-en-Panne, il avait réussi à délivrer la duchesse de la Torre et sa fille des mains des Espagnols. Les deux dames s'étaient évanouies ; la duchesse, soulevée dans les bras robustes de Pitrians, fut transportée dans la clairière et remise à son mari : quant à la jeune fille l'Olonnais ne voulut laisser à personne le soin de la rendre à son père."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À M. VICTOR AZAM
Cher Ami,
Je te dédie cet ouvrage en souvenir de notre vieille et constante amitié,
GUSTAVE AIMARD.
Nous avons abandonné l’Olonnais, au moment où, grâce à l’appui que lui avait prêté Vent-en-Panne, il avait réussi à délivrer la duchesse de la Torre et sa fille des mains des Espagnols.
Les deux dames s’étaient évanouies ; la duchesse, soulevée dans les bras robustes de Pitrians, fut transportée dans la clairière et remise à son mari : quant à la jeune fille, l’Olonnais ne voulut laisser à personne le soin de la rendre à son père.
La poursuite des ravisseurs avait entraîné les flibustiers assez loin du lieu, où primitivement s’était livré le combat. L’Olonnais demeuré seul près de doña Violenta, car tous les flibustiers avaient répondu à l’appel de Vent-en-Panne, et s’étaient élancés sur ses pas, enleva délicatement la jeune fille entre ses bras, et se mit en marche pour rejoindre ses compagnons.
Depuis quelques jours à peine, l’Olonnais avait débarqué à Saint-Domingue, c’était la première fois qu’il s’enfonçait si avant dans l’intérieur ; il ne connaissait pas le pays.
À cette époque, déjà bien loin de nous, Saint-Domingue n’était en réalité qu’une immense forêt vierge ; coupée çà et là, par de vastes savanes, où l’herbe poussait drue, et s’élevait parfois à six, sept, et même huit pieds de hauteur.
Les établissements fondés par les Espagnols et les Français, l’avaient été sur le bord de la mer seulement. On avait défriché quelques centaines d’acres de terre, et tout avait été dit.
Depuis l’invasion des Français, et la façon audacieuse dont ils s’étaient établis dans l’île, les Espagnols contraints de se défendre, contre les attaques continuelles de ces implacables ennemis, avaient, à la vérité établi un cordon de ranchos le long de leurs frontières, ranchos que, avec tout l’orgueil castillan, ils décoraient pompeusement du nom de villes. Mais ces misérables bourgades disséminées à de longues distances, étaient enfouies et comme perdues, au milieu de l’Océan de verdure, qui les cernait de toutes parts.
Les forêts américaines sont excessivement redoutables ; par cette double raison que la végétation y est tellement puissante, que les arbres y atteignent une hauteur considérable, et font régner, sous leur couvert, un jour crépusculaire ; de plus ces forêts sont invariablement composées de la même essence. Il faut donc avoir acquis une grande expérience, et surtout une grande habitude de la vie des bois, pour ne pas courir le risque de s’égarer sous ces dômes de verdure, où tout bruit meurt sans écho ; où l’air ne circule qu’avec peine, et où la névrose ne tarde pas à amener l’anémie, et la mort.
Les exemples sont, nombreux de chasseurs perdus dans les forêts américaines, qui ont pendant des semaines entières tourné dans le même cercle ; et qui, s’ils n’ont pas succombé, ont été retrouvés, les cheveux blanchis et privés de raison ; il est admis en principe, que lorsqu’on est perdu dans une forêt vierge, on y meurt.
Après avoir marché pendant environ une demi-heure, l’Olonnais reconnut avec épouvante, qu’il s’était égaré.
Il déposa doucement son léger fardeau à terre ; il craignait en continuant à marcher, de s’égarer davantage ; et allant puiser de l’eau dans son chapeau à une source voisine de l’endroit où il se trouvait, il essaya de faire revenir la jeune fille à elle.
L’évanouissement de doña Violenta, avait été causé seulement par la terreur profonde qu’elle avait éprouvée, à la brutale agression dont elle avait failli être victime. Elle ne tarda pas à ouvrir les yeux ; sa surprise fut extrême, en se voyant seule avec l’Olonnais, dans un lieu aussi désert.
De toutes les facultés de l’homme, la mémoire est celle qu’il perd le plus vite, mais aussi celle dont en général il reprend le plus tôt possession.
La jeune fille se rappela bientôt les évènements qui s’étaient passés ; une légère rougeur empourpra ses joues pâlies, et fixant son doux regard sur le flibustier, en même temps qu’elle essayait de sourire :
– Oh ! je me souviens, dit-elle, c’est vous qui m’avez sauvée !
– Hélas ! mademoiselle, répondit l’Olonnais, je donnerais ma vie, pour que vous disiez vrai ; mais je crains malheureusement de ne vous avoir sauvée d’un danger terrible, que pour vous exposer à un plus terrible encore !
– Que voulez-vous dire ? murmura-t-elle.
– C’est en vain que depuis une demi-heure j’essaie de rejoindre mes compagnons. Vous le savez, je ne suis que depuis peu dans ce pays ; je ne le connais pas, et force m’est de vous avouer que je ne retrouve plus ma route.
– N’est-ce que cela ? dit-elle en riant avec insouciance ; je ne vois pas là grande raison de s’effrayer ; nos amis ne nous voyant pas revenir, se mettront à notre recherche ; il est impossible qu’ils ne nous retrouvent pas, si nous ne les retrouvons pas nous-mêmes.
– Je suis heureux de vous voir si courageuse, mademoiselle.
– Qu’ai-je à redouter ? n’êtes-vous pas près de moi ? depuis que je vous ai rencontré pour la première fois, je ne compte plus les services que vous m’avez rendus ; aussitôt qu’un danger m’a menacée, je vous ai toujours vu apparaître à mes côtés, prêt à me défendre et toujours votre protection m’a sauvegardée.
– Mademoiselle !
– Oh ! je ne suis pas ingrate ! si je ne vous ai rien dit, c’est que les circonstances ne m’ont pas permis de le faire ; mais puisque aujourd’hui l’occasion s’en présente enfin, je la saisis avec empressement, monsieur, pour vous témoigner toute la reconnaissance que j’éprouve pour les services que vous m’avez rendus.
En parlant ainsi, le visage de la jeune fille s’était couvert d’une pâleur subite ; elle avait baissé ses yeux si doux, dans lesquels brillaient des larmes.
– Oh ! mademoiselle ! que suis-je ? pour que vous daigniez me parler ainsi que vous le faites ; si j’ai été assez heureux pour vous rendre quelques services, j’ai trouvé dans mon cœur, tout le prix que j’en pouvais attendre ; je ne saurais rien réclamer de plus. Je ne suis qu’un être obscur ; perdu dans la foule, dont jamais, hélas ! je ne réussirai à sortir ; je suis trop loin de vous pour qu’un de vos regards s’égare sur moi.
– Vous êtes injuste, et vous me jugez mal, monsieur. L’affection que vous porte mon père est grande ; ma mère vous considère comme un ami fidèle et dévoué ; ne me permettez-vous donc pas de vous regarder moi aussi comme tel.
– Cette amitié, mademoiselle me comble de joie, dit-il avec une profonde expression de tristesse ; elle dépasse de si loin tout ce que j’aurais osé espérer, que je ne trouve pas dans mon cœur, de paroles pour exprimer les sentiments que me fait éprouver cette adorable bonté.
– Laissons cela ; dit gaiement la jeune fille en se levant, et rétablissant par un geste gracieux de désordre de sa toilette ; je suis une princesse malheureuse et persécutée ; enlevée par de méchants enchanteurs et délivrée par un preux chevalier ; cela n’est-il pas bien ainsi ?
– Oui, vous avez raison mademoiselle ; seulement le preux chevalier n’est qu’un pauvre frère de la Côte, un homme presque mis hors la loi commune.
– Ne dites pas cela, en quelques jours à peine ; vous avez su conquérir une place très honorable parmi vos compagnons ; souvenez-vous de ceci, monsieur : qui possède courage, persévérance et loyauté, doit acquérir los, richesses et bonheur.
– Est-ce une prophétie que vous me faites ? répondit l’Olonnais avec un sourire amer.
– Non, dit-elle, en détournant la tête pour cacher sa rougeur, mais c’est peut-être un espoir que j’exprime.
Il y eut un court silence.
Les deux jeunes gens étaient en proie à une émotion d’autant plus vive, qu’ils essayaient davantage de la cacher.
– Vous sentez-vous assez forte, mademoiselle, reprit l’Olonnais après un instant, pour essayer avec moi de retrouver notre route ? ou préférez-vous attendre mon retour auprès de cette source ?
– Non pas ! s’écria-t-elle vivement ; je ne veux sous aucun prétexte me séparer de vous ; donnez-moi votre bras, monsieur, je suis prête à vous suivre.
Ils se remirent en marche, après que l’Olonnais se fut orienté de son mieux.
De temps en temps, c’est-à-dire de six minutes en six minutes, le flibustier déchargeait son fusil, mais vainement ; le bruit du coup de feu s’envolait, mourant sans écho sous le couvert.
Bien qu’il feignît l’indifférence et presque la gaieté, pour ne pas effrayer sa compagne, le jeune homme était en proie à une douleur, que chaque seconde qui s’écoulait rendait plus intense ; il sentait que plus il marchait, plus il s’égarait.
Les arbres se succédaient les uns aux autres, se ressemblant tous, comme s’ils eussent été taillés sur le même modèle ; les forces de la jeune fille s’épuisaient, elle commençait à peser lourdement au bras du boucanier ; bien qu’elle ne se plaignit pas, qu’elle essayât de sourire, il était facile de s’apercevoir que sa fatigue était grande.
Afin de ne pas épuiser sa petite provision de poudre, le flibustier avait été contraint, de cesser de décharger son arme.
Le jour s’avançait ; la lueur sombre qui régnait sous le couvert se faisait de plus en plus obscure ; bientôt les forces de la jeune fille la trahirent complètement ; elle s’affaissa sur elle-même.
L’Olonnais avec cette énergie que donne le désespoir, enleva la pauvre enfant à demi-évanouie, dans ses bras et essaya de continuer ses recherches.
Ce n’était pas sans un sentiment de joie douloureuse, qu’il sentait les boucles soyeuses et parfumées de la jeune fille, dont la tête languissante reposait sur son épaule, frôler doucement son visage.
Mais les forces humaines ont des limites qu’elles ne sauraient impunément franchir ; le flibustier sentait le sang lui monter à la gorge, ses tempes battaient à se rompre, des lames de feu traversaient son regard ; il n’avançait plus qu’avec peine, marchait en chancelant comme un homme ivre ; prévoyant avec terreur, que bientôt il tomberait vaincu, aux pieds de celle qu’il prétendait sauver ; quelques minutes encore, et c’en était fait.
Tout à coup, une voix claire, aux notes cristallines se fit entendre sous la feuillée,
Cette voix chantait la délicieuse ronde normande, qui commence ainsi :
L’Olonnais à ces accents bien connus, et qui lui révélaient l’approche d’un secours inespéré, sentit l’espoir rentrer dans son cœur ; il réunit toutes ses forces pour tenter un dernier effort ; à trois reprises différentes, il poussa un cri aigu, strident, particulier aux marins pendant la tempête, et qui sur l’aile de la brise s’envole à des distances considérables, cri qui n’a de comparable que celui des montagnards se répondant d’un pic à un autre.
Après son troisième cri, le jeune homme posa doucement à terre doña Violenta complètement évanouie ; et il roula sur le sol, incapable de lutter davantage.
À travers le brouillard sanglant qui obscurcissait sa vue, il lui sembla voir la forme svelte et gracieuse de Fleur-de-Mai, émerger de derrière les arbres et se diriger en toute hâte de son côté ; mais dompté par la souffrance, il perdit presque aussitôt le sentiment des objets extérieurs.
Lorsqu’il revint à lui, il aperçut Fleur-de-Mai, agenouillée à son côté, et lui prodiguant les soins les plus délicats.
Doña Violenta penchée sur lui, le regardait avec une expression étrange ; dans laquelle la joie et la douleur se confondaient tellement, qu’il était impossible de deviner lequel de ces deux sentiments dominait l’autre.
– Pourquoi te hasardes-tu ainsi dans les bois, toi qui es tout nouveau dans la colonie ? lui dit Fleur-de-Mai d’un ton de léger reproche ; si je n’avais pas pensé à toi, tu aurais été perdu ; ami ; avant deux jours ton cadavre serait devenu la proie des bêtes sauvages ; ne recommence pas de telles folies ; je ne serai pas toujours là, pour me mettre à ta recherche.
– Comment se fait-il que tu m’aies retrouvé, Fleur-de-Mai ? Je ne me souviens pas de t’avoir aperçue parmi nos compagnons ?
– C’est vrai, dit-elle avec un pâle sourire, je ne suis qu’une pauvre jeune fille, moi ; je crains le contact des frères de la Côte, quoique cependant, ils soient bons pour moi, et me traitent comme leur enfant ; mais mon cœur m’avait dit que peut-être tu aurais besoin de moi ; voilà pourquoi je me suis mise à leur suite ; lorsque le combat a été terminé, et que l’on n’a plus retrouvé la jeune demoiselle, j’ai compris d’où provenait ton absence.
– Oui, murmura doña Violenta, c’est à lui que cette fois encore je dois mon salut.
– C’est vrai, pour vous sauver, il s’est exposé à mourir ! et elle murmura comme si elle se fût parlé à elle-même : « Oh ! je le sens à mon cœur, ce doit être cela qu’on appelle de l’amour ! »
À ces paroles si brusquement prononcées sans intention apparente, les deux jeunes gens tressaillirent ; une vive rougeur empourpra leurs visages, et ils détournèrent la tête.
– Pourquoi cette émotion ? Pourquoi cette honte ? ce sentiment n’est-il pas naturel ? ne vient-il pas du cœur ? reprit Fleur-de-Mai d’une voix plaintive. De même que le soleil vivifie les plantes, l’amour est un rayonnement divin que Dieu, dans son ineffable bonté, a mis au cœur de l’homme pour épurer son âme.
– À quoi bon dire ces choses, Fleur-de-Mai ? j’éprouve, pour cette dame, le plus profond respect ; la distance est trop grande entre nous ; nos positions dans la société trop différentes, pour que le sentiment dont vous parlez puisse exister.
La jeune fille sourit doucement, en hochant tristement la tête.
– Vous essayez vainement, dit-elle, de donner le change aux sentiments qui vous agitent : vous vous aimez sans le savoir peut-être ; si vous descendiez en vous-même, vous reconnaîtriez que j’ai dit vrai.
– N’insistez pas sur ce sujet, Fleur-de-Mai ; ne serait-il pas plus convenable au contraire, maintenant que les forces de cette dame sont à peu près revenues, de la ramener près de son père, dont l’inquiétude doit être grande ?
– C’est en vain que vous essayez de me fermer la bouche, reprit-elle, avec une énergie fébrile, vous ne réussirez pas à me tromper. Pourquoi ce noble seigneur est-il venu à Saint-Domingue ? cette noble demoiselle, grâce au rang qu’elle occupe dans la société, ne manquera jamais d’adorateurs, sans qu’il lui soit nécessaire de les choisir parmi les Frères de la Côte. Vous vous aimez, vous dis-je ; quoi qu’il arrive, rien ne pourra vous empêcher d’être l’un à l’autre.
– Arrêtez, madame ! s’écria doña Violenta avec animation, je ne vous connais pas, j’ignore qui vous êtes ; mais à mon tour, je vous demanderai de quel droit vous prétendez faire ce que votre compagnon et moi nous n’avons pas osé tenter, c’est-à-dire scruter nos cœurs ? Et, quand cela serait vrai ? quand un sentiment plus doux, quand une passion plus profonde que la plus sincère amitié se serait, à notre insu, glissé dans notre âme, de quel droit prétendriez-vous nous contraindre à vous faire, à vous, un aveu que nous n’osons nous faire à nous-mêmes ? J’ai contracté d’immenses obligations envers votre ami ; nous avons, pendant plusieurs mois, vécu côte à côte sur le même navire, mais nous allons nous séparer, pour ne jamais nous revoir ; pourquoi, ou plutôt dans quel but, essayez-vous de nous rendre cette séparation plus cruelle qu’elle ne doit l’être ? vous commettez presque une mauvaise action, en essayant de provoquer des aveux que ni lui, ni moi ne pouvons, ni ne devons faire.
– Vous voyez bien que vous l’aimez, madame, mon cœur ne m’avait pas trompée ; je savais que cela était ainsi. Eh bien, je serai plus franche que vous ne le voulez l’être ; moi, madame, je n’ai aucune considération à garder ; je suis une orpheline vivant au jour le jour, comme les oiseaux du ciel ; j’aime l’Olonnais ; je l’aime de toutes les forces de mon âme, depuis la première heure où je l’ai vu ; mais cet amour ne m’a rendue ni injuste, ni jalouse, ni méchante ; il m’a seulement douée de clairvoyance, en me permettant de lire, malgré vous, dans votre cœur, comme dans un livre ouvert ; vous l’aimez et il vous aime, madame ; soit, je ne saurais l’empêcher ; je ne le pourrais et ne le voudrais pas ; mais si j’accepte cette rivalité, ou plutôt si j’admets cette supériorité, que le hasard vous donne sur moi, c’est à la condition que vous aimerez mon ami, comme je l’aurais aimé moi-même ; maintenant venez, madame, je vais vous reconduire à votre père.
– Un instant encore ? s’écria l’Olonnais avec énergie, cette explication que vous avez provoquée, Fleur-de-Mai, et dans laquelle vous nous avez entraînés malgré notre volonté, doit être complète. Quel que soit le sentiment qui m’agite et gronde dans mon cœur, il faut que Mlle de la Torre sache bien ceci : que je professe pour elle un inaltérable dévouement, que quoi qu’il advienne, je serai toujours le plus respectueux de ses serviteurs, que le jour où elle me demandera ma vie, ce sera avec joie que je la lui donnerai.
– Monsieur, répondit la jeune fille avec émotion, j’ai peut-être regretté un instant, l’intervention étrange quoique bienveillante, de votre amie Fleur-de-Mai ; à présent je ne sais pourquoi, mais il me semble que je suis presque heureuse, de l’avoir entendue parler ainsi qu’elle l’a fait.
– Oh ! mademoiselle ! s’écria-t-il avec passion.
Elle l’interrompit d’un geste et continua avec un sourire triste :
– Dans quelques heures nous serons séparés, mais le cœur franchit les distances, et les pensées dans leur vol rapide, sont toujours près de ceux qu’on aime. Bien que séparées matériellement, nos âmes seront toujours ensemble ; si la différence de ma position sociale exige de moi une certaine réserve, et m’empêche d’exprimer plus clairement ma pensée, pardonnez-moi.
Elle arracha un médaillon suspendu à son cou par une légère chaîne d’or et le présentant au jeune homme.
– Conservez ce souvenir, dit-elle, que ce soit le lien qui nous rattache l’un à l’autre ; soyez bien convaincu, que quoi que le sort décide de moi, jamais je n’oublierai ni les services que vous m’avez rendus, ni l’attachement profond et respectueux que vous m’avez voué.
Le jeune homme prit le médaillon, qu’il pressa sur son cœur, et détournant la tête il fondit en larmes, seul moyen qui lui restait d’exprimer ce qu’il éprouvait et ce qu’il n’osait dire.
– Bien, dit Fleur-de-Mai, vous êtes une noble nature, madame ; Dieu, qui a fait égaux tous les êtres qu’il a créés, saura, croyez-le bien, abaisser les barrières qui s’élèvent entre vous et mon ami. Prends courage, l’Olonnais, tu es jeune, tu es beau, tu es aimé, un jour viendra où tu seras heureux.
Elle prononça ces dernières paroles d’une voix étouffée et les yeux pleins de larmes ; mais bientôt elle releva la tête doucement sourit et sans ajouter un mot elle ouvrit les bras :
Les deux jeunes femmes demeurèrent un instant embrassées ; puis se prenant par la main, elles se mirent en marche pour rejoindre les chasseurs, suivies par l’Olonnais, dont le front pâle et les yeux brûlés de fièvre laissaient deviner le feu intérieur dont il était dévoré.
Ainsi que cela arrive toujours en pareille circonstance, l’Olonnais depuis sa séparation d’avec les frères de la Côte, n’avait fait qu’errer au hasard, mais sans s’éloigner, et en tournant toujours dans le même cercle ; de sorte que lorsqu’il avait rencontré Fleur-de-Mai, lui et Mlle de la Torre, se trouvaient à peine à deux portées de fusil de l’endroit où les flibustiers avaient fait halte.
Fleur-de-Mai, élevée au désert, se dirigeait avec une adresse merveilleuse, au milieu de ce dédale en apparence inextricable, dans lequel elle trouvait son chemin, sans paraître même le chercher.
Tout à coup, le petit groupe émergea du couvert dans une clairière, où les flibustiers avaient établi leur campement provisoire.
La joie fut générale en apercevant Mlle de la Torre ; le duc et la duchesse remercièrent avec effusion l’Olonnais, d’avoir sauvé leur fille.
Le jeune homme eut beau protester que ce qu’il avait fait se réduisait à très peu de chose ; qu’il s’était égaré dans la forêt ; que sans Fleur-de-Mai qui les avait providentiellement rencontrés, leur position était désespérée ; personne ne voulut ajouter foi à ces paroles, que du reste Fleur-de-Mai démentait avec énergie ; force lui fut donc de passer aux yeux de tous pour un héros.
Quelques instants plus tard, l’engagé que M. d’Ogeron avait expédié au Port-Margot, revint avec des chevaux ; ce fut en vain que Montbarts, le Beau Laurent, et les autres chefs de la flibuste, proposèrent aux dames de pousser jusqu’au boucan du Poletais, dont on se trouvait alors très rapproché ; elles ne voulurent pas y consentir. Elles étaient brisées par les émotions successives qu’elles avaient éprouvées, et n’avaient qu’un désir : rentrer dans la ville le plus tôt possible.
On reprit donc la direction du Port-Margot. Ce fut alors, et au moment où la troupe se remettait en marche, qu’elle fut rejointe par l’engagé de Vent-en-Panne. Nous avons rapporté plus haut, qu’elle fut l’issue de sa mission auprès de l’Olonnais.
Il était près de dix heures du soir, lorsque les promeneurs harassés de fatigue, atteignirent la ville, qu’ils avaient quittée si joyeusement, le matin.
L’Olonnais se retira dans la maison de Vent-en-Panne, emportant dans son cœur du bonheur pour une vie entière ; ou du moins il le croyait.
Le lendemain de cette journée si accidentée, et cependant si heureusement terminée, un orage effroyable éclata sur Saint-Domingue.
Cette fois encore, l’Olonnais eut l’occasion de se signaler et de faire preuve de ce dévouement sans bornes à ses semblables, qui était le côté saillant de son caractère. Sans son courage, son adresse et surtout la connaissance approfondie qu’il possédait de son métier de marin, plusieurs navires et entre autres le vaisseau Le Robuste, auraient été jetés à la côte, et brisés sur les rochers.
Aux premiers éclats de la foudre, aux premiers déchirements de l’ouragan, le jeune homme s’élança au dehors. Par son exemple il électrisa la population, suivi par Montbarts, Pitrians, le Crocodile, Montauban et les plus célèbres flibustiers, qui comme lui, armèrent des pirogues, les montèrent bravement ; il se rendit à bord des bâtiments en perdition, et réussit à les sauver.
Le Robuste, mouillé sur une seule ancre, avait eu son câble rompu ; une seconde ancre jetée trop précipitamment n’avait pas accroché le fond, qu’elle draguait et ne pouvait arrêter la dérive du navire. Presque tous les officiers étaient à terre, l’équipage perdait la tête. Pendant que Montbarts faisait dépasser les mâts de perroquet, caler les mâts de hune et mettre les basses vergues sur les porte-lofs, pour alléger le navire, en donnant moins de prise à la tempête ; l’Olonnais et le capitaine Montauban, montés chacun sur une pirogue qui faisait eau de toutes parts, ballottés comme des bouchons de liège, par les lames furieuses, qui parfois passaient par-dessus leurs embarcations, allèrent, au péril de leur vie, mouiller des ancres à jet au large.
L’équipage du Robuste suivait anxieusement du regard cette audacieuse manœuvre, qui réussit providentiellement ; on aurait dit que la mort reculait devant ces téméraires frères de la Côte.
Au moment où l’on raidit les câbles au cabestan, il n’y avait plus un instant à perdre ; le Robuste n’était plus qu’à une portée de pistolet des rochers.
La tempête se prolongea pendant toute la journée, et toute la nuit suivante ; l’ardeur des flibustiers ne se ralentit pas une minute ; mais le lendemain, lorsque l’ouragan se calma, que la mer redevint maniable, les habitants du Port-Margot constatèrent avec joie que pas un bâtiment n’avait péri pendant la tempête.
M. de la Torre et sa fille, en proie à une terreur profonde, avaient assisté avec une anxiété extrême à cette lutte héroïque, soutenue par ces hommes que l’on était accoutumé à considérer presque comme des bandits, contre les éléments déchaînés et furieux.
Rapporter les remerciements qui furent adressés aux frères de la Côte, et particulièrement à l’Olonnais, serait retomber dans des redites ; nous nous abstiendrons donc d’en parler.
Cependant le rude assaut que son navire avait eu à soutenir, avait donné beaucoup à réfléchir à M. de Lartigues ; il ne se souciait point de s’exposer à une nouvelle tempête, en prolongeant davantage son séjour à Port-Margot.
Comme le cartel parlementaire, qu’il avait demandé au gouverneur de la Havane, pour transporter M. de la Torre et sa famille à la Vera-Cruz, avait été reçu depuis quelques jours déjà par M. d’Ogeron, le commandant du Robuste résolut de mettre le temps à profit, en appareillant au plus vite.
Cette résolution annoncée par M. de Lartigues à la table de M. d’Ogeron, en présence de plusieurs flibustiers invités par le gouverneur, causa une grande émotion à tous les convives ; émotion qui fut surtout vivement ressentie par deux personnes, l’Olonnais et Mlle de la Torre, qui échangèrent un regard empreint d’une navrante tristesse ; pendant tout le temps que dura le repas, ils n’eurent plus le courage de se mêler à la conversation.
Cependant en se levant de table et au moment de prendre congé, l’Olonnais rappelant à lui tout son courage, fit un effort suprême, et s’approchant du duc qui causait avec M. d’Ogeron :
– Monsieur le duc, lui dit-il en le saluant courtoisement ainsi que les deux dames, permettez-moi de vous faire mes adieux, et en même temps de vous adresser tous mes souhaits, pour que vous rencontriez au milieu de vos compatriotes, autant de respectueuses sympathies que vous en avez trouvés parmi nous ; vous allez occuper une position presque royale ; mais mieux que moi, vous le savez sans doute, M. le duc, il n’y a rien de stable que le malheur ; Dieu veuille que ceux qui pendant de si longues années, ont poursuivi votre famille ne vous atteignent pas de nouveau. Mais, ajouta-t-il, en jetant un regard sur doña Violenta, dont les yeux étaient ardemment fixés sur son mâle visage, si, ce que Dieu ne veuille, vos ennemis l’emportaient de nouveau sur vous ; je crois être ici l’interprète de tous mes compagnons, en vous rappelant que sur un rocher perdu de l’Atlantique, il existe des cœurs qui battent pour vous. Vous êtes l’hôte des frères de la Côte, ne l’oubliez pas plus qu’ils ne l’oublieront eux-mêmes. Le jour où vous aurez besoin de leur appui, vous les trouverez tous, prêts à vous défendre. Un mot seulement, un chiffre, un signe quelconque, et nous accourrons vers vous, comme un vol de vautours. Malheur, alors, à ceux qui oseront nous barrer le passage !
– Je n’attendais pas moins de vous, riposta le duc avec chaleur, en lui serrant cordialement la main ; si je suis né en Espagne, j’ai été élevé en France ; c’est dans ce pays que j’ai aimé et souffert, je suis donc Français de cœur ! je vous remercie du fond de l’âme de cette offre généreuse ; cette offre je l’accepte ; ainsi que vous-même me l’avez rappelé, je n’oublierai jamais que j’ai été l’hôte des frères de la Côte ; le jour où j’aurai besoin d’eux je n’hésiterai pas à les appeler ; embrassez-moi, l’Olonnais, nous nous séparons comme deux frères, deux amis. Un de mes plus doux souvenirs sera les quelques jours heureux que j’ai passés à St. -Domingue, parmi les flibustiers ; ces hommes si méconnus, et qui cependant méritent tant d’être appréciés à leur valeur. Adieu à vous, l’Olonnais, adieu à vous tous, messieurs ; n’oubliez pas que le duc de la Torre est vice-roi du Pérou. Vos vaisseaux seront toujours reçus dans ses ports, soit pour se garantir de la tempête, soit pour se ravitailler, soit enfin, pour chercher protection contre un ennemi.
– Messieurs, dit alors M. de Lartigues, les remerciements que je vous adresserais pour les services que vous avez rendus à mon vaisseau, n’exprimeraient que très faiblement la reconnaissance que j’éprouve pour vos généreux procédés. Dans trois mois, je serai de retour en France ; bientôt je l’espère, vous aurez la preuve que j’ai vu le roi, et que je lui ai rendu compte de votre conduite.
Les adieux se prolongèrent quelques instants encore, enfin on se sépara.
L’Olonnais avait le cœur navré ; sa souffrance était d’autant plus grande, qu’il était seul, et ne pouvait épancher sa douleur dans le sein d’un ami.
Au lieu de rentrer chez lui, où il lui aurait été impossible de trouver le calme dont il avait besoin, il alla tristement errer sur la plage, espérant que la solitude rendrait un peu d’équilibre à son esprit, et réveillerait son courage ; il prolongea ainsi sa promenade jusqu’à un bloc de rochers déchiquetés par la mer, et qui aux rayons de la lune prenait des proportions presque fantastiques.
Là, il s’assit, cacha sa tête dans ses mains, et s’absorba dans sa douleur.
Plusieurs heures s’étaient écoulées, sans qu’il eut changé de position ; les étoiles commençaient à s’effacer dans le ciel, lorsqu’une main se posa légèrement sur son épaule, et une voix harmonieuse murmura doucement à son oreille :
– Pourquoi pleures-tu ainsi ? cette séparation était prévue ; elle était inévitable, ne t’abandonne pas à ta douleur ; sois homme ; l’adversité grandit le cœur.
L’Olonnais releva la tête ; il vit devant lui, comme un blanc fantôme, Fleur-de-Mai dont un sourire triste éclairait le gracieux visage.
– Merci de venir ainsi me consoler, Fleur-de-Mai ; répondit le jeune homme d’une voix plaintive, oh ! si tu savais combien je souffre !
– Je le sais, répondit-elle tristement en posant la main sur son cœur ; mais tu te trompes, ami, je ne viens pas te consoler, je viens de te dire : Courage.
– Courage ! murmura-t-il, lorsque tout me manque à la fois ! lorsque je reste seul !
– Non, tu n’es pas seul ; tu as des amis qui t’aiment, et ceux qui partent ne t’oublieront pas. Ce que l’homme fait, Dieu peut le défaire ; déjà je te l’ai dit ; celui qui pleure sera consolé ; il n’y a d’éternel que l’adieu prononcé par une bouche mourante. Espère ! bientôt peut-être, tu retrouveras celle qui va partir. Je l’ai vue, moi.
– Tu as vu doña Violenta, Fleur-de-Mai ? s’écria-t-il avec passion.
– Oui, je l’ai vue ; comme toi, elle succombait sous le poids de la douleur, je lui ai parlé, elle m’a chargée de t’apporter sa dernière parole ; cette parole qui doit être entre vous un signal, si quelque jour elle a besoin de toi.
– Que t’a-t-elle dit ? répète-le-moi vite.
– Oh ! que tu es impatient !
– Si tu savais combien je l’aime, Fleur-de-Mai.
– Oui, tu l’aimes bien ; reprit-elle d’une voix profonde.
– Mais, interrompit l’Olonnais, sans même avoir écouté les paroles de la jeune fille, tu ne me dis pas ce mot qu’elle t’a chargée de me répéter.
– Écoute-moi donc puisque tu veux le savoir, c’est un mot castillan : Recuerdo.
– Merci, Fleur-de-Mai ; merci, tu es bonne ; tu m’as rendu bien heureux.
La jeune fille soupira ; elle jeta un long regard au flibustier dont la tête était retombée pensive sur sa poitrine ; et elle s’éloigna lentement en murmurant à demi-voix :
– Il est heureux !… et moi ?…
Bientôt son gracieux profil s’effaça dans les ténèbres.
Au lever du soleil, le Robuste appareilla et poussé par une bonne brise, il ne tarda pas à disparaître en haute mer.
Le soir du même jour, Vent-en-Panne revint à Port-Margot, l’ouragan l’avait contraint malgré lui à différer son retour.
Les deux matelots eurent une longue conversation pendant laquelle l’Olonnais raconta franchement à son ami, sans rien lui cacher, ce qui s’était passé entre lui et doña Violenta.
Vent-en-Panne regretta beaucoup de ne pas avoir vu le duc de la Torre avant son départ, afin de le mettre en garde contre ses ennemis, en le prévenant des machinations qu’ils tramaient traîtreusement contre lui.
Ce fut à la suite de cette importante conversation entre les deux matelots, qu’ils résolurent de tenter une expédition contre San Juan de la Maguana, afin de s’emparer, s’il était possible, des papiers importants que le Chat-Tigre devait avoir entre les mains.
Nous reprendrons maintenant notre récit au point où nous l’avons interrompu ; c’est-à-dire, au moment où les deux frères de la Côte se sont endormis, presque en vue du village, dans lequel ils voulaient s’introduire.
Il était près de trois heures de l’après-midi ; cependant les deux flibustiers et leurs engagés dormaient encore aussi profondément que s’ils n’eussent jamais dû se réveiller.
Qui sait pendant combien de temps encore ce sommeil se serait prolongé, si tout à coup les Venteurs, qui eux, ne dormaient pas heureusement, n’avaient comme d’un commun accord, non pas donné de la voix, mais simplement poussé une plainte étouffée presque insaisissable ; on aurait cru que les braves bêtes comprenaient de quelle importance il était pour leurs maîtres de ne pas trahir leur présence.
Cependant si faible que fut cette plainte, elle suffit pour éveiller des hommes auxquels la continuelle appréhension de dangers terribles tenait, même dans le sommeil, l’esprit en vedette.
– Eh ! qu’y a-t-il, Monaco ? demanda Vent-en-Panne, à l’un des Venteurs, dont les yeux animés d’une expression presque humaine étaient fixés sur lui.
L’intelligent animal remua la queue et pointa le museau dans la direction de l’étang de Riquille, en grondant sourdement, mais cependant d’une façon toute amicale.
– Ah ! ah ! fit Vent-en-Panne, il parait qu’il nous arrive des visites ? voyons un peu à qui nous allons avoir affaire ?
Son attente ne fut pas longue, à peine achevait-il de parler que deux hommes parurent.
Ces deux hommes, armés jusqu’aux dents, marchaient avec une précaution extrême ; sept ou huit engagés les suivaient à distance.
– Eh ! fit le flibustier, Montbarts et Montauban ! ils sont en avance, il me semble ; ou bien aurions-nous par hasard dormi trop longtemps, et me tromperais-je sur l’heure ? cela serait singulier ! enfin attendons.
Montbarts et Montauban, les deux célèbres chefs de la flibuste, dont l’un au moins est déjà connu du lecteur, continuaient à s’avancer ; mais en redoublant de précautions, au fur et à mesure qu’ils approchaient de l’endroit, où Vent-en-Panne et ses compagnons étaient campés.
Lorsqu’il les vit assez proches de lui, le vieux frère de la Côte se décida à se montrer ; les arrivants négligèrent alors toutes précautions et marchèrent résolument en avant ; il ne leur fallut que quelques minutes pour rejoindre leurs amis ; les compliments furent brefs ; ce n’était pas une visite de cérémonie, mais un rendez-vous d’affaires ; les flibustiers étaient en expédition.
– Quoi de nouveau ? demanda Montbarts.
– Rien ; nous sommes arrivés à onze heures du matin ; rien n’a bougé autour de nous.
– Bon ! les Gavachos ne se méfient pas alors ! fit le capitaine Montauban, charmant jeune homme de vingt-cinq ans au plus, aux manières exquises, aux traits fins et aristocratique, et dont la physionomie avait une rare expression de douceur féminine. Cordieu ! nous allons avoir une belle camisade, on pourra jouer des couteaux !
– Allons ! allons ! Montauban, lui dit en souriant Montbarts, calme-toi un peu. Tudieu ! comme tu prends feu, compagnon !
– C’est vrai ; mais aussi c’est si amusant de houspiller les Gavachos.
– Le Poletais n’a pas encore paru ? demanda Montbarts.
– Il ne devait pas venir ici ; son poste était du côté de l’étang de Riquille.
– C’est juste ! combien a-t-il d’hommes avec lui ?
– Il n’a que ses engagés ; cinq rudes compagnons.
– Nous disions donc : Le Poletais, et cinq engagés, six ; Montauban, moi, et nos engagés, seize ; cela fait vingt-deux, vous autres, huit, trente, très bien et le beau Laurent ?
– Il amène quinze hommes.
– Quarante-six ; Ourson Tête-de-Fer ?
– Dix-huit hommes ; avec lui, dix-neuf bien entendu.
– Bon ; quarante-six et dix-neuf, soixante-cinq ; est-ce tout ?
– Mais oui, reprit Vent-en-Panne, je n’ai pas supposé qu’il fallût plus de monde pour une expédition comme celle-ci.
– Le fait est, appuya Montbarts, que nous n’avons pas à redouter une grande résistance ; quelle est la population de ce village à peu près ?
– Cinq cents habitants tout au plus ; dit Vent-en-Panne ; et une garnison composée de trois cinquantaines commandées par un capitaine.
– Oh ! alors nous en viendrons facilement à bout ! dit Montauban.
– Diable ! compagnons, comme vous y allez ! fit en riant l’Olonnais ; une population que vous évaluez au moins à cinq-cents âmes ; une garnison de cent cinquante soldats ! vous trouvez que ce n’est rien contre soixante-cinq hommes, et derrière de bonnes murailles !
Les flibustiers se mirent à rire.
– Tu es encore nouveau parmi nous, matelot, lui dit paternellement Vent-en-Panne ; il te reste encore beaucoup de choses à apprendre, d’abord celle-ci : règle générale en moyenne, un flibustier vaut dix Gavachos, en rase campagne ; derrière de bonnes murailles, ainsi que tu le dis fort élégamment, il peut très bien en abattre six ; ainsi soixante-cinq flibustiers représentent en réalité le chiffre fort respectable de trois cent quatre-vingt-dix hommes résolus et bien armés ; tu vois que c’est plus que suffisant, d’autant plus que dans la population, il faut défalquer, les femmes, les enfants, les vieillards, les moines et les poltrons ; c’est-à-dire au moins les trois quarts des habitants.
– Très bien, insista l’Olonnais, mais restent toujours les soldats.
– Ah c’est vrai, mais ceci est une autre affaire ; les soldats sont pour nous les ennemis les moins redoutables ; voici pourquoi : dans les premiers temps de l’occupation de Saint-Domingue par les frères de la Côte, le gouvernement espagnol avait armé les cinquantaines d’excellents mousquets ; tu sais, n’est-ce pas, que ces cinquantaines ont été créées, dans le but spécial de donner la chasse aux boucaniers ? Or, il arriva ceci : chaudement reçus par nous dans plusieurs rencontres, et rudement houspillés, ainsi que le disait tout à l’heure Montauban, ces pauvres soldats prirent une si grande frayeur de nous, que chaque fois qu’on les expédiait à notre recherche, à peine entraient-ils dans la savane qu’ils commençaient un feu roulant qui durait tant qu’il leur restait une charge de poudre. Ils faisaient ainsi un tel vacarme, que les flibustiers prévenus par le bruit, les laissaient tranquillement continuer leur inoffensive fusillade, et allaient chasser d’un autre côté. Le gouvernement espagnol, toujours intelligent, feignit de se tromper sur le but de ces fusillades intempestives. Au lieu de les attribuer à la lâcheté de ses soldats, il en conclut que ceux-ci méprisaient les armes à feu, bonnes seulement dans les combats à distance ; et préféraient des armes qui leur permissent de lutter corps à corps contre nous. Fort de ce raisonnement, le gouvernement retira aux cinquantaines leurs fusils, et les remplaça par des lances ; de sorte que les pauvres diables quand on les conduit contre nous, marchent en avant, comme des chiens qu’on fouette, où comme des veaux que l’on mène à l’abattoir, car ils ont à l’avance la conviction de leur défaite.
– Ah ! pardieu, matelot voilà qui est fort ! tout ce que tu me racontes là est bien vrai ! tu ne brodes pas un peu ?
– Non ; tout est d’une exactitude rigoureuse ; tu vois, donc que les cent cinquante hommes de la garnison, ne sont pour nous d’aucune importance.
– Oui, ajouta, Montauban, et les Gavachos vont recevoir une jolie brûlée ! que le diable les emporte ! ce sera bien fait pour eux ! À quelle heure donnons-nous l’assaut ?
– Trois heures après le coucher du soleil ; c’est-à-dire à neuf heures ; il faut donner aux señores le temps de s’endormir ; d’ailleurs ils se couchent de bonne heure.
– Oh ! alors, reprit Montbarts, nous avons du temps devant nous ! si j’avais su cela, je ne me serais pas autant pressé d’arriver.
– Comment diable, dit Montauban, allons-nous tuer les heures qui nous restent à attendre.
– Que cela ne vous inquiète pas, compagnons, dit Vent-en-Panne, nous causerons ; cela nous aidera à tromper notre impatience.
– Et puis, ajouta Montbarts, je crois que nous ne ferions pas mal d’envoyer deux de nos engagés battre l’estrade, afin de s’assurer si nos compagnons sont à leurs postes.
– Qui, ceci sera prudent.
Deux engagés furent aussitôt appelés, ils reçurent des instructions détaillées et ils s’éloignèrent.
San Juan de la Maguana n’existe plus aujourd’hui ; elle a été remplacée par la petite ville de San Juan, située à quelques lieues plus bas sur la rivière de Neybe ; à l’époque où se passe notre histoire, elle s’élevait sur les bords d’une petite rivière, nommée la Maguana, qui n’est qu’un affluent du Neybe.
Cette ville, ou plutôt ce village, formait alors la limite extrême de la frontière espagnole ; comme telle c’était un point stratégique d’une très grande importance, pour défendre les possessions espagnoles contre les déprédations des boucaniers.
Cet établissement n’avait, dans le principe, été fondé que dans un but essentiellement militaire ; son existence ne remontait pas à plus de trente ou quarante ans.
D’abord ce n’avait été qu’un fortin, ou plutôt un blockaus, comme on dirait aujourd’hui, construit en troncs d’arbres reliés entre eux par des crampons de fer ; entouré d’un large fossé, d’un talus en terre, auquel deux ou trois ans auparavant, on avait ajouté un chemin couvert, des casemates, et un ouvrage à cornes.
Quelques ranchos misérables s’étaient groupés autour de ce fortin ; peu à peu le nombre de ces ranchos s’accrut ; puis, comme cela arrive toujours dans les centres de population espagnole, on avait bâti une église, trois ou quatre chapelles, fondé deux couvents, un de carmélites pour les femmes, l’autre de capucins.
La population s’était ainsi augmentée jusqu’à atteindre le chiffre de cinq à six cents âmes ; population pauvre, honnête, spécialement occupée au défrichement des forêts, à la culture de la terre et à l’élève des bestiaux.
Pour garantir cette population, une enceinte avait été tracée et un fossé creusé ; on y avait ajouté un talus en terre et un petit fortin, qui ainsi que le premier protégeait le cours de la rivière. Chacun de ces fortins était armé de deux petits canons de bronze, de quatre livres de balles ; de deux espingoles et de quatre fusils de remparts. Cet armement en réalité bien faible, paraissait cependant suffisant pour protéger le village contre un coup de main des flibustiers ; en effet, jusque-là, il avait suffi.
San Juan de la Maguana, dont les ranchos étaient étagés en amphithéâtre sur les pentes d’une haute colline, dernier contrefort des montagnes Noires, baignait le pied de ses dernières maisons dans la rivière, offrait l’aspect le plus charmant et le plus pittoresque ; avec ses constructions mauresques, à toits plats, badigeonnées au lait de chaux, et à demi-enfouies sous un fouillis de bananiers, de grenadiers, d’orangers et d’autres arbres, des régions intertropicales.
Telle était la ville dont soixante-cinq flibustiers avaient résolu de s’emparer par surprise.
Maintenant, pourquoi les frères de la Côte avaient-ils formé cette résolution ? c’est ce que nous allons expliquer en deux mots.
Lorsque Vent-en-Panne avait assisté, invisible, à l’entretien du Chat-Tigre avec le capitaine don Antonio Coronel gouverneur de San Juan de la Maguana, un fait l’avait frappé ; ce fait était celui-ci : Non seulement le Chat-Tigre entretenait des intelligences avec le gouvernement espagnol, mais encore il avait à San Juan une habitation dans laquelle il se rendait souvent ; cette habitation renfermait des papiers précieux pour les flibustiers ; d’autres très importants y avaient été déposés depuis quelques jours.
Vent-en-Panne avait résolu de s’emparer à tous risques de ces papiers ; qui, il en avait la conviction, l’aideraient à éclaircir le mystère dont s’entourait le Chat-Tigre, et lui révéleraient certaines particularités de la vie passée de cet homme ; particularités que le flibustier tenait surtout à connaître.
Le Chat-Tigre ne devait demeurer que deux ou trois jours à San Juan ; il fallait donc se hâter d’agir, si on voulait le surprendre, et s’emparer de ses papiers.
L’expédition avait été aussitôt résolue entre Vent-en-Panne et l’Olonnais ; le lendemain même, après s’être entendus avec quelques-uns de leurs amis, ils s’étaient mis en route, pour tenter la surprise de la ville.
Les engagés envoyés à la découverte, ne furent de retour au campement que vers sept heures du soir ; ils avaient visité tous les postes établis par les flibustiers autour de la ville, communiqué aux différents chefs les ordres qu’ils avaient reçus.
Partout, ils avaient été accueillis de la façon la plus cordiale. Les frères de la Côte attendaient avec impatience le moment de commencer l’attaque ; ce moment arrivé, ils promettaient de renverser tous les obstacles qui leur seraient opposés.
Ces nouvelles furent accueillies par Vent-en-Panne et ses compagnons, comme elles devaient l’être ; c’est-à-dire avec des transports de joie, les flibustiers ne doutèrent pas un instant de la réussite de leur hardi coup de main. Leur impatience redoubla ; ce fut à grand-peine qu’ils se résignèrent à demeurer dans leur embuscade, sans se laisser aller à quelques-unes de ces imprudences dont ils étaient si coutumiers, chaque fois qu’ils tentaient une expédition.
Pour tuer le temps et tromper l’ardeur qui les dévorait, ils ne trouvèrent qu’un moyen ; moyen au reste très pratique ; ce fut de souper ; cependant ce repas fut excessivement frugal ; ils n’osèrent pas allumer le feu, afin de ne pas donner l’éveil aux Espagnols.
Enfin Montbarts sortit de sa ceinture une magnifique montre garnie de diamants, et annonça à ses compagnons qu’il était neuf heures.
Un joyeux hourra accueillit cette nouvelle ; l’on se mit immédiatement en mesure de tout préparer pour l’attaque ; du reste les préparatifs ne furent pas longs ; les flibustiers saisirent leurs armes, émergèrent doucement du couvert et guidés par leurs Venteurs, ils se dirigèrent à pas de loups vers la ville.
Tout les protégeait ; la nuit était noire et sans lune ; le vent soufflant en foudre, ses sifflements continus à travers les branches des arbres, produisaient un bruit sourd qui étouffait le retentissement des pas des flibustiers, sur la terre desséchée de la savane.
Ils atteignirent le rebord du fossé, sans avoir attiré l’attention des sentinelles espagnoles, probablement endormies au fond des échauguettes où des guérites.
Chacun des flibustiers s’était muni, ce que nous avons oublié de noter, d’une énorme botte de broussailles et de menues branches d’arbres, ces fascines furent jetées dans le fossé qu’elles comblèrent presque, sur une largeur de deux pieds et demi, chemin fort étroit à la vérité, mais plus que suffisant, pour des hommes accoutumés à courir sur des vergues de huit pouces de diamètre.
Vent-en-Panne donna un coup de sifflet strident, signal répété comme un sinistre écho par les autres chefs de boucaniers, dont les troupes étaient disséminées autour de la ville ; puis les frères de la Côte s’élancèrent hache en main, traversant le fossé en quelques secondes, ils franchirent le talus, et en poussant de grands cris, ils coururent au pont-levis dont ils attaquèrent les chaînes et qui tomba bientôt avec fracas.
Alors, ils se ruèrent dans la ville comme une légion de démons ; les uns pénétrèrent dans les fortins, dont ils massacrèrent les soldats ; qui surpris dans leur sommeil furent tués avant même d’avoir conscience de ce qui se passait ; d’autres s’emparèrent de l’église et des chapelles, montèrent dans les clochers et firent sonner les cloches à rebours ; d’autres enfin forcèrent l’ayuntamiento, ou maison du gouverneur, saisirent don Antonio Coronel dans son lit et le firent prisonnier avec sa famille.
Cette surprise fut si habilement conduite, et si lestement exécutée, que la ville avait été envahie par tous les côtés à la fois, et qu’en moins d’un quart d’heure les flibustiers s’en trouvèrent les maîtres.
Montbarts s’établit à la maison de ville, fit comparaître le gouverneur devant lui et le condamna à payer séance tenante une somme de 50 000 piastres pour la rançon de la ville, lui annonçant que faute de le faire, lui et cinquante habitants notables de San Juan de la Maguana seraient pendus.
Puis la ville fut livrée au pillage.
Nous passerons légèrement, sur les atrocités commises par les frères de la Côte.
À l’époque où se passe notre histoire, le sac d’une ville, tombée surtout au pouvoir d’hommes comme les boucaniers, était une chose horrible. Ni l’âge, ni le sexe ne réussissaient à préserver les malheureux habitants de l’avarice et de la rage des vainqueurs. Le sort qu’ils réservaient aux femmes surtout, était atroce. Les flibustiers forçaient les portes de toutes les maisons, brisaient les meubles, et s’emparaient de tout ce qui se trouvait à leur convenance. Pour aller plus vite en besogne, ils tranchaient les doigts pour avoir les bagues, et déchiraient les oreilles pour prendre les boucles.
Le désordre était extrême ; c’était vainement que les habitants affolés de terreur imploraient la pitié de ces furieux ; on ne leur répondait que par des ricanements sinistres ou en les assommant à coups de crosse, les déchiquetant à coups de sabre, ou les perçant avec les baïonnettes.
Cependant les flibustiers procédaient avec un certain ordre, dans leur œuvre de rapine. Toutes les richesses enlevées dans les maisons, quelle que fût la valeur des objets, étaient scrupuleusement apportées sur la grande place de la ville, entassées en un monceau sous la garde de quatre sentinelles, qui en répondaient sur leur vie.
La ville avait été soudain illuminée, de loin, on l’aurait crue en feu ; c’était une scène digne de Salvator Rosa, de Ribera, où de Brugel d’Enfer, ces peintres de toutes les horreurs ; pour se débarrasser de ce qu’ils appelaient les criailleries des habitants, les flibustiers les avaient refoulés à coups de crosse dans l’église et les chapelles, où ces malheureux, blessés pour la plupart, se trouvèrent entassés pêle-mêle.
Cependant Vent-en-Panne ne perdait pas de vue le motif qui lui avait fait tenter cette expédition ; après avoir pénétré dans le premier fortin, dont les pièces furent enclouées, démontées et jetées dans le fossé, le massacre de la garnison commença. Un seul alferez échappa à la mort.
C’était un jeune homme de vingt ans à peine, appartenant à une grande famille espagnole ; il était venu à Saint-Domingue pour y faire ses premières armes ; Vent-en-Panne lui garantit la vie sauve et lui assura la liberté, à la condition de le conduire à la maison habitée par le Chat-Tigre ; le jeune homme, à peine échappé à la mort, accepta avec joie cette proposition.
Le Chat-Tigre toujours prudent, avait choisi son logement à une portée de pistolet à peine des remparts ; c’était donc à une courte distance du fortin ; l’alferez y conduisit Vent-en-Panne qui se fit accompagner de l’Olonnais, de Montauban, de Tributor et deux autres de ses engagés.
Arrivé devant la maison, Vent-en-Panne fit conduire par un engagé, l’alferez à l’ayuntamiento, où se trouvait Montbarts afin de mettre le jeune homme sous sa sauvegarde ; puis le frère de la Côte s’approcha, la hache à la main, de la porte de la maison, qu’il essaya d’enfoncer. Le Chat-Tigre était sur ses gardes. Aux premiers cris des boucaniers à leur entrée dans la ville, le transfuge avait pris l’éveil ; comprenant aussitôt que les frères de la Côte tentaient une camisade contre San Juan de la Maguana ; camisade du succès de laquelle il ne douta pas un instant.
Cet homme passé maître en fourberies et en trahisons, se rappela que lors de son entrevue avec don Antonio Coronel, il avait à plusieurs reprises remarqué certains mouvements insolites dans un fourré placé à portée de voix de l’endroit où l’entrevue avait lieu ; mouvements auxquels dans le premier moment il n’avait pas attaché une grande importance, mais qui lui firent alors deviner que sa conversation avait été entendue ; que la surprise de la ville en était la conséquence, et que l’ennemi quel qu’il fût, qui avait assisté à son entretien, n’avait tenté ce hardi coup de main que pour s’emparer de ses papiers ; et peut-être en même temps se défaire de lui.
Le Chat-Tigre était non seulement un scélérat, mais encore il possédait toute la férocité de l’animal dont il avait pris le nom. Convaincu que c’était à lui qu’on en voulait, il résolut d’opposer la plus vive résistance, tandis que son frère, chargé des papiers précieux, qu’à tout prix il voulait soustraire à ses ennemis fuirait, par une porte de derrière, et gagnerait la campagne en toute hâte.
Quant à lui, il était persuadé qu’il réussirait à s’ouvrir passage ; au pis-aller, s’il succombait, son frère resterait pour poursuivre sa vengeance ; sa mort ne serait ainsi qu’une faible satisfaction pour ses ennemis, puisque ses secrets seraient intacts.
Cette détermination prise, le Chat-Tigre barricada solidement la porte de sa maison ouvrant du côté de la ville, donna à son frère des instructions fort détaillées ; lui remit tous ses papiers sans en excepter un seul ; lui assigna un rendez-vous au cas où il réussirait à s’échapper ; puis, ainsi qu’il l’avait arrêté, il le fit sortir par une porte de derrière ; le suivit des yeux jusqu’à ce qu’il se fût perdu dans les ténèbres, rentra, barricada la porte, et se mit à charger ses fusils et ses pistolets, avec cette froide résolution de l’homme qui a fait le sacrifice de sa vie.
Aux premiers coups de hache retentissant contre la porte, le Chat-Tigre disposa ses armes sur une table, à portée de sa main, et ouvrant une fenêtre, tout en ayant soin de s’abriter derrière un volet, il déchargea deux pistolets dans la rue.
Mais les flibustiers étaient gens qui allaient vite en besogne ; l’Olonnais réfléchit que peut-être la maison avait une seconde issue ; il la tourna, résolu à l’attaquer à revers ; l’assaut fut alors donné devant et derrière, et cela si rudement, que bientôt les portes tombèrent et la maison fut envahie.
Le Chat-Tigre, debout dans un angle obscur du palier du premier étage, déchargea ses pistolets sur les flibustiers qui montaient l’escalier en courant ; puis dégainant son épée et la tenant de court, il se jeta à corps perdu au milieu de ses ennemis, avec un rugissement de fauve aux abois.
Il y eut une mêlée horrible dans les ténèbres ; une lutte acharnée, entrecoupée de cris et d’imprécations ; d’autant plus terrible, que les combattants, resserrés dans un espace très étroit, ne pouvant qu’imparfaitement se servir de leurs armes, risquaient de se blesser les uns les autres, en voulant atteindre leur ennemi.
L’audacieuse résolution du Chat-Tigre le sauva ; le projet insensé qu’il avait conçu réussit contre toute prévision ; excepté quelques blessures dans les chairs, blessures sans importance, il atteignit la rue sain et sauf ; courut désespérément jusqu’au rempart, se lança dans le fossé, grimpa le taillis opposé et disparut dans la campagne ; sans être atteint par un seul des coups de fusil tirés contre lui, pendant cette course affolée.
Vent-en-Panne était désespéré ; une fois encore son ennemi avait glissé comme un serpent, entre ses doigts prêts à l’étreindre, et s’était joué de lui ; ce fut en proie à un profond découragement, convaincu à l’avance de l’inutilité de ses recherches, qu’il se résolut à les commencer presque machinalement, et par acquit de conscience.
En effet tous les meubles étaient vides ; les papiers avaient disparu. Avant de fuir, le Chat-Tigre avait tué raide un engagé de Vent-en-Panne et blessé trois autres ; sa retraite avait été celle du Jaguar acculé par les chasseurs ; l’avantage lui était resté ; le vieux flibustier sortit de la maison la tête basse, mâchonnant des imprécations, et ruminant dans sa tête les plus terribles projets de vengeance.
Comme la ville était prise, le pillage à peu près terminé, Vent-en-Panne se dirigea vers l’ayuntamiento, rendez-vous assigné aux flibustiers, pour partager le butin conquis.
Mais en chemin, poussé par une espèce de sourd pressentiment, il se sépara de ses amis ; les laissa continuer leur route, et s’engagea dans les rues les plus sombres de la ville.
Cependant Chanteperdrix n’avait pas réussi à s’échapper aussi facilement que l’avait supposé le Chat-Tigre ; après avoir quitté la maison, il avait piqué tête baissée tout droit devant lui, courant sans regarder où il allait ; il voulait avant tout s’éloigner de la maison au plus vite, se croyant certain de réussir facilement à sortir de la ville ; mais il rencontra à l’exécution de ce projet, des difficultés plus grandes qu’il ne le pensait.
Jamais jusqu’alors, il n’était venu à San Juan de la Maguana où il ne se trouvait que depuis la veille, par conséquent il ne connaissait pas du tout la ville ; de plus Chanteperdrix ne possédait pas la bravoure de son frère. Le Chat-Tigre avait le courage audacieux mais froid du lion ou du jaguar, celui de Chanteperdrix ressemblait à celui de l’hyène et du chacal ; il était cauteleux, sournois, sentiments produits en réalité, par l’instinct de la conservation. L’hyène et le chacal peuvent faire preuve de bravoure, mais ce n’est que lorsque ces animaux se sentent acculés, que toute fuite leur est impossible.
Tel était Chanteperdrix.
Après avoir couru assez longtemps, il s’arrêta pour reprendre haleine et essayer de reconnaître s’il se trouvait près des remparts. L’endroit où il avait fait halte formait une espèce de carrefour où plusieurs rues aboutissaient ; dans ces rues, on voyait s’agiter des torches, passer des ombres rapides ; parfois l’éclair d’un coup de feu zigzaguait les ténèbres.
Quant au carrefour, il était désert, sombre et silencieux.
Chanteperdrix respira.
– J’échapperai, murmura-t-il, les ténèbres me couvrent ; je ne dois pas être éloigné des remparts, mais comment y arriver ?
Là était la difficulté.
– Tout doit être fini maintenant ; reprit-il après un instant ; si je retournais du côté de la maison ? ces rues sont désertes ; je ne cours pas le risque d’être attaqué ; d’ailleurs, ajouta-t-il, je suis armé ; si l’on m’y contraint, je saurai me défendre.
Il retourna alors sur ses pas, mais lentement, avec précaution ; rasant les murailles, interrogeant à chaque pas l’obscurité, la sondant du regard, afin de s’assurer qu’il n’était ni suivi, ni épié.
Il atteignit ainsi l’angle d’une rue, le tourna machinalement, et s’engagea au hasard, dans une nouvelle direction ; soudain un cri de joie lui échappa ; à cent pas à peine devant lui, se dressait la masse sombre du rempart.
– Je suis sauvé ! s’écria-t-il.
Et sans plus réfléchir, il s’élança en courant vers ce rempart, qu’un instant auparavant il désespérait presque d’atteindre. Tout à coup, il reçut un choc tellement violent qu’il trébucha, fit quelques pas à reculons, et finalement roula sur le sol ; il avait été donné à l’improviste, contre un individu, qui au moment où il passait débouchait d’une rue voisine.
Cet individu marchait la tête basse et l’air fort préoccupé ; cependant à cette rude attaque, après avoir, lui aussi, reculé en trébuchant, il avait poussé une exclamation de colère, et s’élançant sur son malencontreux agresseur, il le prit rudement à la gorge et lui appuya un genou sur la poitrine.
– Drôle ! s’écria l’inconnu en brandissant une énorme hache sur la tête du pauvre diable, rends-toi, ventre-dieu ! ou tu es mort !
– Je me rends, señor ! je me rends ; murmura l’autre d’une voix lamentable ; il avait reconnu dans l’homme dont l’arme le menaçait, un flibustier.
– Eh ! fit celui-ci avec un geste de surprise aussitôt réprimé, qui avons-nous donc-là ? voilà une voix que je connais, il me semble ? et se penchant vers lui : Que faites-vous donc là, maître Chanteperdrix ? ajouta-t-il d’une voix goguenarde.
– Je… je ne sais pas, balbutia l’autre.
– Ah ! vous ne savez pas ? cela est singulier ! je crois que vous le savez fort bien au contraire ; vous vous échappiez, hein, mon maître ?
– Eh ! quand cela serait, capitaine ! est-il donc défendu à un pauvre diable d’essayer de sauver sa vie, dans une nuit comme celle-ci ?
– Nullement ; mais vous vous sauviez bien vite ; on vous poursuivait donc ?
– Personne, illustre capitaine, mais j’avais hâte de me mettre en sûreté, je vous l’avoue.
– Je ne vois aucun mal à cela au contraire, il n’est pas défendu de chercher à sauver sa vie ; ainsi donc, vous couriez vers le rempart ?
– Hélas ! oui, noble capitaine ; si je n’avais pas eu la malchance de vous rencontrer je l’aurais atteint déjà ; mais je n’ai pas de bonheur.
– Allons, allons, mon maître, tout cela s’arrangera peut-être beaucoup mieux que vous ne le supposez ; nous ne sommes pas aussi féroces, nous autres boucaniers, qu’on nous en fait la réputation. Il est vrai que je suis votre ennemi, mais je vous avais moi-même autorisé à vous retirer ici ; je n’ai donc aucunement l’intention de vous nuire ; ma parole vous garantit ; voyons, relevez-vous, mon maître.
Et il lui tendit la main.
Chanteperdrix se releva péniblement.
– Seriez-vous blessé ? lui demanda Vent-en-Panne.
– Non, je ne crois pas, mais j’ai le corps tout endolori.